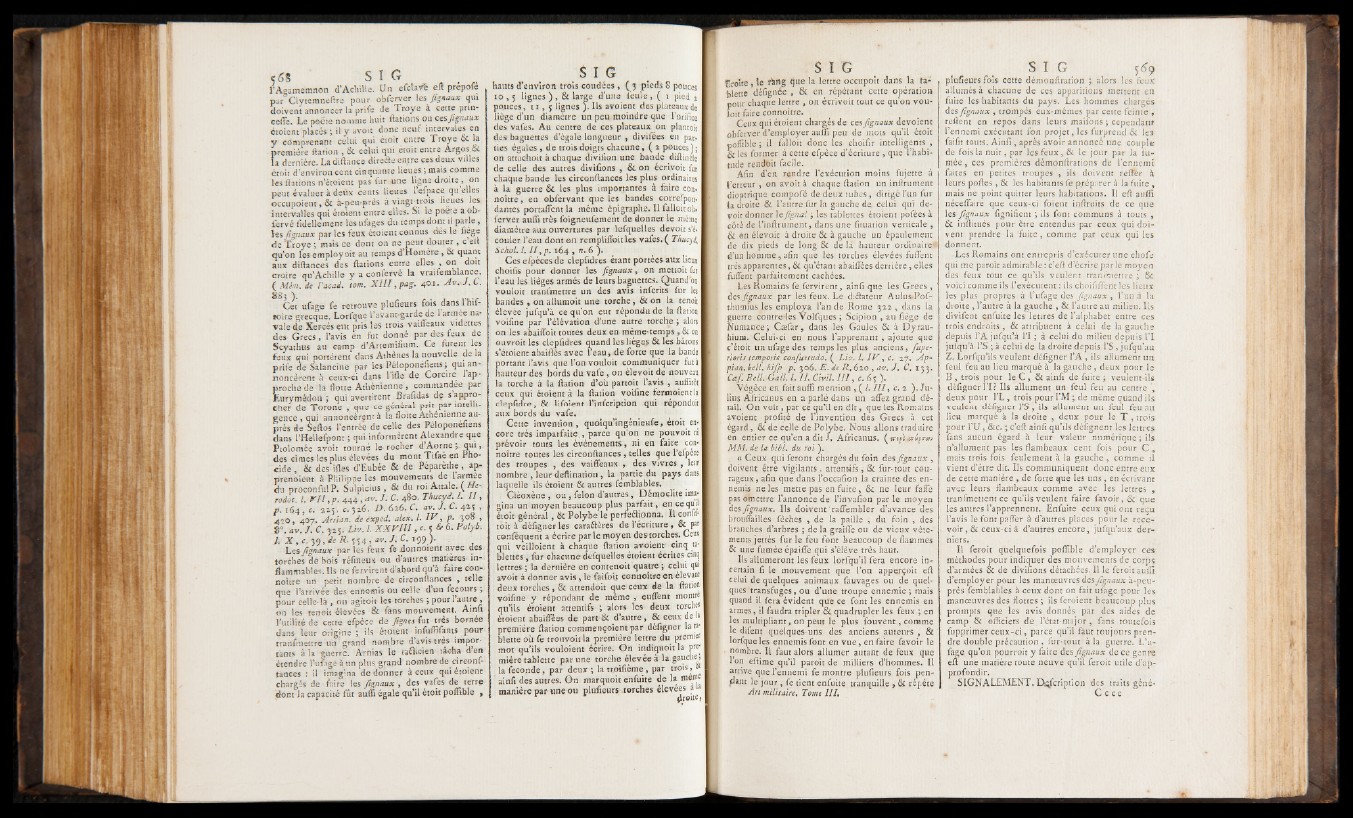
< 6 8 S I G
l’Agamemnon d’Achille. Un efctavé eft prépofé
par Clytemneftre pour obferver les Jignaux qui
doivent annoncer la prife de Troye à cette prin-
ceffe. Le poëte nomme huit ftations ou cesJignaux
étoient placés ; il y avoir donc neuf intervales en
y comprenant celui qui étoit entre Troye & la
première dation , & celui qui étoit entre Argos 6c
la dernière. La diftance dire&e entre ces deux villes
étoit d’environ cent cinquante lieues ; mais comme
les dations n’étoient pas fur une ligne droite, on
peut évaluer à deux cents lieues 1 efpace qu elles
eccupoient, & à-peu-près à vingt-trois lieues les
intervalles qui étoient entre elles. Si le poëte a ob-
fervé fidellement les ufages du temps dont il parle,
les /ignaux par les feux étoient connus dès le hege
de Troye ; mais ce dont on ne peut douter , c’elt
qu’on les employoit au temps d’Homère, & quant
àux diftances des dations entre elles , on doit
croire qu’Achrlle y a confervé la vraifemblance.
( Mèm. de l'acad. tom. X I I I ,pag. 4 ° i* 4 v .J . C.
88Cet ufàge fe retrouve plufieurs fois dans l’hif-
foire grecque. Lorfque l’ avant-garde de 1 arméé navale
d.e Xereès eut pris les trois vaiffeaux videttes
des Grecs, l’avis en fut donné par des feux de
Scyathus au camp d’Artemifium. Ce Ujrenr les
feux qui portèrent dans Athènes la nouvelle de la
prife de Sàlancine par les Péloponéfiens ; qui annoncèrent
à ceux-ci dans l’ide de Corcire 1 ap -
proche de la flotte Athénienne, commandée par
Eurymédotî ; qui avertirent Braficlas de s approcher
de Terone , que ce général prit par intelligence
, qui annoncèrent à la flotte Athénienne auprès
de Seflos l’entrée de celle des Péloponefiens
dans l’Hellefpont ; qui informèrent Alexandre que
Ptolomée avoit tourné le- rocher d Aorne qui,
des cimes les plus élevées du mont Tifaé en rho-
cide , & des iflës d’Eubée & de Péparethe, ap-
prenoient à Philippe les mouvements de 1 armée
du proconfiilP. Sulpicius , & du roi Attale. (
rodot. I. V i l ,p. 444 , av. J. C. 480* ThucydL I I ,
p . 164, c. 215. c. 326. D. 626. C. av. J. C. 423 ,
41O, 407. Arrian. de exped. ait». L I V , P* 3 °® »
. jg°. av. /. C. f i ÿ Liv. L X X V I I I , c. 3 & 6. Polyb.
I. X ,.c .39, de R. 5-54 , av. J. C. 199 ).
Les Jignaux par les feux fe don noient avec des
torches de bois réfin eux ou d autres matières inflammables.
Ils ne fervirent d'abord qu à faire connût
tre un petit nombre de circonftances , telle
que l’arrivée des ennemis ou celle d’un fecours ;
pour celle-là , on agi toit les torches ; pour l’autre,
on les tenon élevées & fans mouvement. Ainfi
l’utilité de cette efpèce de fignes iut très bornée
dans leur origine ; ils étoient infuffifants pour
tranfmettre un grand nombre d’avis-très importants
à la guerre. Arnias le taflicien tâcha d en
étendre Pufageàun plus, grand nombre de cireonf-
tances : il imagina de donner a ceux qui etoient
chargés de faire les Jignaux , des vafes de terre
dont la capacité fût auffi égale qu’il étoit poffible ,
S I G
hauts d’environ trois coudées , ( 3 pieds 8 pouces
10 ,3 lignes ) , & large d’une feule , ( 1 pied a
ponces, 1 1 , 5 lignes ). Us avoient des plateaux de
liège d’un diamètre un peu moindre que l’orifice
des vafes. Au centre de ces plateaux on plantoit
des baguettes d’égale longueur , divifées en par-
ties égales % de trois doigts chacune, ( 2 pouces);
on attachoit à chaque divifion une bande diflincle
de celle des autres divifions , & on écrivoit fm
chaque bande les circonftances les plus ordinaires
à la guerre & les plus importantes à faire con«
noître, en obfervant que les bandes correfpon'
dantes portaffent la même épigraphe. Il falloir oh*
ferver aufîi très foigneufement de donner le même
diamètre aux ouvertures par lefquelles devoir s’é«
couler l’eau dont ©n remplifloit les vafes. ( Thucyd,
Schol. l. //, p. 164 , n. 6 ).
Ces efpèces de clepfidres étant portées aux lieux
choifis pour donner les Jignaux, on mettoit fut
l’eau les lièges armés de leurs baguettes. Quand'on
vouloit tranfmettre un des avis inferits fur les
bandes , on aliumoit une torche, & on la tenoit
élevée jufqu’à ce qu’on eut répondu de la ftation
voifine par l’élévation d’une autre torche J alors
on les abaiffoit toutes deux en même-temps , & on
ouvroit les clepfidres quand les lièges & les bâtons
s’étoient abaiffés avec l’ eau , de forte que la bande
portant l’avis que l’on vouloit communiquer fut à
hauteur des bords du vafe , on élevoit de nouveau
la torche à la ftation d’où partoit l’avis , auffitôl
ceux qui étoient à la ftation voifine fermaient la
clepfidre, 8c lifoient l’infcription qui répondoit
aux bords du vafe.
Cette invention, quoiqu’ingénieufe, étoit en*
core très imparfaite., parce qu’on ne pouvoit ni
prévoir touts les événements, ni en faire con*
noître toutes les circonftances, telles que l’efpèce
des troupes , des vaiffeaux , des vivres , leur
nombre , leur deftination, la partie du pays dans
laquelle ils étoient & autres femblables,
Cléoxène , o u , félon d'autres, Dénjoelite ima*
gina un moyen beaucoup plus parfait, en ce quil
étoit général, & Polybe le perfeâionna, Il confif-
toit à défigner les caraâères de l’écriture, & par
conféquent a écrire par le moyen des torches. Ceux
qui veilloient à chaque ftation avoient cinq tablettes,
fur chacune defquelles étoient écrites cinq
lettres ; la dernière en contenoit quatre \ celui qui
avoit à donner avis, le faifoit eonnoure en'élevant
deux torches, & attendoit que ceux de la ftation
voifine y répondant de même , euffent montre
j qu’ils étoient attentifs ; alors les deux torche*
I étoient abaiffées de part & d’autre, & ceux de 1»
première ftation commençoient par défigner la ta*
blette où fe trouvoit la première lettre du premier
mot qu’ils vouloient écrire. On indiquoit la pre*
mière tablette par une torche élevée à la gauche)
la fécondé, par deux ; la tr.oifième, par trois, $
ainfi des autres. On marquoit enfuite de la même
manière par une ou plufieurs torches élevées a»
r ètonet
SI G
Çroïte, le fàng que la lettre occupoît dans la tablette
défignée , & en répétant cette opération
pour chaque lettre , on écrivoit tout-ce quon vou-
foit faire connoître.
Ceux qui étoient chargés de ces Jignaux dévoient
ôbferver d’employer auffi peu de mots qu’il étoit
poffible ; il falloir donc les choifir intelligents ,
& les former à cette efpèce d’écriture , que l’habitude
rendbit facile.
Afin d’en rendre l’exécution moins fujette à
l’erreur , on a'voit à chaque ftation un inftrument
dioptrique compofé de deux tubes, dirigé l’un fur
la droite & l ’autre fur la gauche de celui qui de-
yoit donner le Jignal ; les tablettes étoient pofées à
côté de l’inftrument, dans une fituation verticale ,
on élevoit à droite & à gauche un épaulement
de dix pieds de long & de la hauteur ordinaire^
d’un homme, afin que les torches élevées fuffent
très apparentes, & qu’étant abaiffées derrière, elles
fuffent parfaitement cachées.
Les Romains fe fervirent, ainfi que les Grecs ,
des Jignaux par les feux. Le diélateur Aulus-Pof-
thumius les employa l’an de Rome 322, dans la
guerre contre4es Volfques ; Scipion , au fiège de
Nùmance; Cæfar, dans les Gaules & à Dyrau-
hiuoe. Celui-ci en nous l’apprenant , ajoute que
c’étoit un ufage des temps les plus anciens, fupe-
risris temporis confuttudo. J L iv .l.IV ^ c , 27. Ap-
pian. bell. hifp p. 306. E. de R, 620, av. J . C. 133.
Ccef. Bell.rGall. I . IL Civil. I I I, c. 63 ).
Végèce en^fait auffi mention , ( L I I I , c. 2 ). Julius
Africanus en a parlé dans un affez grand détail.
On voit, par ce qu’il en dit, que les Romains
avoient profité de l’invention des Grecs à cet
égard, & de celle de Polybe. Nous allons traduire
en entier ce qu’en a dit J. Africanus. ( mpt <^crm
MM. de la bibl. du roi ).
. « Ceux qui feront chargés du foin des Jignaux ,
doivent être vigilants, attentifs ) & fur-tout courageux,
afin que dans l’occafion la crainte des ennemis
ne les mette pas en fuite, & ne leur faffe
pas émettre l’annonce de l’invafion par le moyen
des Jignaux. Ils doivent raffembler d’avance des
brouffailles .fèehes , de la paille , du foin , des
branches d’arbres ; de la graiffe ou de vieux vête-'
ments jettés fur le feu font beaucoup de flammes
& une fumée épaiffe qui s’élève très haut.
Ils allumeront les feux lorfqu’il fera encore incertain
fi le mouvement que l’on àpperçoit eft
celui de quelques animaux fauvages ou de quelques
transfuges, ou d’une troupe ennemie ; mais
quand il fera évident que ce font les ennemis en
armes, il faudra tripler & quadrupler les feux ; en
les multipliant, on peut le plus fouvent, comme
le difent quelques-uns des anciens auteurs , &
lorfque les ennemis font en vue, en faire favoir le
nombre. Il faut alors allumer autant de feux que
Ion eftime qu’il paroit de milliers d’hommes. Il
arrive que.l’ennemi fe montre plufieurs fois pendant
le jour, fe tient enfuite tranquille , & répète
A r t m ilita ir e. T om e I I I .
S I G 569
plufieurs fois cette démonftration ; alors les feux
allumés à chacune de ces apparitions mettent en
fuite les habitants du pays. Les hommes chargés
des Jignaux , trompés eux-mêmes par cette feinte ,
reftent en repos dans leurs maifons ; cependant
l’ennemi exécutant fon p roje tte s furprend & les
faifit touts. Ainfi, après avoir annoncé une couplt
de fois la nuit, par les feux, & le jour par la fumée
, ces premières démonstrations de l’ennemi
faites en petites troupes , ils doivent reft'er à
leurs poftes , & les habitants fe préparer à la fuite,
mais ne point quitter leurs habitations. Il eft aufli
néceffaire que ceux-ci foient inftruits de ce que
les Jignaux Signifient ; ils font communs à touts ,
& inftitués pour être entendus par ceux qui doivent
prendre la fuite, comme par ceux qui les
donnent.
Les Romains ont entrepris d’exécuter une chofe
qui me paroîr admirable : c’eft d’écrire par le moyen
des feux tout ce qu’ils veulent tranfmettre ; 8c
voici comme ils l’exécurent: ils choififfent les lieux
les plus propres à l’ufage des Jignaux , l’un à la
droite , l’autre à la gauche , & l’autre au milieu. Iis
divifent enfuite les lettres de l’alphabet entre ces
trois endroits , & attribuent à celui de la gauche
depuis l’A jufqü’à l’I ; à celui du milieu depuis 1T
jufqu’à l’S ; à celui de la droite depuis l’S , jufqu’au
Z. Lorfqu’ils veulent défigner l’A , ils allument un
fenl feu au lieu marqué à la gauche , deux pour le
B , trois pour le C , & ainfi de fuite ; veulent-ils
défigner l’I ? Us allument un feul feu au centre ,
deux pour l’L , trois pour l’M ; de même quand ils
veulent défigner l’S , ils allument un feul feu au
lieu marqué à la droite , deux pour le T , trois
pour l’U , &c. ; c’eft ainfi qu’ils défignent les lettres
fans aucun égard à leur valeur numérique ; ils
n’allument pas les flambeaux cent fois pour C ,
mais trois fois feulement à la gauche, comme il
vient d’être dit. Us communiquent donc entre eux
de cette manière , de forte que les uns , en écrivant
avec leurs flambeaux comme avec les lettres ,
tranfmettent ce qu’ils veulent faire favoir, 8c que
les autres l’apprennent. Enfuite ceux qui ont reçu
l’avis le font paffer à d’autres places pour le rece-r
voir ,& ceux-ci à d’autres encore, jufqu’aux derniers.
Il feroit quelquefois poffible d’employer ces
méthodes pour indiquer des mouvements de corps
d’armées 8c de divifions détachées. Il le feroit auffi
d’employer pour les manoeuvres des Jignaux à-peu-
près femblables à ceux dont on fait ufage pour les
manoeuvres des flottes ; ils feroient beaucoup plus
prompts que les avis donnés par des aides de
camp & officiers de l’état-major, fans toutefois
fupprimer ceux-ci, parce qu’il faut toujours prendre
double précaution , fur-tout à la guerre. L’ufage
qu’on pourroit y faire des Jignaux de ce genre
eft une matière toute neuve qu’il feroit utile d’approfondir.
SIGNALEMENT. Dy^cription des traits géné-
C c cc