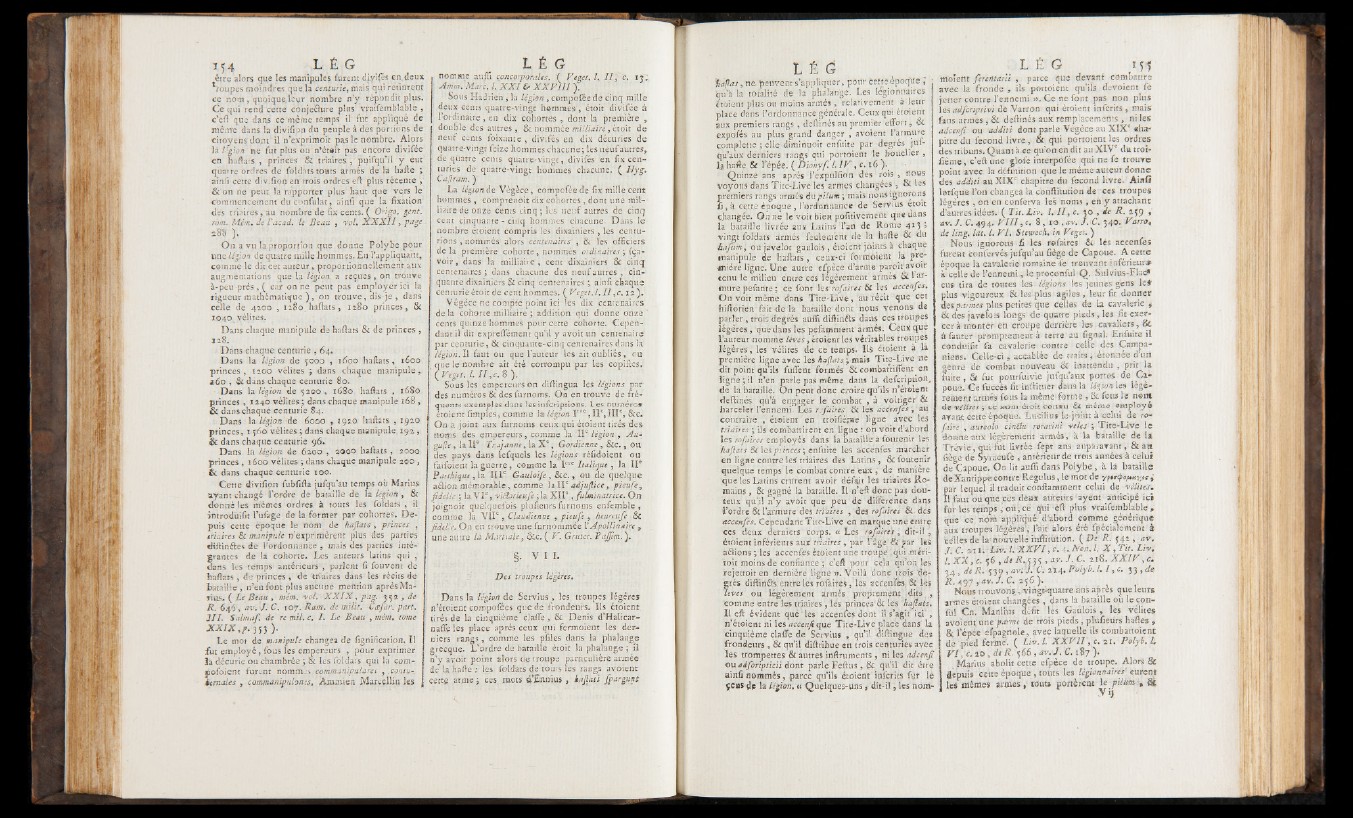
154 LÉ G
être alors que les manipules furent diyifés en, deux
loupes moindres que la centurie, mais qui retinrent
ce nom , quoique/lèur nombre n’y répondît plus.
Ce qui rend cette conjecture plus vraïfemblable ,
c’eft que dans ce meme temps il fut appliqué de
mêirre dans la divifipn du peuple à des portions de
citoyens dont il n’exprimoit pas le nombre. Alors
là l'gion ne fut plus ou n’étoit pas encore div.ifée
en haftats , princes & triair'es., puifqii’il y eut
quatre Ordres de foldats touts armés de la ha fie ;
ainfi cette divifion'en; trois ordres eft plus récente ,
& on ne peut la rapporter plus haut que vers le
commencement dit confulat, ainfi que la fixation
des triaires, au nombre de fix cents. ( Origo, gent.
rom. Mém. de l ’acad. le Beau , vol. X X X I I > page
288 ).
Ôn a vu la proportion que donne Polybe pour
une légion de quatre mille hommes. En l’appliquant,
comme le dit cet auteur , proportionnellement aux
augmentations que la légion a reçues , on trouve
à-peu près, ( car on ne peut pas employer ici la
rigueur mathématique ) , on trouve, dis-je , dans
celle de 42.00 , 1280^ hafiats , 1280 princes, 8c
1040 yélites.
Dans chaque manipule de haftats & de princes ,
328.
Dans chaque centurie , 64.
Dans la légion de 5000 , 1600 haftats, 1600.
princes, 1200 vélites ; dans chaque manipule,
i6 o , & dans chaque centurie 80.
Dans la légion de 5200 , 1680 haftats , 1680
princes , 1240 vélites ; dans chaque manipule 168 ,
& dans chaque centurie 84.
Dans la légion de 6000 , 1920, haftats , 1,920;
princes, 1 ÿ6a vélites ; dans chaque manipule. 192 ,.
& dans chaque centurie 96.
Dans la légion de 6200 , 2000 haftats , 2000.
princes , 1600 vélites ; dans chaque manipule 200,
& dans chaque centurie 100.
Cette divifipn fubfifta jufqu’au temps où Marius ;
ayant changé l’ordre de bataille de la légion , St
donné les mêmes ordres, à tours les foldats , il
introdùifit l’ufage de la former par cohortes. Depuis
cette époque le nom, de haftats , princes ,
triaires 8c manipule n’exprimèrent plus des parties
diftinftes de l'ordonnance , mais des parties intégrantes
de là cohorte. Les auteurs latins qui ,
dans les témps; antérieurs , parlent fi fouvent de
haftats , de princes , de triaires dans les récits de
bataille , n’en font plus aucune mention après Marius.
( Le Beau y mém. 'vol.' X X IX , pag. 3 32 , de
B. 646, av. Ji C. 107. Ram. de milit, Cezjàr. part.
3 1 1. Salmafi. de remit, c. 1 . Le Beau , mém. tome
553 )•
Le mot de manipule changea de lignification. Il
Lut employé, fous les empereurs , pour exprimer
la décurie ou chambrée ; & les foldais qui la com-
pofoient furent nommas commanïpulares , .cornu-,
kemales y çQinmanipuhn;$, Ammien Marcellin les
L É G
nomme aufti çpncorporales. ■ ( Veget. I. I l , c. 13;
Amm!Marc. /, X X I & X X V I I I ).
Sous Hadrien, la légion »composéede cinq mille
deux cents quatre-vingt hommes, étoit divifée à
l’ordinaire, en dix cohortes , dont la première ,
double des autres , & nommée militaire, étoit de
neuf cents foixante , divifés en dix décuries de
quatrq-vingt feize hommes chacune ; les neuf autres,
de quatre cents quatre-vingt, divifés en fix centuries
de quatre-vingt hommes chacune. ( Hvg.
Caftram, )'
La légion de Végèce, compofée de fix mille cent
ho mmes , comprenoit dix cohortes dont une milliaire
de onze cents cinq; les neuf autres de cinq
cent cinquante - cinq hommes chacune- Dans le
nombre étoient compris les. dixainiers , les centu-
; rions a nommés' alors centenaires , & les officiers
delà première cohorte, nommés ordinaires; fça-
v o ir , dans la milliaire , cent dixainiers 8c cinq
; centenaires ; dans chacune des neuf autres , cin-
■ quante dixainiers & cinq centenaires ; ainfi chaque
centurié étoit de cent hommes. ( Veget. L II ,c. 12 ).
Végèce ne compte point ici les dix centenaires
de la cohorte milliaire ; addition qui donne onze '
cents quinze hommes pour cette cohorte. Cepen-
dant.il dit expreffément qu’il y avoit un centenaire
par centurie, & cinquante-cinq centenaires dans la
; légion. Il faut ou que l’auteur les ait oubliés, ou
’ que le nombre ait été corrompu par les copiftes*
(, Veget. I. I I , c. 8 ).•
Sous les empereurs on diftingua les légions par
des numéros & des furnoms. On en trouve de fréquents
exemples'dans lesinfcriptions. Les numéros
étoient harpies> comme la légion Iere, IIe, IIIe, &c.
On a joint aux furnoms ceux qui étoient tirés des
noms des empereurs, comme la IIe légion , Au-
gufte, la IIe Tr.jjanne, la X e, Gardienne , & c ., ou
des pays dans lefquels les légions réfidoient ou
faifoient la guerre, comme la l crc Italique , la IF
Parikique , la IIIe Gauioife , St c . , ou de quelque
aâioiimémorable, comme la I Ie adjuftice, pieufe,
fidelle4 la V Ie, vietpruufe ; la XIIe , fdminatrice. On
joignoit quelquefois plufieurs furnoms enfemble,
j comme la VIIe , Claüdienne , pieufe , heureufe &
fidellc. On en trouve une furno aimée Y Apollinaire y
une autre la Martiale, &c. ( V. Gruter. Fajftm. }.
§• v u .
Des troupes légères.
Dans la légion de Servius , les. troupes légères
n’étoienr compofées que de frondeurs. Ils étoient
tirés de la cinquième cl af t e& Denis d’Halicar-
naffe les place après ceux qui fermoient les derniers
rangs, comme les pfiles dans la phalange
grecque. L’ordre de. bataille étoit la phalange ; il
n’y avoit point alors de troupe particulière armée
de la. ha fie ; les foldats de tout s les rangs avoient
cettg arme ; ces mots tl’Lnnius , kaftati fparguas
L É é
Mafias, ne jpetivent s’appliquer, pour ceftèépoqüe ,
iqu’à la totalité de la phalange. Les légionnaires
étoient plus ou moins armés , relativement à leur
place dans l’ordonnance générale. Ceux qui étoient
aux premiers rangs , deftinés au premier effort j oc
expofés au plus grand danger , avoient l’armure
complette ; elle diminuoit enfuite par degrés juf-
qu’aiix derniers rangs qui portoient le bouclier ,
lahafte & l’épée. ( Dionyfi l. IV t c. 16 ).
Quinze ans après l ’expiilfion des rois, nous
voyons dans Tite-Live les armes changées , & les
premiers rangs armés du pii tint ; mais nous ignorons
b , à cette époque , l’ordonnance de Servius étoit
changée. On ne le voit bien pofitivement que dans
la bataille livrée aux Latins l’an de Rome 4 * 3 ■>
vingt foldats armés feulement de la hafte 8c au
iitifiim, ou javelot ga,iilois, étoient joints à chaque
manipule de haftats , ceux-ci formoient la première
ligne. Une autre efpèce d’arme paroît'avoir
tenu le milieu entre ces légèrement armés Sc 1 armure
pefarite ; ce font ItS'fof tires & les accenfes.
On voit même dans Tité-Live,'au récit que cet
hiftorien fait'de la bataille'doiit nous venons de
parler , trois degrés aufti diftinéts dans ces troupes
légères, que dans les pefamment armés. Ceux que
l ’auteur noairrie lèVéS, étoient lés véritables troupes
légères, les vélites de ce temps. Us étoient à la
première ligne arec les haftats Tite-Livc ne
dit point qu’ils fuffent formés & combattiffent en
ligne ; il n’en parle pas même dans la defçripûon^
de la bataille. On peut donc croire qu’ils n’étoient
deftinés qu’à engager le combat , à voltiger &
harceler l’ennemi Les r.faires. 8t les accenfes , au
contraire , étoient en troifièpse ligne avec les
triaires ; ils combattirent en' ligne : on voit d’abord
les rofalrcs employés dans la bataille'à foutenir les
hafiats 81 les prince^ ; enfuite les accenfes marcher
en ligne contre les' triaires des Latins , & foutenir
quelque temps le combat contre eux , de maniéré
que les Latins crurent avoir défait les triaires Romains
, & gagné la bataille. Il n*èft donc pas douteux
qu’il n’y avoit que peu de différence dans
l’ordre & l’armure des triaires , des rofaires & des
accenfes. Cependant Tite-Live en marque une entre
ces deiix derniers corps. « Les refaire*, '9
étoient inférieurs aux! triaires , par l’âge Si par les
a étions ; les accenfes étoient une troupe;, qui .méri-
toit moins de confiance ; c’eft pouf cela qu’on les
rejettoit en dernière ligne ». Voilà donc trois 'degrés
diftin&s; entre les rofàites, les accenfes. & lès
lèves ou légèrement armés proprement ,dits ,
’comme entre les triaires , lés princes'& lés haftats.
Il eft évident que les accenfes dont il s’agit 'id ‘ ,
n’étoient ni les accenfi que Tite-Live place dans- la
cinquième claffe de Servius , qu’il diftingue des
frondeurs , & qu’il diftribue en trois centuries avec
les trompettes & autres inftruments , ni les adeenfi
ou adforipticii dont parle Feftus , & qu’il dit être
ainfi nommés, parce qu’ils étoient inferits fur le
Çeas de la légion. « Quelques-uosdit-il, les nonl-
L É G 151
moïent feretttarii , parce que devant combattre
avec la fronde. , ils portoient qu’ils cfevoient fé
jerter contre l’ennemi ». Ce ne font pas non plus
le sadfcriptivi de Varron qui étoient inferits, mais
fans armes, & deftinés aux remplacements , ni les
adeenfi ou additt dont parle Végèce au XIXe chapitre
du fécond livre , & qui portoient les ordres
des tribuns. Quant à ce qu’on en dit au X IVe du troi-
fième, c’eft une glofe interpolée qui ne fe trouve
point avec la définition que le même auteur donne
des additi au XIXe chapitre du fécond livre. Ainfi
lorfque l’on changea la cbnftitution de ces troupes
légères ,. on en conferva les noms , en y attachant
d'autres idées. ( Tit. Liv.. /. ƒ/, <?. 30 , de R. 239 *
av. J. Ç. 494. V III ,c . 8 , i o , av. J. C. 340. Varro4
de ling.lat. L. VI. Stewech. in Veget.')
Nous ignorons fi les rofaires & lés accenfes
furent confervés jufqu’au fiège de Capoue. A cette
époque la cavalerie romaine fe trouvant inférieur»
à"celle de L’ennemi, le proconfuLQ. SulviusrFlac*
eus tira de toutes les légions les jeunes gens le t
plus vigoureux & les plus agiles, leur fit donner
des parmes plus petites que celles de la cavalerie »
8c des javelois longs de quatre pieds, les fit exercer
à monter eh croupe derrière les - cavaliers, &.
àfauter promptement à terre au lignai. Enfuite il
conduifit fa cavalerie contre celle des Campa-
niens. Celle-ci, accablée de traitsétonnée d’urt
genre de combat nouveau & inattendu , prit la
fuite, St fut pourfuivie jufqu’aux portes de Capoue.
Ce fuccès fit inftituer dans la légion le» légèrement
armés fous la même forme , & fous le nom
de vélites ; ce nom étoit cousu 8c même employé
ayatit cette époque. Lucilius le-joint à celui de ro-
fiire\y ’aureolo cïnptu roraririi veles] ; Tite-Live le
dorme aux légèrement armés, à la bataille de la
Trévie , qui-fut livrée fept ans; auparavant, & ati
fiège de Syràcufè , antérieur de trois années à celui
de Capoue. On lit aufti dans Polybe , à là bataille
de Xantippe contre Regulus, le mot de y
par lequel il traduit conftamment celui de vélites.
Il faut ou que ces deux auteurs-àyent anticipé ici
fù'r les temps ; où;ce qui èft plus Vraïfemblable ,
que ce nom appliqué d'abord comme générique
aux troupes légères1; .Fait 'alors éfé fpécialemeht à
celles de la'hohvellé mftitütion. (D e R. 542, av.
Ji C. 211 ; Liv. I. X X V I , c. Non. I. X , Tït. Livi
l.XXyC. 56 , de , av. J. C. 218. X X IV ,c .
3 4 , de R . 539 , avïJl C; 2Ï4. Polyb. I. I 9c. 33 , de
R. 497 ,• av. J. C. 25.6 ).
Nous trouvons, vingt^quatre àns après que leurs
armes étoient changées , dans la bataille où leçon*
fül Cn. Manlius défit les Gaulois , les vélites
avoient unt ftdrrne de trois pieds , plufieurs haftes ,
& l’épée efpagrtole, avec laquelle ils combattoient
de pied fermé. ( Liv.l. X X V I I , c. 21. Polyb. L
V I , c. 20, de R. 566, av. J. C. 187 ).
Marius abolit cette efpèce de troupe. Alors &
depuis cette époque , toüts les légionnaires' eurent
les mêmes armes, tout» portèrent le pilim -, &
y»)