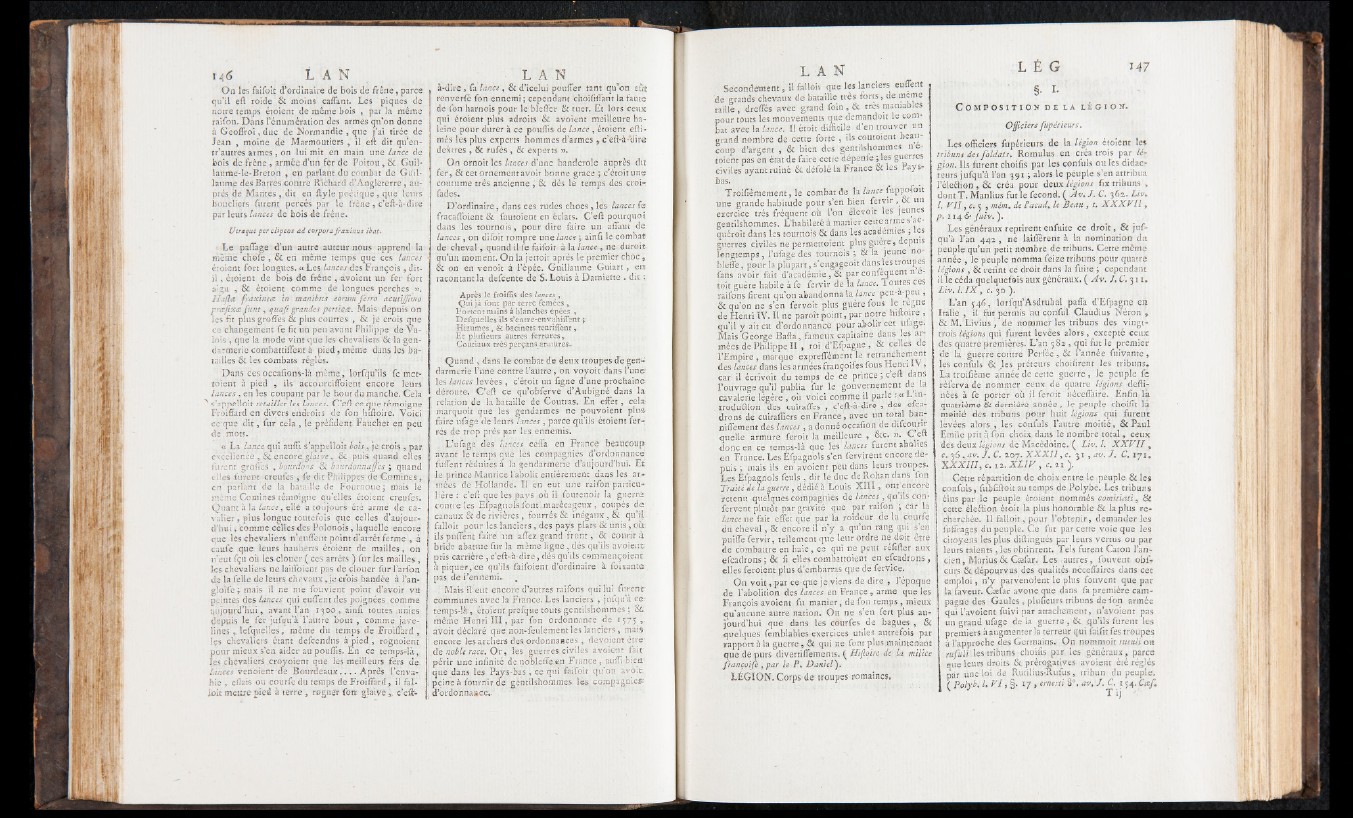
O n les fa ifo it d’ o rd in a ire d e bo is de f r ê n e , pa rce
q u ’ il e ft ro id e & m o in s caftant. L e s p iq u e s de
n o tre tem p s é to ie n t d e même bo is , par la m êm e
ra ifon . D a n s l ’én um é ra t io n des armes q u ’o n d on n e
à G e o f f r o î , d u c d e N o rm an d ie , q u e j ’ ai t iré e de
J ean , m o in e d e M a rm ou tier s , i l eft d it q u ’en-
tr’au tre s a rm e s , on lu i mit en main u n e lance de
b o is d e fr ê n e > armé e d’un fe r d e P o itou , & G u il-
la um e -le -B r e to n , en pa rlant du com b a t de G u i l laum
e des B arres c o n tre R ich a rd d’A n g le te r r e , auprès
de M a n te s , d it en f t y le po é t iqu e , q u e leu rs
b o u c lie r s fu ren t p e rc é s par le f r ê n e , c’ è ft-à-dire
pa r leu rs lances d e b o is d e fr ê n e .
U traque perclipeos ad cQrpora fraxinus ibat.
L e p a ffa ge d’ un au tre au teu r n o u s ap prend la
m êm e c h e fë , & en meme tem p s q u e ces lances
é to ien t fo r t lo n g u e s . « L e s lances d es F ran ç o is , dit-
i l , é to ie n t d e b o is d e fr ê n e » a v o ie n t un fe r fo r t
a igu , & é to ie n t c om m e de lo n g u e s p e rche s ». llaftcz fraxinete in manibus eorurn ferro acutijjimo
prcefixce funt, quafi grandes penictz. M a is d epuis on
le s fit plus g ro ffe s & plus cou rte s , & je c rois que
c e ch a n g em en t fe fit un p eu a v an t P h ilipp e de V a lo
is , q u e la m o d e v in t q u e les ch e v a lie r s & la g e n d
a rm e r ie com b a ttiffen t à p i e d , m êm e dans le s b a ta
ille s & le s c om b a ts ré g lé s .
D a n s c e s o c c a fio n s -là m èm è , Lorfqu’ ils fe met-
to ie n t à pied , ils a c c o u r c if lo ie n t e n c o r e leu rs lances , en le s c ou p an t pa r le b o u t du m a n ch e . C e la
N s ’a p p e llo it retailler les lances.. C ’eft ce q u e tém o ign e
Fro iffa rd en d iv e r s endro its d e fo n hifto ire. V o ic i
c e 'q u e d i t , fu r c.ela., le pré fid en t F a u ch e t en peu
d e . m o ts.
« L a lance, qu i aufti s ’ ap p e llo it bois, je cro is , par.
e x c e lle n c e , & e n c o r e glaive, & puis quan d e lle s
fu ren t gro ffes , bourdons oc bourdonnaft'es ; quan d
e lle s fu ren t c r eu fe s , fe d it P hilippe» d e C om in e s
en pa rlant d e la b a ta ille de F o u r n o u e ; mais le
m êm e C om in e s tém o ign e q u ’e lle s é to ien t c reu fe s .
Q u a n t à la lance, e lle -a to u jo u r s été arme d e c a v
a lie r , p lu s lo n g u e to u te fo is q u e c e lle s d ’au jo u r d
’hui , com m e c e lle s des P o lo n o i s , la q u é lle en c o r e
q u e les c h e v a lie r s n’ eu ffen t p o in t d’arrê t fe rm e , à
cau fe qu e leu r s hau berts é to ie n t de m a ille s , on
n ’eu t feu ou le s c lo u e r ( ces arrêts ) fu r les ma illes ,
le s ch e v a lie r s ne la ifib ien t pas de c lo u e r fu r l ’a r fo n
d e la fe lle de leu r s c h e v a u x r je crois bandée à l’an-
g lo îfe y mais- il n e me fo ü v ie n t po int d’a v o ir v u
pe intes d es lances qui e u ffen t des po igné es com m e
au jo u rd ’ h u i , a v an t l ’an 1-300 , ainfj toute s .unies
dep uis le fe r ju fq u ’à l ’autre b o u t , c om m e ja v e lin
e s le fq u e l ie s , m ême d u temps d e F ro i ffa rd ,
le s ch e v a lie r s é tan t d e fe en du s à p i e d , ro gn o ien t
p o u r mieu x s’en aide r au pouffis. E n ce temps-là.,
i'es ch e v a lie r s c ro y o ie n t q u e les me illeu r s fe rs de.
lances v e n o ie n t d è B o u r d e a u x . . . . A p r è s l ’e n v a h
ie eflais o u c o u r fe d u temps de F ro iffa rd , il fa ll
a i t m e u re p ied à te rre , ro gn e r foin g l a i v e ,, c ’e ft-
L AN
à-dire, fa lance , & d’icelui pouffer tant qu’on eût
renverfé fon ennemi; cependant choififfant la faute
de fon harnois pour le bleffer & tuer.. Et lors ceux
qui étoient plus adroits & avoient meilleure haleine
pour durer à ce pouffis-de lance , étoient efti-
més les plus experts hommes d’armes y c’eft-à-*dire
dextres , & rufés , & experts ».
On orrioit les lances d’une banderole auprès du
fer, & cet ornement avoit bonne grâce ; c’étoitune
coutume très ancienne » 8c dès le temps des croit
fades.
D ’ordinaire, dans ces rudes chocs , lés lances fe
fracafloient 8c fautoient en éclats. C ’eft pourquoi
dans les tournois, pour dire faire un affaut de
lances, on difoit rompre une lance ; ainfi le combat
de cheval, quand il fe faifoit à la lance y ne duroit
qu’un moment. On la jettoit après le premier choc ,
& on en venoit à l’épée. Guillaume Guiart, en
racontant la defeente de S . Louis à Damiette . dit x
Après le froiffis des lances
Q u i jà font par terre femées
Portent mains à blanches épées ,
Defquélles ils s’entre-envahiffent y
Hiaumes , & bacinets tenriiTent y
Et piufieurs autres ferrures ».
Coutiau-x très perçans anmires..
Quand , dans le combat de deux troupes de gendarmerie
l’une contre l’autre, on voyoit dans l’une-
j les lances Jevées , c’étoit un figue d’une prochaine
déroute. C’eft ce qu’ofeferve d’Aubigné dans la
relation de la bataille de Contras.. En effet, cela-,
marquoit que les gendarmes ne pouvoient plus
■ faire ufàge de leurs lances , parce qu’ils étoient fer-,
! rés de trop près par les ennemis.
L’ufage des lances ceffa en France beaucoup-1
; avant le temps que les compagnies d’ordonnance
fuffent réduites à la gendarmerie d’aujourd’hui. Et
le prince Maurice l’abolit entièrement dans les armées
de Hollande. Il en eut une raifon particulière
: c’eft que les pays où il foutenoit la guerre
. contre les Espagnols font , marécageux , coupés de
canaux & de rivières , fourrés & inégaux , & qu’il
falloit pour les lanciers, des pays plats & unis, où-,
ils püffent faire un affez grand front, & courir à
bride abattue fur la même ligne, dès qu’ils avoient
pris carrière ,.c’eft-à-dire, dès qu’ils commençoient
à piquer, ce qu’ils faifoient d’ordinaire à. foixante
pas de l’ennemi.. .
Mais il eut encore d’autres raifon» qui lui furent
communes avec la France. Les lanciers , jnfqu’à ce.*
temps-là1, étoient prefque tôuts gentilshommes ; 8c.
même Henri I I I , par fon ordonnancé de 1575
avoit déclaré que non-feulement les lanciers , mais
encore les archers des ordonnances ,. dévoient être*
.de noble race. O r , les guerres civiles avoient fait'
périr une infinité de. nobleffe en France, auffi-biem
que dans les Pays-bas , ce qui faifoit qu’on avoir
peine à fournir de gentilshommes, les, compagnies;
d’ordonnasce..
Secondement, Il falloit que les lanciers enflent
de grands chevaux de bataille très forts, de meme
taille , dreffés avec grand foin , 8c très maniables
pour touts les mouvements que demandoit le combat
avec la lance. Il étoit difficile d en trouver un
grand nombre de cette forte , ils coutoient beaucoup
d’argent , & bien des gentilshommes ne-
toient pas en état de faire cette dépenfe ; les guerres
civiles ayant ruiné 8c défolé la France 8c les Pays-
bas.
Troisièmement, le combat de la lance fuppofoit
une grande habitude pour s’en bien Servir » oc 11 n
exercice très fréquent où l’on élevoit les jeunes
gentilshommes. L’habileté à manier cette arme s ac-
quéroit dans les tournois 8c dans les académies ; les
guerres civiles ne permettoient plus guère, depuis
longtemps, l’ufage des tournois ; & la jeune nobleffe,
pour la plupart, s’engageoit dans les troupes
fans avoir fait d’académie , & par conféquent 11 e-
toit guère habile à fe fervir de la lance. Toutes ces
raifons firent qu’on abandonna la lance peu-à-peu ,
& qu’on ne s’en fervoit plus guère fous le régné
de Henri IV. Il ne paroît point, par notre hiftoire ,
qu’il y ait eu d’ordonnance pour abolir cet tuage.
Mais George Bafta, fameux capitaine dans les armées
de Philippe II , roi d’Efpagne , & celles de
l’Empire , marque expreffément le retranchement
des lances dans les armées françoifes fous Henri IV ?
car il écrivoit du temps de ce prince ; c eft dans
l ’ouvrage qu’il publia fur le gouvernement de la
cavalerie.légère , où voici comme il parle : « L in-
. îrodu&ion des cuiraffes , ç’eft-à-dire , des efea-
drons de cuiraffiers en France, avec un total ban-
niffement des lances , a donné occafion de difcourir
quelle armure feroit la meilleure , 8cc. ». C eft
donc en ce temps-là que les lances furent abolies
en France. Les Efpagnols s’en fervirent encore depuis
; mais ils en avoient peu dans leurs troupes.
Les Efpagnols feuls , dit le duc de Rohan dans fon
Traité de la guerre , dédié.à L o u i s X I I I , ont encore
retenu quelques compagnies de lances \ qu ils cdn-
fervent plutôt par gravité que par raifon ; car là
lance ne fait effet que par la roideur de la courfé
du cheval, & encore il n’y a qu’un rang qui s’en
puiffe fervir, tellement que leur ordre ne doit être
de combattre en haie, ce qui ne peut réfifter aux
efeadrons ; 8c fi elles combattoient en efeadrons ,
elles feroient plus d’.effibarras que de ferviçe. .
On voit, par ce-que je viens de dire , l’époque
de l’abolition des lances en France , arme que les
François avoient fu manier, de fon temps , mieux
qu’aucune autre nation. On ne s’en fert plus aujourd’hui
que dans les côurfes de bagues , &
quelques femblables exercices utiles autrefois par
rapport à la guerre, & qui ne font plus maintenant
que de purs divertiffements. ( Hiftoire de- la milice
françoife, par le P, Daniel').
LÉGION. Corps de troupes romaines»
§• 1
C o m p o s i t i o n de la l é g i o n .
Officiers fupérieurs.
Les officiers fupérieurs de la légion étoient les
tribuns des foldats. Romulus en créa trois par légion.
Ils furent cheifis par les confuls ou Tes didacr
teurs jufqu’à l’an 391 ; alors le peuple s’en attribua
réleàion , & créa pour deux légions fix tribuns ,
dont T. Manlius fut le fécond. ( Av> J . C. 362,. Liv.
/. V I I , c. 5 , mém, de l’acad^ le Beau , t. X X X V I I ,
p. 1146* fuiv. ).
Les généraux reprirent enfuite ce droit, 8c jufqu’à
l’an 442 , ne laiffèrent à la nomination du
peuple qu’un petit nombre de tribuns. Cette même
année , le peuple nomma feize tribuns pour quatre
légions , & retint ce droit dans la fuite ; cependant
il le céda quelquefois aux généraux. ( Av. J.C. 311.
Liv. /. I X , c. 30 ).
L’an 546, lorfqu’Asdrubal paffa d’Efpagne en
Italie , il fut permis au conful Claudius Néron ,
8c M. Liviüs , de nommer les tribuns des vingt-
trois légions,qui furënt levées alors, excepté ceux
des quatre premières. L’an 582 , qui fut le premier
| de la guerre contre Perlée, & l’année fui vante,
I les confuls & les préteurs choifirent les tribuns.
La troisième année de cette guerre, le peuple fe
réfer va de nommer ceux de quatre légions defti-
nées à fe porter où il feroit néceffaire. Enfin là
quatrième 8c dernière année, le peuple choifit là
moitié des tribuns pour huit légions qui furent
levées alors » les confuls l’autre moitié , & Paul
Emile prit à fon choix dans le nombre total, ceux
des deux légions de Macédoine.'( Liv. I. X X V I I y
c..36,,0V. J. C. 207. X X X l l 9c. 31 , av. J. C, 171.
X X X I I I , c. 12. X L IV 21 ).
Cette répartition de choix: entre le peuple & les
confuls, fubfiftoit au temps de Polybe. Les tribuns
élus par .le peuple étoient nommés çornitiati, 8c
cette èleéhon étoit la plus honorable & la plus recherchée.
Il falloit, pour l’obtenir, demander les
fuffrages du peuple. Ce fut par cette voie que les
citoyens les plus diftingués par leurs vertus ou par
leurs talents , les obtinrent. Tels furent Caton l’an-
- cien, Marius,& Cæfar. Les . autres , fouvent obf?
çurs & dé.pourvus des qualités néceffaires dans cet
i emploi, n’y parvenoient le plus fouvent que par
la faveur. Cæfar avoue que dans fa première campagne
des Gaules , piufieurs tribuns de -fon armée
qui l’avoîent fuivi par attachement, n’a voient pas
un grand ufage de la guerre , & qu’ils furent les
premiers à augmenter la terreur qui faifit les troupes
à l’approche des Germains. On nommoit rutuli on
rufuli lestribuns choifis par les généraux» parce
que leurs droits & prérogatives avoient été réglés
par une loi de Rutilius-Rufus, tribun du peuple.
( Polyb. I, V I , §• 1 7 , ernerti 8°. av, J. C. 154. Cæ/ .