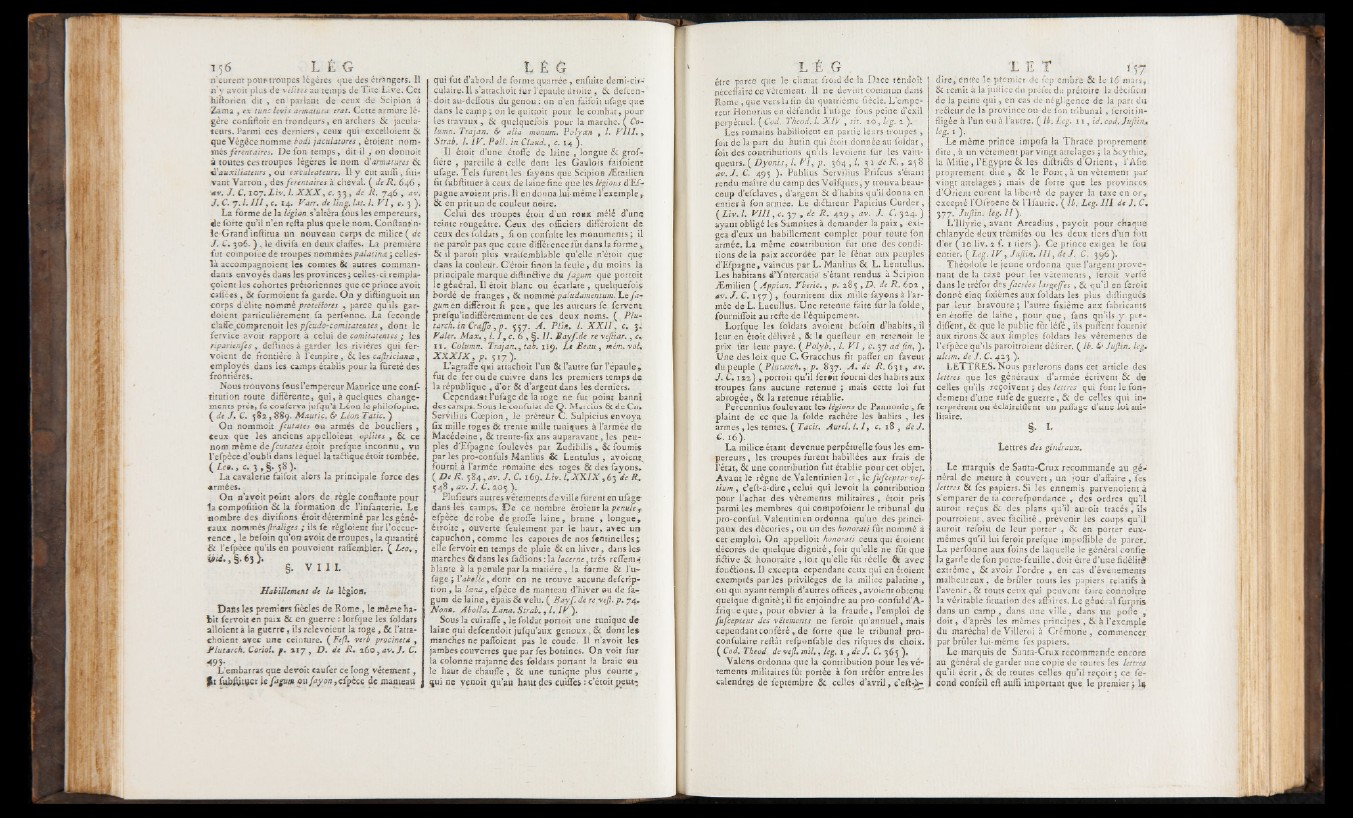
n’eurent pour-troupes légères que des étrangers. Il
n’y avoit plus de vélites au temps de Tite Live. Cet
liiflorien dit , en parlant de ceux d.e Scipion à
Zama , ex tune levis armatura erat. Cette armure lé*
•gère confiftoit en frondeurs, en archers & jacula-
teurs. Parmi ces derniers, ceux qui excelloient &
que Yégèce nomme bodi jaculatores, étoient nommés
ferentaires. De fon temps, dit-il , on donnoit
à toutes ces troupes légères le nom d’armatures &
<Tduxiliateurs , ou exculeateurs. Il y eut auffi , fut-
vant Varron , des ferentaires à cheval. ( de R. 646 ,
■ <iv. J . C, 107.Liv. I. X X X , c. 33 , de R. 746 , av,
J . C. 7. /. I I I , c, 14. Varr. de ling. lat. I. V I , c, 3 ),
La forme de la légion s’altéra fous les empereurs,
de forte qu’il n’en refia plus que le nom. Confian t n-
le-Grand infîitua un nouveau corps de milice ( de
J . C. 306. ) , le divifa en deux claffes. La première
fut compofee de troupes nomméespalatïn<zm, celles-
là accompagnoient les comtes & autres commandants
envoyés dans les provinces; celles-ci rempla-
■ çoîent les cohortes prétoriennes que ce prince avoit
caffées , & formdient fa garde. On y diôinguoit un
■ corps d’élite nommé proteSores , parce qu’ils gar-
doient particuliérement fa perfonne. La fécondé
claffe^comprenoit les pfeudo-comitatentes , dont le
fervice avoit rapport à celui de comitatentes j les
riparienfes, deflinés à garder les rivières qui fer-
voient de frontière à l ’empire , & les cafiricianæ ,
employés dans les camps établis pour la fureté des
frontières.
Nous trouvons fous l’empereur Maurice une conf-
titution toute différente, qui, à quelques changements
près, fe conferva jufqu’à Léon le philofophe*
( de J. C. 58 2 ,8 8 9 . Mauriç. & Léon Tatic. )
On nommoit Jcutates ou armés de boucliers ,
ceux que les anciens appelloient oplites , & ce
nom même de feutates étoit prefque inconnu , vu
l ’efpèce d’oubli dans lequel la ta&ique étoit tombée.
{ L e t . , c . 3 ,§ .5 8 ) .
La cavalerie faifok alors la principale force des
armées.
On n’avoit point alors de règle confiante pour
la compofition & la formation de l’infanterie. Le
nombre des divifions étoit déterminé par les,généraux
nommés firaliges ; ils fe régloient fur l’occurrence
, le befein qu’on avoit de troupes, la quantité
& l’efpèce qu’ils en pouvoient raffembler. £ Léo, ,
üfid,, §. 63 }.
§- V I I L
Habillement de la légion.
Dafis les premiers fiècles de Rome , le même bât
i t fervoit en paix & en guerre ;■ lorfqae les foîdats
alloient à la guerre, ils relevoient la toge , & l’atta-
choient avec une ceinture. ( Fefl. verb procineta ,
R lut ar ch. Coriol, p. 217 , D. de R, 2.60 >av. J. C.
493-
L ’embarras que devoit eaufer ce long vêtement,
f i fub iU^r le fagum ou fayon, efpèce de manteau
LÉO
qui fut d’abord de forme quarrée, en fuite demi-circulaire.
Il s’attachoit fur l’épaule droite , 6c defeen-
- doit au-deffous du genou : on n’en faifoit ufage que
dans le camp ; on le quittoit pour le combat, pour
les travaux , & quelquefois pour la marche. ( Co»
lumn. Trajan. 6* alla monum. Polyatn , l. VIII. ,
Strab, I. IV. Poil, in Claud,, c. 14 ).
Il étoit d’une étoffe de laine , longue & grof-
fière , pareille à celle dont les Gaulois faifoient
ufage. Tels furent les fayons que Scipioa Æmilien
fit fubflituer à ceux de laine fine que les légions d'Ef-
pagne avoient pris. Il en donna lui-même l’exemple *
& en prit un de couleur noire.
Celui des troupes étoit d'un roux mêlé d’une
teinte rougeâtre. Ceux des officiers différoient de
ceux des foldats, fi on confnlte les monuments ; il
ne paroît pas que cette différence fût dans la forme
& il paroît plus vraifemblable qu’elle n’étoit que
dans la couleur. C ’étoit fiaon la feule, du moins la
principale marque diflinâive du fagum que portoit
le général. Il étoit blanc ou écarlate , quelquefois;
bordé de franges , & nommé paludamentum. Le fa»
gumen différoit fi peu, que les auteurs fe fervent
prefqu’indifféremment de ces deux noms. ( Plu-
tarch. in Craffb , p. 357. A . Plin. l. X X IJ , c. 3*
Valer. Max, , /. I 9c. 6 , § . II. Bayf.de re vefiiar. , c*
11. Column. Trajan. , tab. HO. Le Beau , mérn, vol,
X X X IX , p. 5 17 ).
L’agraffe qui attachoit l’un & l’autre fur l’épaule»
fut de fer ou de cuivre dans les premiers temps de
; la république , d’or & d’argent dans les derniers.
| Cependant l’ufage de la toge ne fut point banni
des camps. Sous le confulat de Q. Marcius & de Cnv
Servilius Çcepion, le préteur C. Sulpicius envoya
fix mille toges 8c trente mille tuniques à l’armée de
Macédoine, 6c trente-fix ans auparavant, les peuples
d'Efpagne foulevés par Zudibilis , & fournis;
par les pro-confuls Manlius & Lentulus , avoient
fourni, à l’armée romaine des toges & des fayons.
( De R. 5 84, av. J. C. 169. Liv. I, X X IX ,63 de R,
548 , av. J. C. 205 ).
Plufieurs autres vêtements' de ville furent en ufage
dans les camps. De ce nombre étoient la penule ,
efpèce dérobé de groffe laine, brune , longue,
étroite, ouverte feulement par le haut,, avec un
capuchon, comme les capotes de nos feminelles £
elle fervoit en temps de pluie & en hiver, dans les-
marches & dans les fa&ions : la laccrne, très reffem-
blante à la penule par la matière , la forme & l’u-
fage ; Xabolie, dont on ne trouve aucune deferip-
tion , la Icena, efpèce de manteau d’hiver ou de fa-r
gum de laine, épais & velu. ( Bayf. de re.vefi, p, 74.
Nonn, Abolla. Lana. Strab, , l, IP ).
Sous la cuiraffe , le foldat portoit une tunique de
laine qui defeendoit jufqu’aux genoux, 6c dont les
manches ne paffoient pas le coude. Il n’avoit les
jambes couvertes que par fes bottines. On voit fur
la colonne trajanne des foldais ponant la braie ©u
le haut de chauffe, & une tunique plus courte ,
qui ne yenoit qu’au haut des cuiffes : c ’étoit peutêtre
parce que le climat froid de la Dàcë rendoil
néceffaire ce vêtement. Il ne devint commun dans
Rome , que vers la fin du quatrième fiècle. L’empereur
Honorius en défendit l’ufage fous peine d’exil
perpétuel. ( CW. Theod. I. XIP , tit. 10 3 leg. 2 )., -
Les romains habiiloient en partie leurs troupes ,
foit de la-part du butin qui étoit donnée au foldar,
foit des contributions qu’ils levoient fur les vainqueurs.
( Dyonis, /. VI ^ p. 364 , /. 31 de R . , 258
av. J. C. 495 ). Publius Servilius Prifcus s’étant
rendu maître du camp des Volfques, y trouva beaucoup
d’efclaves, d’argent & d’habits qu’il donna en
entier à fon armée. Le dictateur Papirius Curder,
( Liv. I, V III, c. 37 , de R. 429, av. J. C. 324. )
ayant obligé les Samnites à demander la paix , exigea
d’eux un habillement complet pour toute fon
armée. La même contribution fut une des conditions
de la paix accordée par le fénat aux peuples
d’Efpagne, vaincus par L. Manlius & L. Lentullus.
Les habitans d’Yntercatia' s’étant rendus à Scipion
Æmilien ( Appian. Yberïc. , p. 285 >D. de R. 602 ,
av. J. C. 157) , fournirent dix mille fayons à l’armée
de L. Lucullus. Une retenue faite fur la folde,
fourniffoit au refte de l’équipement.
Lorfque les foldats avoient befoin d’habits, il
leur en étoit délivré , & lt quefteur en retenoit le
prix fur leur paye. ( Polyb<, l. V I , c. 37 ad fin, ).
Une des loix que Ç. Gracchus fit pafîer en faveur
du peuple (Plutarch. ,\p. .837. A . de R. 6 3 1 , av.
J . C. 122) , portoit qu’il feroit fourni des habits aux
troupes fans aucune retenue ; mais cette loi fut
abrogée, & la retenue rétablie.
Percennius foulevant les légions de Pannonie, fe
plaint de ce que la folde rachète les habits , les
armes , les tentes» ( Tacit. Aurel. l . l y c. 18 , de J.
C .1 6 ) .
La milice étant devenue perpétuelle fous les empereurs
, les troupes furent habillées aux frais de
l ’état, & une contribution fut établie pour cet objet.
Avant le règne de Valentinien 1er, le fufeeptor vef-
tiurn, c’efi-à-dire, celui qui levoit la contribution
pour l’achat dés vêtements militaires , étoit pris
parmi les membres qui compofoient le tribunal du
pro-conful. Valentinien ordonna qu’un des principaux
des décuries , ou un des honorati fût nommé à
cet emploi. On appelloit honorati ceux qui étoient
décorés de quelque dignité, foit qu’elle ne fût que
fiélive & honoraire , foit qu’elle fût réelle & avec
fon étions. Il excepta cependant ceux qui en étoient
exemptés par les privilèges de la milice palatine ,
ou qui ayant rempli d’autres offices, avoient obrenu
quelque dignité; il fit enjoindre au pro-conful d’A frique
que, pour obvier à la fraude, l’emploi de
fiifcepiéeur des vêtements ne feroit qu’annuel, mais
cependant conféré, de forte que le tribunal pro-
confulaire reliât refponfable des rifques da choix.
( Cod. Theod, de vefi, mil, , leg. 1 , de J. C. 365
Valens ordonna que la contribution pour les vêtements
militaires fût portée à fon tréfor entre-les
calendrçs de feptembre 6c celles d’avril, c’eû-jàdire,
entfe le pfemier de fep'embfe & le 16 mars,
& remit à la jullice du préfet du prétoire la décifion
de la peine q u i, en cas de négligence de la part du
reéleurde la province ou de fon tribunal, feroit infligée
à l’un ou à l’autre. ( Ib. Leg. 1 1 , id. cod. Juflin.<
leg. 1 ) .
Le même prince impofa la Thrace proprement
dite , à un vêtement par vingt attelages ; la Scythie,
la Mifie , l’ Egypte & les diftri&s d’O rient, i’Afie
proprement dite , & le Pont, à un vêtement par
vingt attelages ; mais de forte que les provinces
d’Orient eurent la liberté de payer la taxe en o r ,
excepté l’Ofroene & l’Ifaurie. ( Ib. Leg. I I I de J. C.
377. Jufiin. leg. //).
L ’Illyrie, avant Arcadius , payoit pour chaque
chlanyde deux trémifes ou les deux tiers d’un fou
d’or (10 liv. 2 f. 1 tiers). Ce prince exigea le fou
entier. ■ ( Leg. I V , Jufiin. I I I , de J. C. 3 96 ).
Théodofe le jeune ordonna que l’argent provenant
de la taxe pour les vêtements, feroit verfé
dans le tréfor des facrées largejfes , & qu’il en feroit
donné cinq fixièmes aux foldats les plus diflingués
par leur bravoure; l’autre fixième aux fabricants
en étoffe de laine , pour que, fans qu’ils y perdirent,
& que le public fût léfé, ils puffent fournir’
aux tirons & aux fimples foldats les vêtements de
l’efpèce qu’ils paroîtroient défirer. ( lb. 6* Jufiin. leg«
ultim. de J. C. 423 ).
LETTRES» Nous parlerons dans cet article des
lettres- que les généraux d’armée écrivent & de
celles qu’ils reçoivent ; des lettres qui font le fondement
d’une rufede guerre, & de celles qui interprètent
ou é clair ciffent un paffage d’une loi militaire.
§• l
Lettres des généraux.
Le marquis de Sartta-Crux recommande au général
de mettre à couvert, un jour d’affaire , fes
lettres & fes papiers. Si les ennemis parvenoient à
s’emparer de la correfpondançe , des ordres qu’il
auroir reçus & des plans qu’il auroit tracés , ils
pourroient, avec facilité , prévenir les coups qu’i l
auroit réfolu de leur porter , & en porter eux-
mêmes qu’il lui feroit prefque impoflible de parer.
La perfonne aux foins de laquelle le général confie
la garde de fon porte-feuille, doit être d’une fidélité
extrême, & avoir l’ordre , en cas d’événements
malheureux, de brûler touts les papiers relatifs à
l’avenir ,& touts ceux qui peuvent faire connoître
la véritable fituation des affaires. Le général furpris
dans un camp , dans une v ille, dans un pofîe ,
doit, d’après les mêmes principes , & à l’exemple
du maréchal deVilleroi à Crémone, commencer,
par brûler lui-même fes papiers.
Le marquis de Santa-Crux recommande encore
au général de garder une copie de toutes les lettres
qu’il écrit, & de toutes celles qu’il reçoit ; ce fécond
confeil efl auffi. important que le premier ; I4