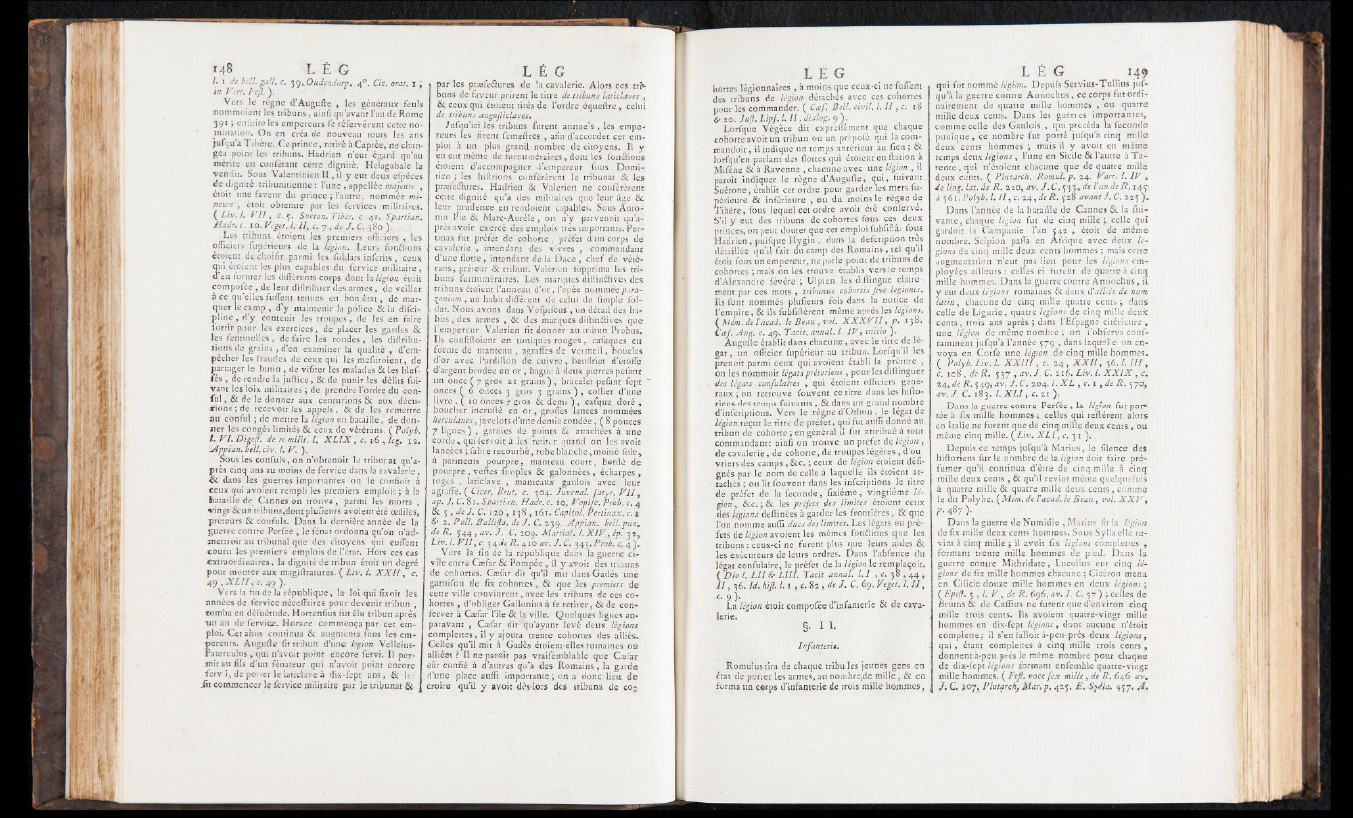
* 4 8 L É G
/. i de bell. gall. c. 39*Oudendorp. 40. Çic, orat. 1 ;
in Verr. ïeji. ).
Vers le règne d’Augufte , les généraux feuls
nommoient les tribuns, ainfi qu’avant l’an de Rome
391 > en fuite les empereurs fe réfervèrent cette no*
mi nation. On en créa dé nouveau touts les ans
jufqu’à Tibère. Ce prince, retiré à Captée, ne changea
point les tribuns. Hadrien n’eut égard qu’au
mérite en conférant cette dignité. Helagabale la
vendir. Sous Valentinien Ï I , il y eut deux efpèces
de dignité tribunitienne : l’une , appellée majeure ,
étoit une faveur du prince ; l’autre, nommée mineure
, étoit obtenue par les fervices militaires. C Liv. I. P I I y c. 3. Sueton. Tiber. c. 41. Spartian.
Hadr. c. lO.Véget.l.ll^c. j.,d e J. Ç. 380 )..
L e s trib un s é to ien t le s premie rs o ffic ier s , les
officiers fu pe r ieur s de la légion. Leu rs fo n d io n s
é to ie n t d e ch o ifir . parmi les foîdars in f c r it s , c eu x
qu i é to ie n t les plus cap ab le s d u fe r v ic e militaire ,
d ’en former le s différents corp s dont la légion étoit
c om p o fé e , de leu r d iftribu er des a rm e s , de v e ille r
a c e q u ’e lle s fu ffen t tenu es en bon é t a t , de ma rq
u e r le camp , d’y ma intenir la p o lic e & la d ifc i-
p l i n e , d’y co n ten ir les t ro u p e s , de les en faire
fb r t ir p o u r les e x e r c i c e s , de pla ce r le s gard es &
le s fe n t in e lle s , de fa ire le s ron de s , le s d ifir ibu -
t io n s de grains , d’en ex am in e r la qu alité , d’emp
ê ch e r les frau d es de c eu x qui les m e fu ro ie n t , de
pa r ta g er le butin , de v ifite r les malades Si les M é fié
s , de ren dre la ju f t i c e , Si de punir les délits fui-
Van t le s lo ix militaires 3 de prendre l’o rd re du co n s
u l , & d e le d o n n e r au x c en tu r ion s & au x d écu p
lo n s ; de r e c e v o ir les ap pe ls , 8c d e les remettre
a u c o n fu l ; de me ttre la légion en b a ta ille , de d o n n
e r les c o n g é s limités 8i c eu x de vété rans . ( Polyb.
I. VI.Digefl. de re milit. I. X L I X , c. 16 , le g. 12.
‘Appian. bell. civ. I. V. ).
S o u s les c o n fu ls , o n n’o b ten o it le tribur.at qn’a-
p r è s c in q an s au mo in s de fe r v ic e dans la c a v a le r ie ,
Si dans le s g u erres im po rtante s o n le c o n fio it à
< eu x qui a v o ie n t rem pli les premiers emplois ; à la
b a ta i lle d e C a n n e s on t r o u v a , parmi les morts ,
v in g t & un tr ib un s ,d o n t p lufîeurs a v o ien t été oe d île s ,
p ré teu r s Si c o n fu ls . D a n s la d ern ière an n é e de la
g u e r r e c o n tre P e r f é e , le fén a t o rd o n n a qu ’on n’ad-
m e ttro ir au trib un al q u e d es c ito y e n s qu i eu ffen t ■
c o u ru le s p r em ie r s em p lo is d e l’ érar. Ho rs c e s cas
e x t r a o rd in a i r e s , la d ign ité de tribun é to it un degré
p o u r mo n te r au x ma giflratures. ( Liv, l. X X I I , c.
49 , X L I I , c. 49 ).
Vers la fin de la république, la loi qui fixoîr les
années de fervice néceffaires pour devenir tribun ,
tomba en défuétude. Hortenfius fut éla tribun après
un an de fervice. Horace commença par cet emploi.
Cet abus continua 8c augmenta fous les em-
ereurs. Auguffe fit tribun d’une légion Velleius-
aterculus , qui n’avoit point encore fervi. Il permit
au fis d’un fénateur qui n’avoit point encore
ierv i, de porter le laticlave à dix-fept ans , & lu
jSt commencer le fervice .militaire par le tribunal &
L É G
par les præfeélures de la cavalerie. Alors ces tri**
buns de faveur prirent le titre de tribuns laticlaves ,
& ceux qui étoient tirés de l’ordre équeflre , celui
de tribuns augufiiclaves.
Jufqu’ici les tribuns furent annuels , les empereurs
les firent femeflres , afin d’accorder cet emploi
à un plus grantl nombre de citoyens. Il y
en eut même de furnuméraires, dont les fondions
étoient d’accompagner d’empereur fous Domi-
tien ; les hiftrions conférèrent le tribunat 8c les
præfeéhirès. Hadrien 8c Valerien ne conférèrent
cçtte dignité qu’à dés militaires que leur âge 8c
leur prudence .en rendoient capables. Sous Antonio
Pie 8c Marc-Aurèle, on n’y parvenoit qu’a-
pres avoir exercé des emplois très importants. Per-
tinax fut préfet de cohorte, préfet d un corps de
cavalerie -, intendant des vivres , commandant
d’une flotte, intendant de la Dace , chef de vétérans,
préteur 8c tribun. Valérie» fupprima les tribuns
furnuméraires. Les marques dîflinélives des
tribuns étoient l’anneau d’or, l’épée nomméep.ira-
\onium , un habit différent de celui du fimple fol-
■ dat. Nous avons dans Vofpifcus , un détail des habits
, des armes , 8c des marques diftinélives que
l’empereur Valerien fit donner au tribun Probus.
Ils confiftoient en tuniques rouges, cafaques en
forme de manteau , agraffes de vermeil, boucles
d’or avec l^irdillon de cuivre , baudrier d’étoffe
d’argent brodée en or , bagué à deux pierres pefant
un once ( 7 gros a i grains) , bracelet pefant fept
on.ces ( 6 onces 3 gros 3 grains ) , collier d’une
livre , ( io onces 7 gros 8c demi ) , cafque doré ,
boucl ier incrufté en o r , groffes lances nommées
herculanes^ javelots d’une demie coudée , ( 8 pouces
7 lignes ) , garnies de points Sc attachées à une
corde, qui fervoit à les retirer quand on les avoit
lancées ;fabre recourbé, robe blanche »moitié foite 9,
à parments pourpre, manteau court, bordé de
pourpre , veftes Amples 8c galonnées , écharpes ,
toges , laticlave , manteaux gaulois avec leur
agraffe. ( Cïcer. Brut. c. 304. Juvenal. fatyr. V I I s
ap. J. C. S i. Spartian. Hadr. c. io, Vopifc.Prob. c. 4
Si 5 , de J. C. 12 0 ,13 8 , 161. Capitol. Pertinax. c. i
& 2. Poil. Ballifla. de J. C. 239. Appian. bell.pun,
de R. 5 4 4 j av‘ 209. Martial. l.XIV.y ép. 32»
Liv. L V II, c. 3 4 de R. 410 av. J. C. 343. Prob. c„ 4 )„
Vers la fin de la république dans la guerre civile
entre Cæfar 8c Pompée , il y avoit des tribuns
de cohortes. Cæfar dit qu’il mit dans Gadès une
garnifon de fix cohortes, 8c que les premiers de
cette ville convinrent, avec les tribuns de ces co- .
hortes , d’obliger Gallonius à fe retirer, 8c de con-
ferver à Cæfar l’île 8c la ville. Quelques lignes auparavant
, Cæfar dit -qu’ayant levé deux légions
complexes, il y ajouta trente cohortes des alliés*
Celles qu’il mit à Gadès étoient-elles romaines o»
alliées ? Il ne paraît pas vraifemblable que Cæfar
eût confié à d’autres qu’à des Romains, la garde
d’une place auffi importante; on a donc lieu de
croire qu’il y avoit dès-lors des tribuns de co-
L É G
hortes légionnaires , à moins que ceux-ci ne fuflent
des tribuns de légion détachés avec ces cohortes
pour les commander. ( Coef Bell, civil, l. I l ,c . 18
& 20. Jufl. Lipf. L I I . dialog. 9 ).
Lorfque Végèce dit expreffément que chaque
cohorte avoit un tribun ou un prépofe qui la com-
mandoit, il indique un temps antérieur au fien ; 8c
lorfqu’en parlant des flottes qui étoient en ftation à
Mifène 8c à Ravenne , chacune avec une légion , il
paroît indiquer le règne d’Augufte, qui, fuivant
Suétone, établit cet ordre pour garder les mers fu-
périeure 8c inférieure , ou du moins le règae de
l ’ibère, fous lequel cet ordre avoit été conferve.
S’ il y eut des tribuns de cohortes fous ces^ deux
princes, on peut douter que cet emploi fubfiflâi: fous
Hadrien , puifque Hygin , dans la defeription très
détaillée qu’il fait du camp des Romains, tel qu il
étoit fous un empereur, ne parle point de tribuns de
cohortes ; mais on les troïive établis vers le temps
d’Alexandre févère ; Ulpien les diftingue claire--
ment par ces mots , tribunus cohortis five legionis.
Ils font nommés plufieurs fois dans la notice de
l ’empire, 8c ils fubfiftèrent même après les légions.
( Mém. de l'acad. le Beau , vol. X X X V I I , p. 138.
Coef. Aug. c. 49. Tacit. annal. I. IV , initio ).
Augufte établit dans chacune , avec le titre cle légat
, un officier fupérieur au tribun. Lorfqu il les
prenoit parmi ceux qui avoient établi la preture ,
on les nommoit légats prétoriens , pour les difiinguer
des légats confuluires , qui étoient officiers généraux
; on retrouve fouvent ce titre dans les hifto-
riens des temps fuivants , 8c dans un grand nombre
d’inferiptions. Vers le règne d’Othon , le légat de
légion reçut le titre de prêtet, qui fut auffi donne an
tribun de cohorte ; en général il fut attribué à tout
commandant: ainfi on trouve un préfet de légion ,
de cavalerie, de cohorte, de troupes légères , d’ouvriers
des camps , 8cc. ; ceux de légion étoient defi-
gnés par le nom de celle à laquelle ils étoient at-
’ tachés ; on lit fouvent dans les inferiptions le titre
de préfet de la fécondé, fixième, vingtième légion
y Sic. ; 8c les préfets des limites étoient ceux
des légions deftinées à garder les frontières, Si que
l’on nomme auffi ducs des limites. Les légats ou préfets
de légion avoient les mêmes fonélions que les
tribuns : ceux-ci ne furent plus que leurs aides Si
les exécuteurs de leurs ordres. Dans l’abfence du
légat confulaire, le préfet de la légion le remplaçoit.
( Dio l. L I I & LUI. Tacit annal. l . I , c. 38,4 4 ,
I l y 36. ld. hifl. L 1 , c. 82 , de J, C. 69. Veget. LIIy
c. 9 ) .
La légion étoit compofée d’infanterie 8c de cavalerie.
Romulustira de chaque tribu les jeunes gens en
état de porter les armes, au nombrejde mille, Si en
forma un corps d’infanterie de trois mille hommes,
L È G 149
qui fut nommé légion. Depuis Servius-Tullius jufqu’à
la guerre contre Antiochus, ce corps fut ordinairement
de quatre mille hommes , ou quatre
mille deux cents. Dans les guerres importantes,
comme celle des Gaulois ,, qui précéda la fécondé
punique, ce nombre fut porté jufqu’à cinq mille
deux cents hommes ; mais il y avoit en même
temps deux légions , l’une en Sicile Si l’autre à Ta-
rente , qui n’étoient chacune que de quatre mille
deux cents. ( Plutarch. Romul. p. 24- V&rr‘ l> IP »
de ling. lat. de R. 210, av. J. C. 533, de Van de R. 145;
æ 561. Polyb. I. I l , c. 24, de R. 528 avant J. C. 225
Dans l’année de la bataille de Cannes Si la fui-
vante, chaque légion fut de cinq mille ; celle qui
gardoit la Campanie l’an 542 , étoit de même
nombre. Scipion paffa en Afrique avec deux légions
de ciiiq mille deux cents hommes ; mais cette
augmentation 'n’eut pas lieu pour les légions employées
ailleurs: celles-ci furent de quatreàcinq
mille hommes. Dans la guerre contre Antiochus, il
y eut deux légions romaines Si deux d’alliés de nom
latin y chacune de cinq mille quatre cents ; dans
celle de Ligurie, quatre légions de cinq mille deu*
cents , trois ans après ; dans l’Efpagne citérieure ,
une légion de même nombre ; on l’obferva conf-
tamment jufqu’à l’année 579 , dans laquelle on envoya
en Corfe une légion de cinq mille hommes.
( Polyb. Liv. I. X X I I I , c. 24 , X X I I y 36. L I I I ,
c. 108, de R. 537 , av. J. C. 216. Liv. I. X X IX , c.
24, de R. 549, av. J. C. 204. /. X L , c. 1 , de R. 570,
av. J. C. 183. l. XLIyC. 21 ).
Dans la guerre contre Perfée , la légion fut por*
tée à fix mille hommes; celles qui relièrent alors
en Italie ne furent que de cinq mille deux cents, ou
même cinq mille. ( Liv. X L I , c. 31 ).
Depuis ce temps jufqu’à Marius, le filence des
hiftoriens fur le nombre de la légion doit faire préfumer
qu’il continua d’être de cinq mille à cinq
mille deux cents , Si qu’il revint même quelquefois
à quatre mille & quatre mille deux cents , comme
le dit Polybe. ( Mém. de l’acad, le Beau, vol, X X V ,
p ■ 487)-
Dans la guerre de Numidie , Marius fit la légion
de fix mille deux cents hommes. Sous Syllaelle revint
à cinq mille ; il avoit fix légions complexes ,
formant trente mille hommes de pied. Dans la
guerre contre Mithridate, Lucullus eut cinq légions
de-fix mille hommes chacune ; Cicéron mena
en Cilicie douze mille hommes en deux légions ;
( Epi fl. 5 y l. V y de R. 6f)6,av. J. C. 57) ; celles de
Èrutus Si de Caffius ne furent que d’environ cinq
mille trois cents. Ils avoient quatre-vingt mille
hommes en dix-fept légions, dont aucune n’étoit
completre; il s’en falloit à-peu-près deux légions,
qui, étant complettes à cinq mille trois cents,
donnent à-peu près le même nombre pour chaque
de dix-fept légions formant enfemble quatre-vingt
mille hommes. ( Feft. voce fex mille, de R. 646 avm
J, C, 107, Plutarçhjf. Man p. 425, £ . SjéJa, 457, A ,