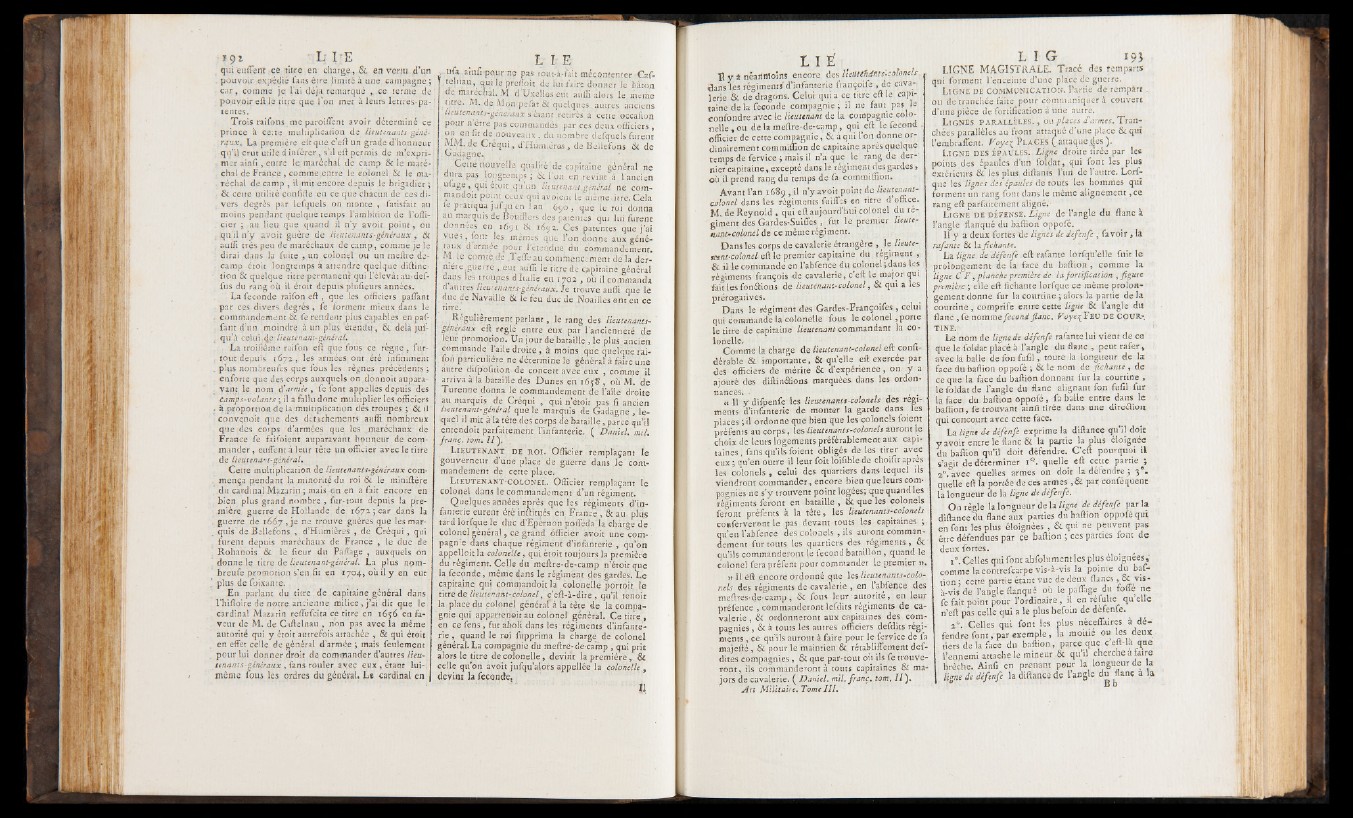
191 ' Lj l'E
qui enflentce-titre en charge., & en vertu ,d’un
. pouvoir expédié fans être limité à une campagne ;
car, comme je la i déjà remarqué ce terme de
pouvoir eft le titre que l’on met à leurs lettres-patentes.’
Trois raifons me paroiffent avoir déterminé ce
prince à ce;te multiplication de lieutenants généraux.
La première eft que c’eft un grade d’honneur
qu’il crut utile d inférer , s’il eft permis de m’exprimer
ainfi , entre le maréchal de camp & le maréchal
de France , comme,entre le colonel & le maréchal
de camp , il mit encore depuis ,1e brigadier ;
6c cette utilité çonfifte eu ce que chacun de ces di-
! vers degrés par lefquels on monte , fatisfait au
moins pendant quelque temps l'ambition de l ’offi-
. cier ; au lieu que quand il n’y avoir point, ou
; qu’il n'y avoir guère de lieutenants-généraux , &
aufli très peu de maréchaux de camp, comme je le
dirai dans la fuite , un colonel ou un meftre. de-
camp étoit longtemps à attendre quelque diftinc-
tion & quelque titre permanent qui l’élevât aü-def-
fus du rang où il étoit depuis plufteurs années.
La fécondé raifon eft , que les officiers paflant
par ces divers degrés , fe forment mieux dans je
. commandement & fe rendent plus capables en paf-
fatit d?un moindre ,à un plus étendu, & delà juf-.
qu’à ce\u\ (\e lieutenant-général.
La troifiéme raifon eft que fous ce régné, fur-
tout depuis 16 72 ,,les armées ont été infiniment
. plus nombreufes que fous les règnes précédents ;
enforte que des corps auxquels on donnoit auparavant;
le nom d'armée , fe font appel lés depuis des
camps-volants ; il a fallu donc multiplier les. officiers
. à proportion de la multiplication des troupes ; & il
convenoit que des détachements aufli nombreux
que des corps d’armées que les maréchaux de
France fe faifoient auparavant honneur de commander
, euflent à leur tête Un officier avec le titre
de lieutenant-général.
Cette multiplication de lieutenants-généraux commença
pendant la minorité du roi & le miniftère
du cardinal Mazarin ; mais en en a fait encore en
bien plus grand nombre, fur-tout depuis la première.
guerre de Hollande de 1672 ; car dqn's la
guerre de 1667 ,je ne trouve guères. que les marquis
de Bellefons , d’Humières , de Créqui , qui
furent depuis maréchaux de France , le duc de
Rohanois & le fleur du PaiTage , auxquels on
donne le titre de lieutenant-général. La plus nom-
breufe promotion s’en fit en 1704, où il y en eut
plus de foixante.
En parlant du titre de capitaine général dans
l ’hiftoire de notre ancienne milice, j’ai dit que le
cardinal Mazarin reftufcita ce titre en 1656 en faveur
de M. de C iftelnau , non pas avec la même
autorité qui y étoit autrefois attachée , & qui étoit
en effet celle de général d’armée ; mais feulement
pour lui donner droit de. commander d’autres lieu-
tenants-généraux , fans rouler ayec eux , étant lui-;
même fous les ordres du général. Le cardinal en
L I E
ufa amfi ppiir ne pas tout-à-fait mécontenter - Cal»
telna.u, qui le prefFoit de lui faire donner le bâton
de maréchal. M d Uxelles eut aufli alors le. même
titre. M. de. Monrpefat & quelques autres anciens
luutenants-gèneraux s‘étant retirés à cette occafion
pour n être pas commandés par ces deux officiers ,
on en fit denou.veaux , du nombre defquels furent
MM. de Créqui, d’Hüm.èros , de Bellefons & de
; Gaqagne.,
Çeitê nouvelle- qualité de capitaine général ne
dura pas longtemps; 6c l ’on en revint à l'ancien
ufage, qui étoit qu un lieutenant général ne com-
mandoit point ceux qui avoient le même. itre. Cela
fe pratiqua jufqu en 1 an 690 , que le roi donna
au marquis de Bonifier s des patentes qui lui furent
données en 1691. 6c 1692. Ces patentes que j’ai
vues , font les memes que l’on donne aux généraux
d armée pour l ’étendue, du commandement.
‘ ., ? corme,de .Teffe au commencement de la dernière
guerre eu.t aufli le titre de capitaine général
daps les troupes d Italie en 1702 , ou il commanda
d autres lieutenants-généraux. Je trouve aufli que le
duc de Navaille 6c le feu duc de Noailles ont eu ce
titre.
Régulièrement parlant, le rang des lieutenants-
généraux eft réglé entre eux par l'ancienneté de
leur promotion. Un jour de bataille a le plus ancien
commande l’aile droite , à moins que quelque rai-
foh particulière ne détermine le général à faire une
autre difpofition de concert avec eux , comme il
arriva à la bataille des Dunes en 16*8 , où M. de
Turenne donna le commandement de l’aîle droite
au marquis .de Créqui , qui n’étoit pas fi ancien
lieutenant-général que le marquis de Gadagne , lequel
il mit à la tête des corps de bataille, parce, qu’il
ente n doit parfaitement l ’infanterie. ( Daniel, ml,
franc, tom. I l ).
Lieutenant de roi. Officier remplaçant le
gouverneur d’une place de guerre dans .le commandement
de cette place.
Lieutenant-colonel. Officier remplaçant le
colonel dans le commandement d’un régiment.
Quelques années après que les régiments d’infanterie
eurent été inftitués^en France , & au plus
tard lorfque le duc d’Epèrnon .pofledala charge de
colonel général, c.e grand officier avoir une compagnie
dans chaque régiment d’infanterie , qu’on
appelloit.la colonelle, qui étoit toujours la première
du régiment. Celle du meftre-de-camp n’étoit que
la.fécondé, même dans le régiment des gardes. Le
capitaine, qui commandoitla .colonelle porroit. le
titre de lieutenant-colonel, c’eft-à-dire , qu’il tenoit
la place du .colonel générafà la tête de la compagnie
qui appar.tèrioit au colonel général. Ce titre,
en ce fens, fut aboli dans les régiments d’infanterie
, quand le roi fupprima la charge de colonel
général. La compagnie du meftre-de-camp , qui prit
alors le titre de colonelle, devint la première, &
celle qu’on avoit jtifqu’alors appellée la colonelle ,
devint la fécondé.
LI É
R y â néanmoins encore des lieütifidfits.côlonels„ .
dans les régiments' d’infanterie françoife, de cavalerie
& de dragons. Celui qui a ce titre eft le capitaine
de la fécondé compagnie; il ne faut pas le
confondre avec le lieutenant de la compagnie colonelle,
ou de la meftre-de-camp, qui eft le fécond .
officier de cette compagnie, 6c à qui l’on donne ordinairement
commlflxon de capitaine après quelque
temps de fervice ; mais il n’a que le rang de dernier
capitaine,, excepté dans le régiment des gardes »
où il prend rang du temps de fa coinmifiion.
Avant l’an 1689 , il n’y avoit point de lieutenant-
colonel dans les régiments fuiffes en titre d office.
M. de Reynold , qui eft aujourd’hui colonel du regiment
des Gardes-Suiffes , fut le premier lieutenant
colonel de ce même régiment.
Dans les corps de cavalerie étrangère , le lieute-
trant-colonel eft le premier capitaine du régiment ,
& il le commande en l’abfence du colonel ; dans les
régiments'françois de cavalerie, c’eft le major qui
fait les fondions de lieutenant-colonel, & qui a les
prérogatives.
Dans le régiment des Gardes-Françoifes , celui
qui commande là colonelle fous le colonel, porte
le titre de capitaine lieutenant commandant la colonelle.
ffl
Comme la charge de lieutenant-colonel eit conü-
dérable & importante, 6c quelle eft exercée par
de§ officiers de mérite & d’expérience, on. y a
ajouté des diftinâions marquées dans les ordonnancés.
• ,
« 11 y difpenfe les lieutenants-colonels des régiments
d’infanterie de monter la garde dans les
places ordonne que bien que les colonels foient
préfents au corps, les lieutenants-colonels auront le
choix de leurs logements préférablement aux capi- :
taines, fans qu’ils foient obligés de les tirer avec
eux ; qu’en outre il leur foit loifible de choifir apres
les colonels , celui des quartiers dans lequel ils
viendront commander, encore bien que leurs compagnies
ne s’y trouvent point logées; que quand les
régiments feront en bataille , & que les colonels
feront préfents à la tête, les lieutenants-colonels
conferveront le pas devant touts les capitaines ; -
qu’en l’abfence des colonels , ils auront commandement
fur touts les quartiers des régiments , & '
qu’ils commanderont le fécond bataillon, quand le
colonel fera préfent pour commander le premier ».
» Il éft encore ordonné que \qs lieutenants-colonels
des régiments de cavalerie , en l’abfence des
meftres-de-camp, 6c fous leur auto rité, en leur
préfence , commanderont lefdits régiments de cavalerie
, & ordonneront aux capitaines des compagnies
, & à touts les autres officiers defdits régiments
, ce qu’ils auront à faire pour le fervice de fa
majefté, & pour le maintien & rétabliffement def-
dites compagnies , 6c que par-tout ou ils fe trouveront,
ils commanderont à touts capitaines & majors
de cavalerie. ( Daniel, mil. franc, tom, I I ).
Art Militaire, Tome III.
lig m
LIGNE MAGISTRALE. Tracé des femparts
qui forment l ’enceinte d’une place de guerre.
L ig n e de c o m m u n ic a t io n . Partie de rempart „
ou de tranchée faite pour communiquer à couvert
d’une pièce de fortification à une autrè.
Lignes p a r a l l è l e s . , ou places d'armes. Tranchées
parallèles au front attaqué d’une place 6c qui
l’erabraffent. Voye^ Places (attaque des).
Ligne des é paü l e s . Ligne droite tirée par les
points des épaules d’un foldat, qui font les plus
extérieurs & les plus diftants l’un de l’autre. Lorfque
les lignes des épaules de touts les hommes qui
forment un rang font dans le même alignement, ce
rang eft parfaitement alignée
Ligne de défense. Ligne de l’angle du flanc à
l’angle flanqué du baftion oppofé.
11 y a deux fortes'de lignes de défenfe , fa voir , la
rafante & la fichante.
La ligne de. défenfe eft. rafante lorfqu’elle fuit le
prolongement de la face du baftion, comme la
ligne C F , planche première de la fortification , figure
première ; elle eft fichante lorfque ce même prolongement
donne fur la courtine ; alors la partie de la
courtine, comprife entre cette ligne 6c l’angle du
flanc , fe nomme fécond flanc. Voye^ Feu de cour-,
tine.
Le nom de ligne de défenfe rafante lui vient de ce
, que le foldat placé à l’angle du flanc , peut rafer,
avec-la balle de fon fufil, toute la longueur de la
face du baftion oppofé ; & le nom de fichante , de
ce que-la face du baftion donnant fur la courtine ,
le foldat de l’angle du flanc alignant fon fufil fur
la face du baftioa oppofé , fa balle entre dans le
baftion * fe trouvant ainfi tirée dans une direélion
qui concourt avec cette face.
La ligne de défenfe exprime la diftance qu il doit
y avoir entre le flanc & la partie la plus éloignée
du baftion qu’il doit défendre. C ’eft pourquoi il
s’agit de déterminer i Q. quelle «ft cette partie^;
2.°, avec quelles armes on doit la defendre ; 3 •
quelle eft la portée de ces armes ,& paç conféquent
la longueur de la ligne de défenfe.
On règle la longueur de la ligne de defenfe par la
diftance du flanc aux parties du baftion oppofé qui
en font les plus éloignées , & qui ne peuvent pas
être défendues par ce baftion ; ces parties font de
deux fortes.
i°. Celles qui font abfolumentles plus éloignées,
comme la contrefearpe vis-à-vis la pointe du baf-
tion ; cette partie étant vue de deux flancs , & vis-
à-vis de l’angle flanqué où le paffage du roffe ne
fe fait point pour l’ordinaire, il en réfulte qu elle
n’eft pas celle qui a le plus befoin de defenfe.
a°. Celles qui font les plus néceflaires à défendre
font ; par exemple, la moitié ou les deux
tiers de la face du baftion, parce que c eft-la que
l’ennemi attache le mineur & qu’il cherche a faire
brèche. Ainfi en prenant pour la longueur de la
ligne de défenfe la diftance de l’angle du flanc a la