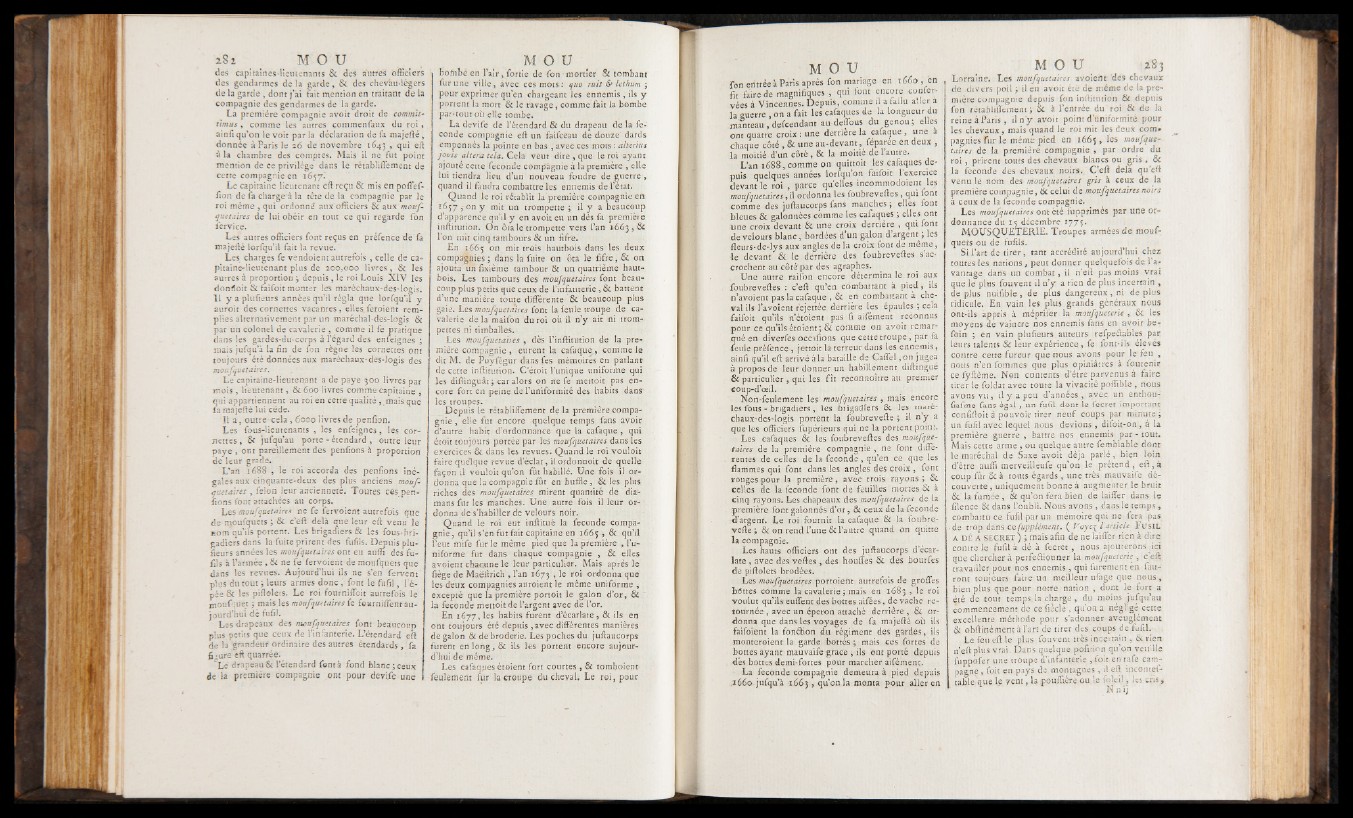
des capitaines-lieutenants & des autres officiers
des gendarmes de la garde, 8c des chevàu-légers
de la garde , dont j’ài tait mention en traitant de la
compagnie des gendarmes de la garde.
La première compagnie avoit droit de commit-
timus , comme les autres commenfaux du roi ,
ainfi qu’on le voit par la déclaration de fa majefté,
donnée à Paris le 26 de novembre 1643 , qui eft
à la chambre des comptes. Mais il ne fut point
mention de ce privilège dans le rétablifl'ement de
cette compagnie en 1637^
Le capitaine lieutenant eft reçu & mis en poflef-
fion de fa charge a la tête de la compagnie par le
roi même , qui ordonné aux officiers 8c moufquetaires
de lui obéir en tout ce qui regarde fort
1er vice.
Les autres officiers font reçus en préfence de fa
majefté lorfqu’il fait la revue. "
Les charges fe vendoient autrefois , celle de capitaine
lieutenant plus de 200,000 livres, 8c les
aurres à proportion ; depuis , le roi Louis XIV les
donfîoit & faifoit monter les maréchaux-des-logis.
11 y a plufieurs années qu’il régla que lorfqu’il y
auroit des cornettes vacantes , elles, feroient remplies
alternativement par un maréchal-des-logis &
par un colonel de cavalerie , comme il fe pratique
dans les gardes-du-corps à l’égard des enfeignes ;
mais jufqu’à la fin de fon règne les cornettes ont
toujours été données aux maréchaux-des-logis des
moufquetaires.
Le capitaine-lieutenant a de paye 300 livres par
mois , lieutenant, & 600 livres comme capitaine ,
qui appartiennent au roi en cette qualité, mais que
fa majefté lui cède.
Il a , outre cela, 6000 livres de penfion.
Les fous-lieutenants , les enfeignes, les cornettes,
& jufqu’au porte - étendard , outré leur
paye , ont pareillement des penfions à proportion
de leur grade.
L’an 1688 , le roi accorda des penfions inégales
aux cinquante-deux des plus anciens mouf- \
quetaires , félon leur ancienneté. Toutes ces penfions
font attachées au corps.
Les moufquet aire s ne fe fervoient autrefois que
de moufquets ; & c’eft delà que leur eft venu le
nom qu’ils portent. Les brigadiers & les fous-brigadiers
dans la fuite prirent des fufils. Depuis plufieurs
années les moufquetaires ont eu auffi des fufils
à l’armée , & ne fe fervoient de moufquets que
dans les revues. Aujourd’hui ils ne s’en fervent
plus du tout ; leurs armes donc , font le fufil, l ’épée
& les piftolets. Le roi fourniffoit autrefois le
moufquet ; mais.les moufquetaires te fewrniffent aujourd’hui
de fufil.
Les drapeaux des moufquetaires font beaucoup
plus petits que ceux de l’infanterie. L’étendard eft
de la grandeur ordinaire des autres étendards , fa
fi »ure eft quarrée.
Le drapeau & l’étendard font à fond blanc; ceux
de la première compagnie ont pour devife une
MOU
bombe en l’air , fortie de fon mortier & tombant
fur une v ille, avec ces mots : quo ruit & lethum ;
pour exprimer qu’en chargeant les ennemis , ils y
portent la mort 8c le ravage, comme fait la bombe
par-tout où elle tombe.
La devife de l’étendard & du drapeau de la fécondé
compagnie eft un faifeeau de douze dards
empennés la pointe en bas , avec ces mots : alterius
jovis altéra tela. Cela veut dire , que le roi ayant
ajouté cette fécondé compagnie à la première , elle
lui tiendra lieu d’un nouveau foudre de guerre,
quand il faudra combattre les ennemis de l’état.
Quand le roi rétablit la première compagnie en
1657 j on y mit un trompette ; il y a beaucoup
d’apparence qu’il y en avoit eu un dès fa première
inftitution. On ôta le trompette vers l’an 1.663 » &
l’on mit. cinq tambours & un fifre.
En 1663 on mit trois hautbois dans les deux
compagnies ; dans la fuite on ôta le fifre, 8c on
ajouta un fixième tambour & un quatrième hautbois.
Les tambours des moufquetaires font beaucoup
plus petits que ceux de l’infanterie, 8c battent
d’une manière toute différente & beaucoup plus
gaie. Les moufquetaires font la feule troupe de cavalerie
delà maifon du roi où il n’y ait ni trompettes
ni timballes.
Les mouf quêtait es , dès l’inftitution de la première
compagnie , eurent la cafaque., comme le
dit M. de Puyfégur dans fes mémoires en parlant
de cette inftitution. C ’étoit l’unique uniforme qui
les diftinguâc ; car alors on rie te mettoit pas encore
fort en peine de l’uniformité des habits dans
les troupes.
Depuis le rétabliffement de la première compagnie
, elle fur encore quelque temps, fans avoir
d’autre habit d’ordonnance que la cafaque, qui
! étoit toujours portée par les moufquetaires dans les
exercices 8c dans les revues. Quand le roi youloit
faire que’lque revue d’éclat, il ordonnoit de quelle
façon il vouîoit qu’on fût habillé. Une fois il ordonna
que la compagnie fût en buffle, & l'es plus
riches des moufquet aire s mirent quantité de dia-
mans fur les .manches. Une autre fois il leur ordonna
de s’habiller de velours noir.
Quand le roi eut inftitué la fécondé compagnie,
qu’il s’en fut fait capitaine en 1663 , & qu’il
l’eut mife fur le même pied que la première , l’uniforme
fut dans chaque compagnie , & elles
avoient chacune le leur particulier. Mais après le
fiège de Maëftrich , l’an 1673 > r° i ordonna que
les deux compagnies auroient le même uniforme ,
excepté que la première portoit le galon d’or, 8c '
la fécondé mettoit de l’argent avec de l’or.
En 1677, les habits furent d’écarlate, 8c ils en
ont toujours été depuis,avec différentes manières
de galon & de broderie. Les poches du juftaucorps
furent en long, & ils les portent encore aujourd’hui
de même.
Les cafaques étoient fort courtes , & tomboient-
feulement fur la croupe du cheval. Le roi, poiir
fon entrée à Paris après fon mariage en 1660 , en
fit faire de magnifiques , qui font encore conler-
vées à Vincennes. Depuis, comme il a fallu aller a
la euerre , on a fait lescafaques de la longueur du
manteau , defeendant au-deffous du genou; elles
ont quatre croix : une derrière la cafaque, une a
chaque côté, 8c une au-devant, féparée en deux ,
la moitié-d’un côté, & la moitié de L autre.
L’an 1688, comme on quittoit les cafaques depuis
quelques années lorfqu on faifoit 1 exercice
devant le roi , parce quelles incommodoient les
moufquetaires,il ordonna les foubreveftes , qui font
comme des juftaucorps fans manches ; elles font
bleues & galonnées comme les cafaqueS ; elles ont
line croix devant & une croix derrière , qui font
de velours blanc, bordées d’un galon d’argent; les
fleurs-de-lys aux angles de la croix font de meme,
le devant 8c le derrière des foubreveftes s’accrochent
au côté par des agraphes.
Une autre raifon encore détermina le roi aux
foubreveftes : c’eft qu’en combattant a pied, ils
n’avoient pas la cafaque , 8c en combattant a cheval
ils.Tavoient r’ejettée derrière les épaules ; cela
faifoit qu’ils n’étoient pas fi aifément reconnus
pour ce qu’ils étoient; 8c comme on avoit remarqué
en diverfes occafions que cette troupe, par fa
feule préfence, jettoit la terreur dans les ennemis,
ainfi qu’il eft arrivé à la bataille de Cartel, on jugea
à propos de leur donner un habillement diftingué
& particulier , qui les fît reconnoître ait premier
coup-d’oeil.
Non-feulement les moufquetaires , mais encore
les fous - brigadiers, les brigadiers & les maréchaux
des-logis portent la foubrevefte ; il n’y a
que les officiers fupérieurs qui ne la portent point.
Les cafaques 8c les foubreveftes des moufquetaires
de la première compagnie , ne font différentes
de celles de la fécondé, qu’en ce que les
flammes qui font dans les angles des croix , font
rouges pour la première, avec trois rayons ; 8c
celles de la fécondé font de feuilles mortes 8c à
cinq rayons. Les chapeaux des moufquetaires de la
première font galonnés d’or, 8c ceux de la fécondé
d'argent. Le roi fournit la cafaque 8c là foubrevefte
; 8c on rend l’une 8c l’autre quand on quitte
la compagnie.
Les hauts officiers ont des juftaucorps d’écarlate
, avec des vertes , des houffes 8c des bourfes
de piftolets brodées.
Les moufquetaires portoient autrefois de groffes
bôttes comme la cavalerie ; mais en 1683 , le roi
voulut qu’ils euffent des bottes aifées, de vache retournée
, avec un éperon attaché derrière , 8c ordonna
que dans les voyages de fa majefté où ils
faifoient la fonétion du régiment des gardes, ils
monteroient la garde bottés ; mais ees fortes de
bottes ayant mauvaife grâce ; ils ont porté depuis
dès bottes demi-fortes pour marcher aifément.
La fécondé compagnie demeura à pied depuis
.1660-jufqu’à 1663 , qu’on la monta pour aller en
Lorraine. Les moufquetaires avoient des chevaux
de divers poil ; il en avoit été de même de la première
compagnie depuis fon inftitution 8c depuis
fon rétabliffement ; 8c à l’entrée du roi 8c de la
reine à Paris , il n’y avoit point d’uniformité, pour
les chevaux, mais quand le roi mit les deux compagnies
fur le même pied en 1665 , les moufquetaires
de la première compagnie , par ordre du
ro i, prirent touts des chevaux blancs ou gris , 8c
la fécondé des chevaux noirs. C ’eft delà qu’eft
venu le nom des moufquetaires gris à ceux de la
première compagnie, 8c celui de moufquetaires noirs
à ceux de la fécondé compagnie.
Les moufquetaires ont été fupprimés par une ordonnance
du 13 décembre 1773.
MOUSQUETERIE. Troupes armées de moufquets
ou de fufils.
Si l’art de tirer , tant accrédité aujourd’hui chez
toutes les nations , peut donner quelquefois de l’avantage
dans un combat, il n’eft pas moins vrai
que le plus fouvent il n’y a rien de plus incertain ,
de plus nuifible, de plus dangereux, ni de plus
ridicule. En vain les plus grands généraux nous
ont-ils appris à méprifer la moufqueterie , 8c les
moyens de vaincre nos ennemis fans en avoir be-
fbin ; en vain plufieurs auteurs refpeâabies par
leurs talents 8c Leur expérience, fe font-ils élevés
contre cette fureur que nous avons pour le feu ,
nous n’en fommes- que plus opiniâtres à foutenir
ce fyftême. Non contents d’être parvenus à faire
tirer le foldat avec toute la vivacité poffible , nous
avons vu, il y a peu d’années, avec un enthou-
fiafme fans éga l, un fufil dont le fecret important
confiftoit à pouvoir tirer neuf coups par minute;
un fufil avec lequel nous devions , difoit-on , à la
première guerre , battre nos ennemis par - tout.
Mais cette arme , ou quelque autre fembiable dont
le maréchal de Saxe avoit déjà parlé, bien loin
d’être auffi merveilleufe qu’on le prétend, eft, à
coup fûr 8c à touts égards , une très mauvaife découverte
, uniquement bonne à augmenter le bruit
Sc lafuriiée, 8c qu’on fera bien de laiffer dans le
filence 8c dans j’oubli. Nous avons , dans le temps,
combattu ce fufil par un mémoire qui ne fera pas
• de trop dans ce fupplément. ( Voycç L article F u s i l
a DÉ a SECRET ) ; mais afin de ne laiffer rien à dire
conirele fufil à dé à fecret, nous ajouterons'ici
que cherchera perfectionner la moufqueterie , c eft
travailler pour nos ennemis , qui finement en fau-
ront toujours faire un meilleur ufage que nous,
bien plus que pour notre nation , dont le fort a
été de tout temps.la charge , du moins jufqu’au
commencement de ce fiècle , qu’on a négligé cette
excellente méthode pour s’adonner aveuglément
& obftinément à l’art de tirer des coups de fufil.
Le feu eft le plus fouvent très incertain , 8c rien
n’eft plus vrai. Dans quelque pofition qu’on veuille
fuppofer une troupe d’infanterie , foit enrafe cam-
| pagne , foit en pays de montagnes , il eft incontei-
table que le yent, la pouffière ou le foleij, les cris,
N n ij