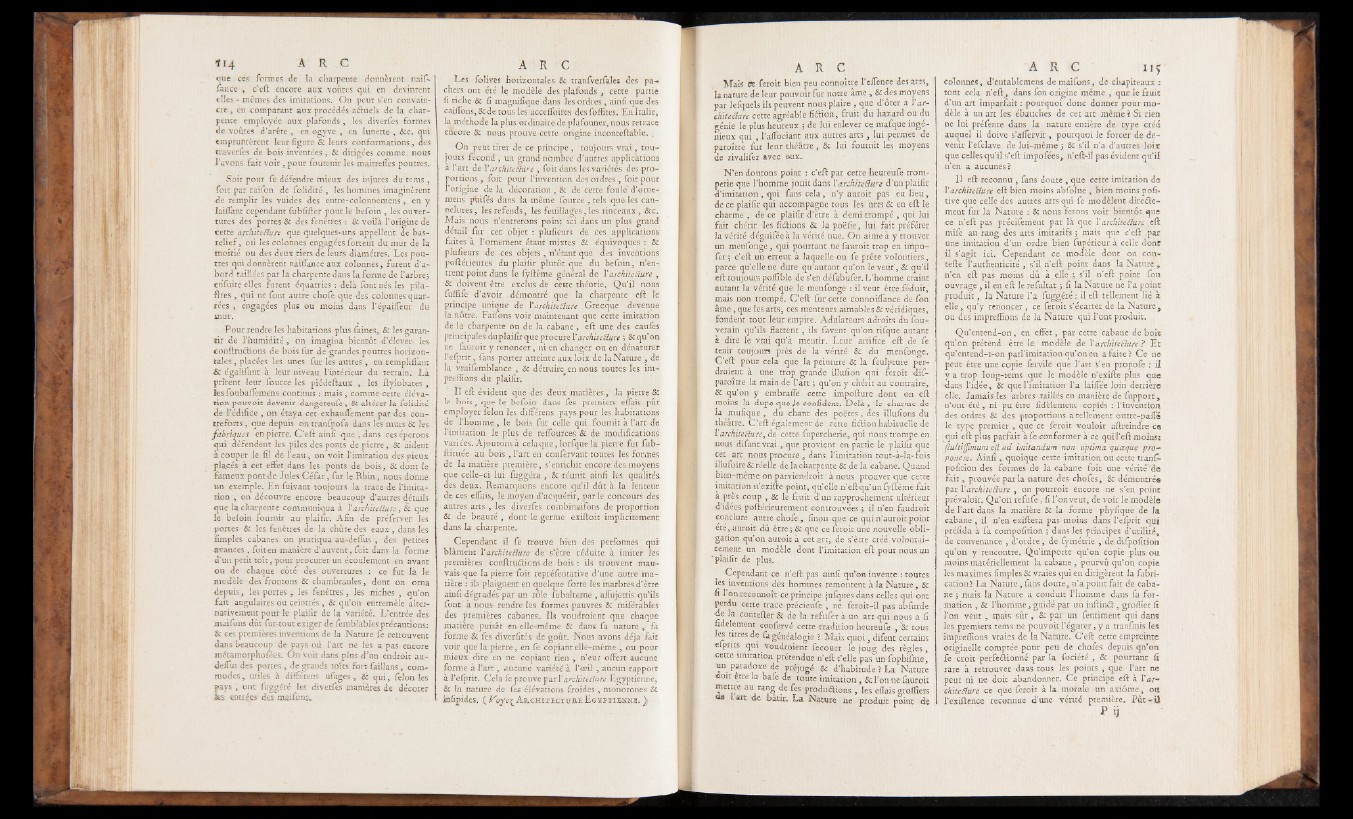
que ces formes de la charpente donnèrent naif-
fance , c’eft encore aux voûtes qui en devinrent
elles - mêmes des imitations. On peut s’en convainc
r e , en comparant aux procédés adtiiels de la charpente
employée aux plafonds, les diverfes formes
de voûtes d’a rê te , en ogyve , en lunette-,'&c. qui
empruûtèrent leur figure 8c leurs conformations, des
traverfes de bois inventées, & dirigées comme, nous
l ’avons fait v o ir , pour foutenir les maitreffes poutres.
Soit pour (e défendre mieux des injures du tems ,
foit par raifon de folid ité , les hommes imaginèrent
de remplir les vuides des entre-colonnemens, en y
laiflànt cependant fubfifter pour le befoin , les ouvertures
des portes & des fenêtres : & voilà l’origine de
cette architeélure que quelques-uns appellent de bas-
re lie f, où les colonnes engagées fortent du mur de la
moitié ou des deux tiers de leurs diamètres. Les poutres
qui donnèrent naiffance aux colonnes, furent d’abord
taillées par la charpente dans la forme de l’arbrej
enfuité elles furent équarries : delà font nés les pila-
flres , qui ne font autre chofe que des colonnes quar-
rées , engagées plus ou moins dans l ’ épaiffeur du
mur.
Pour rendre les habitations plus (aines, & les garantir
de l’humidité on imagina bientôt d’élever les
eonftructions de bois fur de grandes poutres horizontales
, placées les unes fur les autres, en remplilfant
St égalifant à leur niveau l ’intérieur du terrain. L à
prirent leur fource les piédeftaux , les ftylobates ,
les (bubaffemens continus : mais, comme cette élévation
pouvoit devenir dangereufe, 8c altérer la folidité
de Tédifice , on étaya cet exhauflement pat des, contreforts,
que depuis on tranfpofa dans les murs & les
fabriques en pierre. C ’eft ainfi que , dans ces éperons
qui défendent les piles des ponts de pierre, & aident
à couper le fil de l’eau , on voit l’imitation des pieux
placés, à cet effet dans les ponts de bo is , & dont le
fameux pont de Jules C é fa r , fur le Rhin, nous donne
an exemple. En fuivant toujours la trace de Limitation
, on découvre encore beaucoup d’autres détails
que la charpente communiqua à 1'architeélure, & que
le befoin fournit au plaifîr. Afin de préferver les
portes & les fenêtres de la chûte des e a u x , dans les
fim-ples cabanes, on pratiqua au-deffus , des petites
avances , foit en manière d’auvent, fort dans la forme
d’ün petit to ît , pour procurer un écoulement en avant
ou de chaque côté des ouvertures : ce fut là le
modèle des frontons & chambranles, dont on orna
depuis, les portes , les fenêtres, les niches , qu’on
fait angulaires ou ceintrés, & qu’on entremêle alternativement
pour le plaifir de la variétés L ’entrée des
maifons dût fur-tout exiger de femblables précautions:
& ces premières inventions de la Nature Ce retrouvent
dans beaucoup de pays où l’art ne les a pas encore
mé'tamorphofées. On voit dans plus d’un endroit au-
deffus des portes , de grands toits fort fàillans, commodes,
utiles à différens u fages, 8c qui , félon les
pays , ont fuggéré les diverfes manières, de décorer
Jks; entrées des maifons».
Les folives horizontales & tranfverfales des p a -
chers ont été le modèle des plafonds , cette partie
fi riche & fi magnifique dans les ordres, ainfi que des
caillons, & de tous les acceffoires des foffites. En Italie,
la méthode la plus ordinaire de plafonner, nous retrace
encore & nous prouve cette origine inconteftable. .
On peut tirer de ce principe, toujours v r a i, toujours
fécond , un grand nombre d’autres applications
a l’art de l'architecture , foit dans les variétés des proportions
, foit pour l’invention des ordres , foit pour
l’origine de la décoration, & de cette foulé' d’orne-
mens püifés dans la même fource , tels que-les cannelures
, les refends, les feuillages, les rinceaux, &c.
Mais nous n’entrerons point ici dans un plus grand
détail fur cet objet : plufîeurs de ces applications
faites à l’ornement étant mixtes & équivoques : &
plufîeurs de ces objets , n’ étant que des inventions
poftérieures du plaifir plutôt que du befoin, n’entrent
point dans le fyftême général de X architeélure ,
& doivent être exclus de cette théorie. Qu ’il nous
fuffife d’avoir -démontré que la charpente eft le
principe unique de l’architecture Grecque devenue
la notre. Faifons voir maintenant que cette imitation
de la charpente ou de la cabane, eft une des caufes
principales du plaifir que procure l’architeélure j & qu’on
ne fauroit y renoncer, ni en changer ou en dénaturer
l’efprit, fans porter atteinte au xloix de la Nature , de
la vraifemblance , & détruire en nous toutes les im-
preffions du plaifir.
Il eft évident que des deux m a t iè re s ,'la pierre &
le b o is , que le befoin dans fes .premiers effais pût
employer félon les différens pays pour les habitations
de l’homme , le bois fut celle qui fournit à l’art de
l’imitation le plus de reffources & de modifications
variées. Ajoutons à cela que, lorfque la pierre fut fub -
ftituée au b o is , l’art en conférvant toutes les formes
de la matière première, s’enrichit encore'des moyens
que celle-ci lui fuggéra , & réunit ainfi les qualités,
des deux. Remarquons encore- qu’il dût à la lenteur
de ces effais, le moyen d’acquérir, parle concours des
autres arts , les diverfes combinaifons de proportion
& de beauté , dont le germe exiftoit implicitement
dans la charpente.^
Cependant il fe trouve bien des perfonnes qui
blâment l'architeélure de s’être réduite à imiter les
premières conftruCtions de bois : ils trouvent mauvais
que la pierre foit repréfentative d’une autre matière
: ils plaignent en quelque forte les marbres d’être
ainfi dégradés par un rôle fubalterne , affujettis qu’ils
font à nous- rendre les formes pauvres & miférables
des premières cabanes.. Ils voudroient que chaque
matière puisât en elle-même & dans fà nature , fa
forme & fes diverfités de goût. Nous avons déjà fait,
voir que la pierre * en fe copiant elle-même , ou pour
mieux dire en ne copiant r ie n , n’eut offert aucune
forme à l’a r t , aucune variété à l’oeil , aucun rapport
a l’efprit. Ce la fe prouve par l’architeélure Egyptienne,
& la nature de fes élévations froides, monotones 8t
infipides. ( Voyeq A e.chixe.ct u&e. E g ¥Pt i£n n j . )j
Mais ce feroit bien peu connoître l’effence des arts,
la nature de leur pouvoir fur notre âme , 8c des moyens
par lefquels ils peuvent nous plaire , que d oter à 1 ar-
chitellure cette agréable fiction, fruit du hazard ou du
génie le plus heureux 5 de lui enlever ce mafque ingénieux
qui , l’affociant aux autres arts , lui permet de
paraître fur leur théâtre, & lui fournit les moyens
de rivalifer avec e*ux.
N ’en doutons point : c’eft par cette heureufe tromperie
que l’homme jouit dans 1 'architeélure d’un plaifir
d ’imitation, qui fans ce la , n’y auroit pas eu lieu ,
de ce plaifir qui accompagne tous les arts 8c en eft le
charme , de ce plaifir d’être à demi trompé , qui lui
fait chérir les fi étions & la poëfie, lui fait préférer
la vérité déguifée à la vérité nue. On aime à y trouver
un menfonge, qui pourtant ne fauroit trop en impo-
fer ; c’eft un erreur à laquelle on fe prête volontiers,
parce qu’elle ne dure qu’autant qu’on le v eu t, & qu’il
eft toujours poffible de s’en dëfabufer. L ’homme craint
autant la vérité que le menfonge : il veut être féduit,’
mais non trompé. C ’eft fur cette connoiffance de fon
âme, que ies arts, ces menteurs aimables & véridiques,
fondent tout leur empire. Adulateurs adroits du fou-
verain qu’ils flattent, ils favent qu’on rifque autant
à dire le vrai qu’à mentir. Leur artifice eft de fe
tenir toujours près de la vérité & du menfonge.
C ’eft pour cela que la peinture & la fculpture per-
droient à une trop grande illufîon qui feroit dif-
pàroître la main de l’art ; qu’on y chérit au contraire,
8c qu’on y embraffé cette impofture dont on èft
moins la dupe que je confident. D e là , le charme de
la mufique , du chant des poètes, des illufîons du
théâtre. C ’eft également de cette fiction habituelle de
l’architeélure, de cette fupercherie, qui nous trompe eh
nous d ifan tv ra i, que provient en partie le plaifir que
cet art nous procure , dans l’imitation tont-à-la-fois
illufoire & réelle de la charpente & de la cabane. Quand
bien-même 011 parviendrait' à nous prouver que cette
imitation n’exifte point, qu’elle n’eftqu’ un fyftême fait
a près coup , & le fruit d’un rapprochement ultérieur
d’idées poftérieurement controuvées j il n’en faudrait
conclure autre chofe , finon que ce qui n’aurait point
été, auroit dû être5 & que ce ferait une nouvelle obligation
qu’on auroit à cet art, de s’être créé volontairement
un modèle dont l’imitation eft pour nous un
' plaifîr de plus.
Cependant ce n’eft pas ainfi qu’on invente : toutes
les inventions des hommes remontent à la Nature, &
fi l’onreconnoît ce principe jufques dans celles qui ont
perdu cette trace précieufe , ne feroit-il pas abfurde
de la contefter & de la refufer à un art qui nous a fi
ndelement confervé cette tradition heureufe , & tous
les titres de fa généalogie ? Mais q u o i, difent certains
elprits qui voudroient fecouer le jou g des règles,
cette imitation prétendue n’eft t’elle pas un fophifme,
mn paradoxe de préjugé & d’habitude ? L a Nature
doit etre la bafe de toute imitation , 8c Tonne fauroit
mettre au ran* de fes produirions , les eflais groffiers
® 1 art de bâtir. L a Nature ne produit point de
colonnes, d’entablemens de maifons, de chapiteaux :
tout cela n’eft^ dans fon origine même , que le fruit
d’un art imparfait : pourquoi donc donner pour modèle
à un art les ébauches de cet art même ? S i rien
ne lui préfente dans la nature entière de type créé
auquel il doive s’affervir, pourquoi le forcer de devenir
l’efclave de lui-même 5 & s’il n’a d’autres lo ir
que celles qu’il s’eft impofées, n’eft-il pas évident qu’il
n’en a aucunes?
Il eft reconnu , fans doute , que cette imitation de
l’architeélure eft bien moins abfolue , bien moins pofî-
tive que celle des autres arts qui fe modèlent directement
fur la Nature : 8c nous ferons voir bientôt que
ce n’eft pas précifement par là que l'architeélure eft
mife au rang des arts imitatifs ; mais que c’eft par
une imitation d’un ordre bien fupérieur à celle dont
il s’agit ici. Cependant ce modèle dont on cori-
tefte l’authenticité , s’il n’eft point dans la Nature ,
n’en eft pas moins dû à elle 5 s’il n’eft point fon
ouvrage , il en eft le refultat 5 fi la N ature ne Ta point
produ it, la Nature Ta fuggéré : il eft tellement lié à
elle , qu’y renoncer , ce ferait s’écarter de la Nature,
ou des impreflîons de la Nature qui l’ont produit.
Q u ’entend-on, en e ffe t, par cette cabane de bois
qu’on prétend être le modèle de l'architeélure ? E t
qu’entend-t-on parl’imitation qu’on en a faite? C e ne
peut être une copie fervilë que l’art Ven propofe : il
y a trop long-tems que le modèle n’exifte plus que
•dans Tidée, 8c que Timitation l’a laiffée loin derrière
elle. Jamais les arbres taillés en manière de fupport,
n’ont é t é , ni pu être fidèlement copiés : l’invention
des ordres & des proportions a tellement outre-paffé
le type premier , cpie ce ferait vouloir aftreindre ce
qui eft plus parfait à fe conformer à ce qui l'eft moins:
jîultijjimwn ejl ad iiiiïtanclutn non o'ptima quoique propane
re. Ainfi , quoique cette imitation ou cette tranf*
pofition des formes de la cabane foit une vérité de
f a i t , prouvée par la nature des chofes, & démontré«
par l'architeélure , on pourrait encore ne s’en point
prévaloir. Qu ’on refufe, fi Ton veut, de voir le m odèle
de l’art dans la matière 8c la forme phyfîqué de la
cabane , il n’en exiftera pas moins dans l’efprit qui
préfida à fa compofition 5 dans les principes d’utilité,
de Convenance , d’ordre, de fymétrie , de difpofîtion
qu’on y rencontre. Qu’importe qu’on copie plus ou
moins matériellement la cabane , pourvû qu’on copie
les maximes fimples & vraies qui en dirigèrent la fabrication?
L a Nature, fans doute, n’a point fait de cabane
5 mais la Nature a conduit l’homme dans fa formation
, & l’homme, guidé par un inftinCt, groffier (î
Ton veut , ipais sû r , & par un fentiment qui dans
les premiers tems ne pouvoit f égarer, y a tranfmis les
impreflîons vraies de la N ature. C’eft cette empreinte
originelle comptée pour peu de chofes depuis qn’on
fe croit perfectionné par la fociété , & pourtant fi
rare à retrouver dans tous les points , que l’art ne
peut ni ne doit abandonner. C e principe eft à l’ architeélure
ce que feroit à la morale un axiome, ou
l’exiftence reconnue d’une vérité première. P û t -U
p ij