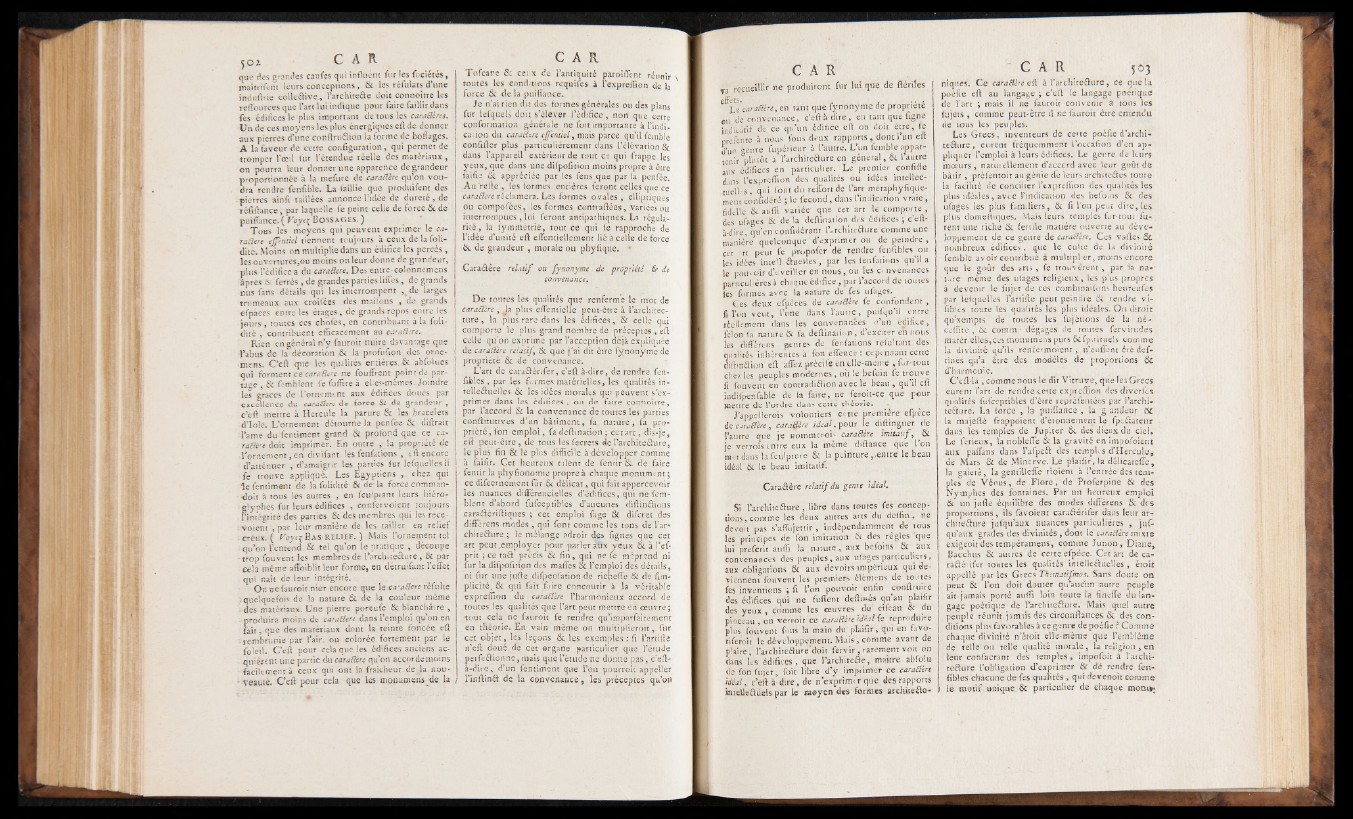
que des grandes caufes qui influent fur les foc iétés,
maitrifent leurs conceptions, & les rèfulats d’une
induftrie coïleétive., l’archite&e doit connoître les
reflources que l’art lui indique pour faire faillir dans
fes édifices le plus important de tous les carattères.
U n de ces moyens les plus énergiques eft de donner
aux pierres d’une conftru&ion la forme de boffages.
A la faveur de cette configuration, qui permet de
tromper l’oeil fur l’étendue réelle des matériaux,
on pourra leur donner une apparence de grandeur
proportionnée à la mefure de carattere qu’on voudra
rendre fenfible. La faillie que produifent des
pierres ainfi taillées annonce l’idée de dureté , de
réfiftance, par laquelle fe peint celle de force & de
puiflance. ( Voye{ B o s s a g e s . )
Tou s les moyens qui peuvent exprimer le caractère
eJTentUl tiennent toujours à ceux de la fétidité.
Moins on multiplie dans un édifice les percés ,
les ouvertures,ou moins on leur donne de grandeur,
plus l’édifice a du carattere. Des entre-colonnemens
âpres & ferrés, de grandes parties liffe s, de grands
nus fans détails qui les interrompent de larges
trumeaux aux croifées des maiions , de grands
efpâces entre les étages, de grands repos entre les
jo u r s , toutes ces chofes, en contribuant à la Yoli-
dité , contribuent efficacement au car attire.
Rien en général n’y fauroit nuire davantage que
l’abus de la décoration & la profufion des orne-
•xnens. C ’eft que les qualités entières. & abfolues
qui forment ce carattere ne fouffrent point'de partage
, & femblent fe fuffire à elles-mêmes. Joindre
les grâces de l ’ornenunt aux édifices doués par
excellence du carattere de force & de grandeur ,
c ’eft mettre à Hercule la parure & les bracelets
d’Iolê. L ’ornement détourne la penfée- & diftrait
l’ame du fentiment grand & profond que ce ca~
rattère doit imprimer. En outre , la propriété de
-l’ornement, en divifant les fenfations , eft encore
d’atténuer , d’amaigrir les parties fur lefquellesil
fe trouve appliqué. Les Egyptiens , chez- qui
l e fentiment de la folidité & de- la force commandent
à tous les autres , en fculptant leurs hiéroglyphes
fur leurs édifices , confervoient toujours
l ’intégrité des parties & des membres qui les rece-
. v o ien t -, par leur manière de les tailler en relief
creux. ( B a s r e l i e f . ) Mais l’ornement tel
qu’on l’entend & tel qu’on le pratique , découpe
- trop fouvént les membres de l’archi reclure , & par
cela même affoiblit leur forme, en détruifant l’effet
qui naît de leur intégrité. ...
On ne fauroit nier encore que le ca-attere réfulle
r quelquefois de la nature & de la couleur même
des matériaux. Une pierre poreufe & blanchâtre ,
produira moins de carattere dans l’emploi qu’on en
fa it , que des matériaux dont la teinte foncée eft
-rembrunie par l’air, ou colorée fortement par le
foleil. C ’eft pour cela que les édifices anciens acquièrent
une partie du carattere qu’on accordemoins
facilement à ceux: qui ont la fraîcheur de la. nou-
• veauté. C ’eft pour cela que les moimmens de la (
Tofcane 8c ceux de l’antiquité paroi fient réunir \
toutes les conditions requifes à l’expreffion de la
force & de la puiflance.
Je n’ai rien dit des formes générales ou des plans
fur lefqüels doit s’élever l’édifice , non que cette
conformation générale ne foit importante à l’indication
du car attire efjentiel, mais parce qu’il femble
confifter plus particuliérement dans l’élévation &
dans l’appareil extérieur de tout ce qui frappe les
y eu x , que dans une difpofition moins propre à être
faille & appréciée par les fens que par la penfée.
A u relie ', les formes entières feront celles que ce
carattere réclamera. Les formes ovales , elliptiques
ou compofées, les formes contraftées, variées ou
interrompues , lui feront antipathiques. La régular
ité , la lymmétrie, tout ce qui le rapproche de
l’idée d’unité eft effentiellement lié à celle de force
&. de grandeur , morale ou phylique, ♦
Caraélère relatif ou fynonyme de propriété & de
convenance.
D e toutes les qualités que renferme le mot de
carattere , la plus eflèntielle peut-être à l ’architecture
, la plus rare dans les édifices, & celle qui
comporte le plus grand nombre de préceptes , eft
celle qu’on exprime par l’acception déjà expliquée
de carattere relatif & que j ’ai dit être fynonyme de
propriété & de convenance.
L ’art de caraéiérifer, c’eft à-dire, de rendre fen-
fibles , par les formes matérielles, les qualités iri-
telleéluelles & les idées morales qui peuvent s’exprimer
dans les édifices,, ou de faire connoître,
par l’accord & la convenance de toutes les parties
conftitutives d’un bâtiment, fa nature, fa propriété,
Ion emp loi, fa deftinatiori ; cet a r t , dis-je,
eft peut-être , de tous les fecrets de l’architeéhire,
le plus fin & le plus difficile à développer comme
■ ' à faifir. C e t heureux talent de fentir &. de faire
fentir la phyfionomie propre à chaque monument.;
ce difeernement fur & dé lica t, qui fait appcrcevoir
les nuances différencielles d’édifices, qui ne fem-
blent d’abord fufceptibl.es d’aucunes diftinâions
caraâériftiques ; cet emploi fage & diferet des
diffêrens modes , qui font comme les tons de l’ar-
chiteâure ; le mélange adroir des lignes que cet
art peut ^employer pour parler aux y e u x & à l’ef-
prit ; ce taéf précis & f in , qui ne fe méprend ni
fur la jdifpofitipn des mafles & l’emploi des détails,
ni fur une jufte clifpenfation de richeffe & de fim-
plicité. & qui fait faire concourir à la véritable
expreflion du carattere l’ harmonieux accord de
toutes les qualités que l’art peut mettre en oeuvre;
tout cela ne fauroit fe rendre qu’imparfaitement
en théorie. En vain même on multipiieroir, fur
cet o b je t , les leçons & les exemples ; fi l’artifte
n’eft doué de cet organe particulier que l’étude
perfectionne, mais que l’étude ne donne pa s, c’eft-
à-dire, d’un fentiment que l’on pourroit appeller
l’inftinét de la convenance, les préceptes, qu’on
ya recueillir ne produiront fur lui que de Hérites
effets. .,
Le caractère, en tant que fynonyme de propriété
<m de convenance, c’eft-à dire, en tant que figne
indicatif de ce qu'un édifice eft on doit ê t r e , fe
préfente à nous fous deux rapports, dont l’un eft
d’un »ente fupèrieur à l’autre. L’un femble appartenir'plutôt
à l’architeélure en général, Se l’autre
aux édifices en ' particulier. Le premier confifte
dans l’expreffion des qualités où idées intellectuelles,
qui font du reffortde l’art métapbyfiqüe-
mem confidéré ; le fécond, dans l’indication vraie ,
fïdetle Scaufli variée que cet art le comporte ,
des ufages St de la deftination des édifices ; c’eft-
à-dire, qu’en confidêrant l’architeSure eomme une-
manière quelconque d’exprimer ou de peindre ,
cet ri peut fe propofer de rendre fenfiblés ou
les idées intell'-âueHes, par les ienfarions qu’il a
le- pouvoir. d’éveiller en nous., ou les convenances
particulières à chaque édifice, par l’accord de toutes
fes forme-, avec la nature de fes ufages.
Ces deux efpèces de caraèlère fe. confondent,
fi l’on v eu t, Pline dans l'autte, puifqu’il entré
réellement dans les convenances «’un édifice,
félon fa nature St fa deftinaiien, d’ exciter eh nous
les diffêrens genres de fenfations refuliant des
qualités inhérentes à fon effencé : cependant cette
diftinflion eft affez précife en elle-meme , fur-tout
chez les peuples modernes , oit le befoin fe trouve
fi fouvent en contradiélion avec le beau , qu’il eft
indifpenfable de la faire, ne feroii-ce que pour
mettre de l’ordre dans cette théorie.
J’appellerois volontiers cette première efpèce
de caraèlère, caragère id éa l, pour le distinguer de
l’autre que je uommeroh caraèlère im itatif, &
je verrois entre eux la même diftance que l’on
met dans là fculpture & la peinture,.entre le beau
idéal St le beau imitatif.
Caraèlère relatif du genre idéal.
Si l’architeflure, libre dans toutes fes conceptions,
comme les deux autres arts du deflitu, ne
devoir pas s’affujettir , indépendamment de tous
les principes de fon imitation St des réglés que
lui preferit anffi la nature, aux befoins 6t aux
convenances des peuples, aux ufages particuliers,
aux obligations & aux devoirs impérieux qui d eviennent
fouvenr les premiers élêmens de tontes
fes inventions ; ft l’on pouvoir enfin conftruire
des édifices qui ne fuffent deftioés qu au plaiftr
des yeux , comme les oeuvres du cifeau & du
pinceau , on verroit ce caraèlère idéal fe reproduire
plus fouvent fous la main du plaiftr, qui en favo-
riferoit le développement. M ais , comme avant de
plaire, l’atchiteéfute doit fe r v ir , rarement voit-on
dans les édifices, que l’architeâe, maître abfolu
de fo n fu je t , foit libre d’y imprimer ce caractère
idéal, c’eft-à-dire, de n’exprimtr que des rapports
imeUeâiiels par le moyen des formes architeétoniques.
C e carattere eft à l’archueéhire, ce que la
poéfie eft au langage ; c ’eft le langage poétique
de l’art ; mais il ne fauroit convenir à tous .les
fujets , comme peut-être il ne fauroit être entendu
de tous les peuples.
Les G re c s , inventeurs de cette poéfie d’archi-
teéhire, eurent fréquemment l’occafion d’en appliquer
l’emploi à leurs édifices. Le genre de leurs
moeurs , naturellement d’accerd avec leur goût de
bâtir , préfentoit au génie de leurs archireéle.s toute
la facilité de concilier l’exprefiion des qualités les
plus idéales, avec l’indication des, befoins & des
ufages les plus familiers, & fi l’on peut dire, les
plus domeftiques. Mais leurs temples fur-tout furent
une riche & fertile matière ouverte au développement
de ee genre de carattere. Ces vaftes &
nombreux éd ifice s, que le culte de la divinité
femble avoir contribué à multiplier, moins encore
que le. goût des a r ts , fe trou vèrent, p a r ia na-.'
t.ire même des ufages religieux, les. plus propres
à devenir -le fujet de ces combinaifons heureufes
par lefquelles l’artifte peut peindre & rendre vi-
fibl-es toute les qualités lés plus idéales. On diroit
qu’xeinpts de toutes les fujetions de la né-
ceflitê , & comm ■ dégagés de toutes fervirudes
matérielles,ces monumens purs 6cfpiriruels comme
la divinité qu’ ils renfermoient, n’euffent été def-
tinés qu’à être des modèles de proportions &
d’harmonie,
C ?eft-là »comme nous le dit V itru v e, que les Grecs
eurent l’art de rendre cette expreflion des diverses
qualités fufceptibles d’ êtcfe repréfentées par l’architeélure.
La force , la puiflance , la g andeur 6c
la majeftè frappoîent d’étonnement le fpcélateur
dans les temples de Jupiter &. des dieux du ciel.
Le férieux, la nobleffe &. la gravité en impofoient
aux paffans dans l’ afpeél des temples d’He rcu le ,
de Mars & de Minerve. Le plaifir. la déheatefîe,
la gaieté, la gentil!effe rioient à l’entrée des temples
de Vénus., de F lo re , de Proferpine & des
Nymphes des fontaines. Par un heureux emploi
& un jufte équilibre des modes diffêrens & des
proportions, ils favoient caraétérifer dans leur àr-
chiteéhire jufqu’aux nuances particulières , juf-
qu’aux grades des divinités , dont le carattere mixte
exîgeoit des tempêramens, comme Junon , Diane.,
Bacchus & autres de cette efpèce. Cet art .de ca-
raâé; ifer toutes les qualités intelleéhieJles , étoit
appelle par les Grecs Thematifmos. Sans doute on
peut & l’on doit douter qu’aucun autre peuple
ait jamais porté aufli loin toute la fin effe du langage
poétique de l’architeéïure. Mais quel autre
peuple réunît, jamais des circonftances & des conditions
plus favorables à ce genre de poéfie ? Comme
chaque divinité n’étoit elle-même que l’emblème
de telle ou telle qualité morale, la religion a eh
leur confacrant des temples, impofbît à î’archi-
teélure l’obligation d’exprimer & dé rendre fen-
fibles chacune de fes qualités, qui devenoit comme
le motif unique, & particulier de chaque mona»