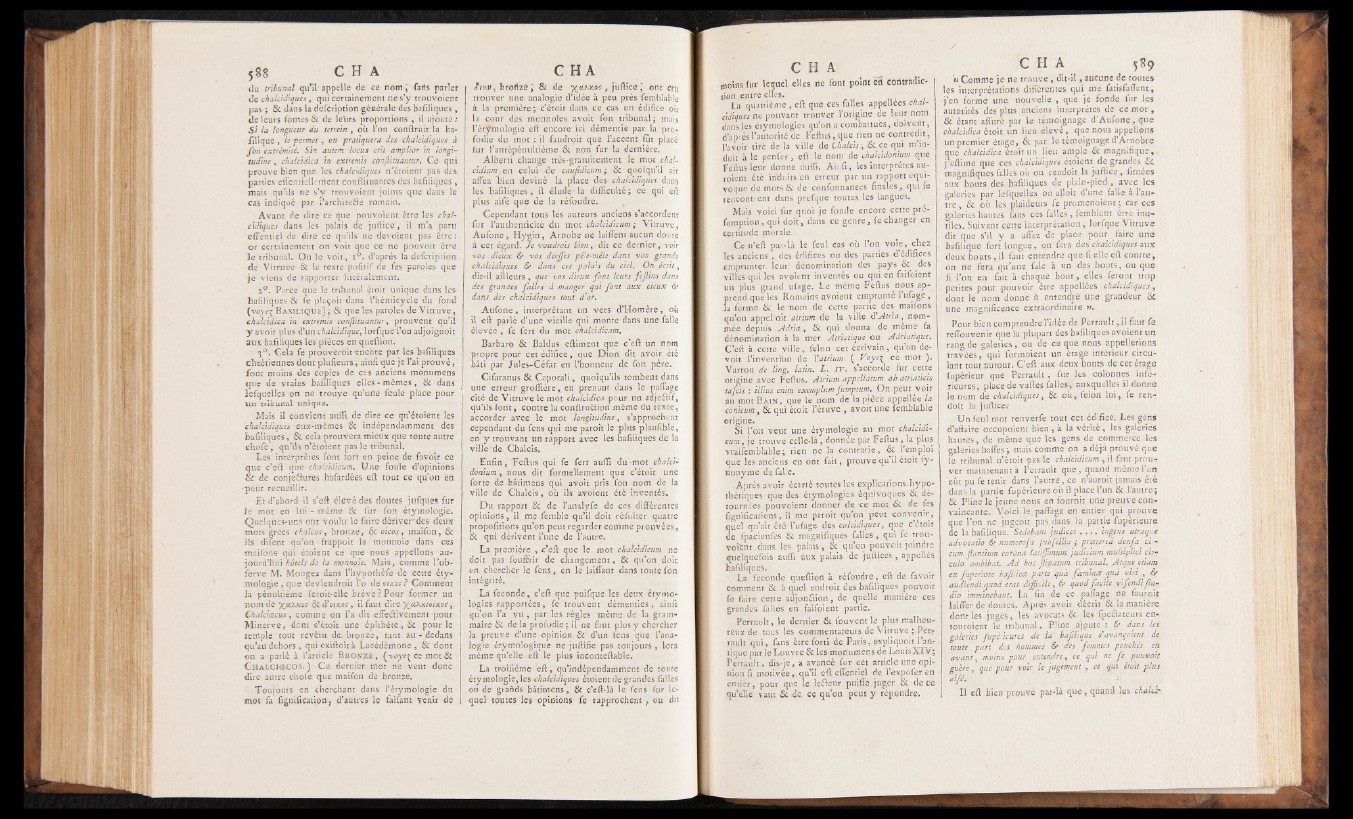
588 C H A
du tribunal qu’il' appelle de ce nom ÿ faris'parler
de chalcidiques, qui certainement ne s’y trouvoient
pas ; & dans la description générale des bafiliques ,
de leurs fomes & de leurs proportions , il ajouté :
S i la longueur du terrein , où l’on conftruit la bafilique,
le permet, on pratiquera des chalcidiques à
fon extrémité. Sin autem locus erit amplior in iongi-
tudine , chalcidica in extremis conjlituantur. Ce qui
prouve bien que les chalcidiques n’étoient pas des
parties elTentiellement conftituantes des bafiliques ,
mais qu’ils ne s’y trouvoient joints que dans le
cas indiqué par l’architeéte romain.
Avant de dire ce que pouvoient être les chalcidiques
dans les palais de juftice , il m’a paru
eflentiel de dire ce qu’ils ne dévoient pas être :
or certainement on voit que ce ne pouvoit être,
le tribunal. On le voit, i° . d’après la description
de Vitruve & le texte pofitif de Ses paroles que
je viens de rapporter littéralement.
a°. Parce que le tribunal étoit unique dans les
bafiliques & Se plaçoit dans l’hémicycle du fond
\voyei Basilique) ; & que les paroles de Vitruve,
chalcidica in extremis conjlituantur, prouvent qu’il
y avoir plus d’un chalcidique, lorfque l’on adjoignoit
aux bafiliques les pièces en queftion.
■ 3°. Cela fè prouveroit encore par les bafiliques
chrétiennes dont plufieurs r ainfi que je l’ai prouvé,
font moins des copies de ces anciens monumens
que de vraies bafiliques elles - mêmes, & dans ,
lesquelles on ne trouye qu’une feule place pour
un tribunal unique.
Mais il convient aqfti de dire ce qti’étoient les
chalcidiques eux-mêmes & indépendamment des
bafiliques, & cela prouvera mieux que toute autre
chofe, qu’ils n’étoient pas le tribunal.
Les interprètes font fort en peine de Savoir ce
que c’efl que chalcidicum. Une foule d’opinions
& de conjeâures hàfardées eft tout ce qu’on en
•peut recueillir.
Et d’abord il s’eft élevé des doutes jufques fur
le mot en lui - même & fur fon étymologie.
Quelques-uns ont voulu le faire dériver'des deux
mots grecs chalcos, bronze, & oicos, maifon, &
ils difent qu’on frappoit la monnoie dans ces
maifons qui étoient ce que nous appelions aujourd’hui
hôtels de la monnoie. Mais, comme l’ob-
ferve M. Mongez dans l’hypothèfe de cette étymologie
5 que deviendroit l’o de otitoç? Comment
la pénultjème feroit-elle brève ? Pour former un
nom de yjthKoç &d’o/xo?, il faut dire y^ecK/UoiKos,
Chalcicecus, comme on l’a dit effeélivement pour
Minerve, dont c’étoit une épith è te, & pour le
temple tout revêtu de. bronze, tant au - dedans
qu’au dehors, qui exiftoit à Lacédémone, & dont
on a parlé à l’article Br o n ze , {jvoye^ ce mot &
C h a l c ioe c o s . ) Ce dernier mot ne veut donc
dire autre chofe que maifon de bronze.
Toujours en cherchant dans l’étymologie dû
mot fa Signification j d’autres le faifant venir de
c H A
brofizè ; & de x aKkoç , jufticëj ont cru
trouver une analogie d’idée à peu près Semblable
à la première; c’étoit dans ce cas un édifice où
la cour des monnoie s avoit fon tribunal ; mais
l’étÿmologie eft encore ici démentie par la pro-
fodie du mot : il faudroit que l’accent fût placé
lur l’antépénultième & non fur la dernière.
Alberti change très-gratuitement le mot chai-
cidium.en celui de eaujidicum ; & quoiqu’il ait
a fiez bien deviné la place des chalcidiques dans
les bafiliques, il élude-là difficulté; ce qui eft
plus aifé que de la réfoudre.
Cependant tous les auteurs anciens s’accordent
fur l’authenticité du mot chalcidicum; Vitruve,
Aufone, Hygin, Arnobe ne biffent aucun doute
à cet égard. Je voudrois bien, dit ce dernier, voir
vos dieux & vos déejjes pêle-mêle dans vos grands
chalcidiques <S* dans ces palais du ciel. On écrit,
dit-il ailleurs, que vos dieux font leurs fejlins dans
des grandes folles' à manger qui font aux deux &
dans des chalcidiques tout d’or.
Aufoné, interprétant un vers d’Homère, où
il eft parlé d’une vieille qui monte dans une falle
élevée , fe fert du mot chalcidicum.
Barbaro & Baldus eftiment que c’eft un nom
propre pour cet édifice, que Dion dit avoir été
bâti par Jules-Céfar en l’honneur de fon père.
Cifaranus & Caporali., quoiqu’ils tombent dans
une erreur groflîère, en prenant dans le paflage
cité de Vitruve le mot chalcidica pour un adjeéïif,
qu’ils font, contre la conftruéüon même du texte,
accorder avec le mot longitudine, s’approchent
cependant du fens qui me paroît le plus plaufible,
en y trouvant un rapport avec les bafiliques de la
viilende^ Chalcis.
Enfin, Feftus qui fe fert aufli du -mot chalcU
donium, nous dit formellement que c’étoit une
forte de bâtimens qui avoit pris fon nom de la
ville de Chalcis, où ils avoient été inventés.
Du rapport & de l’analyfe de ces différentes
opinions, il me femble qu’il doit ré fui ter quatre
propofitions qu’on peut regarder comme prouvées,
& qui dérivent l’une de l’autre.
La première , c’eft que le mot chalcidicum ne
doit pas fouffrir de changement, & qu’on doit
en chercher le fens, en le laiffant dans toute fon
intégrité.
Là fécondé, c’eft que puifque les deux étymologies
rapportées, fe trouvent démenties, ainfi
qu’on l’a vu , par les règles même de la grammaire
& de la profodie ; il ne faut plus y chercher
la preuve d’une opinion &' d’un fens que l’analogie
étymologique ne juftifie pas toujours , lors
même qu’elle eft le plus inconteftable.
La troifième eft, qu’indépendamment de toute
étymologie, les chalcidiques étoient de grandes falles
ou de grands bâtimens, & c’eft-là le fens fur lequel
toutes les opinions fe rapprochent, ou du
moins fur lequel elles ne font poirit êil coritradic-
lion entre elles, ... , ,
La quatrième , eft que cés falles appellees chalcidiques
né pouvant trouver l’origine de leur nom
dans les étymologies qu’on a combattues, doivent,
d’après l’autorité de Feftus, que rien ne contredit,
l’avoir tiré de là ville de Chalcis \ & ce qui m’induit
à le penfer, eft le nom de chalcidontum que
Feftus leur donne âuffi. Air fl, les interprètes au-
roient été induits en erreur par lin rapport équivoque
de mots & de confonnanees finales, qui fe
rencontrent dans prefque toutes les langues.
Mais voici fur quoi je fonde encore cette pre-
Ce n’eft pas-là le feul cas où l’on voie , chez .
les anciens , des édifices ou-'des parties d’édifices
emprunter, leur' dénomination des pays & des
villes qui les avqienr inventés ou qui en faifoient
un plus grand ufage. Le même. Feftus nous apprend
que les Romains avoient emprunté l’ufage ,
la forme & le nom de cette partie des maifons
qu’on appel’oit atrium de la ville d'Atria, nommée
depuis Adria, & qui donna de même fa
dénomination à la mer Atriatiqpe ou Adriatique.
C’eft à cette ville, félon cet écrivain, qu’on de-
voit l’invention de Xatrium ( Voye{ ce mot -).
Varron de ling. latin. L. iv . s’accorde fur cette
origine avec Feftus. Atrium appellatum ab atriaticis.
tafcis : ïllius entra exemplum fumptum. On peut folr
au mot Bain, que le nom de la pièce appellée la
conicum, & qui" étoit l’étuve , avoit une femblable
origine.
Si l’on veut une étymologie au mot chalcidicum,
je trouve celle-là , donnée par Feftus, la plus
vraifemblable; rien ne la contrarie, & 1 emploi
que les anciens en ont fait, prouve qu’il étoit fÿ-
nonyme de falle.
Après avoir écarté toutes les explications.hypothétiques
que des étymologies équivoques & détournées
pouvoient donner de ce mot & de fes
lignifications, il me paroît qu’on peut convenir,
quel qu’ait été l’ufage des cdcidiqv.es, que, c’étoit
de fpacieufes & magnifiques falles , qui fe trou-
vo'fent dans les palais, & qu’on pouvoit joindre
quelquefois auffi aux palais de juftices, appellés
bafiliques.
- La fécondé queftion à réfoudre, eft de favoir
comment & à quel endroit des bafiliques pouvoit
fe faire cette adjonction, de quelle manière ces
grandes falles en faifoient partie.
Perrault, le dernier & louvent le plus malheureux
de tous les commentateurs de Vitruve ; Per?
rault 'qui, fans être forti de Paris, expliquait l’antique
par le Louvre & les monumens de LouisXIV;
Perrault, dis-je, a avancé fur cet article une opinion
fi motivée, qu’il eft effentiel de l’expofer en
entier, pour que le leCteur puiffe juger & de ce
qu’elle vaut & iej ce qu’on peut y répondre.
« Comme je rie trouve, dit-il, aucune de toutes
les interprétations différentes qui me fatisfaflent,
j’en forme une nouvelle , que je fonde fur les
autorités des plus anciens interprètes de ce mot,
3 t étant affuré par le témoignage d’Aufone, que
chalcidica t toit un lieu.élevé, que nous appelions
un'premier étage, & par le témoignage d’Arnobre
que chalcidica étoit un lieu ample & magnifique,,
j’eftime que ces chalcidiques étoient de grandes 3 c
magnifiques falles où on rendoit la juftice, fituées
aux bouts des bafiliques de plain-pied , avec les
galeries par lefquell’es on alloit d’une falle à l’autre
, & où les plaideurs fe promenoient ; car ces
galeries hautes fans ces falles , femblent être inutiles.
Suivant cette interprétation, lorfque Vitruve
dit que s’il y a affez de place pour faire une
bafilique fort longue, on fera des chalcidiques aux
deux bouts , il faut entendre que fi elle eft courte,
on ne fera qu’une fale à un des bouts, ou que
fi l’on en fait à chaque bout, elles feront trop
petites pour pouvoir être appellees chalcidiques,
dont le nom donne à entendre une grandeur 3>C
une magnificence extraordinaire v.
Pour bien comprendre l’idée de Perrault, il faut fe
reffouvenir que la plupart des bafiliques avoient un
rang de galeries , ou de ce que nous appellerions
travées, qui formoient un étage intérieur circulant
tout autour. C’eft aux deux bouts de cet étage
fupérieur que Perrault, fur les colonnes infé*
rieures, place de vaftes falles, auxquelles il donne
le nom de chalcidiques, & où, félon lui, fe rendoit
la juftice.’
Un feul mot renverfe tout cet édifice. Les gens
d’affaire occupoient bien , à là vérité, les galeries
hautes, de même que les gens de commerce les
galeries baffes ; mais comme on a déjà prouvé que
le tribunal n’étoit pas le chalcidicum , il faut prou-;
ver maintenant à Perrault que, quand même l’un
eût pu fetenir dans l’autre, ce n’auroit jamais été
dans la partie fupérieure où il place l’un & l’autre;
& Pline le jeune nous en fournit une preuve convaincante.
Voici le. paflage en entier qui prouve
que l’on ne jugeoit pas dans la partie fupérieure
de la bafilique. Sedebant judices . . . . ingens utraque
advocatio & numerofa fubfellia * prcetereà denfa ci;-
cum Jlantiutn corom latijjimum judicium muhiplici circula
ambibat. Ad hoc Jlipatum tribunal. Atque eïiam
ex fuperiore baflicçe parte quà fæminoe quà yiri , 6*
audiendi quod erat difficile, & quod facile vifendijluy
dio imminebant. La fin de ce paflage ne fauroit
laifler de doutes. Après avoir décrit & la manière
dont les juges , les avocats & les fpeâateurs entouraient
le tribunal, PUne ajoute : & dans les
galeries fupéneures de là bafilique s’avançaient de
toute part des hommes & des femmes -penchés en
avant, moins pour entendre, ce qui ne fe pouvoit
guère, que pour voir le jugement , ce qui etoit plus
«fâ " . * | | • o
Il eft bien prouvé par-là que, quand les chald*.