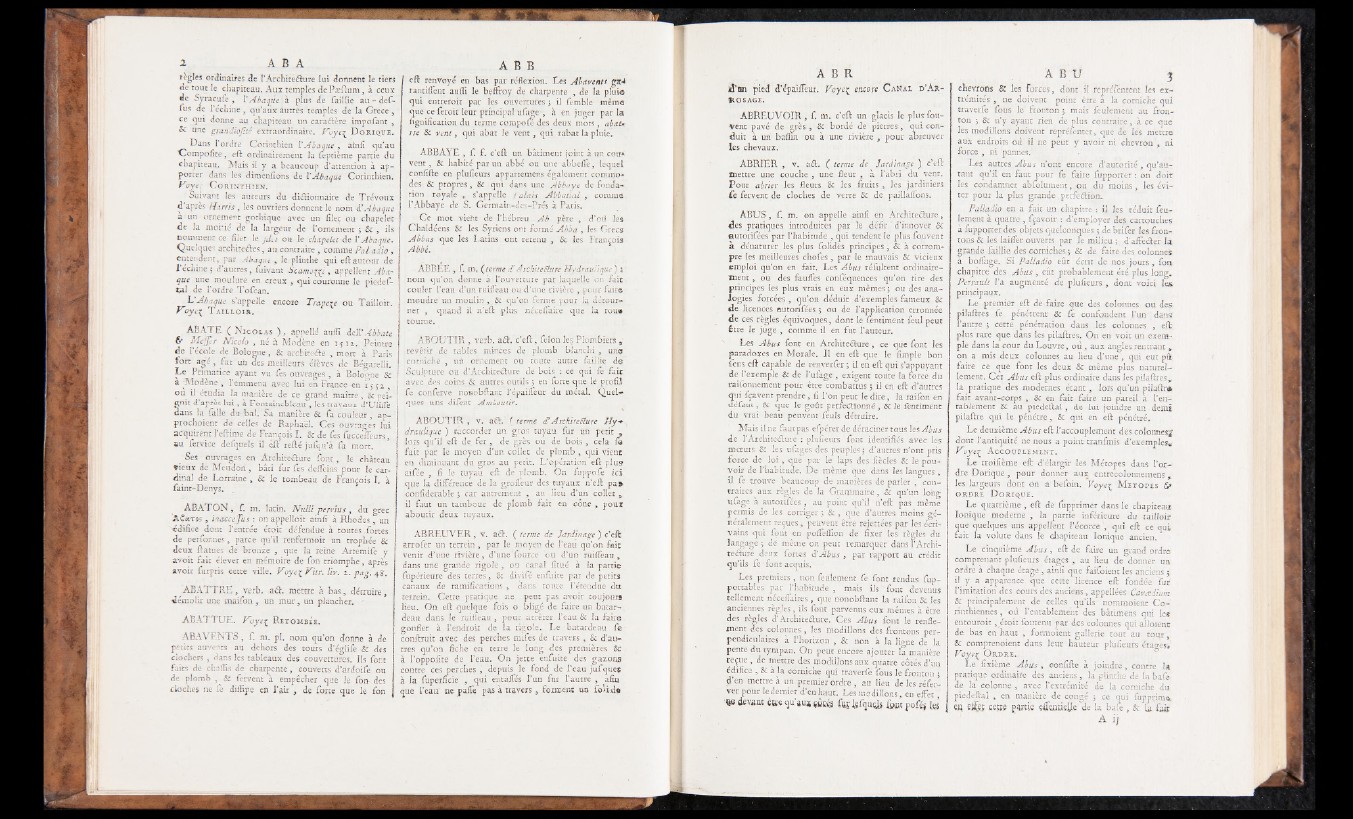
2 A B A
règles ordinaires de l’Architecture lui donnent le tiers
ae tout le chapiteau. Au x temples de Pæftum, à ceux
de Syra cufe, l’Abaque à plus de faillie a u -d e f -
fus de l’échine , qu’aux autres temples de la Gre ce,
ce qui donne au chapiteau un caractère impofant ,
Sc une graridiofiic extraordinaire. Voye^ D o r iq u e .
Dans l’ordre Corinthien Y Abaque , ainfi qu’au
'Compofite, eft ordinairement la feptième partie du
chapiteau. Mais il y a beaucoup d’attention à apporter
dans les dimenfions de Y Abaque Corinthien.
Voye.; C o r in th ien .
Suivant les auteurs du dictionnaire de Trévoux
d ’après Harris , les ouvriers donnent le nom à'Abaque
a un ornement gothique avec un filet ou chapelet
de la moitié de la largeur de l’ornement ; & , ils
nomment ce filet le fUtt ou le chapelet de Y Abaque.
Quelques architectes, au contraire , comme P a la d io ,
entendent, par Abaque , le plinthe qui eft autour de
1 échine ; d autres, luivant Scamoçgi , appellent Abaque
une moulure en creux , qui couronne le piedeft-
^al de l’ordre Tofcan.
L Abaque s appelle encore Trapc^e ou Tailloir.
V oye{ T a il l o ir .
A B A T E ( Nicolas ) , appellé auflî dell’ Abbate
& Mefjer Nicolo , ne' à Mcdène en 1 5 1 z. Peintre
de 1 ecoîe de Bologne , & architecte , mort à Paris
fort â g é , fut uh des meilleurs élèves de Bé<yareîli.
L e Primatice ayant vu fes-ouvrages , à Bologne &
a -Modène , l’emmena avec lui en France -en—1 y j z ,
ou il étudia la manière de ce grand maître, & peignit
d’après lu i , à Fontainebleau , les travaux d’Ulifle
dans la la lie dm-bal. Sa manière & fa couleur, ap-
prochoient de celles de Raphaël. Ces 'ouvra? es lui
acquirent l’eftime de François I. & de fes fuccefcurs,
au fervice defquels il èft refté jufqu’à fa mort.
Ses ouvrages en Architecture fo n t , le château
♦ ieux de M eu do ii, bâti fur les delfeins pour le cardinal
de Lorraine , & le tombeau de François I. à
faint-Denys.
À B A T O N , f. m. latin. Nutli pervius, du grec
ÂÊaTo? , inaccejus : on appelloit ainfi à Rhodes , un
édifice donc l’entrée étoit défendue à toutes .fortes
de perfonnes, parce qu’il renfermoit un trophée &
deux ftatues de bronze , que la reine Artemifé y
avoit fait élever en mémoire de fon triomphe, après
avoir furpris ce-tte ville. Voye^ Vitr. liv. z. pag. 4g.
A B A T T R E , verb. aCt. mettre à bas, détruire,
démolir une maifon , un mur, un plancher. '
A B A T T U E . T o y e i RETOMBEE.
À B A V E N T S , f. m. pl. nom qu’on donne à de
petits auvents au dehors des tours d’églife & des
clochers , dans les tableaux des couvertures. Ils font
faits de ehalfis de charpente, couverts d’ardoife ou
de plomb , & fervent à empêcher que le fon- des
cloches ne fe diifipe en l’air , de forte que le fon
A B B
eft renvoyé en bas par réflexion. Les Âbdvents
ramifient aufli le beffroy de charpente , de la pluie
qui entrerait par les ouvertures ; il femble même
que ce ferait leur principal ufagev, à en juger par la
lignification du terme compole des deux mots, abat»
ire & vent, qui abat le v én t , qui rabat la pluie.
A B B A Y E , f. f. c’eft un bâtiment joint à un cou*
v en t , & habité par un abbé ou une abbeffe, lequel
confifte en plufieurs appartenons également commo-*
des & propres, & qui dans une Abbaye de fonda-*
tion royale , s’appelle Jalais Abbatial , comme,
l’Abbaye de S. Germain-des-Prés à Paris.
C e mot vieht de l’hébreu A b père , d’où les
Chaldéens & les Syriens ont formé Abba , fes Grecs
Abbas que les Latins ont retenu , & les François
Abbé.
À BB EE , f. m. ( terme d'Architecture Hydraulique ) 3
nom qu’on donne à l’ouverture par laquelle on fait
couler l’eau d’un ruifleau ou d’une rivière ,, pour faire
moudre un moulin , & qu’on ferme pour la détourner
, quand il n’eft plus nécefîaire que la roue
tourne.
A B O U T IR , verb. aCL c’e ft , félon les Plombiers ,
revêtir de tables minces de plomb blanchi , une
corniche , un ornement ou toute autre faillie de
Sculpture ou d’Àrchiteélure de bois : ce qui le faip
avec des coins & autres outils ; en forte que lé profil
fe conferve nosobftant l’épailfeur du métal. Qu elques
uns difent Atnboiidr,
A B O U T IR , v. aéïr. ( terme d Architecture Hy-+
draulïque ) raccorder un gros tuyau fur un petit ,
lors qu’il eft de fer , de grès ou de bois , cela 1«
fait par le moyen d’un collet de plomb , qui vient
. en diminuant du gros au petit. L ’opération eft plus
aifée , fi le tuyau eft de plomb. On fuppofe ic i
que la différence de la groffeur des tuyaux n’eft pa»,
confiderable ; car autrement , au lieu d’un c o lle t ,
il faut un tambour. de plomb fait en cône , pour
aboutir deux tuyaux.
A B R E U V E R , v. a<ft. ( terme de Jardinage) c’eft
arrofer un terrein, par le moyen de l’eau qu’on fait
venir d’une rivière, d’uneTource ou d’un ruiffeau ,
dans une grande rigole , ou canal fitué à la partie
fupérieure des terres, & divifé enfuite par de petits
canaux de ramifications , dans toute l ’étendue du
terrein. Cette pratique ne peut pas avoir toujours
lieu. On eft quelque fois o bligé de faire un batardeau
dans lé ruifleau , pour arrêter l’eau & la faire
gonfler à l’endroit de la rigole. L e batardeau fe
confirait avec des perches miles de travers , & d’autres
qu’on fiche en terre le long-des premières &
à I’oppofite de l’eau. On jette enfuite des gazons
contre ces perches , depuis le fond de l ’eau jufques
à la fuperficie , qui entaffés l ’un für l’autre , afin
que l’eau ne paffe pas à travers, forment uo foUd®
A B R
Üt’ fln pied d’ épaiffeur. Voyeç encore C aHal d ’A r-
{ROS AGE.
A B R E U V O IR , f. m. c’eft un glacis le plus fou-
vent pavé de grès , & bordé de pierres, qui c o n duit
a un ballm ou à une rivière , pour abreuver
les chevaux.
A B R IE R , v. a6t. ( terme de Jardinage ) c’eft
mettre une couche , une fleur , à l’abri du vent.
Pour abrier les fleurs & les fruits , les jardiniers
fe fervent de cloches de verre & de paiilaffons.
A B U S , f. m. on appelle ainfi en Àrchiteélure,
des pratiques introduites par le défir ' d’innover &
eutorifées par l’habitude , qui tendent le plus fouvent
a dénaturer les plus folidès principes, & à corrompre
les meilleures chofes, par le mauvais & vicieux
emploi qu’on en fait. Les Abus réfultent ordinairement
, ou des fauffes conféquences qu’on tire des
principes les plus vrais en eux mêmes ; ou des analogies
forcées , qu’on déduit d’èxemples fameux &
de licences autorifées ; ou de l’application erronnée
de ces règles équivoques, dont le fentiment feul peut J
Être le juge , comme il en fut l’auteur.
Les A bus font en Architeélure, ce que font les
paradoxes en Morale. Il en eft que le fimple bon
feus eft capable de renverfer ; il en eft qui s’appuyant
de l’exemple & de l ’ufage , exigent toute la force du
raifonnement pour être combattus ; il en eft d’autres
qui fçavent prendre, fi l’on peut le dire, la raifon en
dé faut, & que le goût perfeélionné , & le fentiment
du vrai beau peuvent feüls détruire.
Mais il ne faut pas efpérer de déraciner tous les Abus
de l’Architeélure : plufieurs font identifiés avec les
moeurs & les ufages des peuples ; d’autres nJont pris
forcé de loi , que par le laps des fiècles 8c le pouvoir
de l’habitude. De même que dans les langues ,
il fe trouve beaucoup de manières de parler , contraires
aux règles de la Grammaire, & qu’un long
ufage 'a autorifées, au point qu’il n’eft pas même
permis de les corriger ; & , que d’autres moins généralement
reçues, peuvent être rejettées par les écrivains
qui font en poffeflion de fixer les règles du
langage ; dé même on peut remarquer dans l’Archi-
teétüre deux fortes d!Abus , par rapport au crédit
qu’ils fè font acquis.
Les premiers, non feulement fe font rendus E x portables
par l’habitude , mais i l s s font devenus
tellement néceflaires , que nonobftant la raifon & les
anciennes règles, ils font parvenus eux mêmes à être
des règles d’ Architeélure. Ces Abus font le renflement
des colonnes, les modillons des frontons per-r
pendiculaires à l’horizon , & non à la ligne de la
pente du tympan. On peut encore ajouter la manière
reçue , de mettre des modillons aux quatre côtés d’un
édifice , & à la corniche qui traverfe fous le fronton ;
d en mettre a un premier ordre , au lieu de les réfer-
ver pour k dernier d’en haut. Les modillons, en e f fe t ,
ç s dé vaut êtfe qu au* l^fquç^s (yjjt poféj lç§
A B U 3
chevroüs & les forces, d o n t . il reprefentent les extrémités
, ne doivent point être a la corniche qui
traverfe fous le fronton ; mais feulement au fronton
; & n’y ayant rien de plus contraire, à ce que
les modillons doivent représenter, que de lés mettre
auk endroits où il ne peut y avoir ni chevron , ni
force , ni pannes.'
Les autres Abus n’ont encore d’autorité , qu’autant
qu’il en faut pour fe faire fupporter : on doit
les condamner abfolument, ou du moins, les éviter
pour la plus grande .perfeélion.
Palladio en a fait un chapitre : il les réduit feulement
à quatre , fçavoir : d’employer des cartouches
à fupppïter des objets quelconques ; de brifer les frontons
& les laiffer ouverts par le milieu ; d’affeéler la
grande faillie des corniches,; & de faire des colonnes
a boffage. Si Palladio eût écrit de nos jou rs, fo a
chapitre des Abus , eût probablement été plus long.
Perrault l’a augmenté de plufieurs , dont voici les,
principaux.
L e premier eft de faire que des colonnes ou des
pilaftres fe pénétrent & fe confondent l’un dans
l’autre ; cette pénétration dans les colonnes , eft
plus rare que dans les pilaftres. On en voit un exemple
dans la cour du Louvre, o ù , aux angles rentrant 9
on a mis deux colonnes au lieu d’une', qui eut pû
faire ce que font les deux & même plus naturellement.
Ce t Abus eft plus ordinaire dans les pilaftres,
la pratique des modernes étant , lors qu’un pilaftr*
fait avant-corps , & en fait faire un pareil a l’entablement
& au piedeftal, de lui joindre un demi
pilaftre qui le pénétre, & qui en eft pénétré.
L e deuxième Abus eft l ’accouplement des colonnes^
dont l’antiquité ne nous a point tranfmis d’exemples«
Voyc^ A ccouplement.
L e troifième eft d’élargir les Métopes dans l’ordre
D o riqu e, pour donner aux entreçolonnemens,
les. largeurs dont on a befoin. Voyez Metopes ô*
ordre D orique.
Le quatrième , eft de fupprimer dans le chapiteau
Ionique moderne , la partie inférieure du tailloir
que quelques uns appellent l’écorce ', qui eft ce qui
fait la volute dans le chapiteau Ionique ancien.
Le cinquième A b u s , eft de faire un grand ordre
comprenant plufieurs étages , au lieu de donner un
ordre à chaque étage, ainfi que faifoient les anciens ;
il y a apparence que cette licence eft fondée fur
l ’imitation des cours des anciens, appellées Cavcedium
& principalement de celles qu’ils nommoient C o rinthiennes
, ' où l’entablement des bâtimens qui les
entourait ,/ to i t foutenu par des colonnes qui alloienc
de bas en haut , formoient gallerie tout au to u r ,
& comprenoient dans leur hauteur plufieurs étapes#
Voye£ Ordre.
L e fixième A b u s , confifte à joindre, contre la
pratique ordinaire des anciens, la plinthe de la bafe
de la colonne, avec l’extrémité de la corniche du
piedeftal , en manière de congé ; ce qui fuppçimet
Çfl e f e çefte partie Æ u ÿ ç i ie de la b a fe , & la frur
A ij