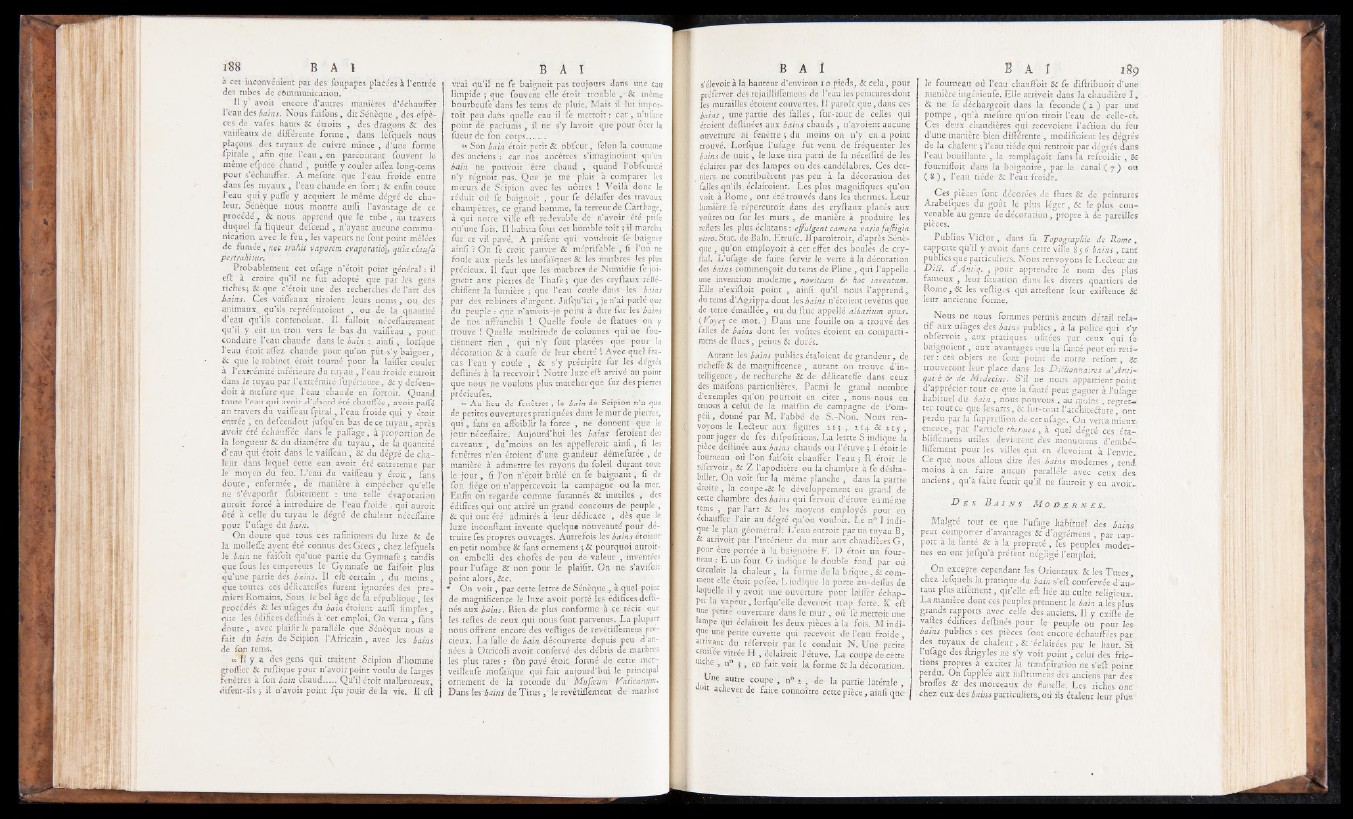
a cet inconvénient par des foupapes placées à l’entrée
des tubes de communication.
Il y avoit encore d’autres manières d’échaufFèr
l’eau des bains. Nous faifons, dit Sénèque , des efpè-
ces de vafes hauts & étroits , des dragons & dès
vailleaux de différente forme, dans lefquels nous
plaçons des tuyaux de cuivre mince , d’une forme
fpirale , afin que l’ea u , en parcourant fouvent le
même efpace chaud , puiffe y couler affez long-tems
pour s’échauffer. A mefure que l’eau froide entre
dans fes tuyaux , l’eau chaude en fort 5 & enfin toute
l’eau qui y paffe y acquiert le même degré de chaleur.
Sénèque nous montre aufîi l’avantage de ce
procédé , & nous apprend que le tube , au travers
duquel fa liqueur defcënd , n’ayant aucune communication
avec le fe u , les vapeurs ne font point mêlées
de fumée , nec trahit vaporem evaporatio\3 quia chiufa
pertrahitur.
Probablement cet ufage n’étoit point général : il
eft à croire qu’il ne fut adopté que par les gens
riches} & que c ’étoit une des recherches de l’art dès
bains. Ces vaiffeaux tiraient leurs noms, ou des
animaux., qu’ils repréfentojent , ou de la quantité
d’eau qu’ils contenoient. Il falloit néceffairement
qu’il y eût un trou vers le bas du vaiffeau , pour,
conduire l’eau chaude dans le bain : ainfi * lorfque
l’eau étoit affez chaude pour qu’on pût s’y baigner,
& que le robinet étoit tourné pour la laiffer couler
à l’extrémité inférieure du tuyau , l’eau froide entroit
dans le tuyau par .l’extrémité fupérieure, & y defcen-
doit à mefure que l’eau chaude en fortoit. Quand
toute l’eau qui avoit d’abord été chauffée, avoit paffé
au travers du vaiffeau fpiral, l’eau froide qui y étoit
entrée , en dèfcendoit jufqu’en bas dè cç tuyau, après
avoir été échauffée dans le paffage, à proportion de
la longueur & du diamètre du tuyau , de la quantité
d’eau qui étoit dans le vaiffeau, & du degré de chaleur
dans lequel cette eau avoit été entretenue parle
moyen du feu. L ’eau du vaiffeau y é to it , fans
dpute'," enfermée, de manière à empêcher qu’elle
ne s’évaporât fubitement : une telle évaporation
auroit forcé à introduire de l ’eau froide , qui aurait
ôté à celle du tuyau le dégré de chaleur néceffaîre
pour fufag e du bain.
On doute que - tous ces rafinimens du luxe & de
la molleffe ayent été connus des Grecs, chez lefquels
le bain ne faifoït qu’une partie du Gymnafe > tandis
que fous les empereurs le Gymnafe ne faîfoit plus
qu’une partie dés bains. Il eft certain , du moins ,
que toutes ces dêlicat-effës furent ignorées des premiers
Romains. Sous le bel.âge de la république. , lès
procédés & les ufages du bain étoient auflî fimples ,
que les édifices deftinés à 'cet emploi. On verra , fans
dou te, avec plaifir le parallèle que Sénèque nous à
fait du bain de Scipion l’A fr ica in , avec les bains
de fon rems,
« Il y a des gens qui traitent Scipion d’ homme
grofïier & rufrique pour n’avoir point voulu de larges
fenêtres à fon bain chaud......Qu’il étoit malheureux,
difent-ils 3 il n’avoit point fçu jouir de là vie. Il eft
j vrai qu’il ne fe bàignoit pas toujours dans une eau
limpide 3 que foiivent elle étoit trouble , & même
bourbeufe dans les tems de pluie. Mais il lui impor-
, toit peu dafis quelle eau il fe mettoit : c a r , n’ufant
point dè parfums, il rie s’y lavoit que pour ôter la
fueur de fon corps.......
« Son ba in étoit petit & obfcur, félon la coutume
. des anciens car nos ancêtres s’imaginoient qu’un
bain ne pouvoir être chaud , quand l’obfcunté
n’y régnoit pas. Que je me plais à comparer les
moeurs de Scipion avec les nôtres 1 V o ilà donc le
réduit'où fe bàignoit , pour fe délaffer des travaux
champêtres, ce grand homme, la terreur de Carthage,
à qui notre ville eft redevable de n’avoir été prife
qu’une fois. Il habita fous'Cet humble toît 5 il marcha
fur ce vil pavé. A préfent qui voudrait 'fe- baigner
ainfi ? On fe croit pauvre & méprifable , fi l’on ne
foule aux pieds les mofaïques & les marbres les plus
précieux. Il faut que lés marbres de Numidie fe joignent
aux pierres de Thafè} que des cryftaux réflé-
chiffent la lumière 3 que l’eau ‘coule dans les" bains
par des robinets d’argent. Jufqu’i c i , je n’ai parlé que
' du peuple : que n’aurois-je point à dire fur les bains
de nos affranchis 1 Quelle foule de ftatues -on y
trouve i Quelle multitude de colonnes qui ne fou-
' tiënnent rien , qui n’y font placées que pour la
décoration & à caufe de leur cherté 1 Avec quel fracas
l’eau y coule , 8c s’y précipite fur les dégrés
deftinés à la recevoir 1 Notre luxe eft arrivé au point
que nous ne voulons plus marcher que fur dès pierres
précieufès.
« A u lieu de fenêtres, le bain de Scipion n’a que.
de petites ouvertures pratiquées dans le mur de pierres,
q u i , fans en affoiblir la force , ne donnent que le
jour néceffaire. Aujourd’hui les1 bains feraient des
caveaux , du*moins on les appellerait ainfi , fi les
fenêtres n’en étoient d’une giandeur démefurée , de
manière à admettre les rayons du foleil durant tout
le jour , fi l’on n’étoit brûlé en fe baignant, fi de
fon fiége on n’appercevoit la campagne ou la mer.
Enfin 011 regarde comme furannés & inutiles , des
édifices qui ont attiré un grand concours de peuple ,
& qui ont été admirés à leur dédicace dès que le
luxe inconftant invente quelque nouveauté pour détruire
fes propres ouvrages. Autrefois les bains étoient
en petit nombre & fans ornemens 3 & pourquoi auroit-
on embelli des choies de- peu de valeur , inventées
pour l’ ufage & non pour le plaifir. On ne s’âvifeit
point alors, &c.
* On v o it , par cette lettre de Sénèque , à quel point
de magnificenje leduxe avoit porté les édifices deftinés
aux bains. Rien de plus conforme à ce récit que
les certes de ceux qui nous font parvenus. L a plupart
nous offrent encore des veftiges de revêtiffemens précieux.
L a falle de bain découverte depuis peu d’années
à Otricoli avoit confervé des débris de marbres
les plus rares : fôn pavé étoit formé de cette mer-
veilleufe mofaïque qui fait aujourd’hui le principal
ornement de la rotonde du Mufceum Vaticanuin..
Dans les kains de T itu s , le revêîiffement de marbre
s’élevoit à la hauteur d’environ 10 pieds, 8c cela, pour
préferver des rejailliffemens de l’eau les peintures dont
les murailles étoient couvertes. Il paraît.que, dans ces’
bains , une partie des falles , fur-tout de celles qui
étoient deftinées aux bains chauds , 11’avoient aucune
ouverture ni fenêtre 5 du moins on n’y en a point
trouvé. Lorfque l ’ufage fut venu de fréquenter les
bains de nuit, le luxe tira parti de la nécelfité de les
éclairer par des lampes ou des candélabres. Ces derniers
ne contribuèrent pas peu à la décoration des
falles qu’ils. éclairaient. Les plus magnifiques qu’on
voit à Rome, ont été trouvés dans les thermes. Leur
lumière fe répercutoit dans des cryftaux placés- aux
voûtes ou fur les murs , de manière à produire les
reflets-les plus éclatans : effulgent caméra vario fafiigia
vitro. Seat. de Bain. Etrufc. Il paraîtrait, d’après Sénèque
, qu’on employoit à cet effet des boules de cry-
ftal. L ’üfage de faire fervir le verre à la décoration
des bains commençoit du tems de Pline , qui l ’appelle
une invention moderne , novitium & hoc inventum.
Elle n’exiftoit point , ainfi qu’il nous l’apprend,
du tems d’Agrippa dont les bains n’étoient revêtus que
de terre émaillée, ou du ftuc appelle albarium opus. .
(Foye^ ce mot. ) Dans une fouille on a trouvé des
falles de bains dont, les voûtes étoient en comparti -
mens de ftucs, peints & dorés.
Autant les bains publics étaloient de grandeur, de
richeffe & de magnificence , autant on trouve d’intelligence
, de recherche & de délicateffe dans ceux
des maifons particulières. Parmi le grand nombre
d’exemples qu’on pourrait en citer , nous-nous en
tenons à celui de la maifon de campagne de Pom-
péii, donné par M . l’abbé de S.-Non. Nous renvoyons
le Leéteur aux figures 113 Z I4 & z i j ,
pour juger de fes difpofitions. L a lettte S indique la
pièce deftinée aux^bains chauds ou l’étuve 31 étoit le
fourneau où l’on faifoit chauffer l’eau 3 R étoit le
réfervoir, & Z l’apoditère ou la chambre à fe désha- I
biller. On voit fur la même planche , dans la partie
droite , la coupe .& le développement en grand de
cette chambre des bains qui fervoit d’étuve en même
tems , par l’art & les moyens employés pour en
échauffer l’air au dégré qu’on vouloit. Le n° I indique
le plan géométral. L ’eau encrait par un tuyau B ,
& arrivoit par l’intérieur du mur aux chaudières G ,
pour être portée à la baignoire F. D étoit un fourneau
: E un four. G indique le double fond par où
circulait la chaleur , la forme de la brique, & comment
elle étoit pofée^L indique la porte au-deffus de
laquelle il y avoit une ouverture pour laiffer échapper
la vapeur, lorfqu’elle devenoit trop forte. K eft
une petite ouverture dans le mur , où fe mettoit une
lampe qui éclairait les deux pièces à la fois. M indique
une petite cuvette qui recevoir de l’eau froide,
arrivant du réfervoir par le conduit N . Une petite
croifee vitrée H , éclairait l’étuve. L a coupe de cette
■ e > n° 3 , en fait, voir la forme & la décoration..
ünê àHU» la partie latérale ,
“Oit achever de faire conuoicre cette pièce, ainfi cpe-^
le fourneau où l’eau chanffoit 8c fe diftribuok d’une
manière ingénieufe. Elle arrivoit dans la chaudière I ,
& ne fe déchargeoit dans la fécondé ( z ) par une
pompe , qu’à mefure qu’on tirait l’eau de celle-cL
Ces deux chaudières qui recevoient l’aéHon du feu
d’une manière bien differente , modifioient les dégrés
de la chaleur ; feau tiède qui rentrait par dégrés dans
l’eau bouillante , la remplaç.oit fans la refroidir , 8s
fournifloit dans la baignoire , par le canal C 7 ) ou
( 8 ) , l’eau tiède 8c l’eau froide.
Ces pièces font décorées de ftucs & de peintures
Arabefques du goût le plus lég e r , & le plus convenable
au genre de décoration, propre à de pareilles
pièces.
Publius Vitftor, dans la Topographie de Rome ,
rapporte quril y avoir dans cette ville 85 6 bains , tant
publics que particuliers. Nous renvoyons le Leéleur au
Diff. d'Antiq. , pour apprendre le nom des plus
fameux , leur fituation dans les divers quartiers de
Rome, ■ & les vertiges' qui attellent leur exiftence 8S
'leur ancienne forme.
Nous ne nous femmes permis aucun détail relat
i f aux ufages des bains publics, à la police qui s’y
obfervoit , aux pratiques ufttées par ceux qui fe
baignoient, aux avantages que la faute peut en reii-
rer : ces objets ne font point de notre reffort, 8c
, trouveront leur place dans les DiSlionnaïres d'.Anti-
quvé & de Médecine* S ’il ne nous appartient poinr
d’apprécier tout ce que la fanté p eut gagner à l ’ufao-e
habituel du bain, nous pouvons, au moins regretter
tout ce que les arts, & fur-tout l'archiEecfure f ont
perdu par la fuppreflîon de cet ufage. On verra mieur-
encore, par 1 article therines , a quel déoxé ces éta^*
blmemeüs utiles devinrent des monumens d’embé-
liffement pour les villes qui en élevoient à l’envier
Ce que nous allons dire des. bains modernes , tend
moins à en faire aucun' parallèle avec ceux des
anciens , qu’à faire fentif qu’il ne lauroic y en avoir.
D e s B a i n s M o d e r n e s .,
Malgré tout ce que f ufage habituel des Bains-
peut comporter d’avantages 5c d^agrémens , par rapport
à la fanté & à la propreté , les peuples modernes
en ont jufqu,’à préfent négligé l’emploi;
On excepte cependant les Orientaux & les Turcs ,:
chez lefquels Ta pratique du bain s’eft confervée d’autant
plus aifément, q.u’elle eft liée au culte religieux.
L a manière dont ces peuples prennent le bain a. les plus
grands rapports avec celle des anciens. Il y exifte de
Veilles édifices deftines pour le- peuple ou pour les*
bains pubfics ces pièces font encore échauffées par:
des tuyaux de chaleur , & éclairées par le . haut. Si
lu fag e des ftrigyles ne s’y voit po in t, celui des frictions
propres a exciter la tranfpiration ne s’efl: point
perduv On fupplé’e aux ihftrumens des anciens par des'
broffes & des morceaux de flanelle. Les riches ont
chez eux des bains particulierSjOÙ ils étalent leur plus;