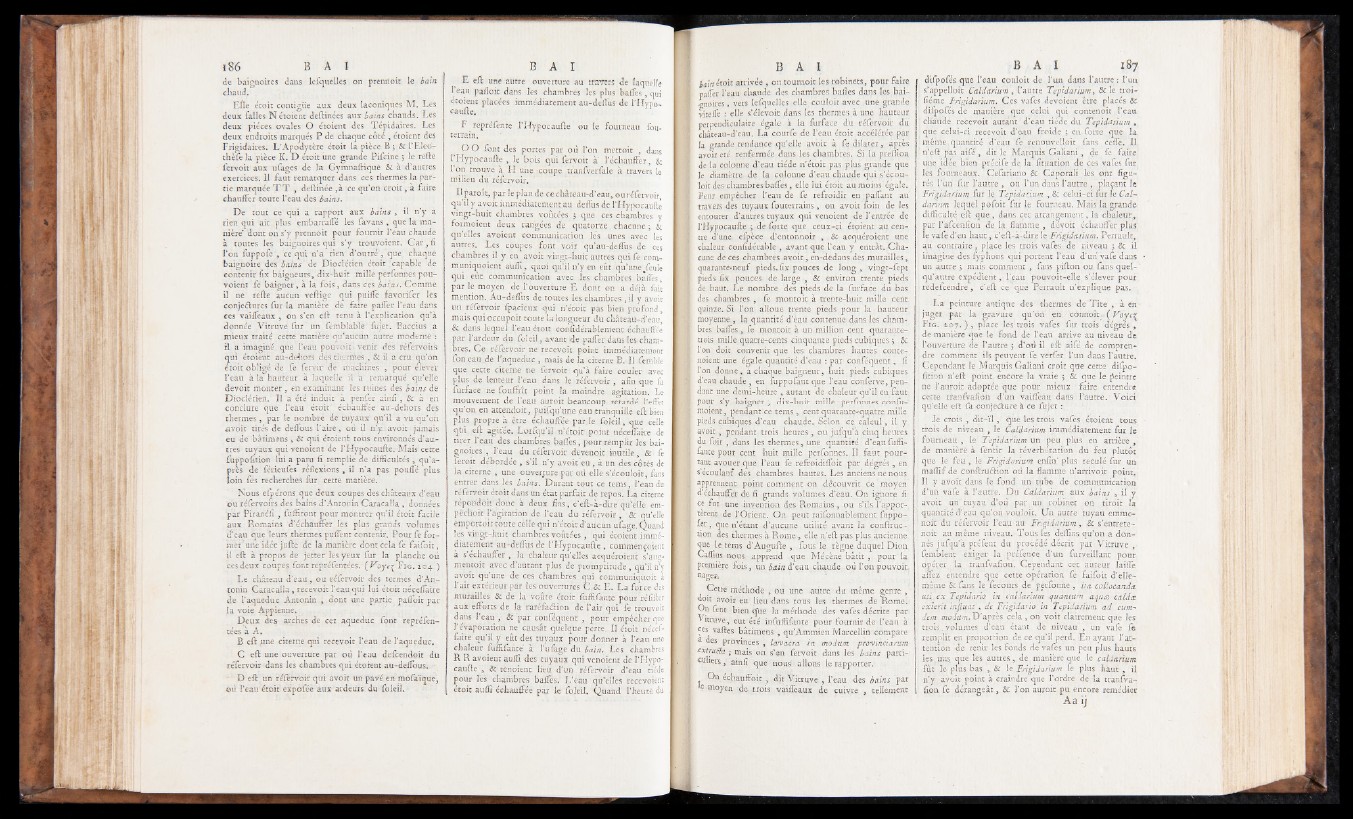
de baignoires dans lefquelles on prenüoit le bain
chaud.
Elle étoit contiguë aux deux laconiques M. Les
deux falles N étoient deftinées aux bains chauds. Les
deux pièces ovales O étoient des Tépidaires. Les
deux endroits marqués P de chaque côté , étoient des
Frigidaires. L ’Apodytère étoit la pièce B ; & l’Eleo-
thèfe la pièce K. D étoit une grande Pifcine ; le refte
fervo itaux ufages de la Gymnaftique & à d’autres
exercices. Il faut remarquer dans- ces thermes la partie
marquée T T , deftinée ,à ce qu’on cro it, à faire
chauffer toute l’eau des bains.
D e tout ce qui a rapport aux bains , il n’y a
rien qui ait plus embarraffé les favans , que la manière*
dont on s’y prennôit pour fournir l’eau chaude
à toutes les baignoires qui s’y trouvoient. G a r , fi
l’on fuppofe , ce qui n’a rien d’outré , que chaque
baignoire des bains de Dioclétien étoit capable de
contenir fix baigneurs, dix-huit raillé perfonnes pou-
voient fe baigner, à la fo is , dans ces bains. Comme
il né refte aucun veftige qui puiffe favorifer les
conjectures fur la manière de faire paffer l’eau dans
ces vaifTeaux , on s’en eft tenu à l’explication qu’à
donnée Vitruve fur un femblable fujet. Baccius a
mieux traité cetté matière qu’aucun autre moderne :
il a imaginé que l’eau pouvoir > venir des réfervoirs
qui étoient au-dehors des thermes , & il a cru qu’on
étoit obligé de fè fervir de machines , pour élève'r
l’eau à la hauteur à laquelle il a remarqué qu’elle
devoit monter , en examinant les ruines des bains de
Dioclétien. Il a été induit à penfer ainfî , & à en
conclure que l’eau étoit échauffée au-dehors des
thermes , par le nombre de tuyaux qu’il a vu qu’on
avoir tirés de défieras l’aire, où il n ly .avoir jamais
eu dé bâtimens , & qui étoient toiis environnés d’autres
tuyaux qui venoient de l’Hypocaufter Mais cette
fuppofition lui a paru fi remplie de difficultés , qu’a-
près de férieufes réflexions , il n’a pas pouffé plus
loin fes recherches fur cette matière.
Nous efpérons que deux coupes des châteaux d’eau
ou réfervoirs des bains d’Antonin Caracaîla , données
par Piranéfi , fuffiront pour montrer qu’il étoit façile
aux Romains d’échauffer les plus grands volumes
d’eau que leurs .thermes puffent contenir. Pour fe former
une idée jüfte de la manière dont cela fe faifoit,
il eft à propos de jetter les yeux fur la planche où
ces deux coupes font répréfentées. ( V^oye{ Fig. 104 )
Le château d’e a u , ou réfervoir des termes d’A n-
tonin C.aracalla, recevoit l’eau, qui lui étoit néceffai-çe
de l’aqueduc Antonin , dont une partie pafloit par
la voie Appienne. ,
Deux des arches de cet aqueduc font repréfen-
tées à A .
B eft ,une citerne qui recevoit l’eau de l’aqueduc.
C eft une ouverture par où l’eau defeendoit du
réfervoir dans les chambres qui étoient au-defTous. •
D eft un réftrv'oir qui avoir un pave en mofaïque,
où l’eau étoit expofée aux ardeurs, du foleil.
E eft une autre ouverture au travers de îaquelfe
l’eau pafloit dans les chambres les plus baffes, qui
étoient placées immédiatement au-deffus de l’Hypo-
caufte.
F repréfènte l’Hypocaufte ou le fourneau fou-
terrain.
O O font des portes par où l’on mettoit , dans
1 Hypocaufte , le bois qui fervoit à l’échauffer, &;
l’on trouve à FI une .coupe tranfverfale à travers le
milieu du réfervoir.
Il paroît, par le plan de ce château-d’eau, ou réfervoir
qu’il y avoit immédiatement au deffus de l’PIypocaufte
vingt-huit chambres voûtées > que ces chambres y
formoient deux rangées de quatorze chacune 5 &
qu’elles avoient communication les unes avec les
autres. Les coupes font voir qu’au-deffus de ces
chambres il y en avoit vingt-huit autres qui fe coni-
muniquoient auffi, quoi qu’il n’y en eût qu’une%feule
qui eût communication avec les chambres baffes,
par le moyen de l’ouverture É dont on a déjà fait
mention. Au-deffus de toutes-les chambres , il y avoit
un réfervoir fpàciéux -qui h’ étoit pas bien profond ,
mais quioccupoit toute la longueur du château-d’eau,
& dans lequel l’eau étoit considérablement échauffée
par l’ardeur du fole il, avant, jde paffer dans les chambres.
C e réfervoir ne recevoit point immédiatement
fon eamde l’gqueduc , mais de la citerne B. Il femble
que cette citerne ne fervoit qu’à faire couler avec
plus de lenteur l’eau dans le réfervoir , afin que fa
furfaee ne fouffrît point la moindre agitation. Le
mouvement de l ’eau auroit beaucoup retardé l’effet
qu’on en attendoit, puifqu’une eau tranquille eft bien
plus propre à être échauffée parùe fole il, que celle
qüi eft agitée. Lorfqu’il n’é to if point néceffaire de
tirer l’eau des chambres baffes, .pour-rèm plir les baignoires
, l’eau du réfervoir devenoit inutile, & fe
feroit débordée , s’il n’y avoit e u , à un des côtés de
la citerne , une ouverture par où elle s’écouloit, fans
entrer dans les bains. Durant tout ce tems, l’eau du
réfervoir étoit dans un état parfait de repos. L a citerne
répondoit'donc à deux fins, c’eft-à-dire qu’elle em-
péchoit l’agitation de l’èau du réfervoir, & qu’elle
êmpertoit toute celle qui n’étoit d’aucun ufage. Quand
les vingt-huit chambres voûtées , qui étoient immédiatement
au-deffus de l’Pïypocaufte , commençojent
a s’échauffer , la chaleur qu’elles acquéroient s’aug-
mentoit avec d’autant plus de promptitude, qu’il n’y
avoit qu’une de ces chambres qui communiquoit à
l’air extérieur par les ouvertures C ,& E . L a force des
murailles & de la voûte étoit fuffifante pdur'réfifler
! auX efforts de la raréfaction de l’air qui. fe trouvoit
dans l’eau , 8t par eonféquent , pour empêcher que
l’évaporation ne causât quelque perte. Il étoit' nécef-
faire-qu’il y eût des tuyaux pour, donner à l’eau une
chaleur fuffifante a l’ufagé du bain. Les chambres
R R avoient auffi des tuyaux qui venoient de l’FIypo-
caufte , & tenoient lieu d’un. réfervoir d’eau tiède
pour lès chambres baffes. L ’eau qu’elles recevoient
étoit auffi échauffée par le foleil. Quand l’heurè du
bain étoit arrivée , ontournoit les robinets, pour faire
pa/Ter l’eau chaude des chambres, balles dans les baignoires,
vers lefquelles elle couloir avec une grande
vîtefTe : elle s’élevoit dans les thermes à une hauteur
perpendiculaire égale à la furfaee du réfervoir du
château-d’eau. La courfe de l ’eau étoit accélérée par
la grande tendance qu’elle avoit à fe dilater, après
avoir été renfermée dans les chambres. Si la pr.effiom
de la colonne d’eau riéde n’étoit pas plus grande que
le diamètre de la: colonne d’ eau chaude qui s’écouloit
des chambres b a f f e , elle lui étoit au moins égale.
Peur empêcher l’eau de fe refroidir enpaffant au
travers des tuyaux fouterrains , on avoit foin de les
entourer d’autres tuyaux qui venoient de l’entrée de
l’Hypocaufte ; de forte que ceux-ci étoient au centre
d’une, efpèce d’entonnoir , & acquéroient une
chaleur confidérable', avant que l’eau y entrât. Chacune
de ces chambres avoir, en-dedans des murailles,:
q.uaranterneuf pieds, fix ^pouces de lo n g , vingt-fept
pieds fix pouces de large , & environ trente pieds
de haut. Le nombre des pieds de la furfaee du bas
des chambres , fe montoit à trente-huit mille cent
quinze. Si l’ on alloue trente pieds pour la hauteur
moyenne , la quantité d’èau contenue dans les cham*
bres baffes , fe montoit à un million cent quarante-
trois mille qiiatre-cents cinquante pieds cubiques j &
l’on doit; convenir que les chambres hautes conte-,
noient une égale quantité d’eau : par eonféquent, fi
l’on donne, a chaque baigneur, huit pieds cubiques,
d’eau chaude, en fuppofant que l’eau conferve, pendant
une demi-heùre , autant de chaleur qu’il en-faut
pour s’y baigner , dix-huit mille - perfonnes çonfu-
moient, pendant ce tems, cent quarantè-qqatre mille
pieds cubiques d’eau chaude., Sélon ce ca lcu l, il y
avoit , pendant trois heures , ou jufqu’à cinq heures
du fpir , dans les thermes, une quantité d’eau fuffifante
pour cent huit mille perfonnes. Il, faut pourtant
avouer que l’eau fe refroidifl'oit par dégrés , en
s écoulant des chambres hautes. Les anciens ne nous
apprennent point comment on découvrit ce moyen
d’échauffer de fi grands volumes d’éâu. On ighore fi
ce fut une invention des Romains , ou s’ils rapportèrent
de l’Orient. O11 peut raifonnablement fuppo-
le r , que n’étant d’aucune utilité avant la conftruc-
tion des thermes à : Rome, elle n’eft pas plus ancienne
que le tems d’Augufte , fous le règne duquel Dion
Cadras nous, apprend que Mécène bâtit , pour la
première fois , un bain d’eau chaude où l’on pouvoir,
nager: J 1 t _
Cétté méthode , ou une autre du même genre ,
doit avoir eu lieu dans tous les thermes de Rome i
On fent bien que la méthode des vafes décrite par;
vitruve, eut été infuffifante pour fournir de l’eau à
ces vaftes bâtimens , qu’Ammien M arcellin compare
a ^es provinces , lavacra in modum proviheiarum
&xtruEla • mais on s’en fervoit dans les bains particuliers
, ainfi que nous allons le rapporter.
On échauffoit , dit Vitruve , l’eau des bains par
moyen de trois vaifTeaux de cuivre , tellement
difpofés que Teau couloir de l’un dans l'autre : l’un
s’appelloit Caldarium , l’autre Tepidarium, & le troi-
fiéme frigidarium. Ces vafes dévoient être placés Sc
difpofés de manière que celui qui contenoit l’eau
chaude recevoit autant d’eau tiède du Tepidarium ,
que celui-ci recevoir d’eau froide j en.forte que la
même. quantité d’eau fe renouvelloit fans ceffe. II.
n’eft pas aife , dit le Marquis G alian i, de fè faire
uiie idée bien précife de la fituation de ces vafes fur
les fourneaux. Çefariano 3c Caporali les ont figurés
l’un fur l ’autre , ou l’un dans l’autre , plaçant le
Frigidarium far le Tepidarium ,.& celui-ci fur le Caldarium
lequel pofoit fur le fourneau. Mais la grande
difficulté eft q u e , dans ,cet arrangement, la chaleur,
par l’afeenfion de la flamme , dévoit échauffer plus;
le vafe d’en haut, c’eft-à-dire le Frigidarium. Perrault,,
au contraire, place les trois vafès de niveau 5 & il
imagine des Typhons qui portent l’eau d’un vafe dans
un autre ; mais comment , fans pifton ou fans quel-
qu’autre expédient, l’eau pouvoit-elle, s’élever pour
I redefeendre , c’eft ce• que Perrault n’explique pas.
L a peinture antique des : thermes de T ite , à en
juger par la gravure qu’ôii en connoit ( Voye^
Fig. place les trois vafes fur trois dégrés ,
de manière que le fond de l’eau arrive au niveau de
l’ouverture de l’autre j d’où il eft aifé de compren*
dre comment ils peuvent fe vèrfer. l’un dans l’autre.
Cependant le Marquis Galiani croit que cette difpo-
fition n’eft point- encore la vraie 5 & que le peintre
ne l’auroit adoptée que pour mieux faire entendre
cette tranfVafion d’un vaifieâu dans l ’autre. V o ic i
qu’elle eft fa conjeéiure à ce fujet :
Je crois , d i t - ï l , que les trois v a fe s , étoient tous
trois de niveau , le Caldarium immédiatement fur le
fourneau , le Tepidarium un peu plus en arrière ,
de manière à fentir la réverbération du feu plutôt
que le f e u , le Frigidarium enfin' plus reculé fur un
maffif de conftruétion où la flamme n’arrivo.it point.
II y avoit dans le fond un tube de communication
d’un vafe à l ’autre. Du Caldarium aux b a in s , il y
avoit un tuyau d’où par un robinèt on tiroit la
quantité d’eau qu’on vouloit. Un autre tuyau ernme-
noit du réfervoir l’eau au Frigidarium, & s’entrete-
noit au même niveau. Tous les deffins qu’on a donnés
jufqu’à préfent du procédé décrit par . Vitruve ,
femblent exiger la préfence d’un furveillant pour
opérer la tranfvafion. Cependant cet auteur laifle
allez entendre que cette opération fe faifoit d’elle-
même & fans le fecours de perfonne , ita collocanda.
utCcx Tepidario in caldarium quantum aquez c aidez
exierit influai, de Frigidario;in Tepidarium ad eum-
dem modum. D ’après cela , on voit clairement que les
trois. volumes d’eau étant de niveau , un vafe fe
remplit en proportion de ce qu’il perd. En ayant l’ attention
de tenir les fonds de vafes un peu plus hauts
les , uns. que les autres , de manière que le caldarium
fût le plus bas , & le Frigidarium le plus haut , il
n’y avoit point à craindre que l’ordre de la tranfvafion
fe .dérangeât, & l’on auroit pu encore remédier