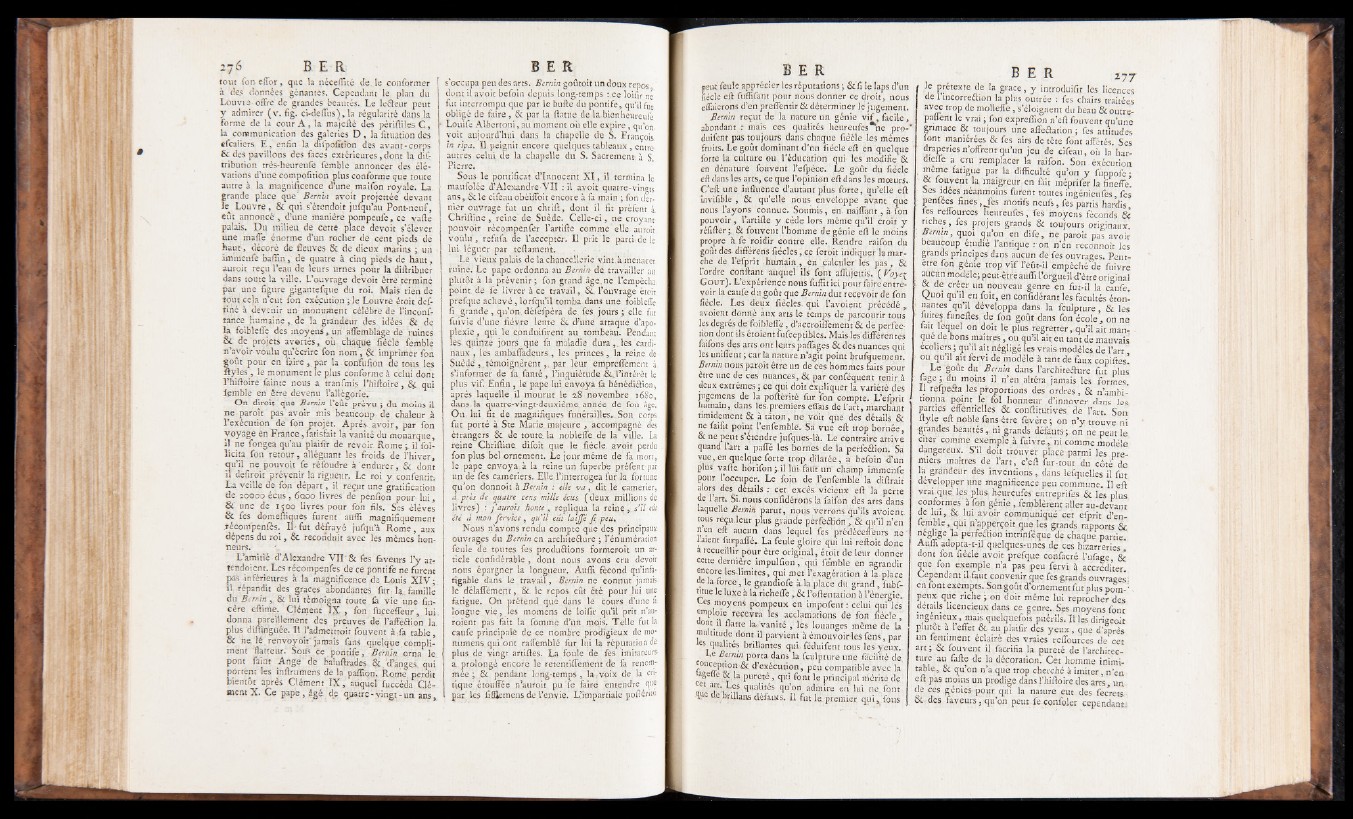
276 B E R
tout fou effor, que la néceflité de. le conformer
à des données gênantes. Cependant le plan du
Louvre- offre de grandes beautés.. Le leéteur peut
y admirer (v. fig. ci-defïùs), la régularité dans la
Forme de la cour A , la majefté des périodes C ,
la communication des galeries D , la fituation des
efcaliers E , enfin la dilpolîtion dès avant-corps
& des pavillons des faces extérieures, dont la distribution
très-heureufè femme annoncer des élévations
d’une compofition plus conforme que toute
autre à la magnificence d’une. maifôn royale. La.
grande place que' Bernin avoit projettée devant
le Louvre, & qui s’êtendoit jufqu’àu Pont-neuf,
eût annoncé, d’une manière pompeufe, ce vafte
palais. Du milieu de cette place devoit s’élever,
une maffe énorme d’un rocher de cent pieds de
haut-, décoré de fleuves 8c de dieux marins ; un
im'menfe badin, de quatre à cinq pieds de haut,
auroit reçu Peau de leurs urnes pour la diftribuer
dans toute la ville. L’ouvrage devoit être terminé
par une figure gigantefque du roi. Mais rien de
tout cela n’eut fon exécution ;le Louvre étoit def-
tiné à devenir un monument célébré de l’inçonf-
tance humaine ,. de la grandeur des idées .& de
la foiblefle des moyens , un aflemblage de ruines.
& de projets avortés, où chaque fièclé femble
n’avoir voulu qu’écrire fon nom , 8c imprimer fpn
goût pour en faire,.par la confufion de tous les
ftyles , le monument le plus conforme à celui.dont
l ’hiftoire fainte nous a tran finis l’hiftoire, 8c qui
femble en être.devenu l’allégorie.^
On diroit que Bernin l’eut prévu ; du moins il
ne paroît pas avoir mis beaucoup-de chaleur à
l’exécution de fon projet. Après avoir, par fon
voyage èn France, fatisfait la vanité du monarque,
il ne fongea qu’au plaifir de revoir Rome il foi-
licita fon retour , alléguant les froids de l’hiver,
qu’il ne pou voit fe réfoudre à endurer, & dont
il dèfiroit prévenir la rigueur. Le roi y confenrit?
La veille de fon départ, il reçut une gratification
de 20000 écus , 6ooo livres de penfiçn pour- lui,
& une de 1500 livres pour fon fils. Ses élèves
& fës domeftiques furent aufli magnifiquement
jrécompenfés. IL fut défrayé jufqua Rome, aux
dépens du roi, 8c. fécondait avec les mêmes honneurs.
L’amitié d’Alexandre VII’ & fes faveurs l’y at?
fendoient. Les récompenfes de ce pontife ne furent
pas-inférieures à la magnificence de Louis XIV \
il répandit des grâces abondantes fur. la. famille
du Berrùn ,. & lui témoigna toute (a vie une fin-
cère eftime. Clément IX , fon fii.çceffeur, lui
donna pareillement des preuves dé PafFéélion la.
plus diftinguéè. Il Padmetttoit fouvent à ;fa table,
& ne, lé renvoyôit jamais fans quelque compliment
flatteur. Sous ce pontife, Bernin orna le
pont faint Angë! dé baluftrades 8c d’anges, qui
portent les inftrumens de la paflaonl. Rome, perdit
bientôt après Clément IX , auquel fuccéda Clé-
ment X. Ce pape, âge de quatre-vingt-un. ans,
B E R
s’occupa peu des arts. Berrùn goûtoit un doux repos
dont il avoit befoin depuis long-temps :.ce loiflr ne
fut interrompu que par le bufte du pontife, qu’il fut
obligé de faire, & par la ftatue de la.bienheureufe
Louife Albertoni, au moment où elle expire, qu’on,
voit aujourd’hui dans la chapelle de S. François
in ripa. Il peignit encore quelques tableaux, entre-
autres celui, de la chapelle du S. Sacrement à S.
Pierre.
Sous le pontifjcat d’innocent X I , il termina le
maufolée d’Alexandre VII : il avoit quatre-vingts
ans, & le cifeau obèiflbit encore à fa main ;.fon dernier
ouvrage fut un chrift, dont il fit préfent à
Chrifline, reine de Suè.de. Celle-ci, ne croyant
pouvoir récompenfer l’artifte comme elle auroit
voulu, refufa de l’accepter. Il prit*le partiide le
lui léguer par teftament.
Le vieux palais de la chancellerie vint.à.menaccr
ruine.' Le pape ordonna au Berrùn de travailler au
plutôt à la prévenir; fon grand âge.ne l’empêcha
point de fe livrer à ce travail, 8c. l’ouvrage étoit
prefque achevé, lorfqu’iTtomba.dans une foiblefle.
fi. grande , qu’on-, défefpéra de. fes jours ; elle fut
fuivie d’une fièvre lente 8c d’une attaque d’apoplexie,
qui. le conduisirent, au tombeau. Pendant
les. quinze jours que fa maladie dura,.les cardinaux
, les ambaffadeurs., les princes, la reine de
Suède'^témoignèrent ,. par leur emprefîement à
s’informer de fa famé , l’inquiétude 8c. l’intérêt le
; plus vif. Enfin , le pape lui envoya fa bénédi&ion,
| après laquelle il mourut le 2.8 novembre 1680,
dans la quatre-vingt-deuxième, année de fon âge.
On. lui fit de magnifiques funérailles*. Son corps
fut porté à Ste. Marie, majeure , accompagné des
étrangers 8c de toute la noblefie.de la ville. La
reine Chriftioe. difoit que le fiècle. avoir perdu
fon plus bel ornement. Le jour même de fa mort,
le pape, envoya;;à la reine un fuperbe préfent pair
un de fes cameriers. Elle, l’interrogea fur la. fortune
qu’on donnoit à Bernin : elle va, dit.le çamerier,
à près de quatre cens mille écus (deux millions de
livres-) : j'aurais honte , répliqua la rein è s'il eût.
été à mon fervice , qu'il eùt laijje Jî peu*
Nous n’avons rendu compte que dés principaux
ouvrages du Bernin en ardiiteéhire ; rénumération
feule de toutes fes productions formeroit un article
confidérable, dont nous avons cru devoir
nous épargner la longueur. Aufli. fécond qu’infatigable
dans le travail, Berrùn ne connut jamais,
le délaffément, 8c le repos eût été pour lui une
fatigue. On prétend que dans le cours d’une fi
longue v ie, les momens de loifir qu’il prit n’au-
rojent pas fait la fomme d’un. mois. Telle fut la
caüfe principale de ce nombre prodigieux de mo-
nu mens qui ont raffemblé fur lui la réputation de
plus de vingt artiftes. La foule de fes . imitateurs,
a. prolongé encore le retentiflement de fa renommée
; 8c. pendant long-temps, la,voix de la critique
étouffée n’auroit pu Te faire entendre çjw
par. les lifflemens de l’envie. L’impartiale poflériw
B E R
peut feule apprécier les réputations ; 8c’fi le laps d’un
fiècle eft fuffifant pour nous donner ce droit, nous
effaierons d’en preflentir 8c déterminer le jugement.
Bernin reçut de la nature un génie vif, facile,
abondant .- mais ces qualités heureufes *ne pro-’
duifent pas toujours dans chaque fiècle les mêmes
fruits. Le goût dominant d’un fiècle eft èn quelque
forte la culture ou, l'éducation qui les modifie 8c
en dénature fouvent l’efpèce. Le goût du fiècle
eft dans les arts, ce que l’opinion eft dans les moeurs-
C*eft. une influence d’autant plus forte, qu’elle eft
ùivifible , 8c qu’elle nous enveloppe avant que
nous l’ayons connue. Soumis, en. naiflant, à;fon
pouvoir , l’artifte y cède lors même qù’iT croit y
réfifter;. 8c fouvent l’homme de génie eft le moins
propre à.fe roidir contre elle. Rendre raifon du
goût des différens fiècles ,.ce feroit indiquer la marche
de l’efprit .humain , èn ‘calculer lè's pas , 8c
Tordre confiant auquel ils font aflùjettis. {Foyer
Goût). L’expérience nous fuffit ici pour faire entrevoir
la caufe du goût que Bernin dut recevoir de fon
fiècle. Les deux fiècles. qui Tavoient précédé,,
avoient donné aux arts le temps de parcourir tous
les degrés de foiblefle, d’accroiffement 8c dè perfection
dont ils étoientlufceptibles. Mais-les'diffé rentes
faifons des arts ont leurs paflages 8çdès nuances qui
les unifient ; car la nature.ir’âgit point brufquement.
Bernin nous paroît être, un de ces hommes faits pour
être une de ces nuances, ,8ç par conféquent tenir à
deux extremes ; ce qui doit.éxpliquer la variété des j
jugèmens de la poftérité fur. fon compte. L’efprit ;
humain, clans les.premiér-s efîais de l’art, marchant
timidement 8c à tâton , ne voit que dés détails 8c
ne faifit point Tenfemblé. Sa vue eft trop bornée,
& ne peut s’étendre jufques-là. Le contraire arrive
quand l!art a paffé les bornes dé la perfeâiôri. Sa
vue, en quelque forte trop dilatée, a befoin d’un
plus vafte horifon il Îiîi-, faut lin champ immenfe
pour l’occuper. Le foin de Tenfemble la diftrait
alors des détails r cet. excès, vicieux eft la perte
de 1 artw Si, nous confidérons la faifon des arts dans
laquelle Bernin parut, nous verrons qu’ils avoient
tous reçu.leur plus grande gèrfeâibn , & qu’il n’en
nen eft aucun dans lequel Tes prédécefleurs ne
l aient furpaffé. La feule gloire qui lui reftoit donc
a recueillir pour être original, étoit de leur donner,
cette dernière impulfionqui femble en agrandir
encore les-limites, qui met l’exagération à la,place
de la force, le grandiofe à.la.place dii grand, fubf-
tuue le luxe à la richeffe ,.8c l’oftentation à Ténergie..
Les moyens pompeux en impofent : celui qui lès
emploie recevra les acclamations de fon fiècle,
ont il flatte la; vanité , les louanges même de la
multitude dont il parvient à émouvoir-les fens, par
fes qualités brillantes qui. féduifent tous les yeux-
Le Bernin porta dans la fculpture une facilité de,
J0nc^Pj?n & d’exécution, peu compatible avec la
âge fe oc la pureté, qui font le principal mérite de
et art*.Les qualités qu’on admire en lui ne. font
que ilè brillans défauts. Il fut le premier qui^Tous
B E R 2 7 7
le prétexte de la grâce, y introduifit les licences
de l’incorredion la plus outrée : fes chairs traitées
avec trop de mollefle, s’éloignent du beau 8c outre-
pailent le vrai ; fon expreflion n’eft fouvent qu’une
grimace 8c toujours une affe&ation ; fes attitudes
font maniérées 8c fes airs de tête font affétés. Ses
ÿaperiesn’offrenrqu’un jeu de cifeau, où la har-
diefre a cru remplacer k raifon. Son exécution
meme fatigue par la difficulté qu’on y fuppofe:
& fouvent h maigreur en fait méprifer la fineffe.
oes idées néanmoins furent toutes ingénieufes, fes
: penfées fines, Jes motifs neufs, fes partis hardis,
fes reffources heureufes, fes moyens féconds 8c
rî chev» fes Pr°jets grands 8c toujours originaux.
. Bernm, quoi qu’on en dife, ne paroît pas avoir
bèauêoup étudié l’antique : on n’en reconnoît les
grands principes dans aucun de fes ouvrages. Peut-
être fon génie trop vif l’eût-il empêché de fuivre
aucun modèle; peut-être aufli l’orgueil d’être original
5 5 cr;fer un nouveau genre en fut-il la caufe.
Quoi qu’il en Toit, en confidérant les facultés éton-
; nantes qtfil développa dans la fculpture, 8c les
1 “ uteç funeftes de fon goût dans fon école, on ne
fait lequel on doit lé plus regretter, qu’il ait man-
que de bons maîtres, ou qu’il ait eu tant de mauvais
ecohers; qu’il ait négligé les vrais modèles de l’art
> ou qu’il ait fervi de modèle à tant de faux copiftes!
Le goût du Bernin dans l’architeélure fut plus
i-du moins il n’en altéra, jamais les formes.
Il refpe&a les proportions des ordres, 8c n’ambitionna
point le fol honneur d’innover dans les.
parties éflenriellês. 8c conftitutives dé l’art. Son
ftyle eft noble fans être fêvère ; on n’y trouve ni
-grandes beautés ,, ni grands défauts ;, on ne peut le
citer comme exemple à fuivre.," ni comme modèle
dangereux. S’il doit trouver place parmi les premiers
maîtres de l’art, c’eft fur-tout du côté de
Ta gràùdêur des inventions, dans lefquelles il fut
développer une magnificence peu commune. Il eft
vraTque. les plus heureufes entreprifes 8c les plus
conformes à fon génie j femblèrent aller au-devant
de lui, 8c lui avoir communiqué cet efprit d’en-
femblé ,. qüi u’apperçoit que les grands rapports &
néglige Ja perfeéljon intrinlèque de chaque partie.
Aufli adopta-t-il quelques.-unes de ces bizarreries *
dont fon fiècle avoit prefque confacré l’ufage, 8c
que fon exemple n a pas peu fervi à accréditer.
Cependant ihfaut convenir que fes grands ouvrages:
en font exempts. Songout d’ornement fut plus pom- '
peux- que riche ; ori doit même lui reprocher des
détails licencieux dans ce genre.: Ses moyens font
ingénieux , mais quelquefois puérils. Il les dirigeoit
plutôt à l’effet 8c au plaifir des yeux , que d’après
un fentiment éclairé des vraies reffources de cet
art; 8c fouvent il facrifia la pureté de l’architecture
au fafte-tle la décoration. Cet homme inimitable,
8c qu’on n’a que trop cherché à imiter, n’en
eft pas moins un prodige dans Thiftoire des arts, un
de ces .génies-pour qui la nature eut des fecrets
8c. des faveurs, qu’on peut Te.confoler cependant^