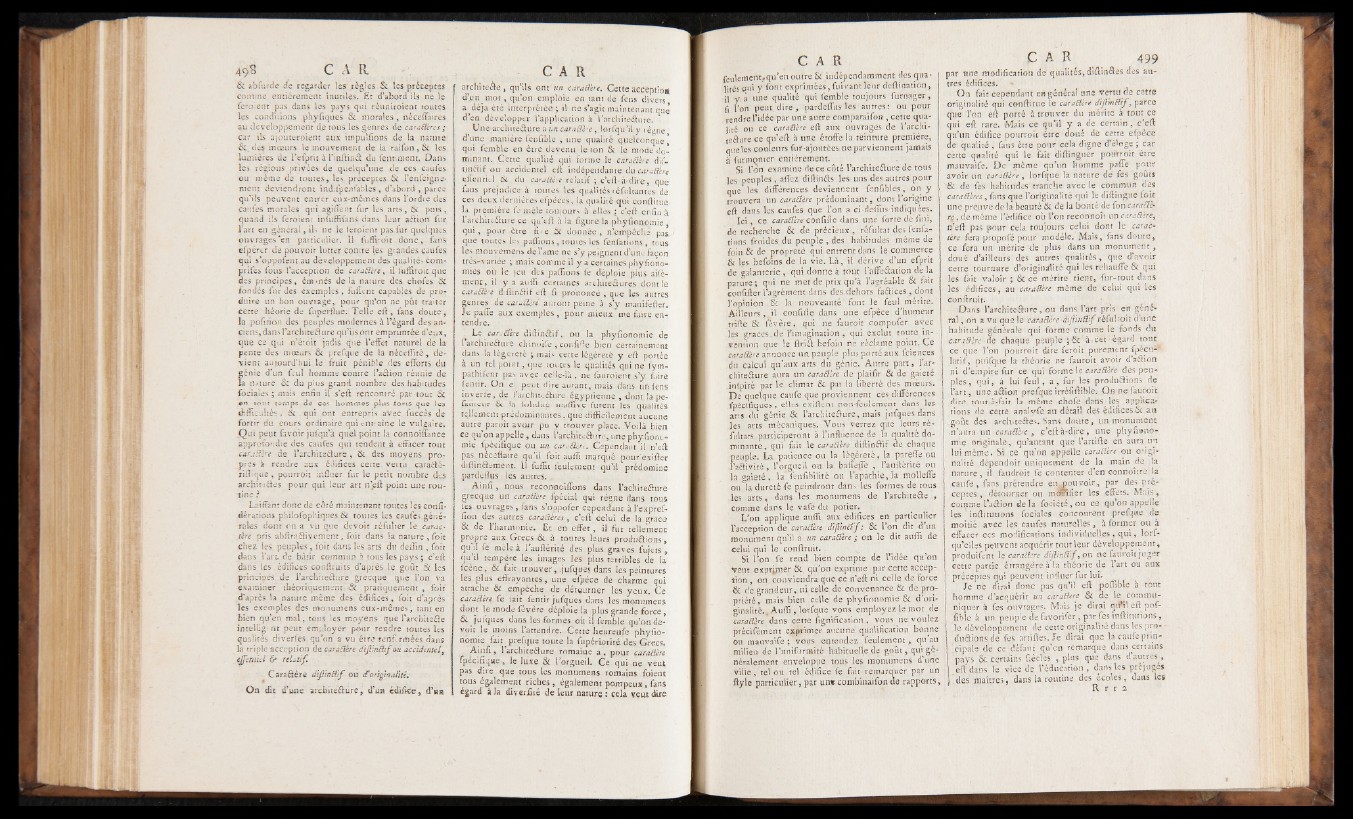
& abfurde de regarder les règles & les préceptes
comme entièrement inutiles. Et d’abord ils ne le
feraient pas dans les pays qui réuniroient routes
les conditions phyfiques & morales , néceflaires
au développement d> tous les genres de caractères ;
car ils ajouteroient aux impuliions de la nature;
& . des moeurs le mouvement de la raifon , & les
lumières de l ’elprit à l’ inftinél du fentiment. Dans
les régions privées de quelqu’une de ces caufes
ou même de toutes, les préceptes & l’enfeigne-
ment deviendront indifpenfables, d’abord , parce
qu’ils peuvent entrer eux-mêmes dans l’ordre des
caufes morales qui a giflent fur les arts, & puis ,
quand ils feroiem inluffifans dans leur aélion fur
l ’art en général, ils ne le f&roient pas. fur quelques
ouv rag e s’en particulier. 11 fuffiroit don c , fans
elpérer de pouvoir lutter contre les grandes caufes
qui s’oppofent au développement des qualité* com-
prifes fous l’acception de caractère, il luffiroit que
des principes, ém més de la nature des chofes- &
fondés fur des exemples, fufîent capables de produire
un bon ouvrage, pour qu’on ne pût traiter
cette héorie de fuperflue. Te lle e f t , fans dou te,
la pofrtion des peuples modernes à l’égard des anciens,
dans l’architetlure qu’ ils ont empruntée d’eux,
que ce qui n’étoit jadis que l’effet naturel de la
pente des moeurs & prefque de la néeeffité, devient
aujourd’hui le fruit pénible des efforts du
génie d’un feu! homme contre l’aâion réunie de
la nature & du plus grand nombre des habitudes
fociales ; mais enfin il s’eft rencontré par tout & j
en tout temps de ces hommes plus forts que les
difficultés-'; ce qui ont entrepris avec fuccès de
fortir du cours ordinaire qui cnn aine le vulgaire.
Q u i peut favori jufqu’à quel point la connoiffance
approfondie des caufes qui tendent à effacer tout
caractère de Parchite&ure , & des moyens propres
à rendre aux édifices cette veitu caraéfé-
riftique, pottrroit influer fur le petit nombre des
architoéles pour qui leur art n’eft point une rou-
-tine ?
Laiflant donc de côté maintenant toutes les-confi-
dérarions pbilofbphiques & toutes les caufe; générales
dont on a vu que devoit jé fulter le caractère
pris abftraélivement, foit dans la nature , foit
chez les. peuples, foit dans les arts du deiîin , foit
dans l’art de bâtir commun à tous les pays ; c’eft ;
dans les édifices conftruits d’après le goût & les I
principes de i’architeéhire grecque que l’on va
examiner théoriquement -& pratiquement , foit
d’après la nature même des édifices, foit d’après
les exemples des monumens eux-mêmes, tant en
bien qu’en mal, tons les moyens .que l’architefte
intelligent peut employer pour rendre toutes les
qualités diverfes qu’on a vu être renfermées dans
la triple acception de caractère difllnClifou accidentel
eJJ'endel & relatif.
Caractère difiinClif ou cloriginalité.
O n dit d’une architéd üre, d’un éd ifice , d’ un
architecte, qu’ ils ont k/i caractère. Cette acception
d’pn m o t , qu’on emploie en tant de fens divers
a déjà été interprétée ; il ne s’agit maintenant,que
d’en développer l’application à l’architeélure.
Une architeéftire a un caraClè-e, lorfqu’il y tègne '
d’une manière fenfible , une qualité quelconque,
qui femble en être devenu le ton & le mode dominant.
Cette qualité qui forme le caractère dif-
tinétif ou accidentel eft indépendante du caractère
eilenticl & du caractère relatif ; c’eft-à-dire, que
fans préjudice à toutes les qualités.! éfultanrcs de
ces deux dernières efpèces-, la qualité qui. conftitue
la première te mêle toujours à elles : c’eft enfin à
rarcliucérure ce qu’eft à la figure la pbÿfiojgpmie,
q u i , pour être fixe & donnée, n’empêché pas.J
que toutes les paffions , toutes les fenfations, tous
les.mouvemens del’ame ne s’y peignent d’une façon
très-variée ; mais comme il y a certaines phyfiono-
mies oit le jeu des paffions fe déploie plus aifé-
ment, il y a aufli certaines architedlures dont le
caraClère d ftmélif eft fi prononcé , que les autres
genres de caraClèré auront peine à s’y manifefter.
Je paffe aux exemples , pour mieux me faire en-,
tendre.
Le caraCtèrê diftinélif, ou la phyfionomie de
l’architeélure chinoife , confifte bien certainement
dans la légèreté ; mais cette légèreté y eft portée
à un tel poin t, que toutes le qualités qui ne fym-
pathifent pas avec cefle-là. ne fa-ur oient s’y faire
Jenrir. On ei. peut dire autant, mais dans un fens
tn ve r le , de i’aichueéhire égyptienne , dont la pe-
fanteur & la folidite maffive furent les qualités
tellement prédominantes. que difficilement aucune
autre paroît avo ir pu y trouver place. Voilà bien
ce qu’on appelle, dans l’archite&ure, une phyfionc-
mie fpéeiflque ou un caraCtère. Cependant il n’eft
pas néceflaire qu’il foit aufli marqué pourexifter
diftinéiement. Il fuffit feulement qu’il prédomine
pardeflus lés autres. ,
A in f i , nous reconnoiffons dans l’achireélure
grecque un caratlère fpécial qui règne dans tous
lès ouvrages , fans s’oppofer cependant à l’expref-
fion des autres caractères , c’eft- celui de la grâce
& de l ’harmonie. Et en e f fe t , il fut tellement
propre aux Grecs & a toutes leurs produirions,
qu’tl fe mêle à l’auftérité des plus graves fujets ,
qu’il tempère les images les plus terribles de la
fcèn e , & fait trou ver, -jufques dans les peintures
les plus effrayantes, une efpèce de charme qui
| attache & empêche de détourner les y eu x . Ce
caractère fe fait fentir jufques dans les monumens
dont le mode fevère déploie la plus grande forc e ,
& jufques dans les formes ou il femble qu’on de-
voit le moins l’attendre. Cette heureufe phyfionomie
fait prefque toute la fupérlorité des Grecs*
A in f i , l’archite&ure romaine a , pour caraClère
fpécifique , le luxe & l’orgueil. C e qui ne veut
pas dire que tous les monumens romains, foient
tous également riches, également pompeux, fans
egard à la diverfiié de leur nature î cela veut dire
feulement/qu’en outre & indépendamment des qualités
oui y font exprimées, fui vaut leur deftination,
il y. à une qualité qui femble toujours furnager,
fi l’on peut, d i r e , pardeffus les autres: ou pour
rendre l’ idée par une autre comparaifon , cette qualité
ou ce caraClère eft aux ouvragés de l ’archi-
tefture ce qu’eft à une étoffe la teinture première,
que les couleurs fur-ajoutées ne parviennent jamais
à furmonter entièrement.
Si l’on examine de ce côté l’architeéhire de tous
les peuples , affez diftin&s les uns des autres pour
que les différences deviennent fenftbles, on y
trouvera un caractère prédominant, dont l ’origine
eft dans les caufes que l’on a ci-deflus indiquées.
Ici , ce caraClère conftfte dans une forte dé fini,
de recherche & de précieux , réfultat des fenfations
froides du peuple , des habitudes même de
foin & de propreté qui entrent dans le commerce
& les befdins de la vie. L à , il dérive d’un efprit
de galanterie , qui donne à tout l'affectation de la
parure; qui ne met de prix qu’à l’agréable & fait
eonfifter l’agrément dans des dehors faétices , dont
l’opinion & la nouveauté font le feul mérite.
Ailleurs , il conftfte dans une efpèce d’humeur
trîfte & fé v è re , qui ne fauroit compofer avec
les graces.de ^imagination , qui exclut toute invention
que le ftriCt befoin ne réclame point. Ce
caraClère annonce un peuple plus porté aux fciences
du calcul qu’aux arts du génie. Autre part, 1?architecture
aura un caraClère. de plaifir & de gaieté
in (pire par le climat & pat la liberté des moeurs.
De quelque caufe que proviennent cçs différences
fpècifiques, elles exiftent non-feulement dans les
arts- du génie & l’architeâure, mais jufques dans
les arts mécaniques. Vous verrez que leurs ré-
fnltars. participeront à l’ influence de la qualité dominante
, qui fait le caraClère diftinétif de chaque
peuple. La patience ou la légèreté, la parefle ou
l’aétiviité , l ’orgueil on la baffeffe , ï’anftérité ou
la g aieté, la'l'enfibilité ou l’apathie, la molleffe
ou la dureté fe peindront dans les formes de tous
les a r ts , dans les monumens de l’architeéte ,
comme dans le vafe du potier.
L ’on applique aufli aux édifices en particulier
l’acception de caraClère d ijlinCtf : & 1 on dit d un
monument qu’il a , un caraClère ; on le dit aufli de
celui qui le conftruit.
Si l ’on fe rend bien compte de l’ idée qu’on
veut exprimer & qu’on exprime par cette acception
, on conviendra que ce n’eft ni celle de force
& de grandeur, ni celle de convenance & de propriété,
mais bien celle de phyfionomie' & d ’originalité..
Aufli , lorfque vous employez le mot de
caraClère dans cette lignification , vous ne voulez
précifément exprimer aucune qualification bonne
ou mauvaife ; vous entendez feulement, qu’au
milieu de l’unifbrrRité Habituelle de g o û t , qui g é néralement
enveloppe tous les monumens d’une
v ille , tel ou tel édifice fe fait remarquer par un
ftyle particulier, par un* combinaifonaa rapports,
par tine modification de qualités, diftin&es des autres
édifices.
O n fait cependant en général uns vertu de cette
originalité qui conftitue le caraClère dijlinClif, parce
que l’on eft porté à trouver du mérite à tout ce
qui eft rare. Mais ce qu’il y a de certain, c ’eft
qtt’un édifice pottrroit être doué dé cette efpècè
de qualité , fans être pour cela digne d’éloge ; car
cette qualité qui le fait diftinguer poüVroit être
mauvaife. D e même qu’un homme paffe poitr
avoir un caractère, lorfque la nature dé fes goûts
de fes habitudes tranche avec le commun dès
caradères, fans que l’originalité qui lé diftingue foit
une prejive de la beauté & de la bonté de fon caraCtè-
re, de. même l’édifice oit l’on reeonnoît un caraClère,
n’eft pas pour cela toujours celui dont le caractère
fera propofé pour modèle. M ais , fans dou te ,
ce fera un mérite de plus dans un monument ,
doué d’ailleurs des autres qualités, que d’avoir
cette tournure d’originÆté qui les rehaufle & qui
les fait valoir ; & ce mérire rient, fur-tout dans
les édifices, au caraClère même de celui qui les
conftruit.
Dans l’architeéhire, où dans l’art pris en général
, on a vu que le caraClère-dijlinClif réfulroit d une
habitude générale qui formé comme le fonds du
caractère dç chaque peuplé $ '& à-, oet égard tout
ce que l’on pourrait dire feroit purement fpécu-'
la tif, puifque la théorie ne fauroit avoir d’aélion
ni d’empire fur ce qui forme le caraClère des peup
le s , qui, à lui feul , a , fur les produirions de
l’a r t , une aérion prefqueirréfiftible. On ne fauroit
dire tout-àrfait la même chofe dans les applications
de cette analvfe au détail des édifices & au
goût des architectes. Sçtns dou te , un monument
n’aura un caraClère , c ’eft à -dire, une phyfiano-
mie originale., qu’autant que l’artifte en aura un
lui même. Si ce qu’on appelle caraClère ou originalité
dépendoit uniquement de la main de la
nature, il faudrôit fe contenter d’en connoître la
caufe , fans prétendre en mouvoir-;, par des préceptes
, détourner ou modifier les effets. Mais ,
comme l’airion de là foc iété, ou ce qu’on appelle
les ' ihftitutions fociales concourent prefque de
moitié avec les caufes naturelles, à former ou à
effacer ces modifications individuelles , q u i , lorf-
qu’elles peuvent acquérir tout leur développement,
produifent le c arallere difiinClif, on ne fauroit juger
cette partie étrangère à la théorie de l’art ou aux
préceptes qui peuvent influer fur lui.
Je ne dirai donc pas qu’ il eft pofîible à tout
homme d ’acquérir un càraCtere & de le communiquer
à fes ouvrages. Mais je dirai qtï?il eft pofi-
fible à un peup’e de favorifer, par fes inftitutions,
le développement de cette originalité dans les pro- -
duilions de fes arriftes. Je dirai que la caufe principale
de ce défaut qu’en remarque dans certains
pays & certains fiècles , plus que dans cl autres ,
eft dans le vice de l’éducation, dans les préjuges
des maîtres, dans la routine des é c o le s , dans les
R r r 2