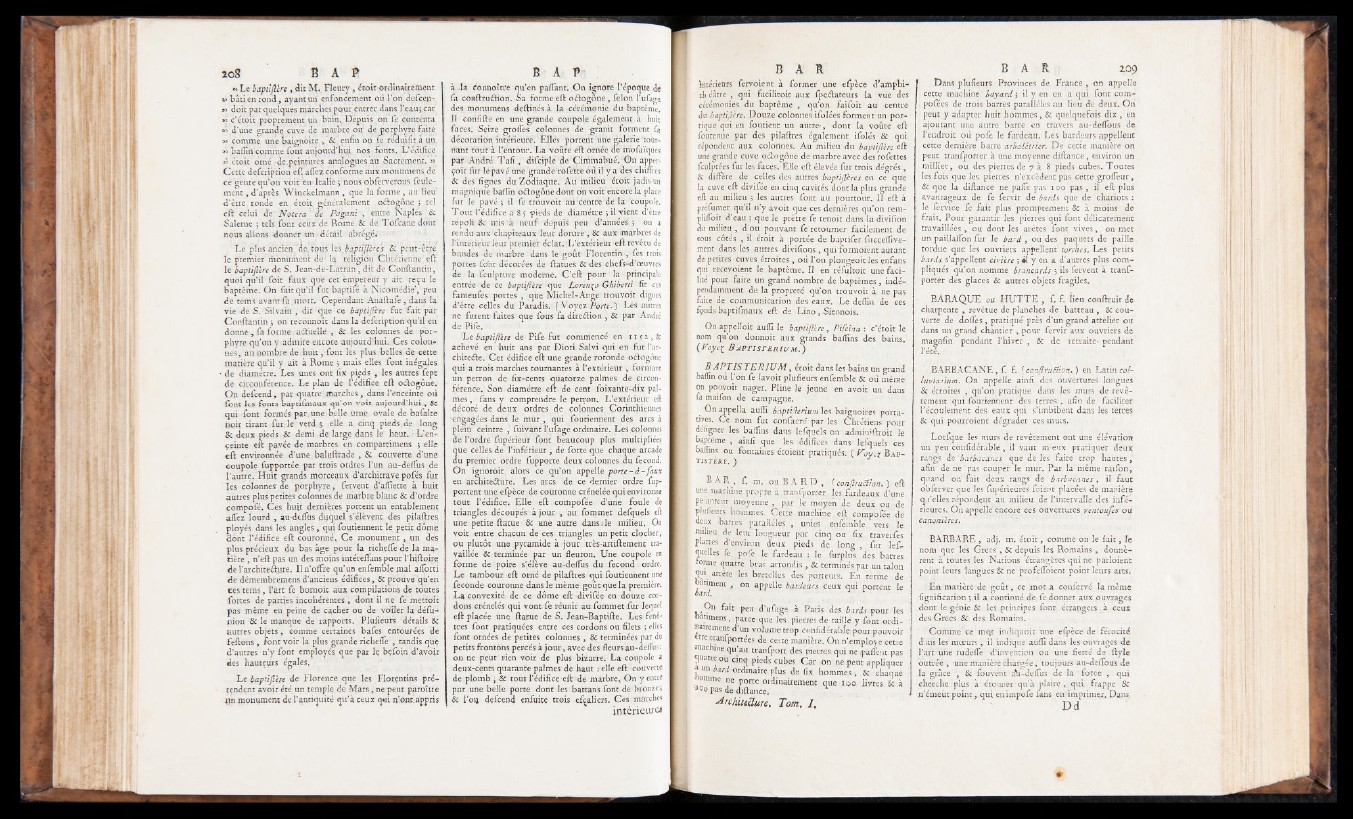
îoS B A P
<cLe baptijlère , dit M . F leury, étoit ordinairement
bâti en rond, ayant un enfoncement où l’on defcen-
» doit par quelques marches pour, entrer dans l’eauj.çar
sa c’ étoit proprement un bain.. Depuis on le çoriténta
as d’une grande cuye de marbre ou' de porphyre faite
m comme une baignoire, Sç enfin on Te redujfit à un
m baltîri comme font aujourd’hui nos fonts. L ’édifice
33 étoit orné de.pçintùres analogues au Sacrement. »
Cette description ef. a fiez conforme aux monumens de
ce genre qu’on voit en Italie j nous obferverons feulement
, d’après Winckelmann, que la forme , au liéu'
d’être, ronde en étoit, généralement oétogône j.jtel
eft celui de Nocera. de Pagani , entre Nàplés' &
Salerne ; tels font ceux dé Rome & dé Tofcane dont
nous allons donner un détail abrège.- ■ ■ 1
L e plus ancien/de-, tous les baptîjlères 8c peut-être
le premier monument de ta religion Chrétienne eft
le baptijlère de S. Jean-de-Latran, dit de Cpnftantin,
quoi qu’il foit faux que cet èmpérëür y ait reçu le
baptême. On fait qu’il fut baptifé à Nicomédie’, peu
de tems avant fa .mort. Cependant Ahaftafe , dans la
vie de S. Silvaîn , dit que ce baptijlère fut fait par
Conftantin ; on reconnoît dans la defcription qu’il en
donne, fa forme aétüeilê , & les colonnes de porphyre
qu’on y admire encore aujourd'hui. Ces colonnes,
au nombre de huit,-font les plus belles de cette
matière qu’il y ait à Rome ; mais elles font inégales
de diamètre. Les unes ont fix pieds , les autres fept
de circonférence. Le plan de l’édifice eft o&ogône.
O n defcend, par quatre' m arches, dans l’enceinte où
font les fonts baptifmaux qu’on voit aujourd’h u i , &
qui font formés-par.une belle urne ovale de bafalte
noir tirant fur; le verd.s .elle a cinq pieds.de long
& deux pieds • & demi de large dans le haut. ; L ’en-
çpinte eft pavée de marbres en compartimens > elle
eft environnée d’une baluftrade , & couverte d’une
coupole fupportée par trois ordres l’un au-deflùs de
l’autre. Huit grands morceaux d’architrave pofés fur
les colonnes de p.orphyre, fervçnt d’aflîette à huit
autres plus petites colonnes de marbre blanc & d’ordre
çompofé. Ces huit dernières portent un èntablement
aflez lourd , au-deflùs duquel s’élèvent des pilaftres
ployés dans les angles , qui foutiennent le petit domè
dont l’ édifice eft couronné, C e monument , un des
plus précieux du bas âge pour la richpfle de la matière
, n’eft pas un des moins intéreflans pour l’hiftoire
de l’architefture. Il n’offre qu’ un enfemble mal aflorti
de démembremens d’anciens édifices, & prouve qù’en
ces tems, l’art fe bornoit aux compilations de toutes
fortes de parties incohérentes , dont il né fe mçttoït
pas même en peine de cacher ou de vdfier la défü-
nion & le manque de rapports. Plufieurs détails &
autres objets, comme certaines bafes entourées de
feftons , font voir la plus grande richefle , tandis que
d’autres n’y font employés que par le befoin d’avoir
des hauteurs ég a le s ,,
Le baptijlère de Florence que les Florentins pré-r
tendent avoir été un temple de Mars, ne peut paroiue
un monument de l’antiquité qu’à ceux qui mont,appris
B A P
à la fomioîti'e qu’en paflant. On ignore l*époque de
fa conftru£tion. Sa forme eft oélogone, félon l’ufage
des, mpnumens deftinés à la cérémonie du baptême.
Il coiififte en une grande coupole également, à huit
faeçs. Seize grofles colonnes de grapit forment fa
décoration intérieure. Elle’s portent une galerie tournant
tout à l’entour/La voûte eft ornée de mpfaïques
par-Aiidré T a fi , difciple de Çimmabué. On apper-
çoïc fur lé pavé une grande:rôfettè où il y* a des chiffres
& des fignes du Zodiaque. Au milieu étoit jadis un
magnique baftin o&ogône dont on voit encore la place
fur le pavé ; il fe trouvoit au'centre dé la coupole.
Tout l’édifice a 8 j pieds de diamètre ; il vient d’être
repoli 8c mis à neuf depuis peu d’année^ ; on a
rendu aux chapiteaux leur dorure , & aux «marbres de
l'intérieur leur premier éclat. L ’extérieur eft revêtu de
bandes de marbre dans le goût Florentin •, fes trois
portes font décorées de ftatues & dès chefs-d’oeuvres
de - la fculpture moderne. C ’eft pour la principale
entrée de ce baptijlère que Lorènço Ghiberti fit ces
fameufes portes , qüe Michel-Ange trouvoit dignes
d’être celles du Paradis. (V o y e z Porte.j Les autres
ne furent faites que fous fa direction,- 8c par André
de Pile.
‘Le baptijlère de Pife fut commencé en i i y z ,&
achevé en huit ans par Dioti Salvi qui en fut l’ar-
chiteéte. Ce t édifice eft une grande rotonde o&ogône
qui a trois marches tournantes à l’extérieur , formant
un perron de fix-cents quatorze palmes de circonférence.
Son diamètre - eft de cent foixante-dix palmes
, fans y comprendre le perron. L ’extérieur eft
décoré de deux ordres de colonnes Corinthiennes
•engagées dans le mur , qui foutiennent des arcs à
plein ceintre , fuivant l’ufage ordinaire. Les colonnes
de Tordre fupérieur font beaucoup plus multipliées
que celles de l’ inférieur , de forte que chaque arcade
du premier ordre fupporte deux colonnes du fécond.
On ignoroit alors ce qu’on appelle porte-à-faux
en architefture. Les arcs de ce dernier ordre fup-
portent une efpèce de couronne crénelée qui environne
tout l’édifîcej Elle eft compofée d’une foule de
triangles découpés à jour ., au fommet defquels eft
une petite ftatue & une autre danse le milieu. On
voit entre chacun dé ces triangles un petit clocher,
pu plutôt une pyramide à jour très-artiftement travaillée
& terminée par un fleuron. Une coupole en
forme de poire s’élève au-deflùs du fécond . ordre.
Le tambour ;eft omé de pilaftres qui foutiennent une
iecpnde couronne dans le même goût que la première.
L a convexité de ce dôme eft divifée en douze cordons
crénelés qui vont fe réunir au fommet fur lequel
eft placée une ftatue de S. Jean-Baptifte. Les fenêtres
font pratiquées entre ces cordons ou filets ; elles
font ornées de petites colonnes , & terminées par de
petits frontons percés à jou r, avec des fleurs au-deflùs:
on ne peut rien voir de plus bizarre. L a coupole a
deux-cents quarante palmes de haut : elle eft couverte
de plomb , & tout l’édifice eft de marbre, On y entre
par une belle porte dont les battans font de bronze;
& l'oii defcend enfuite trois efçaliers. Ces marches
intérieure8
B A B
Intérieurs fervoient à former une efpèce d’amphi-
rh éâtre , qui facilitoit aux fpeiftateurs la vue des
cérémonies du baptême , qu’on faifoit au centre
du baptijlère. Douze colonnes ifolées forment un portique
qui en foutient un autre-, dont la voûte eft
foutenue par des pilaftres également ifolés & qui
répondent aux colortnes. Au milieu du baptijlère eft
une grande cuve odlogônè de marbre avec des roféttes
fculptées fur les faces. Elle eft élevée fur trois degrés ,
& diffère de celles des autres bapùjîères en ce que
la cuve eft divifée en cinq cavités dont la plus grande
eft au milieu ; les autres font au pourtour. Il eft à
préfu mer qu’il n’y avoit que ces dernières qu’on rern-
plilToit d’eau ; que le prêtre fe tenoit dans la divifion
du milieu , d'ou pouvant fe retourner facilement de
tous côtés , il étoit à portée de baptifer fueceflïve-
ment dans les autres divi fions , qui formoient autant
de petites cuves étroites , où l’on plongeoit les enfans
qui recevoient le baptême. II en réfultoit une facilité
pour faire un grand nombre de baptêmes, indépendamment
de la propreté qu’on trouvoit à ne pas
faire de communication des eaux. Le deflin de ces
fonds baptifmaux eft de Lino , Siennois.
On appelloit aufli le baptijlère, Pifcina: c’étoit le
nom qu on donnoit aux grands baflins des bains.
(Poyei BAPTISTERIUM.)
B A P T IS T E R JU M , étoit dans les bains un grand
baflin ou l’on fe Iavoit plufieurs enfemble & où même
on pouvoir nager. Pline le jeune en avoit un dans
fa maifon de campagne.
On appella aufli baptifleriurn les baignoires portatives.
Ce nom fut confaeré par les Chrétiens pour
défigner les baflins dans lefquels on ad mini ftr oit le
baptême , ainfi que les 'édifices dans lefquels ces
baflins ou fontaines étoient pratiqués. ( Baptistère.
) ’ .
B A R , f . m. ou B À R D , ( conjlru&ion. ) eft
une machine propre a tranfporter les fardeaux d’une
pe:anteur moyenne , par le moyen de deux ou de
plufieurs hommes. Cette .machine eft compofée de
deux barres parallèles , unies enfemble vers le
milieu de leur longueur par cinq ou fix traverfes
plattes d’environ deux pieds de lo n g ', for lef-
queiles fe pofe le fardeau : le forplus des barres
forme quatre bras arrondis , & terminés par un talon
qui arrête les bretelles des porteurs. En terme de
^atiment ^ on appelle bardeurs ,ceux qui portent le
? n fait peu d'ufage à Paris des b a rds pour les
atimens, parce que les pierres de taille y font ordi- ;
Bairement d’un volume trop confidérabfe pour pouvoir
tre tranfpprtées de cette manière. On n’employe cette
machine qu’au tranfport des pierres qui ne ipàflejit pas
quatre ou cinq pieds cubes. Car on ne peut appliquer
I un bàrd ordinaire plus de fix hommes, & chaque
lomme ne porte ordinairement que io o livres & à
pas de diftance.
■ drchitefturc» Tarn, I»
B A R 209
Dans plufieurs Provinces de France , on appelle
cette machine bayard ; il y en en a qui font com-
. pôfées de trois barres parallèles ail lieu de deux. On
peut y adapter huit hommes, & quelquefois dix , en
ajoutant une autre barre en travers au-deflous de
l’endroit où pofe le fardeau. Les bardeurs appellent
cette dernière barre arbalétrier. De cette manière on
peut tranfporter à une moyenne diftance, environ un
millier, ou des pierres de 7 à 8 pieds cubes. Toutes
les fois que les pierres n’excèdent pas cette grofieur,
& que la diftance ne pafie pas 100 pas , il eft plus
avantageux de fe fervir de bards que de chariots :
le fervice fe fait plus promptement & à moins de
frais. Pour garantir les pierres qui font délicatement
travaillées , ou dont les arêtes font vives, on met
un paillaflon for le bard , ou des paquets de paille
tordue que les ouvriers appellent torches.T e s petits
bards s’appellent civière ; *1 y en a d’autres plus compliqués
qu’on nomme brancards ; ils fervent à tranfporter
des glaces & autres objets fragiles.
B A R A Q U E ou H U T T E , f. f. lieu conftruit de
charpente , revêtue de planches de batteau , & couverte
de dofles, pratiqué près d’un grand attelier ou
dans un grand chantier , pour fervir aux ouvriers de
ma^afin pendant l’hiver , & de retraite«- pendant
l’ éte.
B A R B A C A N E , f. f. (cor.firuflion. ) en Latin col-
luviaiiutn. On appelle ainfi des ouvertures longues
& étroites , qu’on pratique dans les murs de revêtement
qui foutiennent des terres , afin de faciliter
l’écoulement des eaux qui s’imbibent dans les terres
& qui pourroient dégrader ces murs.
Lorfque les. murs de revêtement ont une élévation
un peu.confidérable , il vaut m:eux pratiquer deux
rang«; de barbacancs que de lés faire trop hautes
afin de , ne pas couper le mur. Par., la même raifon,
quand ori fait deux rangs de bnrbacanes , il faut
obferver que les fopérieures foient placées de manière
q t’elles répondent au milieu de l’intervalle des inférieures.
On appelle' ènepre ces ouvertures vencoufes ou
canonières.
BAR BARE , adj. m. é to it , comme on le f a i t , le
nom que les Grecs , & depuis les, Romains , donnèrent
à toutes les Nations étrangères qui ne patloient
point leurs langues & ne profefloient point leurs arts.
En matière de g oû t, ce mot a confervé la même
lignification ; il a continué de. fe donner aux ouvrages
dont lejgénie & les principes-font étrangers à ceux
des Grecs & des Romains.-
Corinne ce mqt indiquoit une efpèce de férocité
dans les moeurs , il indique aufli dans les ouvrages de
l’art une rudefle d’invention ou une fierté de ftyle
outrée , une manière chargée, toujours au-deflous de
la grâce , & fouvént aîù-déflus de la force , qui
cherche.plus à étonner qu’à plaire,..qui frappe &
n’émeut point, qui en,impofe fans en imprimer. Dans
Dd