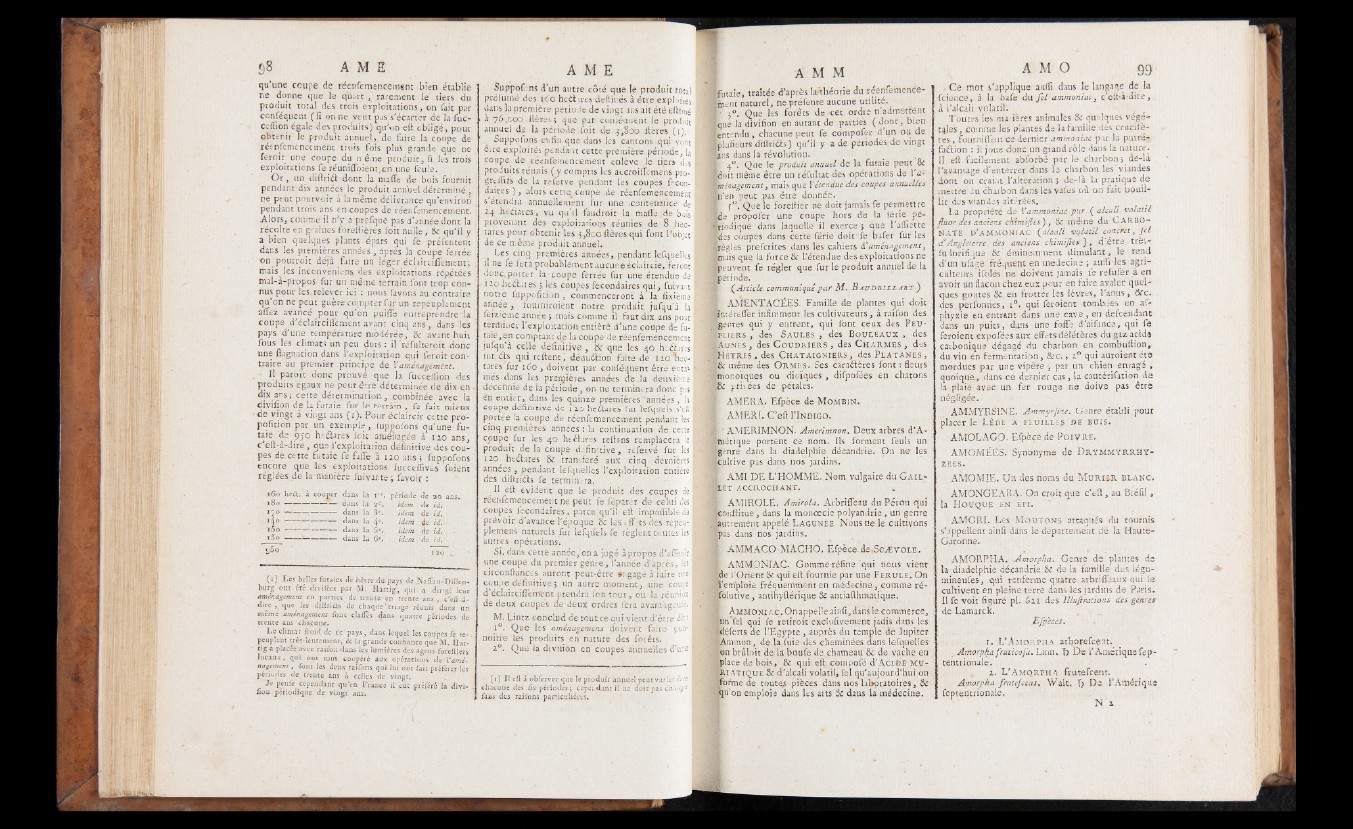
qu'une coupe de réenfemencement .bien établie
ne donne que le quart,_ rarement le tiers du
produit total des trois exploitations, on fait par
conféquent (fi on ne veut pas s'écarter de Ja fuc-
ceflîon égale des produits) qu'on-eft obligé, pour
obtenir le produit annuel, de faire la coupe de
réenfemencement trois fois plus grande que ne
feroic une coupe du irêuie produit, fi les trois
exploitations fe réunilîbient.en une feule.
O r , un diftridl dont la nulîe de bois fournit
pendant dix années le produit annuel déterminé ,
ne peut pourvoir à la même délivrance qu’envirori
pendant trois ans en coupes de réenfemencement.
Alors, comme il n‘y a prefque pas d'année dont la
récolte en graines foreitières loit nulle, & qu’ il y
a bien quelques plants épars qui fe préfentent
dans les premières années, après la coupe ferrée
on pourroit déjà faire un léger éclairciffement;
mais les inconvénient des exploitations répétées
mal-a-propos fur un même terrain font trop connus
pour les,relever ici : nous favons au contraire
qu’ on ne peut guere compter lur un repeuplement
affex avancé pour qu’on puiffe entreprendre la
coupe d’ éclairciffement avant cinq 2ns, dans les
pays d’une température modérée, & avant huit
fous les climats un peu jiurs : il'réfulteroit donc
une ftagnation dans l’exploitation qui l'eroit contraire
au premier principe de l'aménagement.
- I) paroît donc prouvé que la fucceflïon des
produits égaux ne peut être déterminée de dix en
dix ans j cette détermination , combinée avec la
divifion de la futaie fur le terrain , fe fait mieux
de vingt à vingt ans ( i) . Pour éclaircir cette pro-
pofition par un exemple, luppofons qu’une futaie
de 950 h; cia res foit aménagée à 120 ans,
c ’eft-à-dire, que l’exploitation définitive des coupes
de cette futaie fe faite à 120 ans ; fuppofons
encore que les exploitations fuccefiives foient
réglées de la-manière fuivante ; favoir :
160 he&. à couper dans la i re.
1 8 0 ----- ------------—‘ dans la 2e.
170 — ;— ---------- dans la 3e. ■
i4 o — — --------- dans-la 4e*
ï 5o --------------------dans' la 5 e.
i 5o ----------- ----dans la 6e.'
Ç)5o
période de 20 ans.
idem de id.
idem de id.
idem de id. -
idem de id. -
idem • de id.
(1) Les belles futaies de hêtre du pays de Naffau-Dîlten-
burg ont été divifêes par M. Hartig, qui a dirigé leur
aménagement en parties de trente-en trente ans.,, c'eût-à-
dire , que^ les -diftrifîs de chaque*triage réunis dans un '
même aménagement font clafles dans quatre périodes de-
t-rente ans chacune.
Le climat froid de ce pays, dans lequel les coupes fe repeuplent
très-lentenient, & la grandè confiance que M. Hax-
tig a placée avec raifon dans les lumières des agens foreftiers
locaux , qui ont toirs coopéré aux. opérations de ~Vaménagement
, -font les deux raifons qui lui ont fait préférer les
périodes de trente ans à celles de' vingt.
Je genfe cependant qu’en France il eût préféré la diyi- J
non périodique de vingt ans;
Suppofons d'un autre côté que le produit total
préfumé des î-éo heétires deftinés à être exploités
uans la première période de vingt ans ait été eftimé
à 76-,goo Itères j que par conféquent le produit
annuel de la période foit de 3,800 Itères (1).
A Stippofons enfin que dans les cantons qui vont
être exploités pendant cette première période, la
coupe de réenfemencement enlève le tiers- dc$
produits réunis ( y compris les accroiflemens pro-
givfii-fs de la réferve pendant les coupes fe conduiras
) , alors cettev coupe .de réenfem e n cernent
s étendra annuellement fur une -contenance de
24 he&ares, vu qu'il faudroit la mafia de bois
provenant des exploitations réunies de 8 hectares
pour-obtenir les 3,800 Itères qui Font l 'objet
de ce même produit annuel.
Les cinq premières années, pendant Iefquelhs
il ne fe fera probablement aucune éclaircie, Feront
donc, porter la coupe ferrée fur une étendue de
-120 hectares ; les coupes fecondaires qui, fuivant
notre luppofîtion , commenceront à la fixième
année , fourniroient notre produit jufqu'à la
feizïëme année , mais comme il faut dix ans pour
terminer l'exploitation entièrê d'une coupe de futaie,
en comptant de la coupe de réenfemencement
jufqu’à celle définitive, & que les 40 hvéhres
int-éts qui refirent, déduction faite de 120 hec-
tares fur 160 , doivent par conféquent être enta'
mes dans les premières années dé jà deuxième
décennie de la période, on ne terminera donc pas
én entier, dans les quinze premières années, la
coupe definitive de 1T0 hectares fur lefqu'eîs s’eft.
portée la coupe de réenfemencement pendant les j
cinq premières années : la continuation de cette !
coupe fur les 40 he61ares refians remplacera le I
produit de la coupe definitive, réfervé fur les
120 hectares & transféré aux cinq dernières
années, pendant lefquellès l’exploitation entière
des diftriéls fe terminera.
Il efi- évident que le produit dés coupes'de
réenfemencement ne peut fe fé parer de celui des
coupes fecondaires, parce qu'il efi impofiiblede
prévoir d’avance l'époque & les effets des ïepeu-
plemens naturels fur lefqiiels fe règlent toutes les
autres opérations.
Si, dans cette année, on a jugé à propos d’afieoir
une coupe du premier genre , l'année d après, les
circonfiances auront peut-être engagé à faire une
coupe définitive5 un autre moment, une coupe
d'éclaircifîemènt-prendra fon tour, ou la réunion
de deux coupés de deux ordres fera avantàgeuiè.
M, Lintz conclud de tout ce-qui vient d'être dit:
1°. Que les aménagemens doivent faire çon-'j
noitfe les produits en nature des forêts.
2°. Que la divifion en coupes annuelles d’une I
• (1) Il eft à obferver que le produit'annuel peut varier finns
chacune des fîx périodes; cependant il ne doit pas changer
fans des - rai Ions particulières.
[futaie, traitée d’après Ia1 *théorie du réenfemence-
[ment naturel, ne préfente aucune utilité.
W 50. Que les forêts de cet ordre n’admettent
[que la divifion en autant de parties ( dont, bien
[entendu, chacune peut fe co'mpofer d'un ou de
Ipliifietrrs difiriéts) qu'il y a de périodes, de vingt
[ans dans la révolution.
W. 40. Que le produit annuel de la futaie peut &
■ doit même être un réfultat des opérations de 1 <2-
Wrnénagement} mais que l’étendue des coupes annuelles
p ’©h peut pas être donnée.
I Que le foreftier ne doit jamais fe permettre
Ide propofer une coupe hors de la fétie^ pé-
Iriodique dans laquelle il exerce ; que l'aflïette
Ides coupes dans-cette férié doit- fe bafer fur les
■ règles preferites dans lés cahiers d * aménagement y
»nais que la force & l’étendue des exploitations ne
«peuvent fe régler que-fur le produit annuel de la
■ période.
K ( Article communiqué par M. B audrillart^)
i AMENTACÉES. Famille de plantes qui doit
pntéreffer infiniment les cultivateurs, à raifon des
Igenres qui y entrent, qui font ceux des Peupliers
, des Saules , des Bouleaux , des
Sa u n e s , des C oudriers , des C harmes , des
‘Hêtres, des Châtaigniers, des Platanes,
|& même des Ormes. Ses caractères font : fleurs
[monoïques ou dioïques, difpofées en chatons
|& pri\ées de pétales.
I AMERA. Efpèce de Mombin.
I AMERI. C ’eft I'Indigo.
I * AMERIMNON. Amerimnon. Deux arbres d’A-
Imérique portent ce nom. Ils forment feuls un
[genre dans la diadelphie décandrie. On ne les
[cultive pas dans nos jardins. I AMI DE L'HOMME. Nom vulgaire du G a il -
JLET ACCROCHANT.
Ê AMIROLE. Amirola. Arbrifleau du Pérou qui
Iconflitue, dans la -monoecie polyandrie, un genre
■ autrement appelé Lagunée Nous ne le cultivons
■ pas .dans nos jardins.
I AMMACO-MACHO. Efpèce -.dé .Scæ v o l e .
r AMMONIAC. Gomme-réfine qui nous vient
Ide l’Orient & qui efi fournie par une Ferule. On
S ’emploie fréquemment en médecine, comme résolutive,
antinyftérique & antiafthmatiqùe.
■ f- Ammoniac. On appelle ainfi, dans le. commerce,
fiih fel qui fe retiroit exclufivemenc jadis dans les
■ déferts de l’E gypte, auprès du temple de Jupiter
lAmmon, de la fuie des cheminées dans lefquelles
ion brûloit de la boufe de chameau & de vache en
Iplace de bois, & qui efi .co.mpofé d’A cide muriatique
& d’alcali volatil, fel qu'aujourd'hui on
|forme de toutes pièces dans nos laboratoires, &
|qu’on emploie dans les arts 2c dans la médecine.
■ Ce mot s’applique aufli dans le langage de la
fciencé, à la bafe du fe l ammoniac, ç’efl*à-dire,
à l’alcali volatil'. f
Toutes les madères animales & quelques végétales
, comme les plantes de la famille des crucite-
res , fonrnifl'ent ce dernier ammoniac p ir la putré-
faétion : il joue donc un grand rôle dans la nature.
11 . efi facilement abforbé par le charbon ; de-la
l’avantage d’enterrer dans le charbon les viandes
dont on craint, l’altération j de-là la pratique de
mettre iu charbon dans les vafes où on fait bouillir
des viandes altérées.
La propriété de Y ammoniac pur {alcali volatil
fluor des anciens cftïmifl'es ) , üc même du CARBONATE
d'ammoniac faisait volatil concret y f d
£ Angleterre des anciens chimiftes ) , d’être tres-
,fu lorifique & éminemment fiimulant, le rend
d’un uiàge fréquent en médecine ; auilï les agriculteurs
ifolés ne doivent jamais fe refufer à en
avoir un flacon chez eux pour en faire avaler quelques
gotites & en frotter les lèvres, l ’afius, &c .
dès..perfonhes, i° . qui leroient tombées en af-
phyxie en entrant dans une cav e, en defeendant
dans un puits, dans une fofie d’aifance, qui fe
feroient expofées aux effets délétères du gaz acide
carbonique dégagé du charbon en combuftion,
du vin en fermentation, &c. ; 2° qui auroient été
mordues par une vipère , par un chien enrag^é ,
quoique, dans ce dernier cas, la cautérifation de
la plaie avec un fer rouge ne doive pas être
négligée.
AMMYRSINE. Ammyrfme. Genre établi pour
placer le Lèdê a f Lu illes de buis.
AMÔ LAÇO. Efpèce de Poivre.
AMOMÉES. Synonyme de Dr ym m yr rh y -
zees.
AMOMIE. Un des noms du Mu ri ë r blanc.
AMONGEABA. On croit que c 'e ft, au Bréfil,
la Houque en épi.
ÀMORL Les Moutons attaqués du tournis
s'appellent ainfi dans le département dé la Haute-
Garonne.
AMORPHA. Amorpha. Genre de plantes delà
diadelphie décandrie & de h famille des iégu-
mineufes, qui renferme quatre arbrifleaux qui fe
cultivent en pleine terre dans les jardins de Paris.
Il fe voit figuré pi. 621 des lllufirations des genres
de Lamarck.
pffeces.
1. L’Amorpha arborefeent.
_ Amorphafruticofa. Linn. J? De l’Amérique fep-
tentrionale. .
2. L'Amqrpha frutefeent.
Amorpha frutefeens* Walt. J? De l'Amérique
feptentrionale,
N.’ i