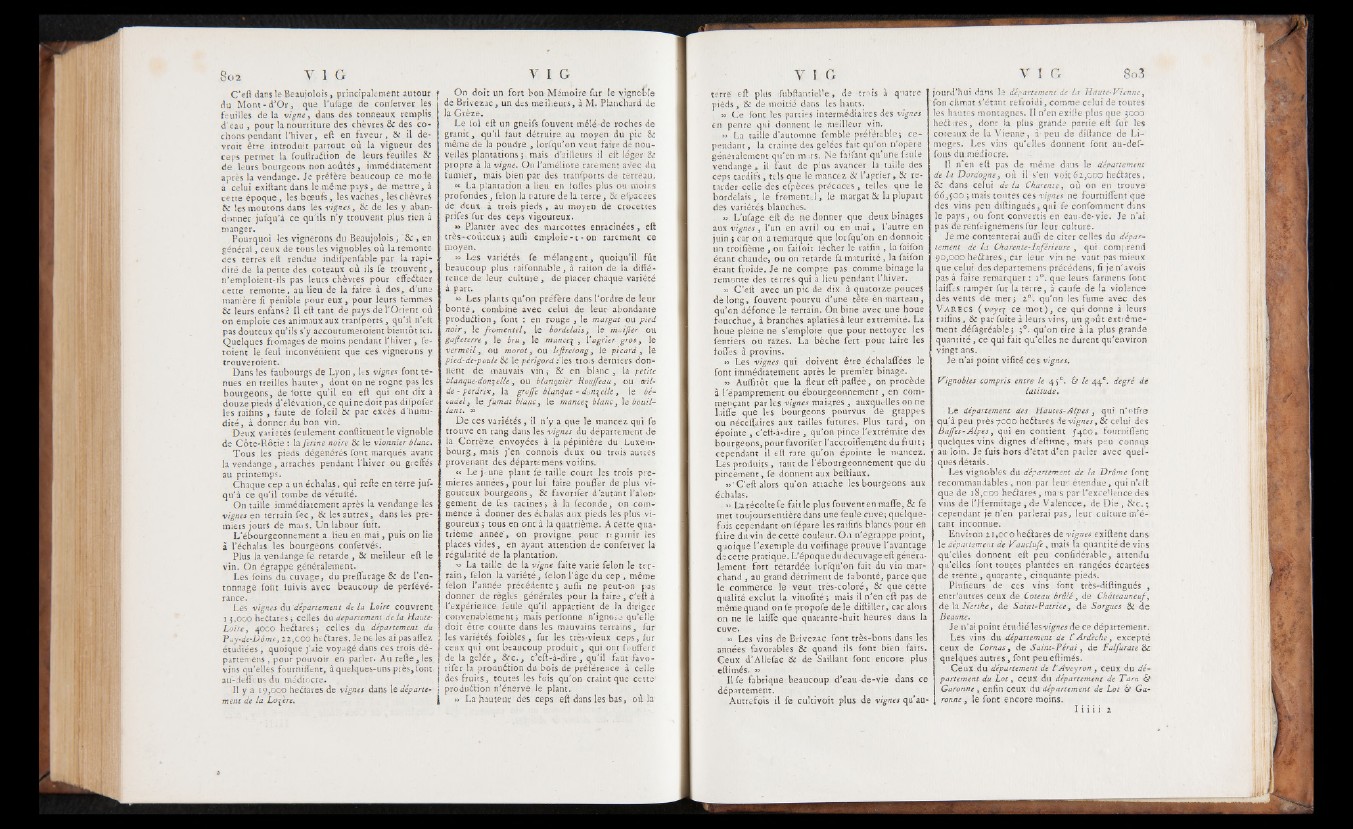
8oa "V 1 G
C ’ eft dans le Beaujolois , principalement autour {
du M on t-d ’O r , que l’ ufage de conferver les
feuilles de la v i g n e , dans des tonneaux remplis
d’eau , pour la nourriture des chèvres & des cochons
pendant l’hiver, eft en faveur, & il de-
vroit être introduit partout où la vigueur des
ceps permet la fouftrattion de leurs feuilles &
de leurs bourgeons non aoûtés , immédiatement
après la vendange. Je préfère beaucoup ce mode
à celui exiftant dans le même pays, de mettre, à
cette époque, les boeufs, les vaches, les chèvres
& les moutons dans les v i g n e s , & de les y abandonner
julqu’à ce qu’ils n’y trouvent plus rien à
manger.
Pourquoi les vignerons du Beaujolois ; , en
général, ceux de tous les vignobles où la remonte
des terres eft rendue indifpenfable par la rapi*
dité de la pente des coteaux où ils fe trouvent,
n’emploient-ils pais leurs chèvres pour effettuer
cette remonte, au lieu de la faire à dos, d’uns
manière lî pénible pour eux , pour leurs femmes
& leurs enfans ? Il eh tant de pays de l’Orient où
on emploie ces animaux aux tranfports, qu’il n’eit
pas douteux qu’ ils s’y accoutumeroient bientôt ici.
Quelques fromages de moins pendant l’hiver, fe-
roient le feul inconvénient que ces vignerons y
trouveroient.
Dans les faubourgs de Lyon, les v ig n e s font tenues
en treilles hautes, dont on ne rogne pas les
bourgeons, de forte qu’ il en eft qui ont dix à
douze pieds d’élévation, ce qui ne doit pas difpofer
les railins , faute de foleil & par excès d ’humid
ité , à donner du bon vin.
Deux variétés feulement conftituent le vignoble
de Côte-Rôtie : la f e rm e n o ir e & le v i o n n i e r b la n c .
Tous les pieds dégénérés font marqués avant
la vendange, arrachés pendant l’hiver ou greffés
au printemps.
Chaque cep a un échalas, qui refte en terre juf-
qu’ à ce qu’ il tombe de vétulié.
On taille immédiatement après la vendange les
v ig n e s e n terrain fe c , & les autres, dans les premiers
jours de mais. Un labour fuit.
L ’ébourgeonnement a lieu en mai, puis on lie
à l’échalas les bourgeons confervés.
Plus la vendange fe retarde , & meilleur eft le
vin. On égrappe généralement.
Les foins du cuvage, du preffurage & de l’entonnage
font luivis avec beaucoup de perfevé-
rance.
Les v i g n e s du d é p a r t em e n t de l à L o i r e couvrent
1 3,000 hetiares ; celles du d e p a r t em e n t d e l a H a u t e -
L o i r e , 4000 hectares j celles du d é p a r t em e n t d u
P u y - d e - D ô m e , 22,coo hettares. Je ne les ai pas allez
étudiées, quoique j’ aie voyagé dans ces trois dé-
partemens , pour pouvoir en parler. Au refte, les
vins qu’elles fourniffent, à quelques-uns près, lont
au-deffcus du médiocre.
Il y a 19,000 hettares de v ig n e s dans le d é p a r t e m
e n t d e l a L o z è r e .
v 1 G
On doit un fort bon Mémoire fur le vignoble
de Brivezac, un des meilleurs, à M. Planchard de
la Grèze.
Le fol eft un gneifs fouvent mêlé*de roches de
granit, qu’il faut détruire au moyen du pic &
même de la poudre , lorfqu’ on veut faire de nouvelles
plantations > mais d’ailleurs il eft léger &
propre à la v i g n e . On l’améliore rarement avec du
tumier, mais bien par des tranfports de terreau.
e« La plantation a lieu en fofiès plus ou moins
profondes, félon la rature de la terre, & efpacées
de deux à trois pieds , au moyen de croceties
prifes fur des ceps vigoureux.
*> Planter avec des marcottes enracinées, eft
très-coûteux j auffi emploie-c-on rarement ce
jBoyen.
m Les variétés fe mélangent, quoiqu’ il fût
beaucoup plus raifonnable, à railon de la différence
de leur culture, de placer chaque variété
à parr.
» Les plants qu’on préfère dans l’ordre de leur
bonté, combiné avec celui de leur abondante
production, font : en rouge , le m a r g a t ou p i e d
n o i r , le f r o m e n t e l , le b o r d e l a i s , le m a i f t e r ou
g a f t e t e r r e , le b ru , le m a n c e ^ , Y a g r i e r g r o s , le
v e r m e i l ,. ou m o r o t , ou le f t r e lo n g , le p i c a r d , le
p ie d -d e -p o u le & le p é r ig o r d : les trois derniers donnent
de mauvais vin; & en blanc, la p e t ite
b la n q u e -d o n $ e lle , ou b la n q u i'e r R o u j f e a u , ou « i l -
d e - p e r d r i x , la g re f fe b la n q u e - d u n ^ e l l e , le b é -
c u d e l t le f u m â t b la n c , le m a n c e [ b l a n c , le b o u i l l
a n t . *>
De ces variétés , il n’y a que le mancez qui fe
trouve en rang dans les v ig n e s du département de
la Corrèze envoyées à la pépinière du Luxembourg,
mais j’en connois deux ou trois aunes
provenant des départemens voifins.
« Le jeune plant fe taille court les trois premières
années, pour lui faire pouffer de plus vigoureux
bourgeons, & favorifer d’autant l’alon*
gement de fts racines» à la fécondé, on commence
à donner des échalas aux pieds les plus vigoureux
j tous en ont à la quatrième. A cette quatrième
année', on provigne, pour regarnir les
places vides, en ayant attention de conferver la
régularité de la plantation.
■ » La taille de la v ig n e faite varie félon le terrain,
félon la variété, félon l’âge du cep , même
félon l’année précédente j auffi ne peut-on pas
donner de règles générales pour la faire, c’ eft à
l’expérience feule qu’ il appartient de la diriger
convenablement j mais perfonne n’ignore qu’elle
doit être courte dans les mauvains terrains, fur
les variétés foibles, fur les très-vieux ceps, fur
ceux qui ont beaucoup produit, qui ont fouffert
de la gelée, & c . , c’eft-à-dire, qu’ il faut favorifer
la -production du bois de préférence à celle
des fruits, toutes les fois qu’on craint que certe-
, production n’énerve le plant,
î » La hauteur des ceps eft dans les bas, où la
terre' eft plus fubftantiel'e, de trois à quatre
pièds, & de moitié dans les hauts.
» Ce font les parties intermédiaires des v ig n e s
en pente qui donnent le meilleur vin.
m La taille d’automne femble préférable ; cependant,
la crainte des gelées fait qu’on, n’opère
généralement qu’en mus. Ne faifant qu’ une féule
vendange, il faut de plus avancer la_ taille des
ceps tardifs, tels que le mancez & l’ agrier, & retarder
celle des efpèces précoces , telles que le
bordelais, le fromentel, le margat & la plupart
des variétés blanches.
- » L’ufage eft de ne donner que deux binages
au\ v i g n e s , l’un en avril ou en mai, l’autre en
juin 3 car on a remarqué que lorfqu’on en donnoit
un troifième , on faifoit lécher le raifin , la faifon
étant chaude, ou on retarde fa maturité, la faifon
étant froide. Je ne compte pas comme binage la
remonte des terres qui a lieu pendant l’hiver.
33 C ’eft avec un pic de dix à quatorze-pouces
dè long, fouvent pourvu d’ une tête en marteau,
qu’on défonce le terrain. On bine avec une houe
fourchue, à branches aplaties à leur extrémité. La
houe pleine ne s’emploie que pour nettoyer les
rentiers ou razes. La bêche fert pour faire les
foffes à provins.
»3 Les v ig n e s qui doivent être échalaffées le
font immédiatement après le premier binage.
33 Auffitôt que la fleur eft paffée, on procède
à l’épamprement ou ébourgeonnement, en commençant
par les v ig n e s maigres , auxquelles on ne
hiffe que les bourgeons pourvus de grappes
ou nécessaires aux tailles futures. Plus tard, on
épointe , c’ eft-à-dire , qu’on pince l’extrémité des
bourgeons, pour favorifer l’accroiffement du fruit;
cependant il eft rare.qa’on épointe le mancez.
Les produits , tant de l’ébourgeonnement que du
pincement, fé donnent aux beftiaux.
33'C ’eft alors qu’on attache les bourgeons aux
échalas.
. 33 L'a récolte fé fait le plus fouvent en maffe, & fe
met Toujoursemièredans une feule cuve; quelquefois
cependant on fépare les raifins blancs pour en
faire du vin de cette couleur. On n’égrappe point,
quoique l’exemple du voifinage prouve l’avantage
de cette pratique. L’époque du décuvage eft généralement
fort retardée lorfqu’on fait du vin marchand
, au grand détriment de là bonté, parce que
le commerce le veut très-coloré, & que cette
qualité exclut la vinofité; mais il n’en eft pas de
même quand on fe propofe de le diftiller, car alors
on ne le laiffe que quarante-huit heures dans la
cuve.
»> Les vins de Brivezac font très-bons dans les
années favorables & quand ils font bien faits.
Ceux d’Allefac & de Saillant font encore plus
eftimés. »3
Il fe fabrique beaucoup d’eau -de-vie dans ce
département.
Autrefois il fe cuîtivoit plus de v ig n e s qu’aujourd’hui
dans le d é p a r t em e n t d e l a H a u t e - V i e n n e ,
Ton climat s’étant refroidi, comme celui de toutes
j les hautes montagnes. Il n’en exiffe plus que 3006
hettares, dont la plus grande partie eft fur les
coteaux de la Vienne, à- peu de diftance de Limoges.
Les vins qu’elles donnent font au-def-
fous du.médiocre.
Il n’en eft pas de même dans le d é p a r t em e n t
d e l a D o r d o g n e , où i f s’en voit 62,000 hettares,
8c dans celui d e l à C h a r e n t e , où on en trouve
66, çoo ; mais toutes ces v ig n e s ne fourniffent que
des vins peu diftingués, qui fe confommenc dans
le pays, ou font convertis en eau-de-vie. Je n’ai
pas derenfeignemens fur leur culture.
Je me contenterai auffi de citer celles du d é p a r tem
e n t d e l a C h a r e n t e - In f é r i e u r e , qui comprend
90,000 hettares, car leur vin ne vaut pas mieux
que celui des départemens précédens, fi je n’avois
pas à faire remarquer : i° . que leurs farmens font
laiffis ramper fur la terre, à caufe de la violence
des vents de mer ; i ° . qu’on les fume avec des
Varecs ( v o y e i ce m o t), ce qui donne à leurs
raifins, & par fuite à leurs vins, un goût extrêmement
défagréable; 30. qu’on tire à la plus grande
quantité, ce qui fait qu’elles ne durent qu’ environ
vingt ans.
Je n’ai point vifité ces v ig n e s .
V ig n o b l e s c o m p r is e n t r e l e 45e. & l e 44e. d e g r é d e
l a t i t u d e .
Le d é p a r t em e n t d e s H a u t e s -A lp e s , qui n’ offre
qu’à peu près 7000 hettares de v i g n e s , & celui des
B a f f e s - A l p e s 3 qui en contient 5400, fourniffent
quelques vins dignes d’eftime, mais peu connus
au loin. Je fuis hors d’état d’ en parler avec quelques
détails.
Les vignobles du d é p a r t em e n t d e l a D r ô m e font
recommandables, non par leur étendue, qui n’eft
que de 18,000 hettares, ma's par l’excellence des
vins de l’Hermitage , de Valencce, de Die , & c . ;
cependant je n’en parlerai pas, leur culture m’étant
inconnue.
Environ 2 i,oco hettares de v i g n e s exiftent dans
le d é p a r t em e n t d e V a u c lu f e mais la quantité de vins
qu’elles donnent eft peu confidérable, attendu
qu’elles font toutes plantées en rangées écartées
de trente, quarante, cinquante pieds.
Plufieurs de ces vins font très-diftingués ,
entr’autres ceux de C o t e a u b r û l é , de C h â t e a u n e u f ,
d elà N e r t h e , de S a i n t - P a t r i c e , de S o r g u e s & de
B e a u n e .
Je n’ai point étudié les v ig n e s de ce département.
Les vins du d é p a r t em e n t d e C A r d è c h e , excepté
ceux de C o r n a s , de S a i n t - P è r a i , de F a l f u r a t e &
quelques autres, font peu eftimés.
Ceux du d é p a r t em e n t d e l 'A v e y r o n , ceux du d é p
a r t em e n t d u L o t , ceux du d é p a r t em e n t d e T a r n &
G a r o n n e , enfin ceux du d é p a r t em e n t d e L o t & G a ro
n n e , le font encore moins.
I i i i i 2