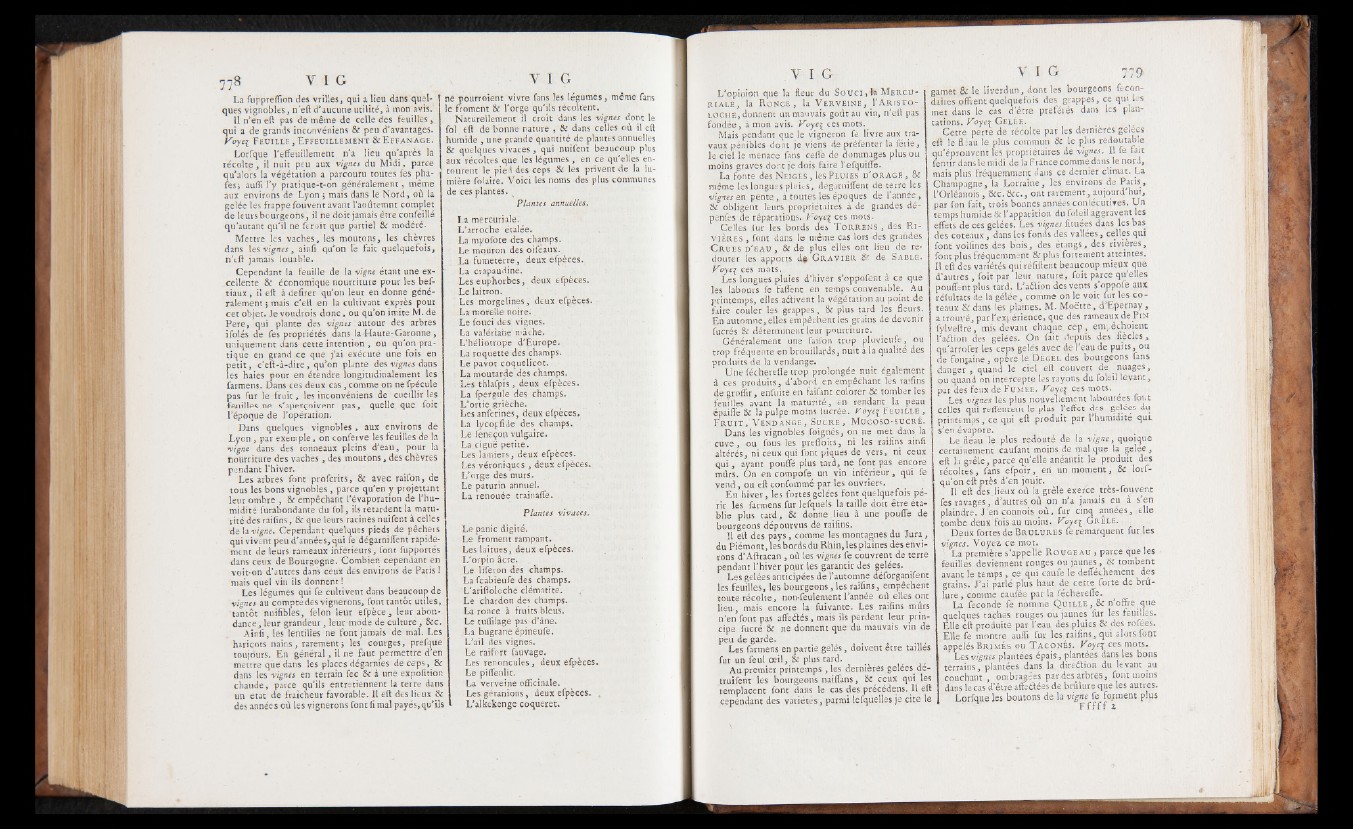
La fuppreffion des vrilles, qui a lieu dans quelques
vignobles, n’eft d’ aucune utilité, à mon avis.
11 n'en eft pas de même de celle des feuilles,,
qui a de grands inconvéniens & peu d'avantages.
V o y e { F e u i l l e , E f f e u i l l e m e n t & E f f a n a g e .
Lorfque l'effeuillement n'a lieu qu'après la
récoltç, il nuit peu aux v ig n e s du M id i, parce
qu'alors la végétation a parcouru toutes fes pha-
fes> auffi l'y pratique-t-on généralement, même
aux environs de Lyon } mais dans le Nord, où la
gelée les frappe fouvent avant l’aoûtemnt complet
de leurs bourgeons, il ne doit jamais être confeillé
qu'autant qu'il ne feroit que partiel 8c modéré-
Mettre les vaches, les moutons, les chèvres
dans les v i g n e s y ainli qu'on lé fait quelquefois,
n’tft jamais louable.
Cependant la feuille de la v ig n e étant une excellente
& économique nourriture pour les bef-
tiaux, iï eft à defirer qu’on leur en donne généralement
5 mais c’eil en la cultivant exprès pour
cet objet. Je voudrois donc, ou qu’on imite M. de
Pere, qui plante des v ig n e s autour des arbres
ifolés de fes propriétés dans la'Haute-Garonne,
uniquement dans cette intention , ou qu’on pratique
en grand ce que j’ai exécuté une fois en
petit, c’ eft-à-dire, qu’on plante des v ig n e s dans
les haies pour en étendre longitudinalement les
farmens. Dans ces deux cas,comme on nefpécule
pas fur le fruit, les inconvéniens de cueillir les
feuilles ne s'aperçoivent pas, quelle que foit
l’époque de l’opératioji.
Dans quelques vignobles, aux environs de
L y on ,.par exemple, on conferve les feuilles de la
v i g n e dans des tonneaux pleins d'eau, pour la
nourriture des vaches , des moutons, des chèvres
pendant l’hiver.
Les arbres font profçrits, & avec raifon, de
tous les bons vignobles , parce qu’en y projettant
leur ombre , & empêchant l'évaporation de l'humidité
furabondante du fol, ils retardent la maturité
des rai fins, & que leurs racines nuifent à celles
de la v i g n e . Cependant quelques pieds de pêchers
qui vivent peu d’années, qui fe dégarniffent rapidement
de leurs rameaux inférieurs, font fupportés
dans ceux de Bourgogne. Combien cependant en
voit-on d’ autres dans ceux des environs de Paris !
mais quel vin ils donnent 1
Les légumes qui fe cultivent dans beaucoup de
v ig n e s au compte des vignerons, font tantôt utiles,
tantôt nuifibles, félon leur efpèce, leur abondance,
leur grandeur, leur mode de culture, &c.
Aînfi, les lentilles ne font jamais de mal. Les
haricots.nains, rarement} les courges, prefque
toujours. En général, il ne faut permettre d’en
mettre que dans les places dégarnies de ceps, &
dans les v ig n e s en terrain fec & à une expofition
chaude, parce qu'ils entretiennent la terre dans
un état de fraîcheur favorable. 11 eft des lieux &
des années où les vignerons font lï mal payés,qu'ils
V I G
ne pourroient vivre fans les légumes, même fans
je froment & l’orge qu'ils récoltent.
Naturellement il croît dans les v ig n e s dont le
fol eft de bonne nature , & dans celles où il eft
humide , une grande quantité de plantes annuelles
& quelques vivaces, qui nuifent beaucoup plus
aux récoltes que les légumes , en ce qu'elles entourent
le pied des ceps & les privent de la lumière
folaire. Voici les noms des plus communes
de ces plantes. x
P l a n t e s a n n u e l le s .
La mercuriale.
L’arroche étalée.
La myofôte des champs.
Le mouron des oifeaux.
La fumeterre, deux efpèces.
La crapaudine.
Les euphorbes, deux efpèces.
Le laitron.
Les morgelines, deux efpèces.
La morelle noire..
Le fouci des vignes.
La valériahe mâche.
L’héliotrope d’Europe.
La roquette dés champs.
Le pavot coquelicot.
La moutarde des champs.
Les thlafpis, deux efpèces.
La fpergule des champs.
L'ortie grièche.
Les anferines, deux efpèces.
La lycopfide des champs.
Le feneçon vulgaire.
La ciguë petite.
Les lamiers, deux efpèces.
Les véroniques , deux efpèces.
L'orge des murs.
Le paturin annuel.
La renouée trainaffe.
P l a n t e s v i v a c e s .
Le panic digité.
Le froment rampant.
Les laitues, deux efpèces.
L'orpin âcre.
Le liferon des champs.
La fcabieufe des champs.
L'ariftoloche clématite.
Le chardon des champs.
La ronce à fruits bleus.
Le tuffilage pas-d'âne.
La bugrane épineufe.
L’ail des vignes.
Le raifort fauVage.
Les renoncules, deux efpèces.
Le piffenlit.
La verveine officinale.
Les géranions, deux efpèces. .
L'alkekenge coqueret.
V I G
L'opinion que la fleur du S p ucT,la M e r c u r
i a l e , la R o n c e , la V e r v e i n e , 1’A r i s t o l
o c h e , donnent un mauvais goût au vin, n’eft pas
fondée, à mon avis. V o y e ^ ces mots.
Mais pendant.que le vigneron fe livre aux travaux
pénibles dont je viens de préfenter la férié,
le ciel le menace fans ceffe de dommages plus ou
moins graves dont je dois faire l'efquiffe.
La fonte des N e ig e s , les P l u i e s d ’ o r a g e , &
même les longues pluies, dégarniffent de terre les
v ig n e s en pente.,, à toutes les époques de l’année ,
& obligent leurs propriétaires à de grandes dé-
penfes de réparations. P ^ o y e ^ ces mots.
Celles dur les bords des T o r r e n s , des R i v
i è r e s , font dans le même cas lors des grandes.
C r u e s d ’ e a u , & de plus elles ont lieu de redouter
les apports d§-G r a v i e r & de S a b l e .
V ~ o y e j ces mots.
Les longues pluies d’hiver s’oppolent à ce que
les labours fe faffent en temps convenable. Au
printemps, elles activent la végétation au point de
faire couler les grappes, & plus tard les fleurs.
En automne, elles empêchent les grains de devenir
fucrés & déterminent leur pourriture.
Généralement une faifon trop pluvieufe, ou
trop fréquente en brouillards, nuit à la qualité des
produits de la vendange.
Une fécherefle trop prolongée nuit également
à ces produits, d'abord en empêchant les raifins
de groffir, enfuite en faifant colorer & tomber les
feuilles avant la maturité, en rendant la peau
épaiffe & la pulpe moins fucrée. V o y e i F e u i l l e ,
F r u i t ," V e n d a n g e , S u c r e , M u c o s o -s u c r é .
Dans les vignobles foignés* on ne met dans la
cuv e, ou fous les preffoirs, ni les raifins ainfi
altérés, ni ceux qui font piqués de vers, ni ceux
q u i, ayant pouffé plus tard, ne font pas encore
mûrs. On en compofe un vin inférieur, qui fe
vend, ou eft confommé par les ouvriers.
En hiver, les fortes gelées font quelquefois périr
les farmens fur lefquels la taille doit être établie
plus tard, & donne lieu à une pouffe de
bourgeons dépourvus de raifins. . _ 11 eft des pays, comme les montagnes du Jura ,
du Piémont, les bords du Rhin, les plaines des environs
d’Aftracan, où les v ig n e s fe couvrent de terre
pendant l’hiver po,ur les garantir des gelées.
Les gelées anticipées de l’automne déforganifent
les feuilles, les bourgeons, les raifins, empêchent
toute récolte, non-feulement l’année où elles ont
lieu-, mais encore- la fui van te. Les raifins mûrs
n’en font pas affeétés., mais ils perdent leur principe
fucré & ne donnent que du mauvais vin de
peu de garde. ' . ' . , . ■
Les farmens en partie gelés, doivent être taillés
fur un feul oe il, & plus tard.
Au premier printemps, les dernières gelées de-
.truifenr les bourgeons naiffans, & ceux qui les
remplacent font dans le cas des précédons. Il eft
cependant des variétés, parmi lefquelles je cite le [
Y I G 779'
gamet 8c le liverdun, dont les bourgeons fecon-
daires offrent quelquefois des grappes, ce qui les
met dans le cas d'être préférés dans les plantations.
V o y e ^ G e l é e . .
Cette perte de récolte par les dernières gelees
eft le fléau le plus commun 8c le plus redoutable
qu’éprouvent les propriétaires de v ig n e s . Il fe fait
fenrir dans le midi de la F rance comme dans le nord,
mais plus fréquemment dans ce dernier climat. La
Champagne, la Lorraine, les environs de Paris,
l ’Orléanois, & c . & c ., ont rarement, aujourd'hui,
par fon fait, trois bonnes années confécutites. Un
temps humide & l'apparition du foleil aggravent les
effets de ces gelées. Les v ig n e s fituees dans les bas
des coteaux, dans les fonds des vallées, celles qui
font voifines des bois, des étangs, des rivières,
font plus fréquemment & plus fortement atteintes.
Il eft des variétés qui réfiftent beaucoup mieux que
d'autres , foit par leur nature, foit parce qu elles
pouffent plus tard. L’a&ion des vents s’oppofe aux
réfultats de la gélée, comme on le voit fur les c o teaux
& dans les plaines. M. Moëtte, d’Epernay,
a trouvé, par l’ expérience, que des rameaux de P in
fylveftre, mis devant chaque, c e p , em-;.échoient
l’aétion des geiées. On fait depuis des fiècles,
qu'arrofer les ceps gelés avec de l’eau de puits, ou
de fontaine, opère le D é g e l des bourgeons fans
danger , quand le ciel eft couvert de nuages,
ou quand on intercepte les rayons du foleil levant,
par des feux de F u m é e . V o y e i ces mots.
Les v i g n e s les plus nouvellement labourées font
celles qui reffentent le plus l’effet des gelées du
printemps, ce qui eft produit par l’humidité quL
s'en évapore.
Le fléau le plus redouté de la v i g n e > quoique
certainement caufant moins de mal que la gelée ,
eft la grêle, parce qu’elle anéantit le produit des
récoltes, ' fans efpoir, en un moment, 8c lorf-
qu’on eft près d’en jouir.
Il eft des.lieux où la grêle exerce très-fouvent
fes ravages , d’autres où on n’ a jamais eu à s’en
plaindre. J’en connois où , fur cinq années, elle
tombe deux fois au moins. V o y e i G r e l e .
Deux fortes de B r û l u r e s fe remarquent fur les
v i g n e s . V o y e z ce mot,
1 La première s’appelle R o u g e a u , parce que les
feuilles deviennent rouges ou jaunes , 8c tombent
avant le temps, ce qui cauie le defféchement des
grains. J’ai parlé plus haut de cette forte de brûlure,
comme caufée parla féçhereffe.
La fécondé fe nomme Q u i l l e , 8c n’offre que
quelques taches rouges ou jaunes fur les feuilles-
Elle eft produite par l’eau des pluies & des rofées.
Elle fe montre auffi fur les raifins, qui alors font
appelés B r im é s ou T a c o n é s . V o y e i ce s mots.
Les v ig n e s plantées épais, plantées dans les bons
terrains, plantées dans la direction du levant au
couchant , ombragées par des arbres, font moins
dans le cas d’être affeétées de brûlure que les autres.
Lorfque les boutons de la v ig n e fe forment plus
I ^ T7 CPÇÇ •,