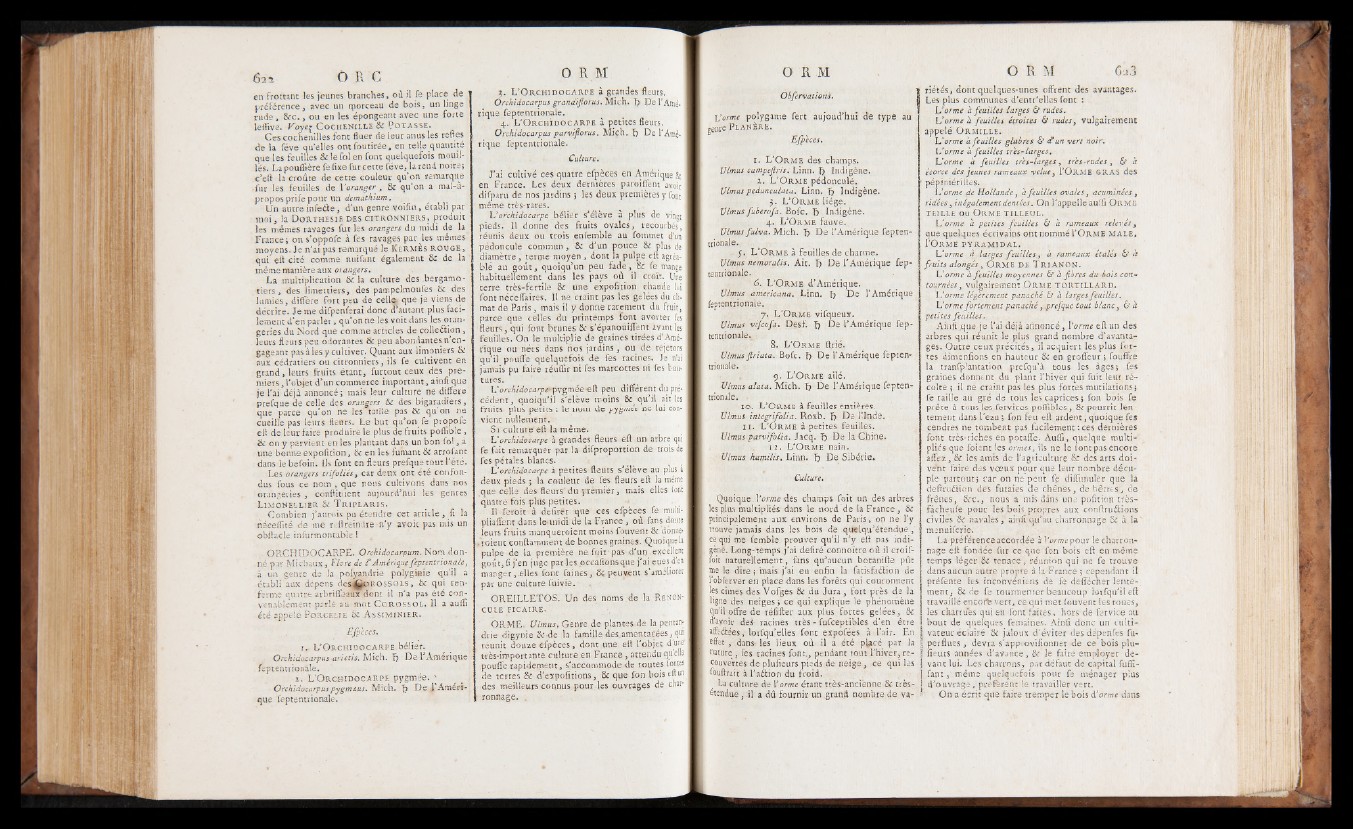
6^5; Ô R C
en frottant les jeunes branches, où il fe place de j
préférence, avec un rporceau de bois, un linge I
rude, & c . , ou en les épongeant avec une forte
lefïive. Voye^ C ochenille & Potasse.
Ces cochenilles font fluer de leur anus les reftes
de la fève quelles ont foutirée,'en telle quantité
que les feuilles & le fol en font quelquefois mouillés.
La pouflière fe fixe fur cette féve.Ja rend noire;
c’eft la croûte de cette couleur qu’on remarque
• fur les feuilles de l ‘oranger, & qu’on a mal-à-
propos prife pour lin demàthium. .
Un autre infe&e, d’un genre voifin, établi par
moi, la Dorthesif. des citronniers, produit
les mêmes ravages fur les orangers du midi de la
France; on s’oppofe à fes ravages par les mêmes
moyens. Je n’ai pas remarqué le Kermès rouge,
qui eft cité comme nuifant également & de la '
même manière aux orangers.
La multiplication & la culture des .bergamo-
tie rs , des iimettiers, des pampelmoufes & des
lumies, diffère fort peu de celle que je viens de
décrire. Je me difpenferai donc d’autant plus facilement
d’en parler, qu’on ne les voit dans les orangeries
du Nord que comme articles de collection,
leurs fleurs peu odorantes & peu abondantes n’engageant
pas à les y cultiver. Quant aux limoniers &
aux cédratiers ou citronniers, ils fe cultivent en
grand , leurs fruits étant, furtout ceux des premiers,
l’objet d’un commerce important, ainfi que
je l’ai déjà annoncé; mais leur culture ne diffère
prefque de celle des orangers & des bigaradiers,
que parce qu’ on né les taille pas & qu’on ne
cueille pas leurs fleurs. Le but qu’on fe propofe
eft de leur faire produire le plus de fruits poflibie,
& on y parvient en les plantant dans un bon fol , à
une bonne expofition, & en les fumant & arrofant
dans le befoin. Ils font en fleurs prefque tout l’été.
Les orangers trifoliés, car deux ont été confondus
fous ce nom , que nous cultivons dans nos
orangeries, condiment aujourd’ hui les genres
Limonellier & T riplaris.
Combien j’aurois pu étendre cet article, fi la
néceffité de me reftreindre n’y avoit pas mis un
obftacle infurmontabîe ! .
ORCHIDOCARPE. Orchidocarpum. Nom donné
par Michaux, Flore de tAmériquefeptentrionâley
à un genre de la polyandrie polyginie qu’il a
établi aux dépens des^üROSSOLS, & qui renferme
quatre arbriffeaux dont il n’a pas été convenablement
parlé au mot C grossol. 11 a suffi
été appelé Porçelïe & A ssiminier.
. Efpcces.
i.. L’Orchidocarpe bélier.
Orchidocarpus arietis. Mich. T} De l’Amérique
feptentrionâle.. ;
2. L’Orchidocarpe pygmée. ■> . . # .j
Orchidocarpuspygm&us. Mich. J? De ,1 Amérique
feptentrionâle,
O R M
L’Orchidocarpe à grandes fleurs.
Orchidocarpus grandiflorus. M ich. "b D e l’Amériq
u e fep ten trio nâle.
4. L’Orchîdocarpe à petites fleurs.
Orchidocarpusparvifiorus. M ich . T? D e l’Amérique
feptentrionâle.
Culture.
J’ ai cultivé ces quatre efpèces en Amérique &
en France. Les deux dernières paroiffent avoir
difparu de nos jardins ; les deux premières y font
même très-rares.
L ’orchidocarpe bélier s’ élève à plus de vingt 1
pieds. Il donne des fruits ovales, recourbés,
réunis deux ou trois enfemble au fommet d'un
pédoncule commun, & d’un pouce &: plus de
diamètre, terme moyen, dont ia pulpe eft agréable
au goût, quoiqu’un peu fade, & fe mange
habituellement dans les pays où il croît. Une
terre très-fertile &: une expofition chaude lui
font néceffaires. U ne craint pas les gelées du climat
de Paris, mais il y donne rarement du fruit, |
parce que celles du printemps font avorter fes I
fleurs, qui font brunes 6c s'épanoüiffent avant les |
feuilles. On le multiplie de graines tirées d’Amérique
ou nées dans nos jardins, ou de. rejetons
qu’ il pouffe quelquefois de fes racines. Je n’ai
jamais pu faire réuffir ni fes marcottes ni fes boutures.
'
XJorchidocarperpvgmêzth peu différent du pré-1
cèdent, quoiqu’ il s’élève moins & qu’ il ait les
fruits plus petits : le nom de pygmée ne lui convient
nullement.
Sa c u ltu re eft la m êm e.
U orchidocarpe à grandes fleurs eft un arbre qui
fe.fait remarquer par la difproportion de trois de
fes pétales blancs* Ja •
Vorchidocarpe à petites fleurs s’élève au plus à
deux pieds ; la couleur de fes fleurs eft la même
.que celle des- fleurs’ du prèmier, mais ël les font
quatre fois plus petites.
Il ■ ferôit à defirër que ces efpèces fe multi-
pliaffent dans le-midi de la France, où fans doute
leurs fruits manqueroient moins fouvent & donne-
. Voient conftamment de bonnes graines. Quoique la
pulpe de la première ne foirpas d’un.excellent
goût, fi j’en juge par lespccafibnsque j’ ai eues d’en
manger,.elles font faines, & peuvent s’améliorer
par une culture fuivie.
OREILLETOS. Un des noms de la Renoncule
ficaire.
ORME. XJlmus, Genre de plantes de la penrandrie
digynie & d e la famille des.amentacées, qui
réunit douze éfpèces, dont une eft l’objet d une*
très-importante culture en France, attendu quelle
pouffe rapidement, s’ accommode de toutes fortes
de terres & d’expofitions, & que fon bois eft un
des meilleurs connus pour les ouvrages de char-
| ronnage. .
O R M
Obfervations.
L‘orme polygame fert
genre Fl an ère.
aujoud’hui de type
Efpèces.
1. L’Orme des champs.
Ulmus campe fr is . Linn. Indigène.
2. L’Orme pédoncule.
Ulmuspedunculata. Linn. Indigène.
3. L’Orme liège.
XJlmus fuberofa. Bofc. Indigène.
4. L’Orme fauve.
Ulmus fulva. Mich. De l’Amérique feptentrionale.
y. L’Orme à feuilles de charme,
Ulmus nemoralis. Ait. T? De l’Amérique fep-
tentrionale.
6. L ’O rme d’Amérique.
Ulmus americana. Linn. U De l’Amérique
feptentrionâle,
7. L'Orme vifqueux.
Ulmus vifcofa. Desft T? De l’Amérique fep-
tentrionale.
8. L’Orme ftrié.
Ulmus Jlriata. bo(ç. fj De l’Amérique fepten-
trionale.
9. L’Orme ailé.
Ulmus alata. Mich. De l’Amérique fepten-
trionale. •
10. L’Orme à feuilles entières.
Ulmus integrifolia. Roxb. fj De l’Inde.
11. L’Orme à petites feuilles.
Ulmus parvifolia. Jacq. T? De la Chine.
12. L’Orme nain.
Ulmus humilis, Linn. 1? De Sibérie.
Culture.
Quoique .Y orme des champs foit un des arbres
les plus multipliés' dans le nord de la France, &
principalement aux environs de Paris, on ne l’y
trouve jamais dans les bois de quelqu’étendue,
ce qui me femble prouver qu’ il n’y eft pas indi-
gènê. Long-temps .j’ai defiré connoître où il croif-
foit naturellement, fans qu’ aucun botanifte pût
me le dire ; mais j’ai eu enfin la farisfaétion de
i’obfèrver en placé dans les forêts qui couronnent
les cimes des Vofges & du Jura, fort près de la
ligne des neiges ; ce qui explique le phénomène
qu'il offre de réfifter aux plus fortes gelées, &
d’aÿoir deâ* racines très - fufceptibles d’ en être
ées, lorfqffelles font expofées à l’air. En
effet , dans- les lieux où il a été plpcé par la
Nature , fes racines font., pendant tout l’hiver, recouvertes
de plufieurs pieds de neige, ce qui les
fouftrait à l’aétion du froid.
La culture de Forme étant très-ancienne & trè.s-
ctendue, -il a dû fournir un grand nombre de va-
O R M
rîétés, dont quelques-unes offrent des avantages.
Les plus communes d’entr’elles font :
U orme a feuilles Larges & rudes.
Uorme a feuilles étoiles & rudes 3 vulgairement
appelé Ormille.
L’orme a feuilles glabres & dJun vert noir.
Uorme à feuilles très-larges.
U orme à feuilles très-larges, très-rudes, & a
écorce des jeunes rameaux velue, l’ORME GRAS des
pépiniériftes.
IJ orme de Hollande, a feuilles ovalesà acuminées ,
ridéess inégalement dentées. On l’appelle aufli ORME
teille ou Orme tilleul.
U orme a petites feuilles & a rameaux relevés,
que quelques écrivains ont nommé I’Orme male,
I'Orme p yramidal.
XJ orme a larges feuilles,y à rameaux étalés & h
fruits alongés, Orme DE T r iANON.
XJ orme a feuilles moyennes & a fibres du bois contournées
, vulgairement O rme tortillard.
XJ orme légèrement panaché & a larges feuilles.
XJ orme fortement panaché , prefque tout blanc , & à
petites feuilles.
Ainfi ,que je l’ai déjà annoncé, Forme eft un des
arbres qui réunit le plus grand nombre d’avantages.
Outre ceux précités, il acquiert les plus fortes
dimenfions en hauteur & en groffeur ; fouffre
la tranfplamation prefqu’ à tous les âges; fes
graines donnent du plant l’ hiver qui fuit leur récolte
il ne craint pas les plus fortes mutilations;
fe taille au gré de tous les caprices ; fon bois fe
prête à tous les fervices poflîbles, & pourrit lentement
dans l’eau ; fon feu eft ardent, quoique fes
cendres ne tombent pas facilement : ces dernières
font très-riches en potaffe. Aufli, quelque multi- .
pliés que foient les ormes, iis ne le font pas encore
affez, & les amis de l’agriculture & des arts doivent
faire des voeux pour que leur nombre décuple
partout; car on ne peut fe diffuùuler que la
deftruétion dés futaies de chênes, de hêtres, de
frênes, &rc._, nous a mis dans une pofiticn très-
fâcheufe pour les bois propres aux cooftruétions
civiles & navales,' ainfi qu’au charronnage & à la"
me nui férié.
La préférence accordée à l‘orme pour le charronnage
eft fondée fur ce que fon bois eft en même
temps léger & tenace, réunion qui ne fe trouve
dans aucun autre propre à la France ; cependant il
préfente les inconvéniens de fe deffécher lente-,
ment, & de fe tourmenter beaucoup iorfqu’il eft
travaillé eneçfe vert, ce qui met-fouvent les roues,
les charrues qui en font faites, hors de fervice au
. bout de quelques femàines. Ainfi donc un culti-
! vateur éclairé & jaloux d’éviter des dépenfes fu-
| per fines , devra s’appiovifionner-de ce bois plu-
I fleurs années d’ avance, & le faire employer de-
j vant lui. Les charrons, par défaut de capital fuffi-
j fa u tm êm e quelquefois pour fe ménager plus
d’ouvrage, préfèrent le travailler vert.
On a écrit que faire tremper le bois d'orme dans
\ M
v i l
M
1