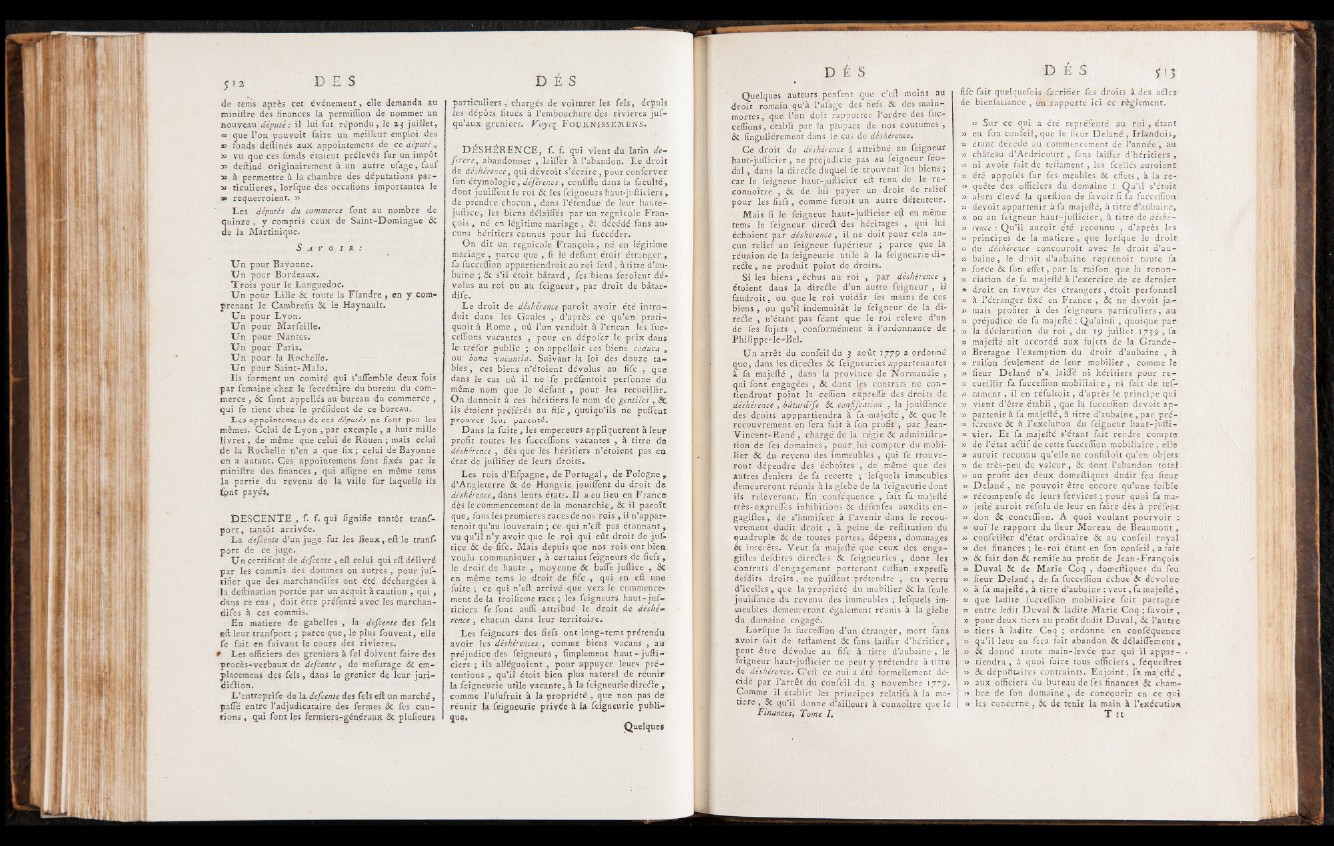
5>2 DES
de terris après cet événement, elle demanda au
miniftre des finances la permiffion de nommer un
nouveau député: il lui fut répondu, le juillet,
« que l ’on pouvoit faire un meilleur emploi dés
» fonds deftinés aux appointemens de ce député,
» vu que ces fonds étoient prélevés fur un impôt
» deftiné originairement à un autre ufage, fauf
33 à permettre à la chambre des députations paras
ticulieres, lorfque des occafions importantes le
a» requerroient. »
Les députés du commerce font au nombre de
quinze, y compris ceux de Saint-Domingue 8t
de la Martinique.
S a v o, r a .*
U n pour Bayonne.
U n pour Bordeaux.
T ro is pour le Languedoc»
U n pour Lille 8c toute la Flandre , en y comprenant
le Cambrefis 8c le Haynault.
Un pour Lyon.
U n pour Marfeille.
U n pour Nantes.
U n pour Paris.
U n pour la Rochelle.
U n pour Saint-Malo,
Ils forment un comité qui s’aflemble deux fois
par femaine chez le fecrétaire du bureau du commerce
, 8c font appellés au bureau du commerce ,
qui fe tient chez le préfîdent de ce bureau.
Les appointemens de ces députés ne font pas les
mêmes. Celui de Lyon , par exemple, a huit mille
livres , de même que celui de Rouen ; mais celui
de la Rochelle n’en a que fix ; celui de Bayonne
en a autant. Çes appointemens font fixés par le
jniniftre des finances , qui affigne en même tems
la partie du revenu de la v ille fur laquelle ils
font payés,
D E S C E N T E , f. f. qui lignifie tantôt tranf-
p o r t, tantôt arrivée.
L a defeente d?un juge fur les lieux , eftle transport
de ce juge.
Un certificat de defeente , eft celui qui eft délivré
par les commis des douanes ou autres , pour juf-
tifier que des marchandifes ont été déchargées à
la dçftination portée par un acquit à caution , qui ,
dans ce cas , doit être préfenté avec les marchanr
difes à ces commis.
En matière de gabelles , la defeente des fels
eft leur tranfport > parce que, le plus fouvent, elle
fç fait en fuivant le cours des rivières.
# Les officiers des greniers à fel doivent faire des
procès-verbaux de defeente , de mefurage 8c em-
placemens des fe ls , dans le grenier de leur juridiction.
L ’entreprife de la defeente des fels eft un marché,
pafle entre l’adjudicataire des fermes 8c fes cautions
, qui font les fermier ? r généraux 8c plufieurs
D É S
particuliers, chargés de voiturer les fels, depuis
les dépôts fitués à l’embouchure des rivières juf-
qu’aux greniers. Foye% FOURNISSEMENS.
D É SH ÉR E N C E , f. f. qui vient du latin de-
ferere, abandonner , laiffer à l’abandon. Le droit
de déshérence, qui dévroit s’é c rire, pour conferver
fon étymologie, déférence , confifte dans la faculté,
dont jouiffent le roi & les feigneurs haut-jufticicrs ,
de prendre chacun , dans l ’étendue de leur haute-
juftice, les biens délaifïcs par un regnicole François
j né en légitime mariage , 8c décédé fans aucuns
héritiers connus pour lui fuccéder.
On dit un regnicole François, né en légitime
mariage, parce que , fi le défunt étoit étranger ,
fa fuccefïîon appartiendroit au roi feul, à titre d’aubaine
; 8c s’il étoit bâtard, fes'biens feroient dévolus
au roi ou au feigneur, par droit de bâtar-
dife.
L e droit de déshérence paroît avoir été introduit
dans les Gaules ,' d’après ce qu’on prati-
quoit à Rome , où l’on vendoit. à l’encan les fuc-
ceffions vacantes , pour en dépofer le prix dans
le tréfor public ; on appelloit ces biens caduca ,
ou bona vacanda. Suivant la loi des douze tables
, ces biens n’étoient dévolus au fifc , que
dans le cas où il ne :fe préfentoit perfonne du
même nom que le défunt , pour les recueillir.
On donnoit à ces héritiers le nom de gentiles ., 8c
ils étoient préférés au fife , quoiqu’ils ne puffent
prouver leur parenté.
Dans la fuite, les empereurs appliquèrent à leur
profit toutes les fuccefïïons vacantes , à titre de
déshérence , dès que les héritiers n’étoient pas en
état de juftifîer de leurs droits.
Les rois d’Efpagne, de Portugal, de Pologne ,
d’Angleterre 8c de Hongrie jouiffent du droit de
déshérence, dans leurs états. Il a eu lieu en France
dès le commencement de la monarchie, 8c il paroît
que, fous les premières races de nos rois , il p’appar*
tenoit qu’au fouverain ; ce qui n’eft pas étonnant,
vu qu’iî n’y avoit que le roi qui eût droit de juf*
tiçe & de-fife. Mais depuis que nos rois ont bien
voulu communiquer , à certains feigneurs de fiefs ,
le droit de haute , moyenne & baffe juftice , 8e
en même tems le droit de _fifc , qui en eft une
fuite ; ce qui n’eft arrivé que vers le commence*
ment de la troïfîemg race ; les feigneurs haut-justiciers
fe font auffi attribué le droit de déshé->
rence, chacun, dans leur territoire.
Les feigneurs des fiefs ont long-tems prétendu
avoir les déshérences , comme biens vacans , au
préjudice des feigneurs, Amplement h au t-ju fti-
ciers ; ils alléguoient , pour appuyer leurs prétentions
, qu’il étoit bien plus naturel de réunir
la feigneurie utile vacante, à la feigneurie direéïc ,
comme l’ufufruit à la propriété , que non pas de
réunir la feigneurie privée à la feigneurie publiâ
t
Quelques
D É S d e s j i 3
Quelques auteurs penfent que c’cft moins | au
droit romain qu’à l’ ufage des fiefs 8c des mainmortes,
que l ’on doit rapporter l’ordre des fuc-
ceflîons, établi par là plupart de nos coutumes ,
8c finguliérement dans le cas de déshérence.
Ce droit d.e déshérence f, attribué au feigneur
haut-jufticier , ne préjudicie pas au feigneur féodal
, dans la diredte duquel fe trouvent les biens ;
car le feigneur haut-jufticier eft tenu de le re-
eonnoître , & de lui payer un- droit de relief
pour les fiefs, comme feroit un autre détenteur.
Mais fi le feigneur haut-jufticier eft en même
tems le feigneur direCt des héritages , qui lui
échoient par déshérence , il ne doit pour cela aucun
relief au feigneur Supérieur ; parce que la
réunion de la feigneurie utile à la feigneurie di~
reéie, ne produit point de droits.
Si les biens , échus au roi ,, par déshérence ,
étoient dans la dircéte d’un autre feigneur , il
faùdroit, ou que le roi vuidâc fes mains de ces
biéns , ou qu’il indemnisât le feigneur de la directe
, n’étant pas féant que le roi releve d’un
de fes fujets ,, conformément à l ’ordonnance de
Phiiippe-le-Bel.
Un arrêt du confeil du $ août 1779 a ordonné
que, dans les directes 8c feigneuries appartenantes
à fa majefté , dans la province de Normandie ,
qui font engagées , 8c dont les contrats ne contiendront
point la 'ceffion expreûe des droits de
déshérence , bâtardife & conffcation , la jouifîance
des droits apppartiendra à fa -majefté , 8c que le
recouvrement en fera fait à fon profit , par Jeàn-
Vincent-René , chargé de la régie 8c adminiftra-
tion de fes domaines, pour.lui compter du mobilier
& du revenu des immeubles , qui fe trouveront
dépendre des échoites , de même que des
autres deniers de fa recette ; lefquels immeubles
demeureront réunis à la glebe de la feigneurie dont
ils relèveront. En conféquence , fait fa majefté
très-expreffes inhibitions ôc défenfes auxdits en-
gagiftes, de s’immifeer à l’avenir dans le recouvrement
dudit droit , à peine de refticution du
quadruple 8c de toutes pertes, dépens, dommages
8c intérêts. Veut fa majefté que ceux' des enga-
giftes defdites directes & feigneuries , dont les
contrats d’engagement porteront ceffion exprefle
defdits droits , ne puiffent prétendre , en vertu
d’icelles , que la propriété du mobilier 8c la feule
jouiffance du revenu des immeubles ; lefquels immeubles
demeureront également réunis à la glebe
du domaine engagé.'
Lorfque la fuccefïîon d’un étranger, mort fans
avoir fait de teftament 8c fans lailfer d’héritier,
peut être dévolue au fife à titre d’aubaine , le
feigneur haut-jufticier ne peut y prétendre à ti.tre
de déshérence. C ’eft ce qui a été formellement décidé
par l’arrêt du confeil du 3 novembre 1779.
Comme il établit l'es principes relatifs à la ma-
tiere , 8c qu’il donne d’ailleurs à connoître que le
Finances, Tome I.
fife fait quelquefois/faerifier fes droits à des a êtes
de bienfaifance , cm rapporte ic i ce règlement.
y> Sur ce qui a été repréfenté au roi , étant
» en fon confeil, que le fieur Delané , Irlandois,
» étant décédé au commencement de l’année, au
» château d’Ardricourt , fans laiffer d’héritiers ,
y> ni avoir fait de teftament, les fceilés auroient
33 été appofés fur fes meubles 8c effets, à la re-- 3> quête des officiers dû domaine : Qu’il s’etoie
33 alors élevé la queilion de favoir fi fa fueceffion
33 devoit appartenir à fa majefté, à titre d’aubaine,
» ou au feigneur haut-jufticier, à titre de déshé- 3> rence : Qu’il aurôit été reconnu , d’après les
33 principes de la matière , que lorfque le droit
» de déshérence concouroit avec le droit d’au-
33 baine, le droit d’aubaine reprenoit toute fa
33 force 8c fon effet, par la rai fon que la renon-
>3 ciation de fa majefté à l’exercice de ce dernier
» droit en faveur des étrangers , étoit perfonnel
33 à l’étranger fixé en France , & ne devoit ja—
33 mais profiter à des feigneurs particuliers, au
33 préjudice de fa majefté : Qu’ainfî , quoique par
33 la déclaration du roi , du 19 juillet 1739 , fa
33 majefté ait accordé aux fujets de la Grande-
33 Bretagne l ’exemption du droit d’aubaine , à
» raifon feulement de leur mobilier , comme le
33 fieur Delané n’a laiffé ni héritiers pour re -
33 cueillir fa fuccefïîon mobiliaire , ni fait de tef-
» tament , il en réfultoit, d’après le principe qui
33 vient d’être établi, que la fueceffion devoit ap-
33 partenir à fa majefté, à titre d’aubaine , par pré-
33 ference & à l ’excîufîon du feigneur haut-julli-
33 'çier. Et fa majefté s’érant fait rendre compte
» de l’état aéïif de cette fueceffion mobiliaire , elle
39 auroit reconnu qu’elle ne cortfiftoit qu’ en objets
33 de très-peu de valeur , & dont l’abandon total
>3 au profit des deux domeftiques dudit feu fieur
33 Delané , ne pouvoit être encore qu’une foible
33 récompenfe. de leurs fer vices ; pour quoi fa ma-
33 jefté auroit réfolu de leur en faire dès à préfent
33 don & 'Conctffion. A quoi voulant pourvoir :
33 ouï le rapport du fieur Moreau de Beaumont,
33 confeiller d’état ordinaire & au confeil royal
’33 des finances ; le» roi étant en fon confeil, a fait
» 8c fait don & remife au profit de Jean -François
33 Duval 8c de Marie Coq , domeftiques du feu
33 fieur Delané , de fa fueceffion échue 8c dévolue
33 à fa majefté , à titre d’aubaine : v eu t, fa majefté ,
33 que ladite fuccefïîon mobiliaire foit partagée
33 entre ledit Duval 8c ladite Marie Coq ; favoir ,
33 pour deux tiers au profit dudit Duval, 8c l’autre
33 tiers à ladite Coq ; ordonne xen conféquence
33 qu’il leur en fera fait abandon 8c délaiffemcnt ,
33 & donné toute main-levée par qui il appar-
>3 tiendra , à quoi faire tous officiers , féqueftres
33 8c dépofittires contraints. E njoint, fa ma;efté ,
33 aux officiers du bureau de fes finances 8c cham-
3» bre de fon domaine , de concourir en ce qui
3ï les concerne , 8c de tenir la main à l ’exécutioi%
T tt