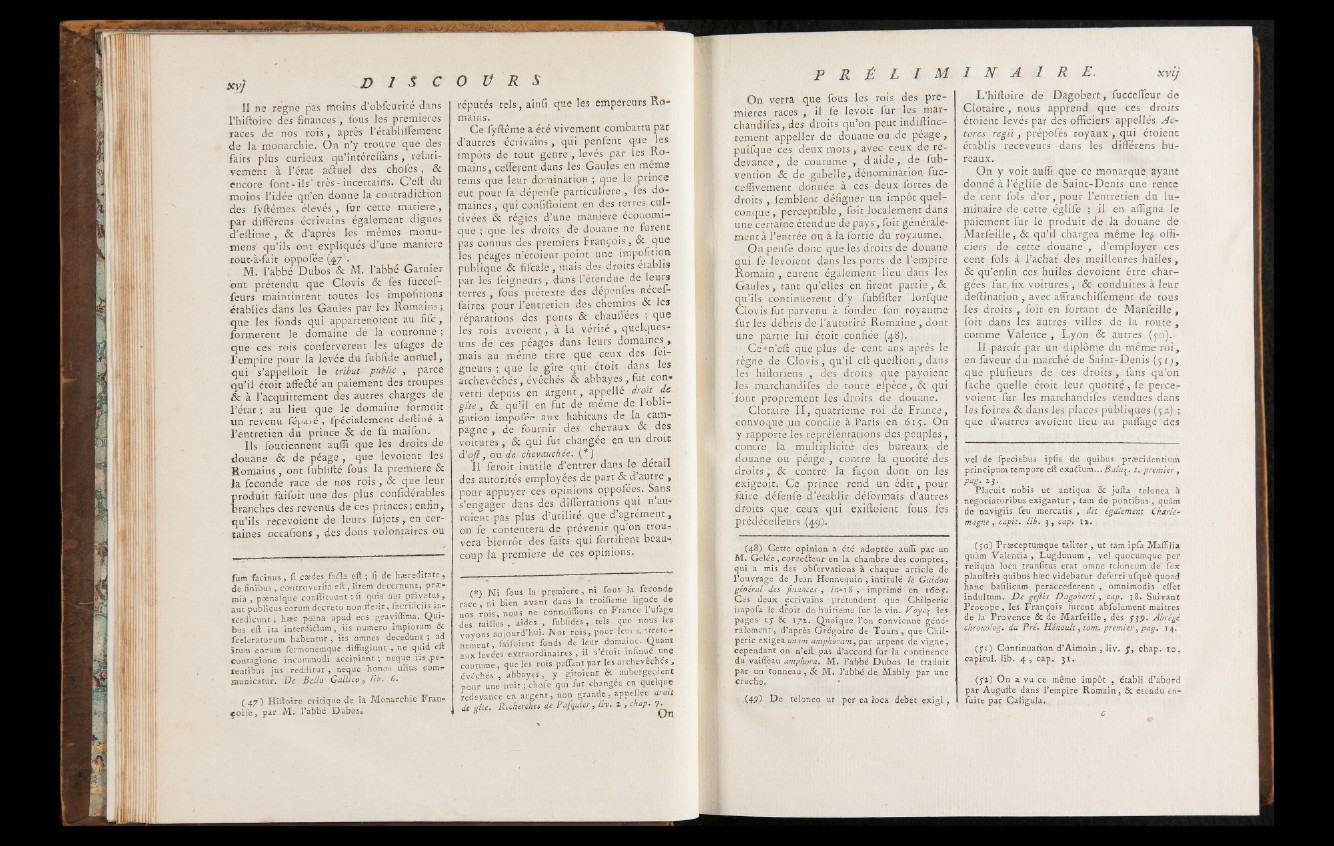
xv] D I S C
Il ne régné pas moins d’obfcurité dans
l ’hiftoire des finances, lous les premières
races de nos rois, apres l’etabliffement
de la monarchie. On n’y trouve que des
faits plus curieux qu’intéreffans, relativement
à l’état aftuel des chofes, &
encore fo n t - ils’ très - incertains. C ’eft du
moins l’idée qu’en donne la .contradiction
des fyftêmes élevés , fur cette matière ,
par différens écrivains également dignes
d’eltime, & d’après les mêmes monu-
mens' qu’ils ont expliqués d’une maniéré
tout-à-fait oppofée (47'.
M. l’abbé Dubos & M. l’abbé Garnier
ont prétendu que Clovis & fes fuccef-
feurs maintinrent toutes les impofitionî
établies dans les Gaules par les Romains ;
que les fonds qui appartenoient au fifc,
formèrent le domaine de la couronne ;
que ces rois cônferverent les ufages de
l ’empire pour la levée du fubfide ann'uel,
qui s’appelloit le tribut public , parce
qu’il étoit affe&é au paiement des troupes
& à l’acquittement des autres charges de
l ’état ï au lieu que le domaine formoit
Un revenu fépare , fpecialement deltine à
l ’entretien du prince & de fa mailbn.
Ils foutiennent auffi que les droits de
douane .& de péage , que levoient les
Romains , ont fubüfté fous la première &
la fécondé race de nos rois , & que leur
produit faifoit une des plus confiderables
branches des revenus de ces princes ; enfin,
qu’ils recevpient de leurs fujets, en certaines
occafions , des dons volontaires ou
fum facinus, fi cædes faéla eft ; fi de hæredirate,
de finibus , côntrovcrfia eft , litem decernunt, p re mia
, poenafque conftiumnt : fi quis aut priva tus,
aut publicus eorum decreto non fterît, facrificiis in-
terdiçunt ; hæc poena apud eos -graviffima. Quitus
eft ita interdiftum, iis numéro impiomm.&
fceleratorum habentur , iis omnes decedunt ; ad
itum .eorum fermoneinque diffugiunt , ne quid eft
contagione incommodi accipiant \ n.eque iis >p£-
tentibus jus redditur , neque honos ullus Gomr
jnunicatur. De JBello Gallico , lib. 6.
( 4 7 ) Hiftoire critique de la Monarchie Fran*
ç-oife, par M . l’abbé Dubos,
O V R s
réputés tels, aînfi que les empereurs Romains.
Ce fyftême a été vivement combattu par
d’autres écrivains, qui penfent que les
impôts de tout genre , levés par les Romains,
celferent dans les Gaules en même
tems que leur domination ; que le prince
eut pour fa dépènfe particulière , fes domaines
, qui confiftoient en des terres cultivées
<5c régies d’une maniéré économique
; que les droits dé douane ne furent
pas connus des premiers François , & que
les péages n’étoient point une impoftion
publique & fifcale, mais des droits établis
par les feigneurs, dans l’étendue de leurs
terres , fous prétexte des dépenfes nécef-
faires pour l’entretien des chemins & les
réparations des ponts & chauffées ; que
les rois avoient, à la vérité , quelques-
uns de ces péages dans leurs domaines ,
mais au même titre que ceux des feigneurs
; que le gîte qui etoit dans les
; archevêchés, évêchés & abbayes, fut con*
| verti depuis en argent, appeilé droit de
' gîtej & qu’il en fut de même de l’obligation
impoféë aux habitans de la campagne
, de fournir des. chevaux & des
voitures, & qui fut changée en un droit
d’oji , ou de chevauchée. .(*) |
Il feroit inutile d’entrer dans le détail
des autorités employées de part & d’autre ,
pour appuyer ces opinions oppolées. Sans
s’engager dans des differtations qui n au*
roient pas plus d?utilit.é, q\ie d’agrément,
on fe contentera de prévenir qu’on trou*
vera bientôt des faits qui fortifient beau1*
coup la première de ces opinions.
(*) N i fous la prçmiere, ni fous la fécondé
race ni bien avant dans la troifieme lignée dp
nos rpis, nous ne çonno,iffions en France l ’ufage
des tailies aides , fubfides, tels que nous les
voyons aujourd’hui. Nos rpis, pour' leur Æ/.itrete^
nement, faifoient fonds de leur domaine.- Quant
aux levées -extraordinaires , il s’étoit infinué unp
coutume, que les rois paffant par les archevêchés ,
évéçhés , abbayes, y gîtoient & aubergeorent
pour une nuit ; chofe qui fut changée en quelque
redeyan.ee en argent, non grande, appellée droit
de gîte. Recherches de Pafyuier, liy. 2, » chap. 7.
p R É L I M
On verra que fous les rois des premières
races , il fe lévoit fur les marchandifes,
des droits qu’on peut indistinctement
appeller de douane ou de péage,
puifque ces deux mots ,• avec ceux de redevance
, de coutume , d'aide, de fub-
vention & de gabelle, dénomination fuc-
cefîivement donnée à ces deux fortes de
droits , femblent défigner un impôt quelconque,
perceptible, foit localement dans
une certaine étendue de pays, foit généralement
à l ’entrée ou à la fortie du royaume.
On penfe donc que les droits de douane
qui fe levoient dans les ports de l’empire
Romain , eurent également lieu dans les
Gaules , tant qu’elles en firent partie , &
qu’ils continuèrent d’y lubfifter iorfque
Clovis fut parvenu à fonder fon royaume
fur .les débris de l’autorité Romaine , dont
une partie lui étoit confiée (48).-/ ,
Ce»n’eft que plus de cent ans après le
règne de Clovis, qu’il eft queftion , dans
les hiftoriens , des droits que payoient
les marchandises de toute efpèce, & qui
font proprement les droits de douane.
Clotaire I I , quatrième roi.de France,
convoque un concile à Paris en 615. On
y rapporte les repréfentations des peuples ,
contre la multiplicité des bureaux de
douane ou péage , contre la quotité des
droits, & contre la façon dont on les
exigeoit. Ce prince, rend un édit, pour
faire défenfe d’établir déformais d’autres
droits que ceux qui exiftoienc fous fes
prédécelfeurs (49).
(48) Cette opinion a été adoptée auffi par un
M. Gelée, correcteur en la chambre des comptes,
qui à mis des obfervations à chaque article de
l ’ouvrage de Jean 'Hennequin , intitulé Le Guidon
général des finances , in* 18 imprimé en 1605.
Ces deux écrivains : prétendent que ' Chilperic
impofa le droit de huitième fur le vin. Voyc* les
pages 1 y & 17a. Quoique l’ on convienne géné.-
ralernentf, d’après Grégoire de T ou rs , que Chilperic
exigea unam ampheram, par arpent de vigne,
cependant on n’eft. pas d’accord fur la continence
du vaiffieau amphora. M. l’abbé Dubos le traduit
par un tonneau-, & M. l’abbé de Mably par une
cruche. ■’ '
(4P) De teloneo ut per ea loca debet e x ig i ,
/ N A I R E. xvîj
L ’hiftoire de Dagobert, fuccefleur de
Clotaire, nous apprend que ces droits
étoient levés par des officiers appellés Ac-
tores régît , prépofés royaux , qui étoient
établis receveurs -dans les différens bureaux.
On y voit aufli que ce monarque ayant
donné à l’églife de Saint-Denis une rente
de cent fols d’o r, pour l’entretien du luminaire
de cette églife ; il en aflîgna le
paiement fur le produit de la douane de
Marfeille, & qu’il chargea même lep officiers
de cette douane , d’employer ces
cent fols à l ’achat des meilleures huiles ,
& qu’enfin ces huiles dévoient être chargées
fur. fix voitures, & conduites à leur
deftinatjon , avec affranchilïèment de tous
les droits , foit en fortant de Marfeille ,
foit dans les autres villes de la route ,
comme Valence , Lyon & autres (50).
Il paroît par un diplôme du même roi,
en faveur du marché de Saint-Den is (5 0 .
que plufieurs de ces droits , fans qu'on
fâche quelle étoit leur quotité, fe perce-
voient fur les marchandifes vendues dans
les foires ôc dans les places publiques (52) ;
que d’autres avoient lieu au paflage des
vel de fpeciebus iplïs de quibus præcidentium
principum tempore eft e x a é l u m t. premier,
mmP
lacuit nobis ut antiqua & jufta telonea à
negociatoribus exigantur , tam de pontibus , quàm
de navigiis feu mercatis , dit également Charlemagne
y capit. lib. 3 , cap. H .
(50) Præceptumque taliter , ut tam ipfa Maflîlia.
quàm Valentla , Lugdunum , vel quocumque per
reliqua loca tranfitus erat omne teîoneum de fex
plauftris quibus hæc videbatur deferri ufquè quoad
hanc balîlicam peraccederent , omnimodis effet
ihdultum. De geftis Dagoberti , cap. 18. Suivant
Procope, les François furent abfolument maîtres
de la Provence & de Marfeille, dès ƒ 3p.'Abrégé
chronolog. du Pré. Hénault, tom. premier, pag. 14.
Q i ) Continuation d’Aimoin , liv. chap. 10,
capitul. lib. 4 , cap. 31.
- (y i) On a vu ce même impôt , établi d’abord
par Augufte dans l ’empire Romain, & étendu en-
fuite par Caligula.
c