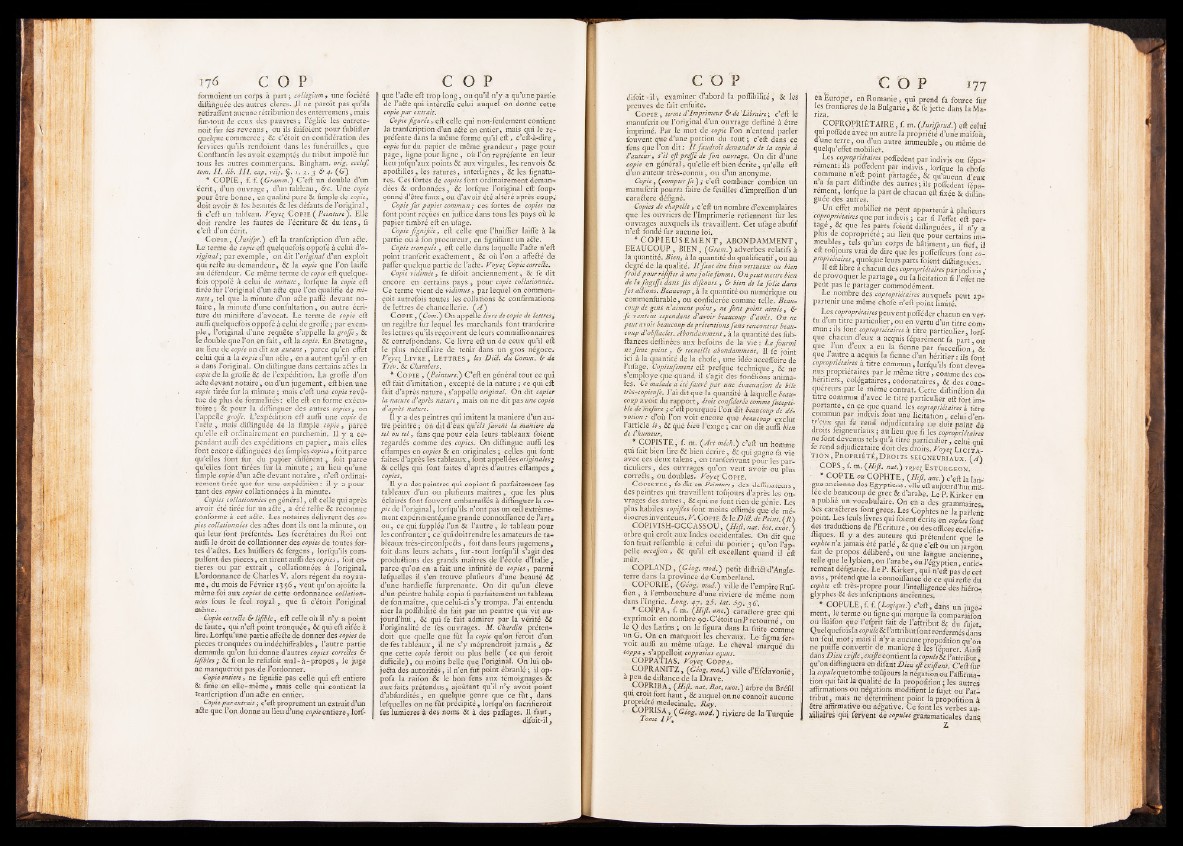
-r / ö C O P
formoient un corps à part ; collegium, une fociété
diftinguée des autres clercs. Jl ne paraît pas qu’ils
retiraflent aucune rétribution des enterremens, mais
fur-tout de ceux des pauvres ; l’églife les entrete-
noit fur fes revenus , ou ils faifoient pour fubfifter
quelque commerce ; & c’étoit en confideration des
Jtervices qu’ils rendoient dans les funérailles , que
Conftantm les avoit exemptés du tribut impofé fur
tous les autres commerçarts. Bingham. orig. ecclef.
tom. II. lib. III. cap. viij. §. %$:. £ & 4.
* CO PIE, f. f. {Gramm.') C ’efi un double d’un
'écrit, d’un ouvrage, d’un tableau, &c. Une copie
pour être bonne, en qualité pure & fimple de copie,
doit avoir & les beautés & les défauts de l’original,
fi c’efi un tableau. Voye{ Copie ( Peinture). Elle
doit rendre les fautes de l’écriture & du fens, fi
e’eft d’un écrit.
CoteiE , ( furifpr.) efi la tranfcription d’un a&e.
Le terme de copie efi quelquefois oppofé à celui d'original
; par exemple, on dit l’original d’un exploit
qui refie au demandeur, & la copie que l’on laide
au défendeur. Ce même terme de copie efi quelquefois
oppofé à celui de minute, lorfque la copie efi
tirée fur l ’original d’un afte que l’on qualifie de minute
, tel que la minute d’un a fie pané devant notaire
, la minute d’une confultation, ou autre écriture
du miniftere d’avocat. Le terme de copie efi
aufli quelquefois oppofé à celui de große ; par exemple
, l’original d’une requête s’appelle la große > &
le double que l’on en fait, efi la copie. En Bretagne,
au lieu de copie on dit un autant, parce qu’en effet
celui qui a la copie d’un afte, en a autant qu’il y en
a dans l’original. On difiingue dans certains aêles la
copie de la grolle & de l’expédition. La groffe d’un
a&e devant notaire, ou d’un jugement , efi bien une
copie tirée fur la minute ; mais c’eft une copie revêtue
de plus de formalités : elle efi en forme exécutoire
8s pour la diftinguer des autres copies, on
l'appelle große. L’expédition efi aufli une copie de
l’aéle., mais diflinguée de la fimple copie, parce
qu’elle efi ordinairement en parchemin. Il y a cependant
aufli des expéditions en papier, mais elles
fönt encore diftinguées des fimples copies > foit parce
qu’elles font fur du papier différent, foit parce
qu’elles, font tirées fur la minute ; au lieu qu’une
fimple copie d’un afte devant notaire, n’eft ordinairement
tirée que fur une expédition : il y a pourtant
des. copies collationnées à la minute.
Copies collationnées en général, efi celle qui après
avoir été tirée fur un a&e, a été relûe & reconnue
conforme à cet aéle. Les notaires délivrent des copies
collationnées des aôes dont ils ont la minute, ou
qui leur font préfentés. Les fecrétaires du Roi ont
aufli le droit de collationner des copies de toutes fortes
d’a&es. Les huifliers & fergens, lorfqu’ils com-
pulfent des pièces, en tirent aufli des copies, foit entières
ou par extrait, collationnées à l’original.
L’ordonnance de Charles V. alors régent du royaume
, du mois de Février 13 56, veut qu’on ajoute la
même foi aux copies de cette ordonnance collationnées
fous le fcel r o y a l, que fi c’étoit l’original
même.
Copie correcte & lifible, efi celle- oit il n’y a point
de faute, qui n’eft point tronquée, & qui efi aifée à
Kre. Lorfqu’une partie affefte de donner des copies de
pièces tronquées ou-indéchiffrables, l’autre partie
demande qu’on lui donne d’autres copies correctes &
lifibrles ; & fi on le refufoit mal-à-propos, le juge
ne manquerait pas de l’ordonner.
Copie entière, ne lignifie pas celle qui efi entière
8c finie en elle-même, mais celle qui contient la
tranfcription d’un aâe en entier.
: Copie par extrait ; ç’èft proprement un extrait d’un
aûe que l’on donne au lieu d’une copie entière, lorf-
C O P
! que l’a&e efi trop long, ou qu’il n’y a qu’une partie
! de l’aâe qui intérefle celui auquel on donne cette
! copie par extrait.
\ Copie figurée , efi celle qui non-feulement contientj
la tranfcription d’un a£le en entier, mais qui le re-
I préfente dans la même forme qu’il e fi, c’eft-à-dire,
| copie fur du papier de même grandeur, page pour
; page, ligne pour ligne , où l’on repréfente en leur
i lieu jufqu’aux points & aux virgules, les renvois &
apoftilles, les ratures, interlignes , & les fignatu-
res. Ces fortes de copies font ordinairement demandées
8r ordonnées, & lorfque l’original efi foup-
çonné d’être faux, ou d’avoir été altéré après eoup.:
Copie fur papier commun; ces fortes de copies ne
font point reçues en juftice dans tous les pays où le
papier timbré efi en ufage.
Copie Jîgnifiée, efi celle que l’huiflier laiffe à la,
partie ou à fon procureur, en lignifiant un aâe.
Copie tronquée, efi celle -dans laquelle l’afte n’eft
point tranferit exactement, & où l’on a affeCté de
palier quelque partie de l’aête. Voye{ Copie correcte.
Copie vidimée, fe difoit anciennement, 8c fe dit
encore en certains pays , pour copie collationnée.
Ce terme vient de vidimus, par lequel on commen-
çoit autrefois toutes les collations & confirmations
de lettres de chancellerie. {A )
Copie , (Com.) On appelle livre de copie de lettres,
un regiftre fur lequel les marchands font tranferire
les lettres qu’ils reçoivent de leurs commiflionnaires
& correfpondans. Ce livre efi un de ceux qu’il efi
le plus néceflaire de tenir dans un gros négoce.
Voye{ Livre , Lettres , les Dict. du Comm. & de
Trév. &C Ckambers.
* Copie , {Peinture.) C ’eft en général tout ce qui
efi fait d’imitation, excepté de la nature ; ce qui efi
fait d’après nature, s’appelle original. On dit copier
la nature d'après nature, mais on ne dit pas une copie
d'après nature.
Il y a des peintres qui imitent la maniéré d’un autre
peintre ; on dit d’eux qu’i/j favent la maniéré de
tel ou tel y fans que pour cela leurs tableaux foient
regardés comme des copies. On difiingue aufli les
eftampes en copies 8c en originales ; celles qui font
faites d’après les tableaux,. font appellées originales •
8c cellps qui font faites d’après d’autres eftampes *
copies.
Il y a des peintres qui copient fi parfaitement les
tableaux d’un ou plufieurs maîtres, que les plus
éclairés font fouvent embarraffés à diftinguer la copie
de l’original, lorfqu’ils n’ont pas un oeil extrêmement
expérimenté,une grande connoiflance de l’art,
ou, ce qui fupplée l’un 8c l’autre , le tableau pour
les confronter ; ce qui doitrendre les amateurs de tableaux
très-circonlpeds , foit dans leurs jugemens,
foit dans leurs achats, fur-tout lorfqu’il s’agit des
productions des grands maîtres de l’ecole d’Italie
parce qu’on en a fait une infinité de copies , parmi
lefquelles -il s’en trouve plufieurs d’une beauté 8c
d’une hardiefle furprenante. On dit qu’un élevé
d’un peintre habile copia fi parfaitement un tableau
de fon maître, que celui-ci s ’y trompa. J’ai entendu,
nier la polfibilite du fait par un peintre qui vit aujourd’hui
, & qui fe fait admirer par la vérité ÔC
l’originalité de fes ouvrages. M. Chardin préten-
doit que quelle que fut la copie qu’on feroit d’un
de fes tableaux, il ne s’y méprendrait jamais, &
que cette copie feroit ou plus belle ( ce qui feroit
difficile), ou moins belle que l’original. On lui ob*
jetta des autorités, il n’en fut point ébranlé ; il op-
pofa la raifon & le bon fens aux témoignages &
aux faits prétendus, ajoûtant qu’il n’y avoit point
d’abfurdités, en quelque genre que ce fû t , dans
lefquelles on ne fût précipité, lorfqu’on facrifieroit
fes lumières à des noms 8c à des paflages. Il faut,
difoit-il,
C O P difoit - i l , examiner d’abord la poflibihté, 8c les
preuves de fait enfuite.
Copie , terme d'imprimeur & de 'Libraire ; c’éft le
manuferit oü l’original d’un ouvrage deftiné à être
imprimé. Par le mot de copie l’on n’entend parler
fouvent que d’une portion du tout ; c’eft dans ce
fens que l’on dit: I l faudroit demander de la Copie à
P auteur, s'il efi preffé de fon ouvrage. On dit d’une
copie en général, qu’elle efi bien écrite, qu’elle efi
d’un auteur très-connu, ou d’un anonyme.
Copie, {compter fa ) ; c’eft combiner combien un
manuferit pourra faire de feuilles d’impreflion d’un
cara&ere déligné.
Copies de chapelle , c ’eft Un nombre d’exemplaires
que les ouvriers de l’Imprimerie retiennent fur les
ouvrages auxquels ils travaillent. Cet ufage abufif
ti’eft fondé fur aucune loi.
* C O P IE U S E M E N T , ABONDÀMMENT,
BEAUCOUP , BIEN, {Gram.) adverbes relatifs à
là quantité. Bien, à la quantité du qualificatif, ou au
degré de la qualité. H fout être bien vertueux oit bien
froid pourréfifier à une jolie femme. On peut mettre bien
de U fageße dans fes difeours , & bien de la folie dans
fes allions. Beaucoup, à la quantité ou numérique ou
commenfurable, ou confiderée comme telle. Beaucoup
de gens n'aimentpoint y ne font poiitt aimés , 6*
fe vantent cependant d'avoir 'beaucoup d'amis. On ne
peut avoir beaucoup de prétentions fans rencontrer beaucoup
d'obfiacles. Abondamment, à la quantité des fub-
fiances deftinées aux befoins de la vie : Là fourmi
ne ferne point , & recueille abondamment. Il fe joint
ici à la quantité de la chofe, une idée accefloire de
l ’ufage. Copieufement efi prefque technique, & ne
s’employe que quand il s’agit des fondions animales.
Ce malade a été fauvé par une évacuation de bile
très-copieufe. J’ai dit que la quantité à laquelle beaucoup
àvôit du rapport, étoit confiderée comme Jiucepti-
ble de Oiefure ; c’eft pourquoi l’on dit beaucoup de dé-
votion : d’où l’on voit encore que beaucoup exclut
l’article le y & que bien l ’exige ; car oft dit aufli bien
de Phumeur.
* COPISTE, f. m. {Art tnéch.) c’eft: un homme
qui fait bien lire & bien écrire, & qui gagne fa vie
avec ces deux talens, en tranferivant pour les particuliers
, des ouvrages qu’on veut avoir où plus
corrects, ou doubles. Voye^ Copie.
Copistes , fe dit en Peinture, dés deiïïnatèürs,
des peintres qui travaillent toûjours d’après les où- :
vrages des autres, & qui ne font rien de génie. Les
plus habiles copifies font moins eftimés que de médiocres
inventeurs.7^. Copie 8e IeDict. de Peint. (R)
COPIVISH-OCCASSOU, {Hifi.nat. bot.exot.)
arbre qui croît aux Indes occidentales. On dit que
fon fruit reflemble à celui du poirier; qu’on l’appelle
occaßou y & qu’il efi excellent quand il efi
mûr.
COPLAND, {Géog. mod.) petit diftrift d’Angleterre
dans la province de Cumberland.
- COPORIE, {Géog. mod.) ville de l’empire Ruf-
fien , à l’embouchure d’une riviere de mérite nom
dansl’Ingrie. Long. 47. 2 S. lat. Sa faG.
* COPPA, f. m. {ffifi. anc.) caraélere grec qui
exprimoit en nombre 90. C ’étoit un P retourné ou
le Q des Latins ; on le figura dans la fuite comme
un G. On en marquoit les chevaux. Le figma fer*-
voit aufli au même ufage. Le cheval marqué du
coppa y s’appelloit coppatias equus. -
• COPPATIAS. Voyeç Coppa;
COPRANITZ, {Géog. mod.) ville d’EfcIavonié,
à peu de diftance. de la Drave.
COPRIBA, {ffifi. nat. Bot. exot.) arbre du Bréfil
qui croit fort haut, & auquel on ne coririoît aucune
propriété medecinale. Ray.
C ° T m n e f v ^ 1111 Bp ) *W re & la Turquie
C O P 177
en Europe , enRomanie, qui prend 6 fouree fur
les frontières de la Bulgarie, & fe iefte dâhs la Mà-
riza.
COPROPRIÉTAIRE, f. m. {Jurïfprud.) efi celui
qui pofféde avec un autre la propriété dW e fflàifoh,
d une terre, ou d’un autre immeuble, ou même de
quelqu’effet mobilier.
, Les ‘ »P'opriitMris. poffedent par indivis ou fépa-
rement: ils poffedent pàr inaivis for'fque la chofe
commune n’eft point partagée, & qu’aucun d’eux
n a la part diftin£te dés autres ; ils poffedent féna-
retnent, lorfque la part de chacun eit fixée & diffih-
guee des autres;
: V “ - elPet mahilier rte Réiit appartenir à plufieurs
Ç°proprietaires:qae par indivis; car .fi l’effet eft partage,
& que les patts foient diftinguées, il nV à
plus de copropriété;; ad lieu que pour certains imi
meubles, tels qu’un corps de bâtiment,.tjn fief, il
èft toujours vrai de dire que lès poflefteurs font co-
B H , quoique leurs parts forent diftingiié.es, '
Il eit libre a chacun des copropriétaires par iûdi vis '
de provoquer le partage, ou la licitation, fi feffet né
petit pas fe partager commodément.
Le nombre des copropriétaires auxquels peut appartenir
Une même' chofe n’eft point limité. 1
< coproprémins peuvent pofféder chacun en ver,
tu d un titre particulier, ou en vertu d’un titre commun
: ils {ont,copropriétaires à titre pàrticiUierilprf-
que chactin d’eux a acquis féparément fa part , ou
que l ’un d’eux a eu la fienr.e p g fucccffion- & '
que 1 autreâ.acquis la fienne d’un héritier: ils font
^propriétairea titre commun, lorfqu’ils'font-deve^
nus propriétaires par le même titre , comme des coc
heritiers, colégataires , çodonataires, & des coacquéreurs
pàr le même contrat. Cette diftinftion dp
-@.re, «O“ ™“ * 4’?y?c le titré particulier eft fort inu-
portante, én ce que qiiand les copropriétaires à titre
commun par ihdiyis'font une licitation, celui d’en-
treux qui fe rend adjudicataire ne doit point de
droits feigneunaux; itilièù que iî dès. copropriétaires
ne font devenus tefs'qu’à titre particulier, celui qui
fe rend adjudicataire doit' des droits, frtiyer Lt c-itàc ■ ïï,?ÿ> PrOPRI1T.1!, PttOI.#. SEIGNEDRIAVX, (^)
( COPS, f. m. (HiJÏ. nol.y voye^ Esxup.GEOrr. ■
- ‘ COPTE ou COPHTE, (Bijl.knc.-) c’eftlalan-'
gue ancienne des Egyptiens : elle eft aujourd’hui mêlée
de beaucoup de grec & d’arabe. Le P. Kirkef en
a publié un vocabulaire. On eh a des grammaires
Ses caraaeres font grecs. LesCophtCs ne la bàHéfli
point. Les feuls livres qui foient écrits en cophte font
des traduaions de l’Ecriture, ou des offices éccléfia-
ftiques.Tl -y a des auteurs qui prétendent que lé
cophte n'a jamais été parlé, & que c’eft ou 'un ,afgOrt
fait de propos délibéré, ou une langue ancienne
telle que le lybien,ou-l’arabe, Ou l’égyptien, entièrement
défigurée. LeP. Kirker, 'qufn’eftpasdecet
avis , prétend que la connoiflance de ce quirefte dii
Cophte eft très,propre pour l’intelligence dès hiéroglyphes
& desânfcriptions anciennes,
' * COPULE, f. f. (logipit.) c’eft, dans utf jiigec
ment , le terme Ou Ligne qui mqrqùè la coriiparàifon
ou liaifon que l’efpnt fait de l’attribut & dit fujet.
Quelquefbisla copute, & l’attributfoht renfermés dans
un feul mot ; maïs il n’y à auciihe propofitibn qu’ôà
ne puiffe convertir dê.maniéré é leS'-féparer. Aihfî
dans Dieu exijle ,éxijle contient la copule & TattrîÊtrt j
qu’on diftinguera en difartt Dieu efi txifiant. Ç’èft fur
la copule que tombé toujours la négation OuTaffirma-
tiotr'qui fait là qualité de la propofinoif; iés autres
affirmations ou négations modifient le fujet ou l’attribut,
mais ne detëimihent point la propofition à
être affirmative 6u: négative. Cè font les verbes an-
xiliaifes qiti fervent dë copules grammaticales dans