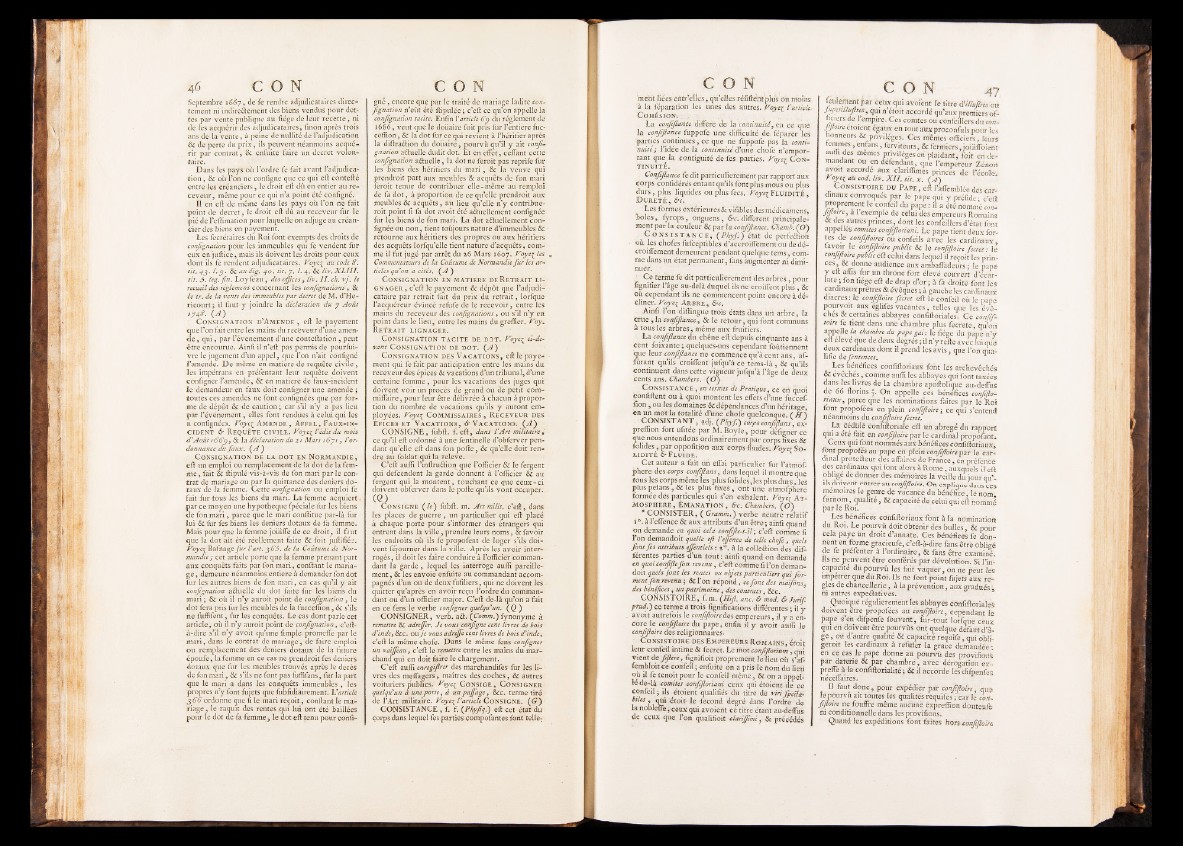
Septembre ï 667, de fe rendre adjudicataires directement
ni indirectement des biens vendus pour dettes
par vente publique au fiége de leur recette, ni
de les acquérir des adjudicataires, finon après trois
ans de la vente, à peine de nullité de l’adjudication
& de perte du prix, ils peuvent néanmoins acquérir
par contrat, <k enfuite faire un decret volontaire.
Dans les paysoù l ’ordre fe fait avant radjudica-
tion , & où l’on ne configne que ce qui eft contefté
entre des créanciers, le droit eft du en entier au receveur,
même pour ce qui n’a point été configné.
Il en eft de même dans les pays où l’on ne fait
point de decret, le droit eft dû au receveur fur le
pié de l’eftimation pour laquelle on adjuge au créancier
des biens en payement.
Les fecrétaires du Roi font exempts des droits de
, confignation pour les immeubles qui fe vendent fur
•eux en juftice, mais ils doivent les droits pour ceux
dont ils fe rendent adjudicataires. Voye£ au code 8.
tit. 4g. I.£). & audig. 40. tit. y . I. 4. & liv.XLIIl.
tit. 5. leg.fin. Loyfeau , des offices, liv. II. ch. vj. le
recueil des réglemens concernant les conjîgnaùons, &
le ir. de la vente, des immeubles par. decret de M. d’He-
ricourt ; il faut y joindre la déclaration du y Août
' 74«?- ( ^ ) : ' ' Consignation d’Amende , eft le payement
que l’on fait entre les mains du receveur d’une amende
, qui, par l’évenement d’une conteftation , peut
être encourue. Ainfi il n’eft pas permis de pourfui-
vre le jugement d’un appel, que l’on n’ait configné
l ’amende. De même en matière de requête civile,
les impétrans en préfentant leur requête doivent
configner l’amende, & en matière de faux-incident
le demandeur en faux doit configner une amende ;
toutes ces amendes ne font confignées que par forme
de dépôt & de caution ; car s’il n’y a pas lieu
par l’évenement, elles font rendues à celui qui les
a confignées. Voye^ Amende , Appel , Faux-incident
& Requête civile. Voye1 l’ édit du mais
d'Août 16'6'ÿ, & la déclaration du z 1 Mars lô'yi, l'ordonnance
du faux. (A )
Consignation de la d o t .en Normandie,
eft un emploi ou remplacement de la dot de la femm
e , fait & ftipulé vis-à-vis de fon mari par le contrat
de mariage ou par la quittance des deniers dotaux
de la femme. Cette conjîgnation ou emploi fe
fait fur tous les biens du mari. La femme acquiert.
par ce moyen une hypotheque fpéciale fur les biens
de fon m ari, parce que le mari conftitue par-là fur
lui & fur fes biens les deniers dotaux de fa femme.
Mais pour que la femme joüîffe de ce droit, il faut
que la dot ait été réellement faite & foit juftifiéa.
Voye^ Bafnage fur l'art, g €5. de la Coutume de Normandie
; cet article porte que la femme prenant part
aux conquêts faits par fon mari, confiant le mariage
, demeure néanmoins entière à demander fon dot
fur les autres biens de fon mari, en cas qu’il y ait
confignation aCtuelle du dot faite fur les biens du
mari ; & où il n’y auroit point de conjîgnation, le
dot fera pris fur les meubles de la fucceflion, & s’ils
ne fuffifent, fur les conquêts. Le cas dont parle cet
article, où il n’y auroit point de conjîgnation, c’eft-
à-dire s’il n’y avoit qu’une fimple promeffe par le
mari, dans le contrat de mariage, de faire emploi
ou remplacement des deniers dotaux de la future
époufe, la femme en ce cas ne prendroit fes deniers
dotaux que fur les meubles trouvés après le décès
de fon mari, & s’ils ne font pas fuffifans, fur la part
que le mari a dans les conquêts immeubles , les
propres n’y font fujets que fubfidiairement. L'article
g 6 6 ordonne que fi le mari reçoit, confiant le mariage
, le raquit des rentes qui lui ont été baillées
poiu- le dot de fa femme, le dot eft tenu pour çonfignë,
encore que par le traité de mariage ladite confignation
n’eût été ftipulée ; c’eft ce qu’on appelle la
conjîgnation tacite. Enfin l3article du réglement de
1666, veut que le doiiaire foit pris fur l’entiere fucceflion
, & la dot fur ce qui revient à l’héritier après
la diftr aCtion du doiiaire, pourvu qu’il y ait conjîgnation
actuelle dudit dot. Et en effet, ceflant cette
confignation aCtuelle, la dot ne feroit pas reprife fur
les biens des héritiers du mari, & la veuve qui
prendroit part aux meubles & acquêts de fon mari
feroit tenue de contribuer elle-même au remploi
de fa dot, à proportion de ce qu’elle prendroit aux
meubles & acquêts, au lieu qu’elle n’y contribue-
roit point fi fa dot avoit été actuellement confignée
fur les biens de fon mari. La dot actuellement confignée
ou non, tient toûjours nature d’immeubles &
retourne aux héritiers des propres ou aux héritiers
des acquêts lorfqu’elle tient nature d’acquêts, comme
il fut jugé par arrêt du 16 Mars 1607. Voye^ les v
Commentateurs de la Coutume de Normandie fur les articles
qu'on a cités. (A )
Consignation en matière de Retrait lignager
, c’eft le payement & dépôt que l’adjudicataire
par retrait fait du prix du retrait, lorfque
l ’acquéreur évincé refufe de le recevoir, entre les
mains du receveur des confignations, ou s’il n’y en
point dans le lieu, entre les mains du greffier. Voy.
Retrait lignager.
C onsignation ta cite de d ot. Voye^ ci-devant
Consignation de dot. (A )
Consignation des Vacations, eft le payement
qui fe fait par anticipation entre les mains du
receveur des épices & vacations d’un tribunal, d’une
certaine fomme, pour les vacations des juges qui
doivent voir un procès de grand ou de petit com-
miflaire, pour leur être délivrée à chacun à proportion
du nombre de vacations qu’ils y auront employées.
Voyei Commissaires , Receveur des
Épices et Vacations, 6* Vacations. ÇA')
CONSIGNE, fubft. f. eft, dans l'Art militaire,
ce qu’il eft ordonné à une fentinelle d’obferver pendant
qu’elle eft dans fon pofte, & qu’elle doit rendre
au foldat qui la releve.
C ’eft aufli l’inftruCtion^que l’officier & le fergent
qui defeendent la garde donnent à l’officier & au
fergent qui la montent, touchant ce que ceux-ci
doivent obfervcr dans le pofte m qu’ils vont occuper. Consigne (/«) fubft. m. Art milit. c’e ft, dans
les placés de guerre, un particulier qui eft placé
à chaque porte pour s’informer des etrangers qui
entrent dans la v ille , prendre leurs noms, & favoir
les endroits où ils fe propofent de loger s’ils doivent
féjourner dans la ville. Après les avoir interrogés
, il doit les faire conduire à l’officier commandant
la garde, lequel les interroge aufli pareillement
, & les envoie enfuite au commandant accompagnés
d’un ou de deux fufiliers, qui ne doivent les
quitter qu’après en avoir reçu l’ordre du commandant
ou d’un officier major. C ’eft de-là qu’on a fait
en ce fe ns le verbe configner quelqu'un. ÇQ )
CONSIGNER, verb. a£t. ÇComm.) fynonyme à
remettre & adreffer. Je vous cOnfigne cent livres de bois
d'inde, & c. ou je vous adrejfe cent livres de bois d'inde,
c’eft la même chofe. Dans le même fens configner
un vaijfeau, c’eft le remettre entre les mains du marchand
qui en doit faire le chargement.
C ’eft aufli enregifirer des marchandifes fur les livres
des meflagers, maîtres des coches, & autres
voituriers publics. Voye^ Consige , Consigner
quelqu'un a une porte, à un pajfage , & c . terme tiré
de l’Art militaire. Voye^ l'article Consigne. (G )
CONSISTANCE , f. f. ÇPhyfiqî) eft cet état du
corps dans lequel fes parties compofantes font tellement
liées efitr’elies, qu’élles réfiftenf plus ou moins
à la féparàtion les unes des autres. Voyeç l'article--
C ohésion-. .;. .
La confifiance différé de la continuité, en ce que
la confifiance fuppofe une difficulté de. féparèr les
parties continues, ce que ne fuppofe pas la continuité
; l’idée de la continuité d’une chofe n’emportant
qite la contiguïté de fes parties. Vqye^ Continuité.
Confifiance fe dit particulièrement par rapport aux
corps confiderés entant qu’ils fontplus mous ou plus
durs, plus liquides ou plus fecs. Voye^ Fluidité ,
D ureté , &c.
Les formés extérieures & vifibles des médicamens,
boles, fyrbps, onguehs, &c< different principalement
par la couleur & par la confifiance. Chamb. ÇO)
. C o n s i s t a n c e , ( Pkyf ) état de perfection
• où les chofes fufceptibles d’accroiffement ou dedé-
eroiffement demeurent pendant quelque tems, comnmueé
dea n;s un état permanent, fans augmenter ni dimi'
Ce terme fe dit particulièrement des arbres, pour
fignifier l’âge au-delà duquel ils he crôiffent p lus, &
où cependant ils rte commencent point encore à décliner.
Voye{ Arbre, & c.
Ainfi l’on diftingue trois états dans un arbre, la
crue j la confifiance, & le retour, qui font communs
à tous les arbres , même aux fruitiers.
La confifiance du chêne eft depuis cinquante ans à
cent foixante ; quelques-uns cependant foûtiennent
que leur confifiance ne commence qu’à cent ans, af-
fûrant qu’ils Crôiffent jnfqu’à ce tems-là, & qu’ils
continuent dans cette vigueur jufqu’à l’âge de deux
cents ans. Chambers. (V )
Consistance , en termes de Pratique, ce en quoi
donfiftent ou à quoi montent lés effets d’tine fuccef-
fion, ou les domaihes & dépendances d’un héritage,
en un mot la totalité d’une chofe quelconque. (H )
< ' CONSISTANT, adj. ÇPhyf.) corpscon/fians, ex-
preflîon fort ufitéè par M. Boylè, pour défigner ce
que nous entendons ordinairement par corps fixes &
iolides, par oppofition aux corps flux des. Voye? Solidité
& FLUIDE;
Cet auteur a fait un effai particulier fur l’atmOf-
phere des corps coififtans ; dans lequel il montre cjue
tous les corps même les plus folides,les plus durs les
plus pefàns, & les plus fixes, Ont une atmofpherë
formée des particules qui s’en exhalent. Vôyei Atmosphère,
ÉMANATION, &c. Chambers. (O)
* CONSISTER, Ç Gramm. ) verbe neutre relatif
i °. à l’effence & aüx attributs d’un être ; ainfi quand
on demande en quoi cela confifie-t-il; c’eft comme fi
l’on demârtdoit quelle eft l'ejjence de telle chofe , quels
font fes attributs effentiels : t ° . à la eolleftion des différentes
parties d’un tout: ainfi quand on demande
eh quoi confifle foh revenu, c’eft comme fi l’on deman-
doit quels font les rentes ou objets particuliers qui forment
f in revenu ; Se l’on répond, ce font des tnaifinsi
des bénéfices + ùripatrimoine, des contrats &e.
CONSISTOIRE, f.m. (Hift. anc.fr mod.&Jurif-
prud.) ce terme; â trois figriifications différentes ; il y
. avoit autrefois le confifioire àes empereurs, il y a encore
le confiftoire du pape, enfin il y avoit aufli le
confiftoire des religionnaires.
Consistoire e>es Emperèürs Romains , étoiç
leur confeil intime & fecret. Lé mot confifiorium , qui
Vient de fiftere, fignifioit proprement le lieu où s’afi
fembloit ce confeil; enfuite on a pris le nom du lieft
où il fe tenoitpour le confeii même, & on a appëb
lé de-là comités cohfiftoriani cèux qui étoient de cé
confeil ; ils étoient qualifiés du titre de viri fpectd
biles, qfti étoit- le fécond degré dans l’ordre de
la nobleffë, ceux qui avoieiït ce titre étant au-dèffus
de ceux que l’on qualifioit clanjfimi, & précédés
feulement fiar ceux qui àvoïbnt le titré SUlhpïs oit
Jupinlluftm, qui n’étoit accordé qu’aux premiers of-
hciers de l’empire. Ces comtes ou confeillers d\\.coru-
Jutoirc etorertt égaux en tout aux proconfuls pour les
honneurs Oc privilèges. Ces memes officiers, leurs
remmes , entans, ferviteurs, & fermiers, ioiiiffoient
aufli des memes privilèges en plaidant , foit en de-
mandant ou en défendant, que l’empeteur Zérton
aVoit accorde aux clanffimes princes de l’écoléi
r jjrcj M coâ. lïv. X I I . tit. x. (A )
Consistoire du Pa pe, éft l’àffembUedesear-
dmaux convoqués par le pape qui y préEde ■ c’eft
proprement le confeil du pape : il a été nommé tona
JiJtoift, à l'exemple de celui des empereurs Romains
& des autres princes, dont les confeillers d’état font
appelles comités corififtoriani. Le pape tient dèux for-
tes de confiftoirà cm cOnfeils àvee lés cardinaux,
H B ,le c°nfifi°ire public & le àmjàoire fecrà : le
conjtjhire public eft celui dans lequel i; reçoit les prin-
ces, & donne audience aux ambaffàdeürs ; le papd
y eft affis fur un thrOné fort élevé couvert d’eéar-
late ; fon fiége eft de drap d’p r; à f a droite font les
cardinauxpretres & évoques ; à gauche lés cardinaux
diacres : le cOnfifioire fiera eft le confeil oit lé papè
pourvoit àux églifes vacàntes , telles que les évè-
cnë's & cetfaiiies abbaye? confiftoriàles: Ce confip.
taire fe tient dans, une cbartibre plus fecreie, qu’on
appelle fe chambre du pape gai: le fiége du papê n’y
eft élèvë que de deux degrés ;il n’y relie avec lui qué
deux cardinaux dOnt il prend les avis, que l’on quai
lifie de fentences.
Les bénéfices cônfiftôriaux font les archevêchés
& évêchés, comme aufli les abbayes qui font taxées
dans les livres de la chambre apoftolique âu-defliiâ
de 66 florins y. On appelle ces bénéfices confifio-
riaux, parce que les nominations faites par le Rot
font propoféës en plein coffifioire ; ce qui s’entend
néanmoins du confiftoire fecret.
• ,c^dtl!é cônfiftoriale eft un abrégé du rappbrt
qui a été fait en confiftoire par le cardinal propofant.
Ceux qui font nommés aux bénéfices cônfiftôriaux*
font propofés au pape en plein confiftoire par le car-
dmal prote&eur des affaires de France, en préfencè
des cardinaux qui font alors à Rome , auxquels il eft
obligé de donner des mémoires la veille du jour qu’-
îls doivent entrer au confiftoire. On explique dans ces
mémoires le genre de vacance du bénéfice, lé nom
fiirnôm, qualité, & capacité de celui qui eft nommé
par lé Rbi.
Les bénéficës cbnfiftofiaiix font à la ndmination
du Roi. Le pourvu doit obtenir des bulles , & pour
cela paye ùn droit d’annate. Ces bénéfices fe donnent
én forme gracieufe, t ’eft-à-dire fans être obligé
de fe prefenter à 1 ordinaire, & fans être examiné.
Ils ne peuvent être conférés par dévolution. Si l ’incapacité
du pourvû les fait vaquer, on ne peut les
impetrer que dii Roi. Ils ne font point fujets aux réglés
de chancellerie, à la prévention, aux gradués -
ni attires expectatives.
Quoique régulièrement les abbayes ebnfiftorialeè
doivent être propoféës au confiftoire, cependant lè
pape s’én dîfpënfe fouvent, fur-tout lorfque ceux
qui en doivent être pourvus ont quelque défaut d’âge
,• oïi d’antre qualité & capacité requife, qui obli-
geroit les cardinaux à refufef la grâce demandée :
en ce cas .le pape donne au pourvu des provifiorii
j)àr datëriè & par chambré, avec dérogation ex-
prefle à la confiftorialité ; & il accorde lés difpenfes
néceffairesi
Il faut donc, pour expédier par confiftoire, qu$»
lë pourvû ait toutes les qualités requifes ; car le cort-
JîJloire ne fouffre même aucune, èxpreflion douteufe
ni conditionnelle dans les prbvifions.
Quand lés expéditions font faites hors aonfiftoire