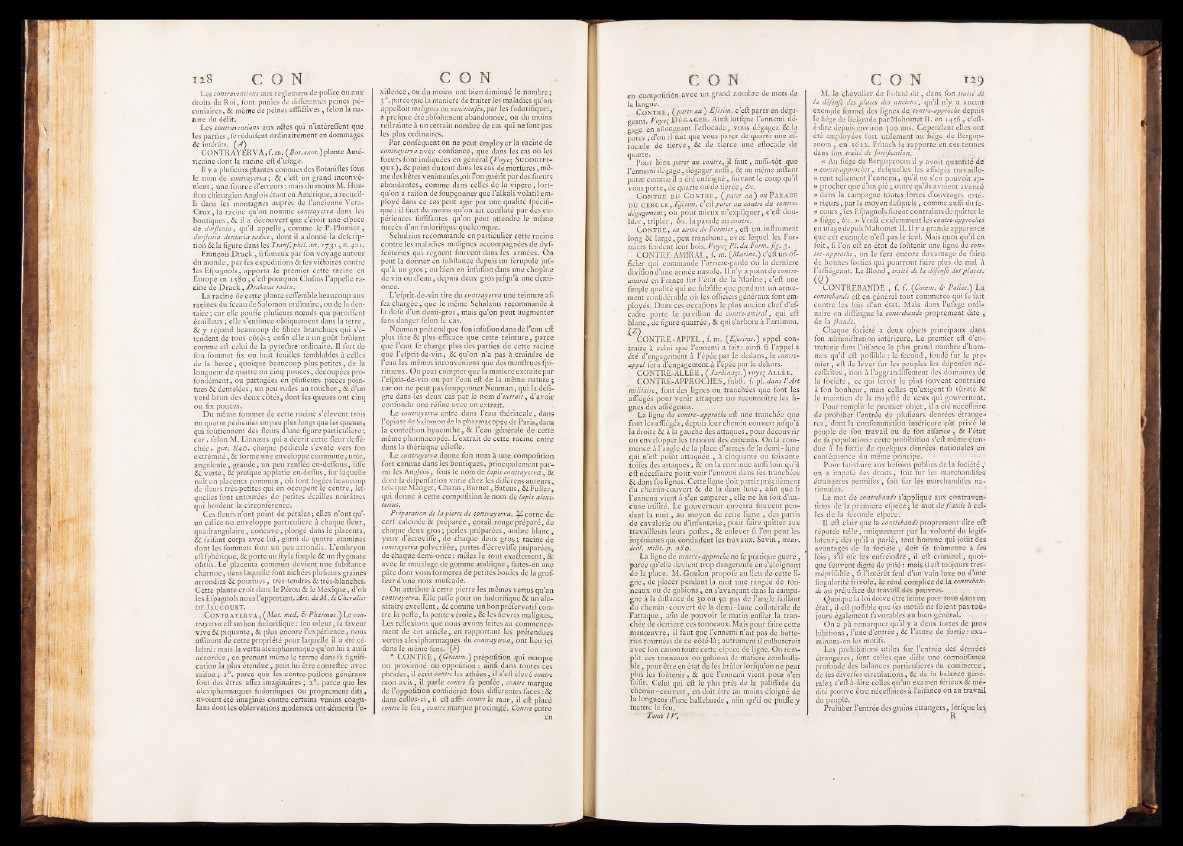
Les contraventions aux reglemens de police ou aux
droits du Roi, l'ont punies de différentes peines pécuniaires
, & même de peines affli&ives, félon la nature
du délit.
Les contraventions aux aûes qui n’intéreffent que
les parties, fe réduifent ordinairement en dommages
intérêts. (A)
CONTRAYERVA, f. m. (Bot. exot.)plante Américaine
dont la racine éft d’iuage.
Il y a plufieurs plantes connues des Botaniftes fous
le nom de contrayerva ; 8c c’eft un grand inconvénient
, une fource d’erreurs : mais du moins M. Hou-
fton chirurgien Anglois étant en Amérique, a recueilli
dans les montagnes auprès de l’ancienne Vera-
Cru x, la racine qu’on nomme contrayerva dans les
boutiques, Sc il a découvert que c’étoit une efpece
de dorflenia, qu’il appelle, comme le P.Plumier ,
dorjlenia dentaria radice, dont il a donné la defcrip-
tion Scia figuré dans les Tranf. phil. an. 773/, n. 42/,
François Drack, li fameux par fon. voyage autour
du monde, par fes expéditions & fes vi&oires contre
les Efpagnols, apporta le premier cette racine en
Europe en 1580; c’eft pourquoi Clufius l’appelle ratine
de Drack, Drakena radix.
La racine de cette plante reffemble beaucoup aux
racines du fceau de Salomon ordinaire, ou de la dentaire
; car elle pouffe plufieurs noeuds qui paroifl'ent
écailleux ; elle s’enfonce obliquement dans la terre,
ôc y répand beaucoup de fibres branchues qui s?é-
tendent de tous côtés ; enfin elle a un goût brûlant
comme ell celui de la pyrethre ordinaire. Il fort de
fon fommet fix ou huit feuilles femblables à celles
de la berce, quoique beaucoup plus petites, de la
longueur de quatre ou cinq pouces, découpées profondément
, ou partagées en plufieurs pièces pointues
Sc dentelées, un peu rudes au toucher, & d’un
verd brun des deux côtés, dont les queues ont cinq
ou fix pouces.
Du même fommet de cette racine s’élèvent trois
ou quatre pédicules un peu plus longs que les queues,
qui foûtiennent des fleurs d’une figure particulière ;
ca r , félon M. Linnæus qui a décrit cette fleur deffé-
chée, gen. 840. chaque pédicule s’évafe vers fon
extrémité, & forme une enveloppe commune, unie,
anguleufe, grande, un peu renflée en-deffous, liffe
& verte, Sc prefque applatie en-deffus, fur laquelle
naît un placenta commun, où font logées beaucoup
de fleurs très-petites qui en occupent le centre, lel-
quelles font entourées de petites écailles noirâtres
qui bordent la circonférence.
Ces fleurs n’ont point de pétales ; elles n’ont qu’un
calice ou enveloppe particulière à chaque fleur,
quadrangulaire, concave, plongé dans le placenta,
& faifant corps avec lui, garni de quatre étamines
dont les fommets font un peu arrondis. L’embryon
eft fphérique, Sc porte un ftyle fimple Sc un ftygmate
obtus. Le placenta commun devient une fubftance
charnue, dans laquelle font nichées plufieurs graines
arrondies Sc pointues, très-tendres & très-blanches.
Cette plante croît dans le Pérou & le Mexique, d’où
les Efpagnols nous l’apportent. Art. de M. Le Chevalier
-DE J AU COURT.
Contrayerva , (Mat. med. & Pharmac.) Le contrayerva
eft un bon fudorifique : fon odeur, fa faveur
vive Sc piquante, & plus encore l’expérience, nous
affûrent de cette propriété pour laquelle il a été célébré
: mais la vertu alexipharmaque qu’on lui a auffi
accordée, en prenant même le terme dans fa fignifi-
cation la plus étendué, peut lui être conteftée avec
raifon; i° .c parce que les contre-poifons généraux
font des êtres affez imaginaires ; z0/. parce que les
alexipharmaques fudorifiques ou proprement dits,
av oient été imaginés contre certains venins coagu-
lans dont les oblervatiôns modernes ont démenti l’exiftence,
ou du moins ont bien diminué le nombre ;•
30. parce que la maniéré de traiter les maladies qu’on-
appelloit m a lig n e s ou v en én eu fe s, par les fudorifiques,
a prefque été abfolument abandonnée, ou du moins
reftrainte à un certain nombre de les plus ordinaires. cas qui ne font pas
Par conféquent on ne peut employer la racine de
co n tr a y e r v a avec confiance, que dans les cas où les
fueurs font indiquées en général (V o y e 1 Sudorifique),
& point du tout dans les cas de morfures, même
des bêtes venimeufes,où Pon guérit par des fueurs
abondantes, comme dans celles de la vipere , lorf-
qu’on a raifon de foupçonner que l’alkalfyolatil employé
dans ce cas peut agir par une qualité fpécifi-
que : il faut du moins qu’on ait conftaté par des expériences
fuffifantes qu’on peut attendre le même
fuccès d’un fudorifique quelconque.
Schulzius recommande en particulier cette racine
contre les maladies malignes accompagnées de dyf-
fenteries qui régnent fou vent dans les armées. On
peut la donner en fubftance depuis un fcrupule juf-
qu’à un gros ; ou bien en infufion dans une chopine
de vin ou d’eau, depuis deux gros jufqu’à une demi-
once.
L’efprit-de-vin tire du co n tr a y e r v a une teinture affez
chargée, que le même Schulzius recommande à
la dofe d’un demi-gros, mais qu’on peut augmenter
fans danger félon le cas.
Neuman prétend que fon infufion dans de l’eau eft
plus fûre Sc plus efficace que cette teinture, parce
que Peau fe charge plus des parties de cette racine
que l’efprit-de-vin, Sc qu’on n’a pas à craindre.de
l’eau les mêmes inconveniens que des menftrues fpi-
ritueux. On peut compter que la matiere extraite par
l’efprit-de-vin ou par l’eau eft de la même nature ;
car on ne peut pas'foupçonner Neuman, qui la défi-
gne dans les deux cas par le nom d’ e x t r a i t, d’avoir
confondu une réfine avec un extrait.
Le c o n tra y e r v a entre dans l’eau thériacale, dans
l’opiate de Salomon de la pharmacopée de Paris, dans
la confection hyacinthe, & l’eau générale de cette
même pharmacopée. L’extrait de cette racine entre
dans la thériaque célefte.
Le c o n tra y e r v a donne fon nom à une compofition
fort connue dans les boutiques, principalement parmi
les Anglois, fous le nom de la p i s c o n t r a y e r v a , &
dont la difpenfation varie chez les différens auteurs,
tels queManget, Charas, Burnet,Bateus, Sc Fuller,
qui donne à cette compofition le nom de l a p i s a l e x i-
te r iu s .
P r ép a ra t io n de l a p ie r r e d e c o n t r a y e r v a . corne de
cerf calcinée & préparée, corail rouge préparé, de
chaque deux gros; perles préparées, ambre blanc,
yeux d’écreviffe, de chaque deux gros ; racine de
co n tra y erv a pulvérifée, pattes d’écreviffe préparées,
de chaque demi-once : mêlez le tout exactement, &
avec le mucilage de gomme arabique, faites-en une
pfeâutre dd’ounnte v noouisx f mourfmceardeez. de petites boules de la grof-
On attribue à cette pierre les mêmes vertus qu’au
c o n tra y e r v a . Elle paffe pour un fudorifiquè & un ale-
xitaire excellent, Sc comme un bon préfervatif contre
la pefte, la petite vérole, Sc les fievres malignes>
Les réflexions que nous avons faites au commencement
de cet article, en rapportant les prétendues
vertus alexipharmaques du c o n tra y e r v a, ont lieu ici
dans le même fens. (h ')
* CONTRE, ( G r d m m .y prépofition qui marque
ou proximité ou oppofition : ainfi dans toutes ces
phrafes, il écrit co n tr e les athées, il s’eft élevé contre mon avis, il parle co n tr e fa penfée, co n tr e marque
de l’oppofition confidérée fous différentes faces : Sc
dans celles-ci, il eft affis co n tr e le mur, il eft placé
co n tr e le f e u , co n tr e marque proximité. C o n tr e entre
ën
en compofition avec un grand nombre de mots-de
ia langue...-v_. ; • • .... h.e--;
S -Contre , ( parer- au ) Efcrim. c’eft parer en dégageant.
V o y e^ D égager. Ainfi lorique l’ennemi dé-
gage en allongeantI’eftocad,e, vous dégagez :$c la
parez; d’où il fuit que vous parez de quarte une_efr
toçade de tierce;, Sc de tierce une eftocade/de
quarte. ; • , . ' , ■ \ .. ; ■ Pour bien paret au contre, il faiit, auffi-tôt que
l’ennemi dégage, dégager au fil, & au même inftant
parer comme il a été enfeigné, fuivant le coup qu’il
vous porte, de quarte oit de tierce, &e. Contre d.u Contré, (parer aie) ou Parade
DU CERCLE, Efcrim. c’eft parer an contre du contre-
dégagement; ou pour mieux m’expliquer, c’eft doubler,
tripier,. &c. la parade au contre: ■
C ontre , en terme de Formier, eft un infiniment
long & large, peu tranchant, avec lequel les Fermiers
fendent leur bois. Voye^ PL du Form.fig. .3, \
CONTRE-AMIRAL, f. m. (Marine.) c'ofr un officier
qui commande l ’arriere-garde ou la derniere
diyïfion d’une armée navale. Il n’y a point de contre-
amiral en France fur l ’étàt de la Marine; c’eft une
fimple qualité qui-ne fubfifte que pendant un arme-;
ment confidérable où les officiers généraux font employés.
Dans ces occasions le plus ancien chef d’ef-
cadre porte le pavillon de contre-amiral ^ qui eft
blanc, de figure quarrée, & qui s’arbore à l’artimpn. m WÊk 1 1 CONTRE - APPEL, f. m. (Èfcnme.) appel contraire
à celui que l’ennemi a fait : ainfi fi l’appel a
.été d’engagement à l’épée par le dedans, le contre-
appel fera d’engagement à l’épee par le dehors. .. ,.
CONTRE-ALLÉE, ( Jardinage.) voye^ ALLEE. .
CONTRE-APPROCHES, fubfl. f. pl. dans F Art
militaire, font des lignes ou tranchées que font . les
affiégés pour venir attaquer ou reconnoître les l i gnes
des affiégeahs.
La ligne de contre - approche .eft une tranchée que
font les affiégés, depuis leur chemin couvert jufqu’à
la droite & à la gauche des attaques, pour découvrir
ou envelopper les travaux des' ennemis. On la commence
à l’angle de la place d’armes de la demi-lune
qui n’eft point attaquée , à cinquante ou foixante
îoifes des attaques, Sc on la continue auffi loin qu’il
eft néceffaire pour, voir l’ennemi dans fes tranchées
Sc dans fes lignés. Cette ligne-doit partir précifément
du chemin-couvert & de la demi-lune, afin que fi
l ’ennemi vient à s’en, emparer, elle ne lui foit d’au-
c'ürië utilité. Le gouverneur enverra fouvent pendant
la nuit., au moyen de cette ligne , des partis
de cavalerie ou d’infanterie, pour faire quitter aux
travailleurs leurs p.offes, Sc enlever fi l’on peut les
ingénieurs qui conduifent les travaux. Savin, nouv.
ècôL milit. p, z8o.. r .
La ligne dé. contré - approche ne fe pratique guere,
parce qu’elle devient trop dangereufé en s’éloignant
de la place. M. Goulon propofe au lieu de cette 1U
gn e,' de placer pendant là. nuit unè rangée de tonneaux
où de gabions., en s’avançant dans la campagne
à la diftance de 30 ou 50 pas de l’angle faillant
du chemin-couvert dë la demi - lune collaterale de
l’attaque, afin de pouvoir le matin enfiler la tranchée
de derrière ces tonneaux. Mais pour faire cette
manoeuvre, il faut que l’ennemi n’àit pas de batteries
tournées de ce côté-là ; autrement il culbuteroit
avec fon canon toute cette efpëcë de ligne. On remplit
ces tonneaux-où gabions de matière combüfth-
ble, pour être en état de les brûler lorfqu’on ne peut
plus les foûtenir, & que l’ennemi vient pour s’en
ïaifir. Celui qui eft le plus près de la paliffade du
"chemin - couvert-, en doit être au moins éloigné de
la longueur d’une hallebarde, afin qu’il ne puiffe y
iùettre le feu."
'" “ Tomel
M.-le chevalier de Folard dit, dans fort traité dé
la defenfe des places des anciens, qu’il n’y a , aucun
exemple formel des lignes de contre-approche depuis
le fiége de Belgrade par Mahomet II. en 1456, c’eft-
à-dire depuis environ 300 ans. Cependant elles ont
été employées fort utilement au fiége, de Bergop-
zoom ,- en 1622. Fritach le rapporte en ces.termes,
dans fon traité de fortification.
« A11 fiége de Bergopzoqm il y avoit quantité de
» contre-approches^, defquelles les affiégés travaille-,
» rent tellement l’ennemi, qu’il ne s’en pouvoit ap-
» procher que d’un pié.; .outre qu’ils avoient avancé
» dahs’ la campagne toutes.fortes d’ouvrages exté-
» rieurs, par le moyen defquels , comme auffi du fe-
>> cours , les Efpagnols furent contraints de quitter lé
» fiége, &c. » Voilà évidemment les contre-approches
en ufage depuis Mahomet II. Il y a grande apparence
que cét exemple n’eft pas le feul. Mais quoi qu’il en
foit, fi l’on eft en état de foûtenir une ligne de con-,
tre-approche, on le fera encore davantage de faire
de bonnes-forties qui pourront faire plus; de mal à
l ’affiegeaiit. Le Blond, traité de la défenfe des places. m H mmggÊÊM ■ 11 ■ I
CONTREBANDE., f. Ér Police.) L i
contrebande eft en général tout commerce qui fe fait
contre les lois d’un état; Mais dans l’ufage ordi-.
naire on diftingue .la contrebande proprement dite
de la fraude. .
Chaque fociété a deux objets principaux dans,
fon .adminiftration intérieure. Le premier eft d’en-
tretenir dans l’a-ifance le plus grand nombre d’hommes
qu’il eft pôffible : le fécond, fondé fur lé premier
, éft de le ver fur les peuplés les dépéri fes né-
ceffaires , non à l’aggrandiffément des domaines de'
la fociété, ce qui feroit le plus fouvent contraire
à fon bonheur, mais cellës qu’exigent fa sûreté &
le maintien de la majefté de céux qui gouvernent.
Pour remplir le premier objet, il a été néceffaire
de prohiber l’entrée de plufieurs denrées étrange-’
res , dont la confommàtiôri intérieure eût privé le
peuplé dé fon travail ou de Ton aifance, & l’état
de fa population : cette prohibition s’eft même étendue
à la. fortie de quelques denrées, natioriales .en
conféquence du même principe.
Pour fatïsfairé aux befoins publies de la fociété ,-
on a imppfé des droits^ foit fur les màrchandifës
étrangefés'pérmifes ; foit fur lés marchandifes nationales.
Le mot dé contrebande s’applique aux contraventions
de la première efpëcé ; lé mot dë fraude à celles
de la féconde efpëce. •
Il eft clair que la conthbàridé proprement dite ëfif
réputée telle , uniquement par la volonté du législateur';
dès qu’il a parlé; tout -homme qui jouit des
avantages de la fociété , 'doit- fe foûmettre à fes
lois; s?il ofe lès enfreindre, il eft criminel, quoi-*
que fouvent dignè de pitié! mais il éft toujours très-
méprifable , fi l’intérêt feul d’un vain luxe ou d’une
fingularité frivole , le rend complice de la contrebande
au préjudice du travail des pauvres.:
Quoique la loi doive être fainte pour tous dans un
état, il eft poflible que fes motifs ne foient pas/tou-
jours également favorables.au bien générai.; - ,
On a pû remarquer, qu’il y a deux fortes, de pro-«
hibitions , l’une d’entrée, & 1 autre de fortie : exa-
mînons-en les motifs.
Les prohibitions utiles, fur l’entrée des', denrées
étrangères, font celles que diéle une"connôiffance
profonde des balances particulières du commerce,
de fes diverfes circulations, Sc.de. la balance générale
; c’eft-a-dire celles qu’un examen férieux & médité
prouve être, néceffaires â l’aifance oiiaii travail
du peuple, .
Prohiber l’entrée des grains étrangers , lörfque Ui