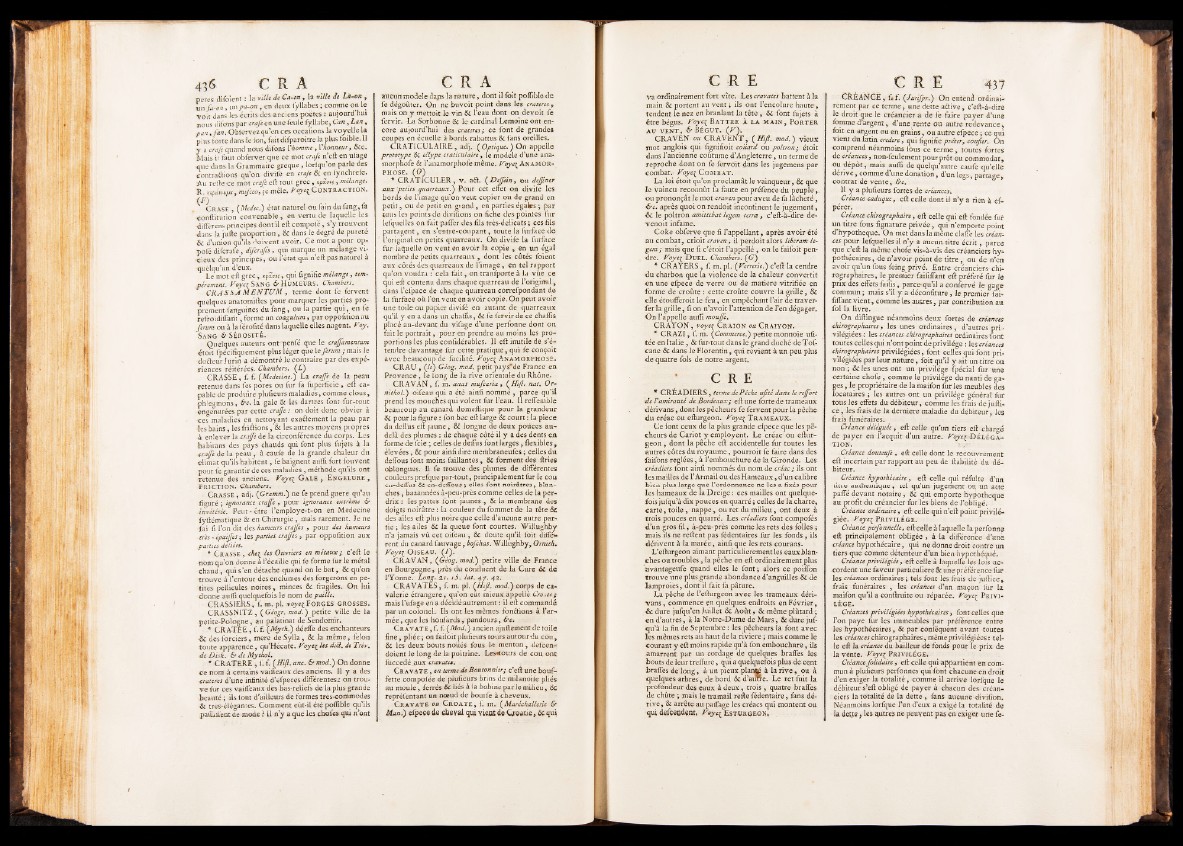
peres difoient : la vitU i t Ca-ca, la vllh i t Li-on ,
•unfa-on, un pa-on , en deux fyllabes ; comme op le
voit dans les écrits des anciens poètes J aujourd’hui
nous difons par craft en une feule fyllabe, Can, Lan,
pan, /à«. Obièrvez qu’en ces oceafions la voyelle la
plus forte dans le Ion, fait difparoîrre la plus foible. Il
y a craie quand nous difons l'homme » l’honneur, &c.
Mais il faut obferver que ce mot craft n’eften ulage
que dans la Grammaire greque, lorlqu’on parle des
contrarions qu’on divile en craft & en lynchrele.
Au relie-ce mot craft efl tout grec , xpawç, mélange.
R . Kic,dvvvfAj, mÿceo, je mêle. Poyt^ C O N T R A C T IO N .
C r a s e , (Medec.) état naturel ou fain du fang, fa
^onftitution convenable , en vertu de laquelle les
différons principes dont il eft compol'é, s’y trouvent
dans la julle proportion, & dans le degre de pureté
& d’union qu’ils doivent avoir. Ce mot a pour op-
po(é diferafe, diferafis, qtii marque un mélange vic
ieu x des principes, ou l’etat qui n eft pas naturel à
■ quelqu’un d’eux.
Le mot eft g rec, xpawff , qui lignifie mélange, tempérament.
Voye{ S a n g & H u m e u r s . Ckambers.
CHASSA MENTUM , terme dont fe fervent
quelques anatomiftes pour marquer les parties proprement
fangumes du fang, ou la partie qui, en fe
refroidiffaiit, forme un coagulum, par oppofition au
ferum ou à la i'érofité dans laquelle elles nagent, Voy.
S a n g & S é r o s i t é .
Quelques auteurs ont"penfé que le craffamentum
étoit fpécifiquement plus léger que le ferum ; mais le
doâeur Jurin a démontré le contraire par des expériences
réitérées. Ckambers. (L)
CRASSE, f. f. (Médecine.) La craffe de la peau
retenue dans fes pores ou fur fa fuperficie, eft capable
de produire plufieurs maladies, comme clous,
phlegmons, &c. la gale & les dartres font fur-tout
engendrées par cette craffe : on doit donc obvier à
ces maladies en nettoyant exactement la peau par
-les bains, les friâions, & les autres moyens propres
à enlever la craffe de la circonférence du corps. Les
ha bit ans des pays chauds qui font plus fujets à la
-craffe de la peau , à caufe de la grande chaleur du
climat qu’ils habitent, fe baignent aufli fort fouvent
pour fe garantir de ces maladies, méthode qu’ils ont
retenue des anciens. Voyeç G a l e , E n g e l u r e ,
F r i c t i o n . Ckambers.
C r a s s e , adj. (Gramm.) ne fe prend guere qu’au
figuré ; ignorance craffe , pour ignorance extrême &
invétérée. Peut - être l’employe-t-on en Medecine
fyftématique & en Chirurgie, mais rarement. Je ne
fai fi l’on dit des humeurs crajfes , pour des humeurs
très - épaiff'es ; les parties craffès , par oppofition aux
-parties déliées.
* C r a s s e , cht{ les Ouvriers en métaux ; c’eft le
nom qu’on donne à l’écaille qui fe forme fur le métal
chaud, qui s ’en détache quand on le bat, 8c qu’on
trouve à l’entour des enclumes des forgerons en petites
pellicules noires, minces 8c fragiles. On lui
donne suffi quelquefois le nom de paille.
CRASSIERS, f. m .p l . voye^F o r g e s g r o s s e s .
CRASSNITZ, ( Gèogr. mod.) petite ville de la
petite-Pologne, au palatinat de Sendomif.
* CR AXÉE, f. f. (Mytk.) déeffe des enchanteurs
•8c desforciers, mere deSylla, & la même, félon
toute apparence, qu’Hécate. Voye^ les dicl. de Trév.
de Disk. & de Mytkol.
* CRATERE , f. f. (Hft. Wm & ”?od.) On donne
ce nom -à certains vaifleaux des anciens. Il y a des
cratères d’une infinité d’efpeces différentes^ on trouve
fur ces vaifleaux des bas-reliefs de la plus grande
beauté ; ils font d’ailleurs de formes très-commodes
& très-élégantes. Comment eût-il été poffible qu’ils
.paffafleat de mode l il n’y a que les chofes qui n’ont
aucun modèle dajis la nature, dont il foit poffible de
fe dégoûter. On ne buvoit point dans les cratères,
mais on .y mettoit le vin & l’eau dont on devoit fe
fervir. -La Sorbonne & le cardinal Lemoine ont encore
aujourd’hui des cratères; ce font de grandes
coupes en écuelle à bords rabattus 8c fans oreilles.
CRATICULAIRE, adj. (Optique.) On appelle
prototype 8c eclype craticulaire, le modèle d’une ana-
morphofe & i’anamorphofe même. Voye{ A n a m o r p
h o s e . (O)
* CRATICULER, v . a&. (Deffün, ou deffiner
aux'petits quarreaux.) Pour cet effet on divile les
bords de l’image qu’on veut copier ou de grand en
petit, ou de petit en grand, en parties égales ; par
tous les points de diviüons on fiche des pointes ftir
lefquelles on fait paffer des fils très-délicats; ces fils
partagent, en s’entre-coupant, toute la furface de
l ’original en petits quarreaux. On divife la furface
fur laquelle on veut en avoir la copie , en un égal
nombre de petits quarreaux , dont les côtés foi.ent
aux côcés des quarreaux de l’image, en tel rapport
qu’on voudra : cela fait, on tranlporte à la vûe ce
qui eft contenu dans chaque quarreau de l’original,
dans l’efpace de chaque quarreau correfpondant de
la furface oii l’on veut en avoir copie. On peut avoir
une toile ou papier divifé en autant de quarreaux
qu’il y en a dans un chaffis, 8c fe fervir de ce chaflis
placé au-devant du vifage d’une perfonne dont on
fait le portrait, pour en prendre au moins les proportions
les plus confidérables. Il eft inutile de s’étendre
davantage fur cette pratique, qui fe conçoit
avec beaucoup de facilité. Voyc{ A n a m o r p h o s e .
CR A U , (le) Géog. mod. petit pays*de France en
Provence, le long de la rive orientale du Rhône.
CR A VAN, f. m. anas mufearia , (Hift. nat. Or-
nithol.) oifeau qui a été ainfi nomme , parce qu’il
prend les mouchés qui volent fur l’eau. 11 reffemblc
beaucoup au canard domeftique pour la grandeur
8c pour la figure : fon bec eft large 8c court : la piece
du deflûs eft jaune, 8c longue ae deux pouces au-
delà des plumes : de chaque côté il y a des dents en
forme de feie ; celles de deffus font larges, flexibles,
élevées, & pour ainfi dire membraneufes ; celles du
deffous font moins Taillantes, 6c forment des ftries
obiongues. 11 fe trouve des plumes de différentes
couleurs prefque par-tout, principalement fur le cou
en-deffus 8c en-deffous ; elles font noirâtres, blanches
, bazannées à-peu-près comme celles de la perdrix
: les pattes font jaunes , & la membrane des
doigts noirâtre : la couleur du fommet de la tête 8c
des ailes eft plus noire que celle d’aucune autre partie
; les ailes 8c la queue font courtes. Willughby
n’a jamais vû cet oifeau , 8c doute qu’il foit diffé*
rent du canard fauvage, bofehas. Willughby, Qrnith.
F oyei-Oiseau. (I) .
• CRAVAN, (Géog. mod.) petite ville de France
en Bourgogne, près du confluent de la Cure 8c dé
l’Yonne. Long. 2.1. iS. lat. 47. 42.
. CRAVATES, f. m. pl. (Hft. mod.) corps de cavalerie
étrangère, qu’on eût mieux.appellé Croate;
mais l’ufage en a décidé autrement : il eft commandé
par un colonel. Ils ont les mêmes fondions à Far-»
mée, que les houiards, pandours, & c .
C r a v a t e , f. f. (Mod.) ancien ajuftement de toile
fine, pliée ; on faifoit plufieurs tours autour-du cou ,
8c les deux bouts noiiés fous le menton, defeen-
doient le long de la poitrine. Lcsttours de cou ont
fuccedé aux cravates.
C r a v a t e , en terme de Boutonnier; c’eft une bouf-
fette compolée de plufieurs brins demilanoiiè pliés
au moule, ferrés 8c liés à la bobine parle milieu, 8c
repréfentant un noeud .de bourfe à cheveux.
C r a v a t e ou C r o a t e , f. m , (Maréchallerie 6*
M a n . ) efpece de cheval qui vieot de C roatie, 8c qui
Va ordinairement fort vite. Les cravates battent à la
main 8c portent au vent ; ils ont l’encolure haute,
tendent le nez en branlant la tête, 8c font fujets à
être bégus. Voye^ Ba t t r e à la main , Porter
au v e n t , 6*Bégut. ( V \
CRAVEN ou GRAVENT, (Hift. mod.) vieux
mot anglois qui fignifioit couard ou poltron; étoit
dans l’ancienne coûtume d’Angleterre, un terme de
reproche dont on fe fervoit dans les jugemens par
combat.- Voye{ C om b a t .
La loi étoit qu’on proclamât le vainqueur, 8c que
le vaincu reconnût fa faute en préfence du peuple
ou prononçât le mot craven pour aveu de fa lâcheté,
&c. après quoi-on rendôit incontinent le jugement,
8c le poltron amittebat legem terra , c’eft-à-dire de*
venoit infâme.
Coke obferve que fi l’appellant, après avoir été
au combat, crioit craven, il perdoit alors liberam le-
gem; mais que fi c’étoit l’appelle , on le faifoit pendre.
Voye^ D uel. Ckambers. (G)
* CRAYERS , f. m. pl. (Verrerie?) c’eft la cendre
du charbon que la violence de la chaleur convertit
eh une efpece de verre ou de matière vitrifiée en
forme de croûte : cette croûte couvre la grille, 8c
elle étoufferoit le feu, en empêchant l’air de traver-
ferfa grille, fi on n’avoit l’attention de l’en dégager.
On l’appelle aufli moufffe.
CRAYON , voye{ C raion ou C raiyon.
* CRAZI, f. m. (Commerce?) petite monnaie ufi-
tée en Italie , & fur-tout dans le grand duché de Tof-
cane 8c dans le Florentin, qui revient à un peu plus
de quatre fols de notre argent»
C R E
* CRÉADIERS, terme de Pêche ufitè dans le reffort
■ de l'amirauté de Bordeaux; eft une forte de trameaux
dérivans, dont les pêcheurs fe fervent pour la pêche
du créac ou efturgeôn. Voye^T rameaux.
Ce font ceux de la plus grande efpece que les pêcheurs
de Cariot y employent. Le créae ou eftur-
geon, dont la pêche eft accidentelle fur toutes les
autres côtes du royaume, pourroit fe faire dans des
faifons réglées, à l’embouchure de la Gironde. Les
scréadiers font ainfi nommés du nom de créac ; ils ont
les mailles de l’Armail ou des Hameaux, d’un calibre
bien plus large que l’ordonnance ne les a fixés pouf
les hameaux de la Drcige : ces mailles ont quelquefois
jufqu’à dix pouces en quarré ; celles de la charte,
carte, toile, nappe, ou ret du milieu, ont deux à
-trois pouces en quarré. Les. créadiers font compofés
d ’un gros fil, à-peu-près comme les rets des folies ;
mais ils ne reftent pas fédentaires fur les fonds, ils
dérivent à la marée, ainfi que les rets courans.
L’efturgeon aimant particulièrement les eaux blanches
ou troubles, la pêche en eft ordinairement plus
Vvantageufe quand elles le font ; alors ce poiffon
trouve une plus grande abondance d’anguilles 8c de
lamproies, dont il fait fa pâture»
La pêche de l’efturgeon avec les trameaux dérivans
, commence en quelques endroits en Février,
8c dure jufqu’en Juillet 8c Août, & même plûtard ;
en d’autres, à la Notre-Dame de Mars, & dure jufqu’à
la fin de Septembre : les pêcheurs la font avec
les mêmes rets au haut de la riviere ; mais comme le
courant y eft moins rapide qu’à fon embouchure, ils
«marrent par un cordage de quelques braffes les
bouts de leur trëffure, qui a quelquefois plus de cent
braffes de long, à un pieux plarié à la r iv e , ou à
quelques arbres, de bord 8c d’aime. Le ret fuit la
profondeur des eaux à deux, trois , quatre braffes
de chûte ; mais le tramail refte fédentaire, fans dérive,
& arrête au paffage les créacs qui montent ou
qui dejfceodent, Voye^ Esturgeon,
CRÉANCE, f»f. (Jurifpr.) On entend ordinairement
par ce terme, une dette aétive, c’eft-à-dire
le droit que le créancier a de fe faire payer d’unè
foraine d’argent, d’une rente ou autre redevance,
foit en argent ou en grains, ou autre efpece ; ce qui
vient du latin credere, qui fignifie prêter, confier-. On
comprend neanmoins fous ce terme, foutes fortes
de créances, non-feulement pour prêt ou commodat,
ou dépôt, mais aufli de quelqu’autre caufe qu’elle
dérive, comme d’une donation, d’un legs-, partage,
contrat de vente , &c.
Il y a p lu fieu r s fo r c é s d e créances.
Créance caduque, eft celle dont il n’y a rien à ef-
perer.
Créante chirographaire, eft celle qui eft fondée fur
un titre fous fignature privée, qui n’emporte point
d’hypotheque. On met dans la même claffe les créances
pour lefquelles il n’y a aucun tkre écrit, parce
que c’eft la même chofe vis-à-vis des créanciers hypothécaires,
de n’avoir point de titre, ou de n’en
avoir qu’un fous feing privé. Entre créanciers- chirographaires,
le premier faififfant eft préféré fur le
prix des effets faifis, parce*qu’il a confervé le gage
commun ; mais s’il y a déconfiture, le premier faififfant
vient, comme les autres, par contribution au
fol la livre.
On diftingue néanmoins deux fortes de créances
chirographaires, les unes ordinaires, d’autres privilégiées.:
les créances chirographaires ordinaires font
toutes celles qui n’ont point de privilège : les créances
chirographaires privilégiées, font celles qui font privilégiées
par leur nature, foit qu’il y ait un titre ou
non ; & les unes ont un privilège fpécial fur une
certaine chofe, comme le privilège du nanti de gages
, le propriétaire de la maifon fur les meubles des
locataires ; les autres ont un privilège général fur
tous les effets du débiteur, comme les frais de jufti-
c e , les frais de la derniere maladie du débiteur, les
frais funéraires.
Créance déléguée , eft celle qu’un tiers eft chargé
de payer en l’acquit d’un autre. Voye^-.D é l é g a t
io n s
Créance douteafe, eft celle dont le recouvrement
eft incertain par rapport au peu de ftabilité du débiteur.
4 Créance hypothécaire, éft celle qui réfulte d’un
titre authentique, tel qu’un jugement oq un afte
paffé devant notaire , 8c qui emporte hypotheque
au profit du créancier fur les biens de l’obligé.
Créance ordinaire, e f t c e lle q u i n ’e ft p o in t p r iv ilé g
ié e . Voyc{ Pr i v i l è g e .
Créance perfonnelle, eft celle à laquelle la perfonne
eft principalement obligée, à la différence d’une
créance hypothécaire, qui ne donne droit contre un
tiers que comme détenteur d’un bien hypothéqué.
Créance privilégiée, eft celle à laquelle les lois accordent
une faveur particulière & une préférence fut j
les créances ordinaires ; tels font les frais de juftice,
frais funéraires , les créances d’un maçon fur la
maifon qu’il a conftruite ou réparée. Voyer P r i v i l
è g e »
Créantes privilégiées hypothécaires , font celles quô
Fon paye fur les immeubles par préférence entre
les hypothécaires , 8t paf conféquent avant toutes
les créances chirographaires, même privilégiées: telle
eft la créance du bailleur dé fonds pour le prix de
la vente. Voye^ P r i v i l è g e »
Créance folidaire, eft celle qui appartient eh côm*
mun à plufieurs perfonnes qui font chacune en droit
d’en exiger la totalité, comme il arrive lorfque le
débiteur s’eft obligé de payer à chacun des créanciers
la totalité de la dette , fans aucune divifion.
Néanmoins lorfque l’un d’eux a exigé la totalité de
la dette, les autres ne peuvent pas en exiger une fe*