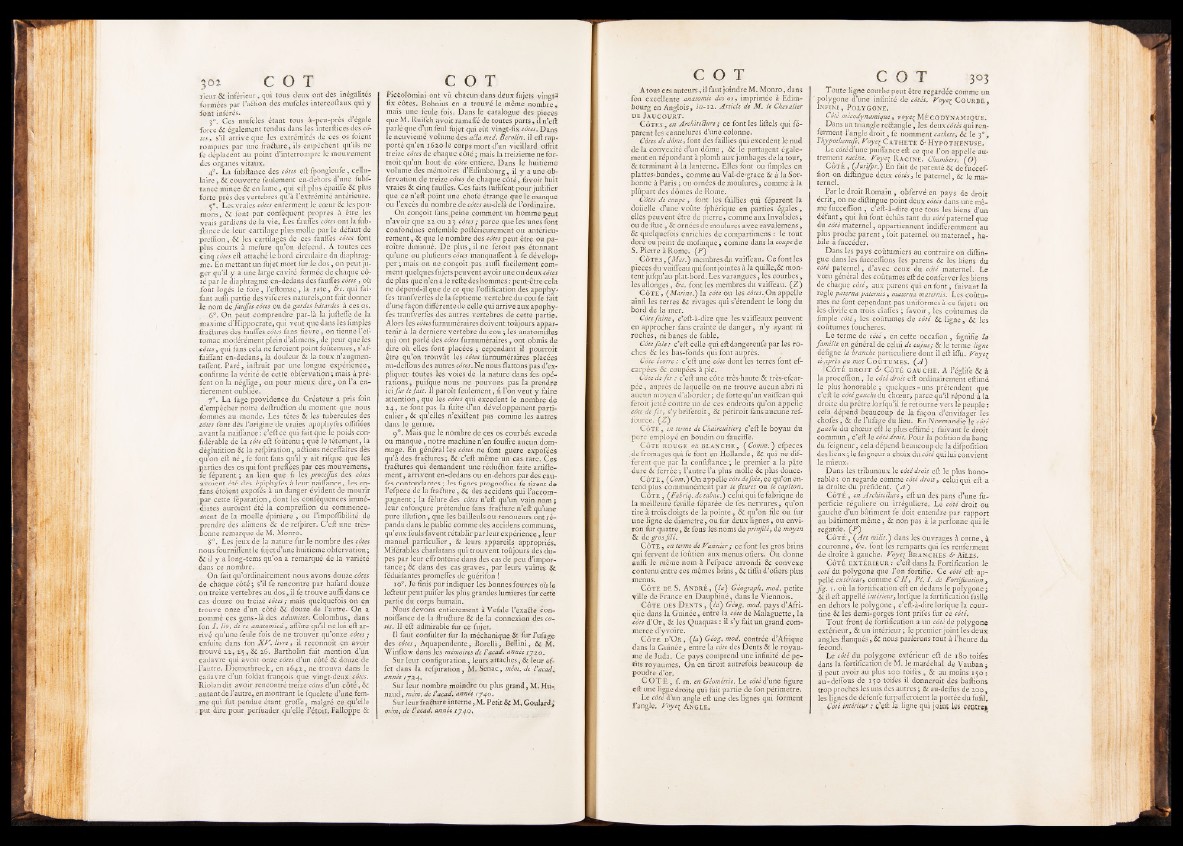
rieur & inférieur, qui tous deux ont des inégalités
formées par l’a&ion des mufcles intercoftaux qui y
font inférés. }
3°. Ces mufcles étant tous à-peu-près d’egale
force & également tendus dans les interftices des côtes
, s’il arrive que les extrémités de ces os foient
rompues par une fraôure, ils empêchent qu’ils ne
fe déplacent au point d’interrompre le mouvement
des organes vitaux.
4°. La fubftance des côtes eft fpongieufe, cellulaire
, & couverte feulement en-dehors d’une fubf-
tance mince & en lame, qui efh plus épaiffe & plus
forte près des vertebres qu’à l’extrémité antérieure.
<j°. Les vraies côtes enferment le coeur & les poumons,
& font par conféquent propres à être les
vrais gardiens de la vie. Les fauffes côtes ont la fub-
ilance de leur cartilage plus molle par le défaut de
preffion, & les cartilages de ces fauffes côtes font
plus courts à mefure qu’on defcend. A toutes ces
cinq côtes eft attaché le bord circulaire du diaphragme.
En mettant un fujet mort fur le dos, on peut ju-
.ger qu’il y a une large cavité formée de chaque côté
par le diaphragme en-dedans des fauffes côtes, où
font logés le foie, l’eftomac , la rate, &c. qui fai-
fant auffi partie des vifceres naturels,ont fait donner
le nom de fautes côtes ou de gardes bâtardes à ces os.
6°. On peut comprendre par-là la juftefle de la
maxime d’Hippocrate, qui veut que dans les fimples
fra&ures des fauffes côtes fans fievre, on tienne l’eftomac
modérément plein d’alimens, de peur que les
côtes, qui fans cela ne feroient point foûtenues, s’af-
faiffant en-dedans, la douleur & la toux n’augmen-
taffent. Paré, inftruit par une longue expérience,
confirme la vérité de cette obfervation ; mais à pré-
fent on la néglige, ou pour mieux dire, on l’a entièrement
oubliée.
7°. La fage providence du Créateur a pris foin
d’empêcher notre deftruûion du moment que nous
femmes au monde. Les têtes & les tubercules des
côtes font dès l’origine de vraies apophyfes offifiées
avant la naiffance : c’eft ce qui fait que le poids con-
lidérable de la côte eft foûtenu ; que le tétement, la
déglutition la refpiration, aélions néceffaires dès
qu’on eft né, fe font fans qu’il y ait rifque que les
parties des os qui font preffées par ces mouvemens,
fe féparent ; au lieu que fi les proceffus des côtes
avoient été des épiphyfes à leur naiffance, les en-
fans étoient expofés à un danger évident de mourir
par cette féparation, dont les conféquences immédiates
auroient été la compreflion du commencement
de la moelle épiniere , ou l’impoflibilité de
. prendre des alimens & de relpirer. C ’eft une très-
. bonne remarque de M. Monro.
8°. Les jeux de la nature fur le nombre des côtes
nous fournifl'ent le fujet d’une huitième obfervation;
& il y a long-tems qu’on a remarqué de la variété
dans ce nombre.
On fait qu’ordinairement nous avons douze côtes
de chaque côté ; s’il fe rencontre par hafard douze
ou treize vertebres au dos, il fe trouve auffi dans ce
cas douze ou treize côtes; mais quelquefois on en
trouve onze d’un côté & douze de l’autre. On a
nommé ces gens - là des adamites. Colombus, dans
fon 1 . liv. de re anatomicâ, affûre qu’il ne lui eft arrivé
qu’une feule fois de ne trouver qu’onze côtes ;
enfuite dans fon XV. livre, il reconnoît en avoir
trouvé 22, 25 ,& 26. Bartholin fait mention d’un
cadavre qui avoit onze côtes d’un côté & douze de
l ’autre. Diemerbroek, en 1642, ne trouva dans le
cadavre d’un foldat françois que vingt-deux côtes.
Riolan dit avoir rencontré treize côtes d’un côté, &
autant de l’autre, en montrant le fquelete d’une femme
qui fut pendue étant groffe, malgré ce qu’elle
put dire pour perfuader qu’elle l’étoit. Falloppe &
Piccolômini ont vu chacun dans deux fujéts vingt-2
fix côtes. Bohnius en a trouvé le même nombre s
mais une feule fois. Dans le catalogue des pièces
que M. Ruifch avoit ramaffé de toutes parts, il n’eft
parlé que d’un feul fujet qui eut vingt-fix côtes. Dans
le neuvième voliime des acla med. Berolin, il eft rapporté
qu’en 1620 le corps mort d’un vieillard offrit
treize côtes de chaque côté ; mais la treizième ne for-
moit qu’un bout de côte entière. Dans le huitième
volume des mémoires d’Edimbourg, il y a une obfervation
de treize côtes de chaque côté, favoir huit
vraies & cinq fauffes.; Ces faits fuffifent pour juftifier
que ce n’eft point une chofe étrange que le manque
ou l’excès du nombre de côtes au-delà de l’ordinaire.
On conçoit fans,peine comment un homme peut
n’avoir que 22 ou 23 côtes ; parce que les unes font
confondues enfemble poftérieurement ou antérieurement
, & que le nombre des côtes peut être ou pa-
roître diminué. De plus, il ne ferôit pas étonnant
qu’une ou plufieurs côtes manquaffent à fe développer
; mais on ne conçoit pas auffi facilement comment
quelques fujets peuvent avoir une ou deux côtes
de plus que n’en a le refte des hommes : peut-être cela
ne dépend-il que de ce que l’offification des apophyfes
tranfverfes de la feptieme vertebre du cou fe fait
d’une façon différente de celle qui arrive aux apophyfes
tranfverfes des autres vertebres de cette partie.
Alors les côtes furnumér-aires doivent toujours appartenir
à la derniere vertebre du cou ; les anatomiftes
qui ont parlé des côtes furnuméraires, ont obmis de
dire où elles font placées ; cependant il pourroit
être qu’on trouvât les côtes furnuméraires placées
au-deffous des autres côtes. Ne nous flattons pas d’expliquer
toutes les voies de la nature dans fes opérations,
puifque nous ne pouvons pas la prendre
ici fur le fait. II paroît feulement, fi l’on veut y faire
attention, que les côtes qui excédent le nombre de
24, ne font pas, la fuite d’un développement particulier
, & qu’elles n’exiftent pas comme lès autres
dans le germe.
90. Mais que le nombre de ces os courbés excede
ou manque, notre machine n’en fouffre aucun dommage.
En général les côtes .ne font guere expofées
qu’à des fra&ures ; & c’eft même un cas rare. Ces
fra&ures qui demandent une réduction faite artifte-
ment, arrivent en-dedans ou en-dehors par des cau-
fes contondantes ; les lignes prognoftics fe tirent de
l’efpece de la fraélure, &s des accidens qui l’accpm-
pagnent ; la fêlure des côtes n’eft qu’un vain nom ;
leur enfonçure prétendue fanS fraéhire n’eft qu’une
pure illufion -, que les bailleuls ou renoueurs ont répandu
dans le public comme des accidens communs,
qu’eux feuls fa vent rétablir parleur expérience, leur
manuel particulier, & leurs appareils, appropriés.
Miférables charlatans qui trouvent toujours des dupes
par leur effronterie dans des cas de peu d’importance
; & dans des cas gravés, par leurs vaines &
féduifantes promeffes de guérifon !,
io°. Je finis par indiquer les bonnes fources où le
lefteur peut puifer les plus grandes lumières fur cette
partie du corps humain.
Nous devons entièrement à Vefale l’exa&e con-
noiffance de la ftru&ure & de la connexion des cotes.
Il èft admirable fur ce fujet.
Il faut confulter fur la méçhanique& furl’ufage
des côtes, Aquapendente, Borelli, Bellini, & M.
Winflow dans les mémoires de l'acad. année 1720.
Sur leur configuration, leurs attaches, & leur effet
dans la refpiration, M. Senac, mém. de l'acad;
année 172.4.
Sur leur nombre moindre ou plus grand, M. Hu-
naud, mém. de l'acad. année 1740.
Sur leur fraûure interne, M. Petit & M. Goulard-J
mém, de l'acad, année 1740,
A tous ces auteurs, il faut joindre M. Monro, dans
fon excellente anatomie des os, imprimée à Edimbourg
en Anglois, in -iz. Article de M. le Chevalier
DE JAUCOURT .
Côtes , en Architecture ; ce font les liftels qui féparent
les cannelures d’une colonne.
Côtes de dômef font des faillies qui excédent le nud
de la convexité d’un dôme , & le partagent également
en répondant à plomb aux jambages de la tour,
& terminant à la lanterne. Elles font ou fimples en
plattes-bandes, comme au Val-de-grace & à la Sorbonne
à Paris ; ou ornées de moulures, comme à la
plupart des dômes de Rome.
Côtes de coupe, font les faillies qui féparent la
doiielle d’une voûte fphérique en parties égales,
elles peuvent être de pierre, comme aux Invalides ;
ou de ftuc, & ornées de moulures avec ravalemens,
6c quelquefois enrichies de compartimens : le tout
doré ou peint de mofaïque, comme dans la coupe de
S. Pierre à Rome. (P)
Côtes , (Mar.) membres du vaiffeàu. Ce font les
pieces.du vaiffeau qui font jointes à la quille,& montent
jufqu’au plat-bord. Les varangues, les courbes,
les allonges, &c. font les membres du vaiffeau. (Z )
Côte , (Marine.) la côte ou les côtes. On. appelle
ainfi les terres & rivages qui s’étendent le long du
bord de la mer.
Côte faine} c’eft-à-dire que les vaiffeaux peuvent
en approcher fans crainte de danger, n’y ayant ni
roches, ni bancs de fable.
Côte fale : c’eft celle qui eft dangereufe par les roches
& les bas-fonds qui font auprès.
Côte écorre : c’eft une côte dont les terres font ef-
carpées & coupées à pic.
Côte de fer : c’eft une côte très-haute & très-efear-
pé e , auprès de laquelle on ne trouve aucun abri ni
aucun moyen d’aborder ; de forte qu’un vaiffean qui
feroit jette contre un de ces endroits qu’on appelle
côte de fer, s’y briferoit, & périroit fans aucune ref-
fource. (Z )
Côte , en terme de Chaircuitier; c’eft le boyau du
porc employé eh boudin ou fauciffe.
CÔ TE ROUGE OU B L AN CH E , ( Comm. ) efpeceS
.de fromages qui fe font en Hollande, & qui ne different
que par la confiftance ; le premier a la pâ,te
dure & ferrée ; l’autre l’a plus molle & plus douce.
C ôte , (Com.) On appelle côtedefoie, ce qu’on entend
plus communément par le fleuret ou le capiton.
CÔTE , (Fabriq. de tabac.) celui qui fe fabrique de
la meilleure feuille féparée de fes nervures, qu’on
tire à trois doigts de la pointe, & qu’on file ou fur
une ligne de diamètre, ou fur deux lignes, ou environ
fur quatre, & fous les noms de prinfiléy de moyen
& de gros filé.
CÔTE, en terme de Vannier ; ce font les gros brins
qui fervent de foûtien aux menus ofiers. On donne
auffi le même nom à l’efpace arrondi & convexe
contenu entre ces mêmes brins, ôc tiffu d’ofiers plus
menus.
Côte de S. André , (la) Géograpk. mod. petite
ville de France en Dauphiné, dans le Viennois.
Côte des Dents , (la) Géog. mod. pays d’Afrique
dans la Guinée, entre la côte de Malaguette, la
côte d’Or, & les Quaquas : il s’y fait un grand commerce
d’yvoire.
Côte d’Or , (la) Géog. mod. contrée d’Afrique
dans la Guinée, entre la côte des Dents & le royaume
de Juda. Ce pays comprend une infinité de petits
royaumes. On en tiroit autrefois beaucoup de
poudre d’or.
C O T É , f. m .en Géométrie. Le côté d’une figure
eft une ligpe droite qui fait partie de fon périmètre.
Le côte d’un angle eft une des lignes qui forment
l’angle. Voye^ Angle.
Toute ligne courbe peut être regardée comme un
polygone d’une infinité de côtés. Voye^ Courbe,
Infini , Polygone.
Côte mécodynamique y voye[ M ÉCOD YN AM IQU E.
Dans un triangle reftangle, les deux côtés qui renferment
l’angle droit, fe nomment cathete, & le 3e,
Vhypothenufe. Voyeç CATHETE & HypOTHENUSE.
Le côte d’une puiflance eft ce que l’on appelle autrement
racine. Voye^ Racine. Chambérs. (O)
Cote , (Jur’fpr.) En fait de parenté & de fuccef-
fion on diftingue deux côtés, le paternel, & le maternel.
Par le droit Romain , obfervé en pays de droit
écrit, on ne diftingue point deux côtés dans une même
fucceffion , c’eft-à-dire que tous les biens d’un
défunt, qui lui font échûs tant du côté paternel que
du cote maternel, appartiennent indifféremment au
plus proche parent, foit paternel ou maternel, habile
à fuccéder.
Dans les pays coutumiers au contraire on diftingue
dans les fucceffions les parens & les biens du
côté paternel, d’avec ceux du côté maternel. Le
voeu général des coutumes eft de conferver les biens
de chaque côté, aux parens qui en font, fuivant la
regie paterna paternis , materna maternis. Les Coûtâmes
ne font cependant pas uniformes à ce fujet : on
les divife en trois claffes ; favoir, les coutumes de
fimple côté, les coûtumes de côté &. ligne, & les
coûtumes foucheres.
Le terme de côté, en cette occafion, fignifie la
famille en général de celui de cujus; & le terme ligne
défigne la branche particuliere dont il eft iffu. Voye^
ci-après au mot Coutumes. (A )
Icôté droit & Côté gauche. A l’églife & à
la proceffion, le côté droit eft ordinairement eftimd
le plus honorable ; quelques-uns prétendent que
c’eft le côté gauche du choeur, parce qu’il répond à la
droite du prêtre lorfqu’il fe retourne vers le peuple :
cela dépend beaucoup de la façon d’envifager les
chofes, & de l’ufage du lieu. En Normandie le côté
gauche du choeur eft le plus eftimé ; fuivant le droit
commun, c’eft le côté droit. Pour la pofition du banc
du feigneur, cela dépend beaucoup de la difpofition
des lieux ; le feigneur a choix du côté qui lui convient
le mieux. .
Dans les tribunaux le côté droit eft le plus honorable
: on regarde comme côté droit y celui qui eft a
la droite du préfident. (A )
Côté , en Architecture y eft un des pans d’une fu-
perficie réguliere ou irréguliere. Le côté droit ou
gauche d’un bâtiment fe doit entendre par rapport
au bâtiment même, & non pas à la perfonne qui le
regarde. (P ) . ;
Côte , (Art milité) dans les ouvrages à corne, à couronne, &c. font les remparts qui les renferment
de droite à gauche. Voye{ Branches & Aîles.
côté EXTÉRIEUR : c’eft dans la Fortification le
coté du polygone que l’on fortifie. Ce côté eft appelle
extérieur y comme C H , PL. I. de Fortification ,
fig. r. où la fortification eft en dedans le polygone ;
& il eft appellé intérieur, lorfque la fortification faille
en dehors le polygone, c’eft-à-dire lorfque la courtine
& les demirgorges font prifes fur ce côté.
Tout front de fortification a un côté de polygone
extérieur, & un intérieur ; le premier joint les deux
angles flanqués, & nous parlerons tout à l’heure du
fécond;
Le côté du polygone extérieur eft de 180 toifes
dans la fortification de M. le maréchal de Vauban ;
il peut avoir aii plus 200 toifes , & au moins r 50 :
au-deffous de 150 toifes il donneroit des baftions
trop proches les uns des autres ; & au-deffus de 200,
les lignes de défenfe furpafferoient la portée du fiifil.
Côté intérieur ; c’eft la ligne qui joint les centre*