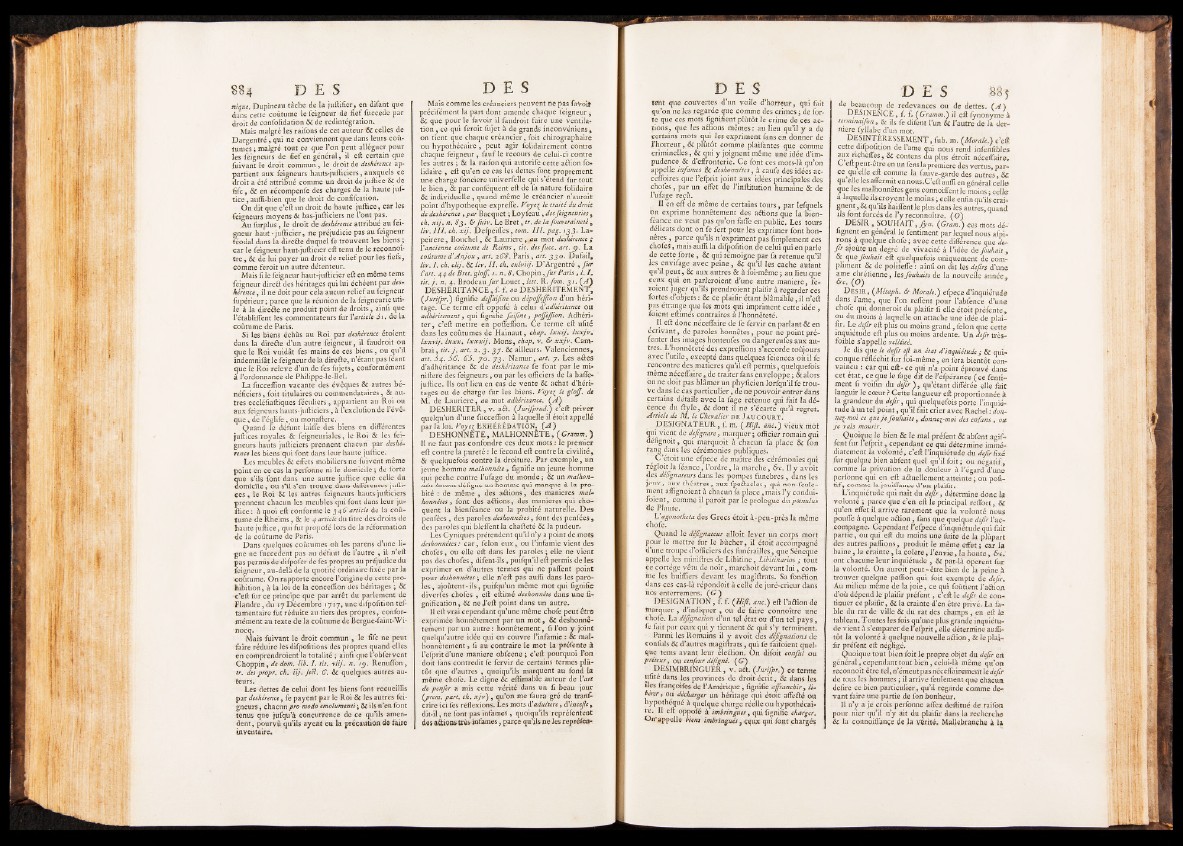
nique. Dupineau tâche de la juftifier, en difant que
dans cette coutume le feigneur de fief fuccede par
droit de confolidation & de rédintégration.
Mais malgré les raifons de cet auteur & celles de
Dargentré, qui ne conviennent que dans leurs coutumes
; malgré tout ce que l’on peut alléguer pour
les feigneurs de fief en général, il eft certain que
fuivant le droit commun, le droit de déshérence appartient
aux feigneurs hauts-jufticiers, auxquels ce
droit a été attribué comme un droit de juftice & de
fifc, & en récompenfe des charges de la haute juftice
, aufli-bien que le droit de confifcation.
On dit que c ’eft un droit de haute juftice, car les
•feigneurs moyens & bas-jufticiers ne l’ont pas.
Au furplus, le droit de déshérence attribue au feigneur
haut - jufticier, ne préjudicie pas au feigneur
féodal dans la dire&e duquel fe trouvent les biens ;
car le feigneur haut-jufticier eft tenu de le reconnoi-
t re , & de lui payer un droit de relief pour les fiefs,
comme feroit un autre détenteur.
Mais fi le feigneur haut-jufticier eft en même tems
feigneur direâ des héritages qui lui échéent par déshérence
, il ne doit pour cela aucun relief au feigneur
fupérieur ; parce que la réunion de la feigneurie utile
à la direôe ne produit point de droits, ainfi que
l’établiiTent les commentateurs fur l'article Si. de la
coutume de Paris.
Si les biens échûs au Roi par déshérence étoient
dans la direéfe d’un autre feigneur, il faudroit ou
que le Roi vuidât fes mains de ces biens, ou qu’il
indemnifâtle feigneur de la direfte, n’étant pas feant
que le Roi releve d’un de fes fujets, conformément
à l’ordonnance de Philippe-le-Bel.
La fucceflion vacante des évêques & autres bénéficiers
, foit titulaires ou commendataires, & autres
eccléfiaftiques féculiers, appartient au Roi ou
aux feigneurs hauts-jufticiers, à l’exclufion de l’évê-
que, de l’églife, ou monaftere.
Quand le défunt laiffe des biens en différentes
juftices royales & feigneuriales, le Roi & les feigneurs
hauts jufticiers prennent chacun par déshérence
les biens qui font dans leur haute juftice.
Les meubles & effets mobiliers ne fuivent même
point en ce cas la perfonne ni le domicile ; de forte
que s’ils font dans une autre juftice que celle du
domicile, ou s’il s’en trouve dans différentes juftices
, le Roi & les autres feigneurs hauts jufticiers
prennent chacun les meubles qui font dans leur juftice
: à quoi eft conforme le 34G article de la coutume
de Rheims, & le 4 article du titre des droits de
haute juftice, qui fut propofé lors de la réformation
de la coutume de Paris.
Dans quelques coutumes oit les parens d’une lir
gne ne fuccedent pas au défaut de l’autre , il n’eû
pas permis de difpofer de fes propres au préjudice du
feigneur, au-delà de la quotité ordinaire fixée par la
coutume. On rapporte encore l’origine de cette prohibition,
à la loi de la conceflion des héritages ; &
c’eft fur ce principe que par arfêt du parlement de
Flandre, du 17 Décembre 1717, une difpofition tef-
tamentaire fut réduite au tiers des propres, conformément
au texte de la coutume de Bergue-faint-'Wi-
nocq.
Mais fuivant le droit commun , le fifc ne peut
faire réduire lêsdifpofitions des propres quand elles
en comprendroient la totalité ; ainfi que l’obfervent
Choppin, dedom. lib. I. lit. viij. n. ig. Renuffon,
tr. des pràpr. ch. iij. fecl. G. & quelques autres auteurs.
Les dettes de celui dont les biens font recueillis
par déshérence, fe payent par le Roi & les autres feigneurs,
chacun pro modo emolumenti ; & ils n’en font
tenus que jufqu’à concurrence de ce qu’ils amendent
, pourvu qu’ils ayent eu la précaution de faire
inventaire.
Mais comme les créanciers peuvent ne pas faVoit
précifément la part dont amende chaque feigneur ,
& que pour le favoir il faudroit faire une ventilation
, ce qui feroit fujet à de grands inconvéniens ,
on tient que chaque créancier, foit chirographaire
ou hypothécaire , peut agir folidairement contre
chaque feigneur, fauf le recours de celui-ci contre
les autres ; & la raifon qui autorife cette aftion fo-
lidaîre , eft qu’en ce cas les dettes font proprement
une charge foncière univerfelle qui s’étend fur tout
le bien, & par conféquent eft de fa nature folidaire
& individuelle, quand même le créancier n’auroit
point d’hypotheque expreffe. Voyt{ le traité du droit
de déshérence, par Bacquet ; Loy feau , des feigneuries ,
ch. xij, n. 83. & fuiv. Le Bret, tr. de lafouveraineté,
liv. I I I , ch. xij. Defpeiffes, tom. III. pag. 133. La-
peirere, Bouchel, & Lauriere 9yiu mot déshérence ;
l’ancienne coutume de Reims, lit. des fucc. art. g . La
coutume d'Anjou , art. zG8. Paris, art. 330. Dufail,
liv. I. ch. clij. & liv. II. ch. cxlviij. D ’Argentré , fur
Part. 44 de Bret. glojf. 1. n. 8. Chopin ,/ur Paris , 1. 1.
tit.j. n. 4. Brodeau fur Louet, lett. R. fom. 31. {A)
DESHÉRITANCE, f. f. ou DESHÉRITEMENT,
(Jurifpr.') lignifie dejfaifine ou dépojfejjion d’un héritage.
Ce terme eft oppofé à celui d’adhéritance ou
adhéritement, qui lignifie faifine , pojfejjion. Adhéri*
ter, c’eft mettre en poffelïion. Ce terme eft ufité
dans les coûtumes de Hainaut, chap. Ixxij. Ixxjv
Ixxvij. Ixxx. Ixxxij. Mons, chap. v. & xxjv. Cambrai,
tit. j . art. z . 3 . 3 j . & ailleurs. Valenciennes,
art, 64. 5 G. GS. yo. y3. Namur, art. y. Les a fies
d’adhéritance & de deshéritance fe font par le mi-
niftere des feigneurs, ou par les officiers de la baffe-
juftice. Ils ont lieu en cas de vente & achat d’héritages
ou de charge fur les biens. Vye^ le gloff. de
M. de Lauriere, au mot adhéritance. {A)
DESHERITER, v. aft. {Jurifprud.) c’eft priver
quelqu’un d’une fucceflion à laquelle il étoit appelle
par la loi. Voyez EXHÉRÉDA.TION. (A )
DÉSHONNÊTE, MALHONNÊTE, ( Gramm. )
Il ne faut pas confondre ces deux mots : le premier
eft contre la pureté : le fécond eft contre la civilité,
& quelquefois contre la droiture. Par exemple, un
jeune homme malhonnête, fignifie un jeune homme
qui peche contre l’ufage du monde ; & un malhonnête
homme défigne un homme qui manque à la probité
: de même , des aérions, des maniérés malhonnêtes
, font des aérions, des maniérés qui choquent
la bienféance ou la probité naturelle. Des
penfées , des paroles deshonnêtes, font des penfées ,
des paroles qui bleffent la chafteté & la pudeur.
Les Cyniques prétendent qu’il n’y a point de mots
deshonnêtes : ca r, félon eu x, ou l’infamie vient des
chofes, ou elle eft dans les paroles ; elle ne vient
pas des chofes, difent-ils, puifqu’il eft permis de les
exprimer en d’autres termes qui ne paffent point
pour deshonnêtes ; elle n’eft pas aufli dans les paroles
, ajoutent - ils, puifqu’un même mot qui fignifie
diverfes chofes , eft eftimé deshonnête dans une fir
gnification, & n e j’eft point dans un autre.
Il eft vrai cependant qu’une même chofe peut être
exprimée honnêtement par un mot, & deshonnê-
tement par un autre : honnêtement, fi l’on y joint
quelqu’autre idée qui en couvre l’infamie : oc malhonnêtement
, fi au contraire le mot la prefente à
l’efprit d’une maniéré obfcene ; c’eft pourquoi l’on
doit fans contredit fe fervir de certains termes plutôt
que d’autres , quoiqu’ils marquent au fond la
même chofe. Le digne & eftimable auteur de Y art
de penfer a mis cette vérité dans un fi beau jour
{prem. part. ch. xjv) , qu’on me faura gré de transcrire
ici les réflexions. Les mots d5adultéré, d’’incefie,
dit-il, ne font pas infâmes , quoiqu’ils repréfentent
des aérions très infâmes, parce qu’ils ne les repréfeuttfht
que couvertes d’un voile d’horreuir, qui fait
qu’on ne les regarde que comme des crimes ; de forte
que ces mots fignihent plûtôt le crime de ces actions,
que les a étions mêmes: au lieu qu’il y a de
certains mots qui les expriment fans en donner de
l ’horreur , & plutôt comme plaifantes que comme
criminelles, & qui y joignent même une idée d’impudence
& d’effronterie. Ce font ces mots-là qu’on
appel!e.infâmes & déshonnêtes, à caufe des idées ac-
ceffoires que l’efprit joint aux idées principales des
chofes, par un effet de l’inftitution humaine & de
l’ufage reçu.
Il en eft de même de certains tours, par lefquels
On exprime honnêtement des aérions que la bienféance
ne veut pas qu’on faffe en public. Les tours
délicats dont on fe fert pour les exprimer font honnêtes
, parce qu’ils n’expriment pas Amplement ces
Chofes, mais aufli la difpofition de celui qui en parle
de cette forte, & qui témoigne par fa retenue qu’il
les envifage avec peine, & qu’il les cache autant
qu’il peut, & aux autres & à foi-même ; au lieu que
peux qui en parleroient d’une autre maniéré, fe-
roient juger qu’ils préndroient plaifir à regarder ces
fortes d’objets : & ce plaifir étant blâmable, il n’eft
pas étrange que les mots qui impriment cette idée ,
foient eftimés contraires à l’honnêteté.
II eft donc néceflaire de fe fervir en parlant & en
écrivant, de paroles honnêtes, pour ne point pré-
fenter des images honteufes ou dangereufes aux autres.
L’honnêteté des expreflions s’accorde toujours
avec l’utile, excepté dans quelques fciences où il fe
rencontre des matières qu’il eft permis, quelquefois
même néceflaire, de traiter fans enveloppe ; & alors
on ne doit pas blâmer un phyficien lorfqu’il fe trouve
dans le cas particulier, de ne pouvoir entrer dans
certains détails avec la fage retenue qui fait la décence
du ftyle, & dont il ne s’écarte qu’à regret.
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
DESIGNATEUR, f. m. ( Hifi, anc. ) vieux mot
qui vient de dejignare, marquer ; officier romain qui
défignoit, qui marquoit à chacun fa place & fon
rang dans les cérémonies publiques.
^ C ’etoit une efpece de maître des cérémonies qui
fPgiori la féance, l’ordre, là matche, &c. Il y avoit
pes défîgnateurs dans les pompes funèbres , dans les
jeux, aux théâtres, aux fpeàacles, qui non-feulement
aflignoient à chacun fa place, mais l’y condui-
foient, comme il paroît par le prologue du pcenulus
de Plaute. •
L’agonotheta des Grecs étoit à,-peu-près la même
chofe.
Quand le déjîgnateur alloit lever un corps mort
pour le mettre fur le bûcher, il étoit accompagné
d’une troupe d’officiers des funérailles, que Sénequè
appelle les miniftres de Libitine, Libitinarios ; tout
ce cortège vêtu de noir, marchoit devant lu i, comme
les huifliers devant les magiftrats. Sa fonérion
dans ces cas-là répondoit à celle de juré-crieur dans
nos enterremens. (G )
DESIGNATION, f. f. {Hifi. anc.) eft l’aérion de
marquer , d’indiquer , ou de faire connoître une
chofe. La défignation d’un tel état ou d’un tel pays,
fe fait par ceux qui y tiennent & qui s’y terminent.
Parmi les Romains il y avoit des defignations de
confuls & d’autres magiftrats, qui fe faifoient quelque
tems avant leur eleérion. On difoit conful ou
préteur9 ou cenfeur déjigné. (C )
DESIMBRINGUÊR, v. aét. {Jurifpr.) ce terme 1
ufite dans les provinces de droit écrit, & dans les
»les françoifes de l’Amérique, fignifie ajjranchir9 libérer
9 ou décharger un héritage qui étoit affefté ou
hypothéqué à quelque ch arge réelle ou hypothécai- I
re. Il eft oppofé à imbringuer9 qui fignifie charger,
On* appelle biens imbringués, ççux qui font chargés
de beaucoup de redevances ou de dettes. {A~\
DESINENCE, f. f» {Gramm.") il eft fynonyme à
terminaifon, & fis fe difent l’un & l’autre de la der-
mere fyllabe d’un mot.
DÉSINTÉRESSEMENT, fub. m. {Morale) c’eft
cette difpofition de l’ame qui nous rend infenfibles
aux richefles, & contens du plus étroit néceflaire*
C eftpeut-etre en un fens la première des vertus, par-
ce^quelle eft comme la fauve-garde des autres, &
qu elle les affermit en nous.C’eft aufli en général celle
que les malhonnêtes gens connoiffentle moins ; celle
à laquelle ils croyent le moins ; celle enfin qu’ils craignent,
& qu’ils haiflentle plus dans les autres, quand
ils font forcés de l’y reconnoître. (O)
DESIR, SOUHAIT, fyn. {Gram.) ces mots dé-
fignent en général le fentiment par lequel nous afpi-
rons à^ quelque chofe ; avec cette différence que de-
fir ajoute un degré de vivacité à l ’idée de fouhait,
& que fouhait eft quelquefois uniquement de compliment
ôc de politefle : ainfi on dit les defirs d’une
ame chrétienne, les fouhaits de la nouvelle année,
& c .{0 )
D é s i r , (Métaph. & Morale.) efpece d’inquiétude
dans l’ame, que l’on reflent pour l’abfence d’une
chofe qui donneroit du plaifir fi elle étoit préfente,
ou du moins à laquelle on attache une idée de plaifir.
Le defir eft plus ou moins grand, félon que cette
inquiétude eft plus ou moins ardente. Un défit très-
foible s’appelle velléité.
Je dis cjue le defir efi un état d’inquiétude ; & quiconque
réfléchit fur foi-même, en fera bientôt convaincu
: car qui eft - ce qui n’a point éprouvé dans
cet état, ce que le fage dit de l’efpérance (ce fentiment
fi voifin du defir) 9 qu’étant différée elle fait
languir le coeur ? Cette langueur eft proportionnée à
la grandeur du defir, qui quelquefois porte l’inquiétude
à un tel point, qu’il fait crier avec Rachel : donnez
moi ce que je,fouhaite , donnez-moi des enfans , oit
je vêtis mourir.
Quoique le bien & le mal préfent & abfertt agi filent
fur l’efprit, cependant ce qui détermine immédiatement
la volonté, c’eft l ’inquiétude du defir fixé
fur quelque bien abfent quel qu’il foit ; ou négatif ,
comme la privation de la douleur à l ’égard d’une
perfonne qui en eft a&uellement atteinte ; ou pofi-
tif, comme la jouiffance d’un plaifir.
L’inquiétude qui naît du defir, déterminé donc la
Volonté ; parce que c’en eft le principal reflbrt, &
qu’en effet il arrive rarement que la volonté nous
pouffe à quelque aérion, fans que quelque défit l’accompagne.
Cependant l’efpece d’inquietude qui fait
partie, ou qui eft du moins une fuite de la piûpart
des autres pallions, produit le même effet j car la
haine, la crainte, la colere, l’envie, la honte, &c
ont chacune leur inquiétude , & par-là opèrent fur-
la volonté. On auroit peut-être bien de la peine à
trouver quelque paflion qui foit exempte de defir.
Au milieu meme de la jo ie, ce qui foûtient l’aérion
d’où dépend le plaifir préfent, c’eft le defir de continuer
ce plaifir, & la crainte d’en être privé. La fable
du rat de ville & du rat des champs, en eft fe
tableau. Toutes les fois qu’une plus grande inquiétude
vient à s’emparer de l’efprit, elle détermine auffi-
tôt la volonté à quelque nouvelle ariion, & le plaifir
préfent eft négligé.
Quoique tout bien foit le propre objet du defir eit
général, cependant tout bien, celui-là même qu’on
reconnoît être tel, n’émeut pas néceffairement le défit
de tous les hommes ; il arrive feulement que chacun
defire ce bien particulier, qu’il regarde comme devant
faire une partie dé fon bonheur.
Il n’y a je crois perfonne affex deftitué dé raifon
pour nier qu’il n’y ait du plaifir dans la recherche
& la cortnoifl’ançe de la vérité. Mallebranche à la