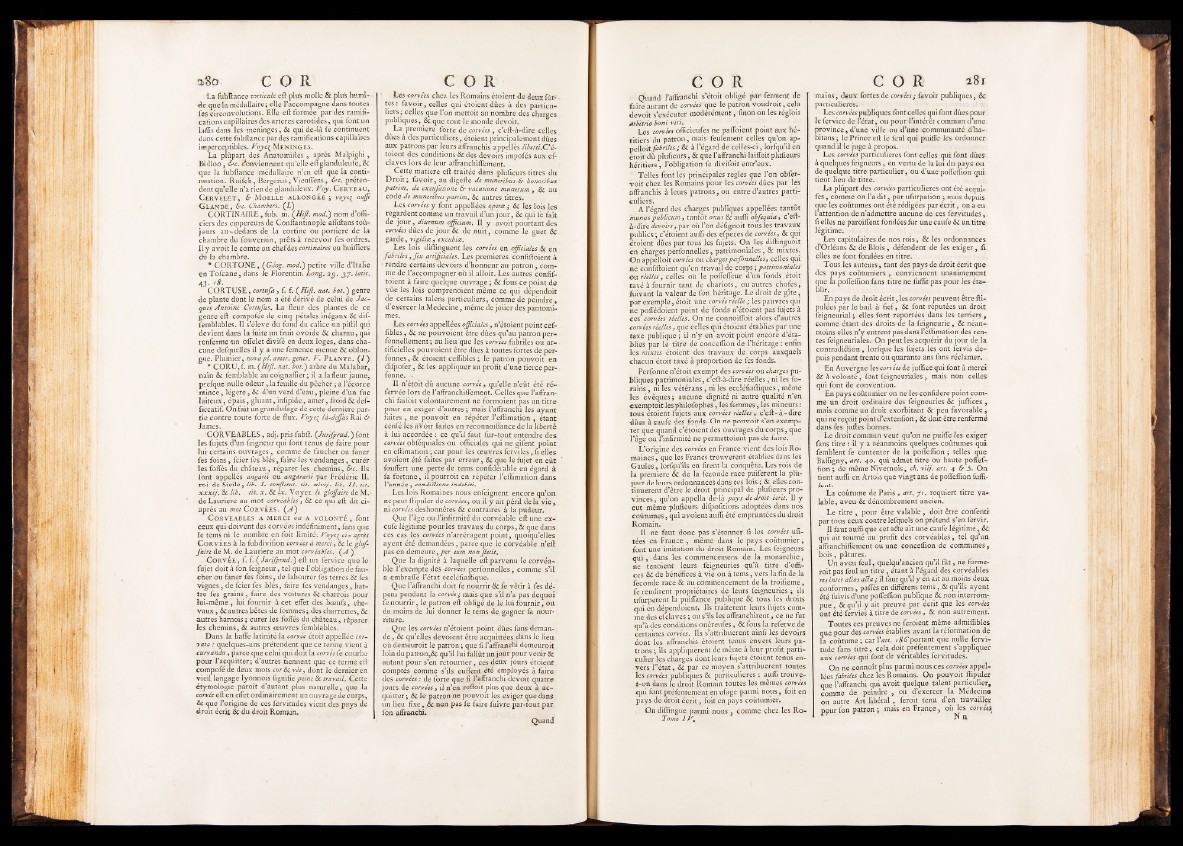
La ftibftance -corticale eft plus molle & plus humid
e que la médullaire ; elle l’accompagne dans toutes
fes circonvolutions. Elle eft formée par des ramifications
capillaires des arteres carotides, qui font un
laffis dans les -méningés, & qui de4à fe continuent
dans -cette fubftance par des ramifications capillaires
imperceptibles. Voye^ Méningés.
La plûpart des Anatomiftès , après Malpighi,
Rsdlôo, &c. Conviennent qu’elleeftglanduleufe, &
•que la lïibftance -médullaire n’en eft que la continuation.
Ruifch , 'Bergerus, Vieuffens, &c, prétendent
qu’elle n’a rien de glanduleux. Voy. Cerveau,
Cervelet, & Moelle allongée ; vpyeç <iuffi
■ Glande, &c.C'hambers. ÇL)
CORTINAIRE, ftib. m. {Hijl.mod.) nom d’officiers
des empereurs de Conftantinople affiftans toujours
au-dedans de la -eortine ou portière de la
chambre du foùverain, prêts à recevoir fes ordres.
Il y avoit le comte ou chef des cortinaires ou huiffiers
de la chambre.
* CORTQNE, ( Géog. mod,) petite ville d’Italie
en Tofcane, dans le Florentin. Long. px). 37. Latit.
43. 18.
CORTUSE, cortufa-, fi f .fHiJl. nat. bot. ) genre
de plante dont le nom a été dérivé de celui de Jacques
Antoine Cortufus. La fleur des plantes de ce
genre eft compofée de cinq pétales inégaux & dif-
lèmblables. Il s’élève du fond du calice un piftil qui
devient dans la fùite un fruit ovoïde & charnu, qui
renferme un offelet divifé en deux loges, dans chacune
defquellès il y a une femence menue & oblon-
gue. Plumier, novapl. amer, gener. V. Plante. (/_)
* CORU,f. m. (Hifi. nat. bot.') arbre du Malabar,
tiâin femblable aucoignaffier; il a la fleur jaune,
prefque nulle odeur, la feuille du pêcher ; a l’écorce
mince, légère, & d’un verd d’eau, pleine d’un fuc
laiteux, épais, gluant, infipide, amer, froid & def-
Ikcatif. On fait un grand ufage de cette derniere partie
contre toute forte de flux. Foye^ là-deffus Rai &
James.
CORVEABLES, adj. pris fubft. (Jurifprud.) font
les fujets d’un feigneur qui font tenus de faire pour
lui- certains ouvrages, comme de faucher ou faner
fes foins, feier fes blés, faire les vendanges, curer
les foffés du château, réparer les chemins, &c. Ils
font appellés angarii ou angararii par Frédéric IL
roi de Sicile, lib. I. conflitut. tit. xlvij. lib-, II. tit.
xx x ij. & lib. tit. x. & Ix. Voyez le gloffaire de M.-
de Lauriere au mot corvéables, & ce qui eft dit ci-
après au mot Corvées. (A )
CO RV E AB LES A MERCI OU A V O LO N T É , fo n t
ceux qui doivent des corvées indéfiniment, fans que
le tems ni le nombre en foit limité; Voye^ ci- après
C orvées à la fubdiviiion corvées à merci, & le glof-
faire de M. de Lauriere au mot corvéables. ÇA )
. C orvée, f. f. {Jurifprud. ) eft un fervice que le
fujet doit à fon feigneur, tel que l’obligation de faucher
ou faner fes foins, de labourer fes terres & fes
vignes, de feier fes blés, faire fes vendanges, battre
fes grains, faire des voitures & charrois pour
lui-même, lui fournir à cet effet des boeufs, chevaux
, & autres bêtes de femmes ; des charrettes, &
autres harnois ; curer les foffés du château, réparer
les chemins, & autres oeuvres femblables.
Dans la baffe latinité la corvée étoit appellée cor-
yata ; quelques-uns prétendent que ce terme vient à
curvando, parce que celui qui doit la corvée fe courbe
pour l’acquitter ; d’autres tiennent que ce terme eft
compofé de deux mots cor & vée, dont le dernier en
vieil langage lyonnois lignifie peine & travail. Cette
étymologie paroît d’autant plus naturelle:, que la
corvée eft en effet ordinairement un ouvrage de corps,
&qu e l’origine de ces fervitudes yient.des pays de
droit écrit îk du droit Romain. ..
Les corvées chez les Romains étoient de deux for*
tes : favoir, celles qui étoient dues à des particuliers
; celles que l’on mettoit au nombre des charges
publiques, & que tout le monde devoir.
a La première forte de corvées , c’eft-à-dire celles
dues à des particuliers, étoient principalement dues
aux patrons par leurs affranchis appellés liberté.C’é*
toient des conditions & des devoirs impofés aiix ef-
claves lors de leur affra nchiffement .
Cette matière eft traitée dans plufieurs titres du
Droit ; favoir , au digefte de muneribus & honoribus
patrim, de exeufatione & vacatione munerum , & au
code de muneribus patrim. & autres titres.
Les corvées y font appellées opéra ,• & les lois les
regardent comme un travail d’un jour, & qui fe fait
de jour, diurnum officium. Il y avoit pourtant des
corvées dues de jour & de nuit, comme le guet &
garde, vigilia , excubia.
Les lois diftinguent les corvées en officiales & en
fabriles, feu artifciales. Les premières confiftoient à
•• rendre certains devoirs d’honneur au patron, comme
de l’accompagner eii il alloit. Les autres confiftoient
à faire quelque ouvrage ; & fous ce péint de
vue les lois comprenoient même ce qui dépendoit
de certains talens particuliers, comme de peindre,
d’exercer la Medecine, même de jouer des pantomimes.
Les corvées appellées officiales , n’étoient point cef-
fibles, & ne pouvoient être dues qu’au patron per-
fonnellement ; au lieu que les corvées fabriles ou artificielles
pouvoient être dues à toutes fortes de per*
fçnnes, & étoient ceflibles ; le patron pouvoit en
dilpofer, & les appliquer au profit d’une tierce per-
fqnne., .
Il n’étoit dû aucune corvée, qu’elle n’eût été ré-
fervé.e lors de l’affranchiffement. Celles que l’affranchi
faifoit volontairement ne formoient pas un titre
pour en exiger d’autres ; mais l’affranchi les ayant
faites , ne pouvoit en répéter l’eftimation , étant
cenfé les avoir faites en reconnoiffance de la liberté
à lui accordée : ce qu’il faut fur-tout entendre des
corvées obféquiales ou officiales qui ne gifent point
en eftimation ; car pour les oeuvres fervilcs, fi elles
avoient été faites par erreur, & que le lujet en eût
fouffert une perte de tems confiderable eu égard à
fa fortune, il pourroit en répéter l’eftimation dans
l’année, conditions indebiti.
Les lois Romaines nous enfeignent encore qu’on
ne peut ftipuler de corvées, ou il y ait péril delà v ie ,
ni corvées deshonnêtes & contraires à la pudeur.
Que l’âge ou l’infirmité du corvéable eft une ex-
eufe légitime pour les travaux du corps, & que dans
ces cas les corvées n’arréragent point, quoiqu’elles
ayent été demandées, parce que le corvéable n’e f t .
pas en demeure, per eum non Jletit.
Que la dignité à laquelle eft parvenu le corvéa- •
ble l’exempte des corvées perfonnelles, comme s’il
a embraffé l’état eccléfiaftique.
Que l’affranchi doit fe nourrir & fe vêtir à fes dépens
pendant la corvée ; mais que s’il n’a pas dequoi
fe nourrir, le patron eft obligé de le lui fournir, ou
du moins de lui donner le tems de gagner fa nourriture.
Que les corvées n’étoient point dûes fans demande
, & qu’elles dévoient être acquittées dans le lieu
oii demeuroit le patron ; que fi l’affranchi demeûroit
loin du patron,& qu’il lui fallût un jour pour venir &
autant pour s’en retourner, ces deux jours étoient
comptés comme s’ils euffent été employés à faire
des corvées : de forte que fi l’affranchi devoit.quatre
jours de corvées, il n’en reftoit plus que deux à acquitter
; & le' patron ne pouvoit les exiger que dans
un lieu fixe, & non pas fe faire fuivre par-tout par.
fon affranchi.
Quand
■ Quand l’affranchi s’étoit obligé par ferment de
faire autant de corvées que le patron voudroit, cela
devoit s’exécuter modérément, finon on les régloit
arbitrioboni viri.
Les corvées officieufes ne paffoient point aux héritiers
du patron, mais feulement celles qu’on ap-
pelloit fabriles ; & à l’égard de celles-ci, lorfqu’il en
étoit dû plufieurs, & que l’affranchi laiffoit plufieurs
héritiers, l’obligation fe divifoit entr’eux.
1 Telles font les principales réglés cjue l’on obfer-
voit chez les Romains pour les corvees dûes par les
affranchis à leurs patrons, ou entre d’autres particuliers.
A l’égard des charges publiques appellées tantôt
munus publicum, tantôt onus & auffi obfequia, c’eft-
à-dire devoirs, par oii l’on défignoit tous les travaux
publics ; c’étoient auffi des efpeces de corvées, & qui
etoient dûes par tous les fujets. On les diftinguoit
en charges perfonnelles, patrimôniales, & mixtes.
On appelloit corvées ou charges perfonnelles, celles qui
ne confiftoient qu’en travail de corps ; patrimoniales
ou réelles, celles où le poffeffeur d’un fonds étoit
taxé à fournir tant de chariots , 011 autres chofes,
fuivant la valeur de Ton héritage. Le droit de gîte,
par exemple, étoit une corvée rcelle ; les pauvres qui
ne poffédoient point de fonds n’étoient pas fujets à
ces corvées réelles. On ne connoiffoit alors d’autres
corvées réelles, que celles qui étoient établies par iiné
taxe publique; il n’y en avoit point encore d’établies
par le titre de conceffion de l’héritage : enfin
les mixtes étoient des travaux de corps auxquels
chacun étoit taxé à proportion de fes fonds.
Perfonne n’étoit exempt des corvées ou charges publiques
patrimoniales, c’eft-à-dire réelles, ni les forains
, ni les vétérans, ni les eccléfiaftiques, même
les évêques ; aucune dignité ni autre qualité n’en
exemptoit lesphilofophes, les femmes ; les mineurs :
tous étoient fujets aux corvées réelles, c’eft-à-dire
dûes à caufe des fonds. On ne pouvoit s?en exempter
que quand c’étoient des ouvrages du corps, que
l ’âge ou l’infirmité ne permettoient pas de faire.
' L’origine des corvées en France vient des lois Romaines
, que les Francs trouvèrent établies dans les’
Gaules, lorfqu’ils en firent la conquête. Les rois de
la première & de la fécondé race puiferent la plûpart
de leurs ordonnancés dans ces lois ; & elles continuèrent
d’être le droit principal de plufieurs provinces
, qu’on appella de-là pays de droit écrit. Il y
eut même plufieurs difpofitions adoptées dans nos
coûtumes, qui avoient auffi été empruntées du droit
Romain.
Il ne faut donc pas s’étonner fi les corvées ufi-
tées en France , même dans le pays coûtumier,
font une imitation du droit Romain. Les feigneurs
q u i, dans les. commencemens de la monarchie,
ne tenoient leurs feigneuries qu’à titre d’offices
& de bénéfices à vie ou à tems, vers la fin de la
fécondé race & au commencement de la troifieme,
fe rendirent propriétaires d e leurs feigneuries ; ils
ufurperent la puiffance publique & tous les droits
qui en dépendoient» Ils traitèrent leurs fujets comme
des efclaves ; ou s’ils les affranchirent, ce ne fut
qu’à des conditions onéreufes, & fous la referve de
certaines corvées. Ils s’attribuèrent ainfi les devoirs
dont les affranchis étoient tenus envers leurs patrons
; ils appliquèrent de même à leur profit particulier
les charges dont leurs fujets étoient tenus envers
l”état, & par ce moyen s’attribuèrent toutes
les corvées publiques & particulières : auffi trouve-
t-on dans le droit Romain toutes les mêmes corvées
c[ui font préfentement en ufage parmi nous, foit en
pays de droit écrit, foit en pays coûtumier.
. On diftingue parmi nous, comme chez les Ro-
Tome IV ,
mains, deux fortes de corvées; favoir publiques, &
particulières.
Les corvées publiques font celles qui font dûes pour I
le fervice de l’état, ou pour l’intérêt commun d’une
province, d’une- ville ou .d’une communauté d ’har.
bitans ; le Prince eft le lèul qui puiffe les ordonner,
quand il le juge à propos.
Les corvées particulières font celles qui font dues,
à quelques feigneurs, en vertu de la loi du pays ou
de quelque titre particulier, ou d’une poffeffion qüi
tient lieu de titre.
La plûpart des corvées particulières ont été acqui-
fes, comme on l’a dit, par.ufurpation ; mais depuis,
que les coûtumes ont été rédigées: par écrit, on a eu.
l’attention, de n’admettre aucune de ces feryitudes
fi elles ne paroiflent fondées fur une caufe & un titre,
légitime.
Les capitulaires de nos rois , & les ordonnances
d’Orléans & de B lois, défendent de les exiger., -fi,
elles ne font fondées en titre.
Tous les auteurs, tant des pays de droit écrit que
des pays coûliumiërs , conviennent unanimement
que la poffeffion fans titre ne fuffit pas pour les établir.
En pays de droit écrit, les corvées peuvent être fti-
pulées par le bail à fief, ôc font réputées un droit
leigneurial ; elles font reportées dans les terriers ,
comme étant des droits de la feigneurie, & néanmoins
elles n’y entrent pas dans l’eftimation des rentes
feigneuriales. On peut les acquérir du jour de la
contradittion, lorfque les: fujets les ont fervis depuis
pendant trente ,oü quarante ans fans réclamer. .
En Auvergne les corvées de juftice qui font à merci'
& à volonté, font feigneuriales, mais non celles
qui font de convention.
En pays coûtumier on ne les confidere point comme
un droit ordinaire des feigneuries & juftices ,
mais comme un droit exorbitant & peu favorable ,
qui ne reçoit point d’extenfion, & doit être renfermé
dans fes juftes bornes.
Le droit commun veut qu’on ne puiffe les< exiger
fans titre : il y a néanmoins quelques coûtumes qui,
fémblent fe contenter de la poffeffion ; telles que
Baffigny, art. 40. qui admet titre ou haute pollef-;
fiôn ; de même Nivernois, ch. viij. art. 4 & 5. On
tient auffi en Artois que vingt ans de poffeffion fuffi-
fent.
• La coûtume de Paris, art. y\. requiert titre valable
, aveu & dénombrement ancien.
Le titre , pour être valable, doit être confentr
par tous ceux contre lefquels.on prétend s’en fervir.
Il faut auffi que cet aûe ait une caufe légitime, &
qui ait tourné au profit des corvéables, tel qu’un
.affranchiffement ou une conceffion de communes ,
bois, pâtures.
Un aveu feül, quelqu’ancien qu’il fût, ne forme-
roit pas l'eul un titre, étant à l’égard des corvéables
res inter alios acla; il faut qu’il y en ait au moins deux
conformes, paffés en differens tems, & qu’ils ayent
été fuivis d’une poffeffion publique & non interrompue
, & qu’il y ait preuve par écrit que les corvées.
ont été fer vies à titre de corvées, & non autrement.'
Toutes ces preuves ne feroient même admiffibles
que pour des corvées établies avant la reformation de
la coûtume ; car Y art. \86 portant que nulle fervi-
tude fans titre, cela doit préfentement s’appliquer
aux corvées qui font de véritables fervitudes.
On ne connoît plus parmi nous ces corvées appellées
fabriles chez les Romains. On pouvoit ftipuler
que l’affranchi qui avoit quelque talent particulier,
comme de peindre , ou d’exercer la Médecine
ou autre Art . libéral , feroit tenu d’en travailler
ppur fon patron ; mais en France , oii les corvées.