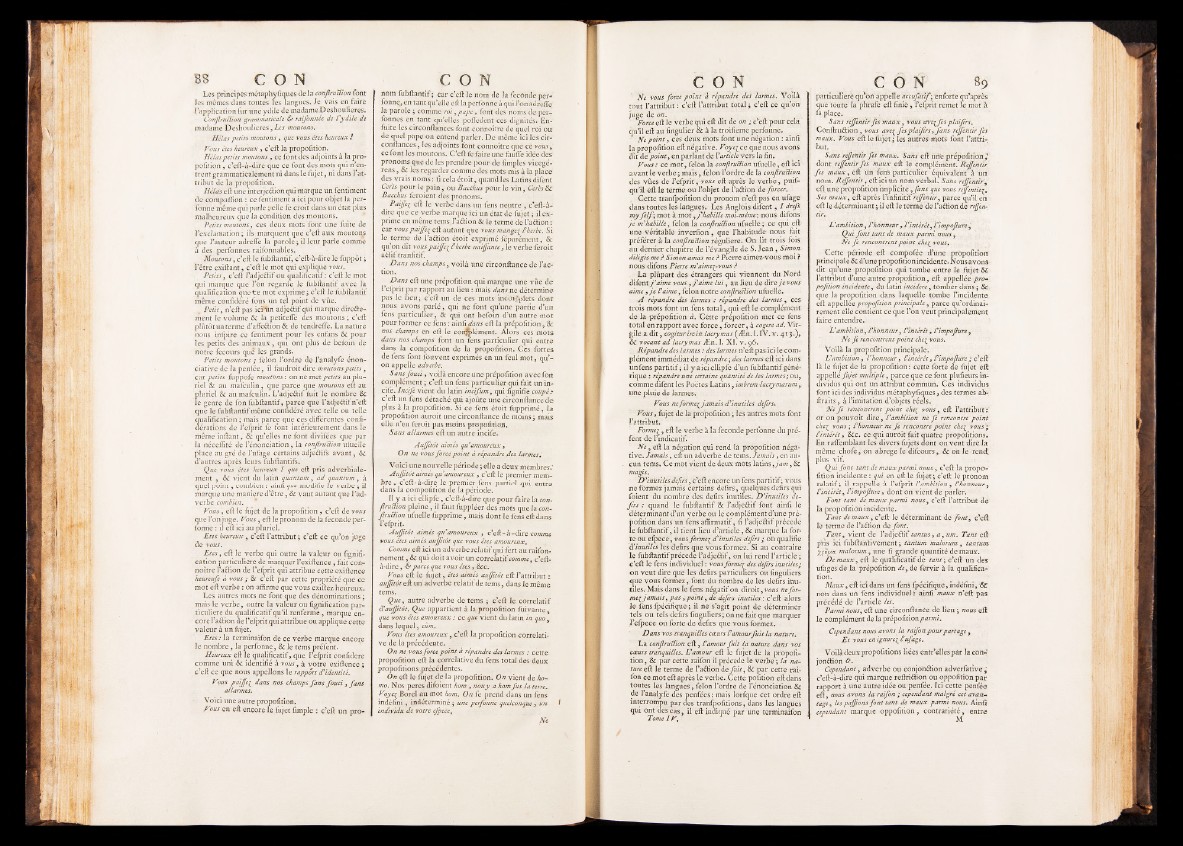
Les principes métaphyfiques de la conflruclion font
les memes dans toutes les langues. Je vais en faire
l ’application fur une ydile de madame Deshoulieres»
■ Conflruclion grammaticale & raifonnéc de Vydile de
madame Deshoulieres, Lw moutons.
Hélas petits moulons, que vous êtes heureux J
Vous êtes heureux , c’eft la propofition. .
Hélas petits moutons , ce font des adjoints à la pro-
pofition , c’eft-à-dire que ce font des mots qui n’entrent
grammaticalement ni dans le fujet, ni dans l’attribut
de la propofition.
Hélas eft une interjection qui marque un fentiment
de compaffion : ce fentiment a ici pour objet la perfonne
même qui parle pelle fe croit dans un état plus
malheureux que la condition des moutons.
Petits moutons, ces deux mots font une fuite de
Pexclamation ; ils marquent que c’eft aux moutons
que l’auteur adrefle la parole ; il leur parle comme
à des perfonnes raifonnables.
Moutons, c’eft le fubftantif, c ’eft-à-dire le fuppôt ;
l ’être exiftant, c’eft le mot qui explique vous.
Petits, c’eft l’adjeCtif ou qualificatif: c’eft le mot
qui marque que l’on regarde le fubftantif avec la
qualification que t e mot exprime ; c’eft le fubftantif
même confidérë fous un tel point de vue.
Petit, n’eft pas icitin adjeûif qui marque dire élement
le volume 8c la petitefle des moutons ; c’eft
plutôt un terme d’affedion & de tendrefle. La nature
nous infpire ce fentiment pour les enfans 8c pour
les petits des animaux, qui ont plus de befoin de
notre fecours que les grands.
Petits moutons ; félon l’ordre de l’analyfe énon-
ciative de la penfée, il faudroit clir z moutons petits,
car petits fuppofe moutons : on ne met petits au pluriel
& au mafeulin, cpie parce que moutons eft au
pluriel 8c au mafeulin. L’adje&if luit le nombre 8c
le genre de fon fubftantif , parce que l’adjedif n’eft
que le fubftantif même confidérë avec telle ou telle
qualification ; mais parce que ces différentes confi-
dérations de l’efprit fe font intérieurement dans le
même inftant, 8c qu’elles ne font divifées que par
la néceftité de l’énonciation, la conftruclion uliielle
place au gré de l’ufage certains adjedifs avant, 8c
d’autres après leurs fubftantifs.
Que vous êtes heureux ! que eft pris adverbialement
, 8c vient du latin quantum, ad quantum, à
quel point, combien : ainfi que modifie le verbe ; il
marque une maniéré d’être, 8c vaut autant que l ’adverbe
combien.
Vous, eft le fujet de la propofition, c’eft de vous
que l’on juge. Vous, eft le pronom de la fécondé per-
fonne : il eft ici au pluriel.
Etes heureux, c’eft l’attribut ; c’eft ce qu’on juge
de vous.
Etes, eft le verbe qui outre la valeur ou lignification
particuliere de marquer l’exiftence, fait con-
noître l’aCtion de l’efprit qui attribue cette exiftence
heureufe à vous ; & c’eft par cette propriété que ce
mot eft verbe : on affirme que vous exiliez heureux.
Les autres mots ne font que des dénominations ;
mais le verbe, outre la valeur ou lignification particuliere
du qualificatif qu’il renferme, marque encore
l’aûion de l’efprit qui attribue ou applique cette
valeur à un fujet.
Etes : la terminaifon de ce verbe marque encore
le nombre, la perfonne, 8c le teîms préfent.
Heureux eft le qualificatif, que l’efprit confidere
comme uni 8c identifié à vous, à votre exiftence ;
c ’eft ce que nous appelions le rapport d'identité.
Vous paijjez dans nos champs fans fouci , fans
allarmes.
Voici une autre propofition.
Vvus en eft encore le fujet fimple : c’eft un pronom
fubftantif ; car c’èft le nom de la fécon dé personne
» en tant qu’elle eft la perfonne à qui l’on adrefle
la parole ; comme roi, pape, font des noms de perfonnes
en tant qu’elles polfedent ces dignités. En-
fuite les circonftances font connoître de quel roi ou
de quel pape on entend parler. D e même ici les circonftances
, les adjoints font connoître que ce vous9
ce font les moutons. C’eft fe faire une faufle idée des
pronoms que de les prendre pour de Amples- vicegé-
rens, 8c les regarder comme des mots mis à la place
des vrais noms : fi cela étoit, quand les Latins difent
Cerès pour le pain, ou Bacùhus pour le v in , Cerès 8c
Bacchus feroient des pronoms.
Paijfe{ eft le Verbe dans un fens neutre , c’eft-à-
dire que ce verbe marque ici un état de fujet ; il exprime
en même tems FaCtion 8c le terme de l’aélion :
car vouspaiffei eft autant que vous mange\£ l ’herbe. Si
le terme de J’aCtion étoit exprimé féparément, 8c
qu’on dît vous paiffez Cherbe naijfante , le verbe feroit
aélif tranfitif.
Dans nos champs, voilà une circonftance de l’action.
Dans eft une prépofition qui marque une vue de
l’efprit par rapport au lieu : mais dans ne. détermine
pas le lieu ; c’eft un de ces mots' incoii$plets dont
nous avons parlé, qui ne font qu’une partie d’un
fens particulier, & qui ont befoin d’un autre mot
pour former ce fens : ainfi dans eft la prépofition, 8c
nos champs en eft le complément. Alors ces mots
dans nos champs font un fens particulier qui entre
dans la compofition de la propofition. Ces fortes
de fens font Souvent exprimés en un feul mot, qu’on
appelle adverbe.
Sans fouci, voilà encore une prépofition avec fon
complément ; c’eft un fens'particulier qui fait unin-
cife. Incife vient du latin incifum9 qui fîgnifie coupé-
c’eft un fens détaché qui ajoûte une circonftance de
plus à la propofition. Si ce fens étoit fupprimé, la
propofition auroit une circonftance de moins; mais
elle n’en feroit pas moins propofition.
Sans allarmes eft un autre incife.'
AuJJitôt aimés qu'amoureux,
On ne vous force point à répandre des larmes
Voici une nouvelle période ; elle a deux membres.’
AuJJitôt aimés qu’amoureux , c’eft le premier membre
, c’eft-à-dire le premier fens partiel qui entre
dans la compofition de la période.
Il y a ici ellipfe, c’eft-à-dire que pour faire la conflruclion
pleine, il faut fuppléer des mots que la conflruclion
ufuelle fupprimé, mais dont le fens eft dans
l’efprit.
AuJJitôt aimés qu’amoureux , c’eft-à-dire -comme
vous êtes aimés aujjitôt que vous êtes amoureux.
- Comme eft ici un adverbe relatif qui fert au raifon-
nement, 8c qui doit avoir un corrélatif comme, c’eft-
à-dire , & parce que vous êtes , 8cc.
Vous eft le fujet, êtes aimés aujjitôt eft l’attribut :
aujjitôt eft un adverbe relatif de tems, dans le même
tems.
Que, autre adverbe de tems ; c’eft le corrélatif
déaujjitôt. Que appartient à la propofition fui vante,
que vous êtes amoureux : ce que vient du latin in quo.
dans lequel, cùm.
V?us êtes amoureux, c’eft la propofition corrélative
de la précédente.
On ne vous force point à répandre des larmes : cette
propofition eft la corrélative du fens total des deux
propofitions précédentes.
On eft le fujet de la propofition. On vient de ho-
mo. Nos peres difoient hom , non y a hom fus la terre.
Vjyeç Borel au mot hom. On fe prend dans un fens
indéfini, indéterminé; une perfonne quelconque, un I
individu de votre efpece.
Ne
yous force point a répandre des larmes. Voilà
tout l’attribut : c’eft l’attribut total ; c’eft ce qu’on
/uge de on. , . . . . .. .... . . v . .
Force eft le verbe qui eft dit de on ; c’eft pour cela
qu’il eft au fingulier 8c à la troifieme perfonnè.
Ne point, ces deux mots font une négation : ainfi
la propofition eft négative. Voyez ce que nous avons
dit de point, en parlant de l’article Vers la fin.
Vous : ce mot, felôn la conflruction üfuellè, eft ici
avant lê verbe ; mais, félon l’ordre de la conflfuclion
des vues de l’elprit, vous eft après le- verbe, puif-
qu’il éft le ternie ou l’objet de 1’aCtion de forcer. ...
. Cette tranfpofition du pronom n’eft pas en ufage
dans toutes les langues. Les Anglôis difent, I drefs
my felf\ mot à m oty j ’habille moi-même', nous difohs’
je m’habille, félon la conftruclion ufuelle ; ce qui eft
une véritable inverfion, que l’habitude nous fait
préférer à la conftruclion réguliere. On lit trois fois
au dernier chapitre de l’évangile de S. Jean, Simon
diligis me ? Simon amas me ? Pierre aimez-vous moi ?
nous difons Pierre m’aimez-vous ?
La plupart des étrangers qui viennent du Nord
difent j'aime vous 9j ’aime lu i, au lieu de dire je vous
aime , je Vaime, félon notre conftruclion ufuelle.
A répandre des larmes ■: répandre des larmes, ces
trois mots font un fens total, qui eft le complément
de la prépofition à. Cétte prépofition met ce fens
total en rapport avec force, forcer, à cogéré ad. Virgile
a dit I xogiturire iti làcrymas (Æn. 1. IV. v . 413 .),
8c vocant ad lacrymas Æn. 1. XI. v . 96.
■ Répandre des larmes : des larmes n’eft pas ici le complément
immédiat de répandre ; des larmes eft ici dans
un fens partitif ; il y a ici ellipfe d’un fubftantif générique
: répandre une certaine quantité de les larmes;ou,
comme difent les Poètes Latins, imbremlacrymaruni,
une pluie de larmes.
Vous ne formez jamais d’inutiles defirs-.
Vous y fujet de la propofition ; les autres mots font
l’attribut.
Formez » k verbe à là fécondé perfonne du préfent
de l’indicatif.
Ne, eft la négation qui rend la propofition négative.
Jamais, eft un adverbe de tems. Jamais, en aucun
tems. Ce mot vient de deux môts latins ,jam, &
magis.
D 'inutiles dejirs y c’eft encore un fens partitif ; VOUS
ne formez jamais certains defirs, quelques defirs qui
foient du nombre des defirs inutiles. D ’inutiles de-
Jirs : quand le fubftahtif 8t l’adje&if font ainfi le
déterminant d’un verbe ou le complément d’une prépofition
dans un fens affirmatif, fi l’adjeélif précédé
le fubftantif, il tient lieu d’article, & marque la forte
Ou efpece, vous formez d''mutilas deflrs ; Oh qualifie
d’inutiles les defirs que vous formez. Si au contraire
le fubftahtif précédé l’adjeélif, on lui rend l’article ;
c’eft le fens individuel : vous formez des defirs inutiles;
on veut dire que les dêfirs particuliers ou finguliers
que vous formez, font du nombre de les defirs inutiles.
Mais dans le fens négatif on diroit, vous ne formez,
jamais, pas, point, de defirs inutiles : c’eft alors
le fens fpécifique-; il ne s’agit point de déterminer
tels ou tels defirs finguliers ; on ne fait que marquer
l ’efpece où forte de defirs que vous formez.
Dans vos tranquilles coeurs l’amour fuit la nature.
La conflruclion eft, Vamour fuie la nature dans vos
coeurs tranquilles. L’amour eft le fujet de la propofition
, & par cette raifon il précédé le verbe ; la nature
eft le terme de l’aftion de fuit, 8c par cette raifon
ce mot eft après le verbe.,Cette pofition eft dans
toutes les langues, félon l’ordre de l’énonciation 8c
de l’analyfe des penfées : mais lorfque cet ordre eft
interrompu par des tranfpofitions, dans les langues
qui ont des cas, il eft indiqué par une terminaifon
Tome IV .
particulierè qu oh appelle accüfàtif ; Onfortè qil’après
. que toute la phrafe eft finiè, l’efprit remet le mot à
; la place.__
«yans reffentir fies maû'x, Vous aVezfes plaifirs.
Conftruâtion , vous avez-fiesplaifirs, fans rejfehtir fes
mauxr. Vous eft. le fujet; les autres mots font l’attri-
; but.
S dns rejjêriiir fies maux. Sahs eft uftte prépofition ,
; dont reffentir fies maux eft le complément. Rejjentir
fes maux, éft Un fens particulier équivalent à un
! nom. Reffentir, 'eft ici un nomvérbal. Sans reffentir J
eft une propofitiôh implicite ,fans que vous reff-ntiez-
Ses maux, eft après l’infinitif reffentir y parce qu’il en
eft le déterminant ; il eft le terme de l’aétion de reffm-
\ tir.
L ’ambition, l ’hotineur , Vintérêtyl ’impofture
. Qui font tant de maux parmi, nous,
Ne fe rencontrent point chez vous>
Cette période eft compofée d’une propofition'
principale 8c d’une propofition incidente. Nous avons-
dit qu’une propofition qui tombe entre le fujet 8c
l’attribut d’une autre propofition, éft appellée propofition
incidente, du latin incidere, tomber dans ; 8c
que la propofition dans laquelle tombe l’incidente
eft appellée propofition principale, parce qu’ordinai-
rement elle contient ce que l’on veut principalement
faire entendre^
L ’ambition, VHonneur, l ’intérêt, Cimpoflurt 9
Ne fe rencontrent point chez vous-.
Voilà la propofition principale.
L’ambition j l ’honneur , Üintérêt, Timpofiüfe j c’elt
là le fujet de la propofition : cette forte ae fujet eft
appelle fujet multiple, parce quê ce font plufieurs individus
qui ont un attribut commun. Cës individus
font ici des individus métaphyfiques, des termes ab-
ftraits, à l’imitation d’objets réels.
‘Ne fe rencontrent point che[ yôïts, eft l’attribut:'
Or on pou voit dire, l ’ambition ne fe rencontre point
\ chez vous » Ehonneur ne fe rencontre point chez vous ;
1 l ’intérêt, 8cc. cé qui auroit fait quatre propofitions.
En raftemblant les divers fujets dont on veut dire la
même chofe, on abrégé le difeours, 8c on le rend,
plus vif.
Qui font tant de maux parmi nous 9 c’eft la propofition
incidente : qui en eft le fujet; c’eft le pronom
relatif; il rappelle à l’efprit Vambition, l ’honneur 9
Cintérêt, l’impàflure , dont on vient de parler.
Font tant de, maux parmi nous, c’eft l’attribut dè
l'a propofition incidente.
Tant de maux, c’eft le déterminant de font, c’eft
le terme de l’aélion de font.
Tant9 vient de l’adjeétif tantus, <z, um. Tant eft
pfis ici fubftarttivèment ; tantum malorum, tantum
Xp»pet malorum, une fi grande quantité de maux.
De maux y eft le qualificatif de tant ; c’eft un des
ufages de la prépofition de9 de fervir à la qualifica*
tion.
Maux, eft ici dans un fons IpécifiqUe, indéfini, &
non dans un fens individuel ï ainfi maux n’eft pas
précédé de l’articlè les.
Parmi nous, eft une circonftanée de lieu ; nous eft
le complément de la prépofition/><zr/7M.
Cependant nous avons la raifon pour partage 9
Et vous en ignorez l'ufage..
Voilà deux propofitions liéès entr’ellespâr la cort«
jonélion &.
■ Cependant, adverbe ou conjonftion adverfative 9
c’eft-à-dire qui marque reftriétion ou oppofifion par
rapport à une autre idée ou penfée. Ici cette penfée
eft, nous avons la raifon ‘ cependant malgré cet avantage,
les paffîons font tant de maux parmi nous. Ainfi
^ cependant marque oppofition, contrariété, entre