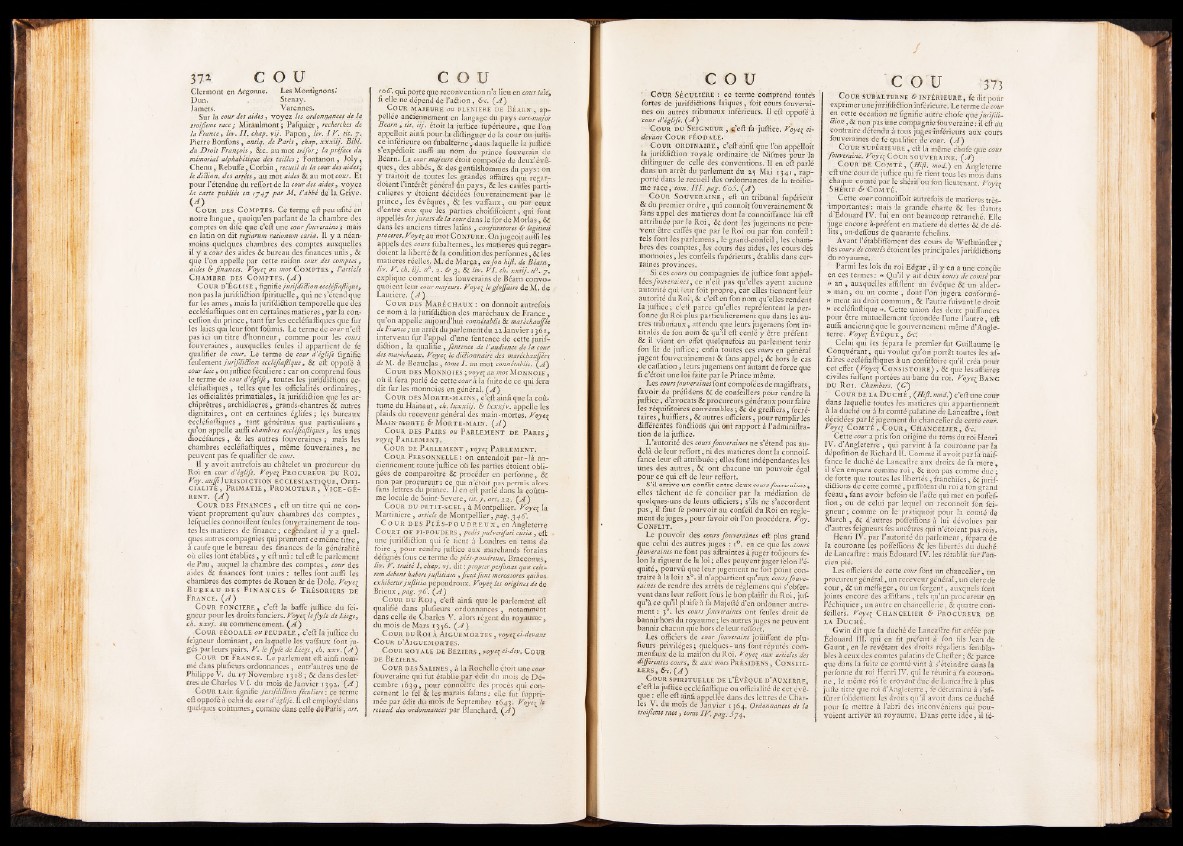
Clermont en Argonne. Les Montîgnons.'
Dun. . Stenay.
Jamets. v . Varennes.
Sur la cour des aides, voyez les ordonnances de la.
sroijîeme race ; Mitaùlmojiî ; Pafquier, recherches de
la France, Liv. II. chap, yij. Papon , liv. IV . tit. y.
Pierre Bonfons, antiq. de Paris , chap. xxxiij. Bibl.
du Droit François , &:c. .au mot tréfor.; la préface du
mémorial alphabétique des tailles ; Fontanon , Joly?
Chenu, Rebuffe, Çorbin , recueil de la cûur des aides-,
le diction, des arrêts , au mot aides & au mot cour. Et
pour l’étendue du reffort de la cour des aide? , voyez
la carte publiée en IJ4J par M. l'abbé de la Grive» ■ WÊÊÊ C o u r d e s C o m p t e s . Ce terme eftpeuufiteen
notre langue, quoiqu’en parlant de la chambre des
comptes on dife que c’eft une cour fouveraine >• mais
en latin on dit regiqrum rationum cùrià. Il y a néanmoins
quelques chambres des comptes auxquelles
il y a cour des aides & bureau des finances unis, &
que l’on appelle par cette raifon cour des comptes ,
aides & finances. Voyez au mot COM P T E S , l'article
C h a m b r e d e s C o m p t e s . ÇA)
C o u r d ’É g l i s e , lignifiejurifdiction ecclifiaftîque,
non pas la jurifdi&ion ipirityelle, qui ne s’étend que
fur les âmes, mais la jurifdiâion temporelle que des
eccléfiaftiques ont en certaines matières,. par la con-
ceflion du prince, tant furies eccléfiaftiques que fur
les laïcs qui leur font fournis. Le terme de tour n’eft
pas ici un titre d’honneur, comme .pour les cours
fouveraines, auxquelles feules il appartient de fe
qualifier de cour. Le terme de cour d'églife lignifie
feulement jurifdiction eccléfiaftique, & eft oppofé à
cour laie, ou juftice féculiere : car on comprend fous
le terme de cour d'églife, toutes les jurifdiftions ec-,
cléfiaftiques , telles que les officialités ordinaires,
les officialités primatiales, la jurifdi&ion que les ar-
chiprêtres, archidiacres, grands-chantres & autres
dignitaires, ont en certaines églifes ; lgs bureaux
eccléfiaftiques , tant généraux que particuliers ,
u’on appelle auffi chambres eccléfiaftiques, les unes
iocéfaines, & les autres fouverainçs ; mais les
chambres eccléfiaftiques, même ïbuveraines, ne
peuvent pas fe qualifier de cour.
Il y avoit autrefois au châtelet un procureur du
Roi en cour d'églife. Voyez PROCUREUR DU R o i.
Vcy. <m^ ï Ju r i s d i c t i o n e c c l e s i a s t i q u e , O f f i -
c i a l i t é , P r i m a t i e , P r o m o t e u r , V i c e - g é -
r e n t . ÇA)
_ C o u r d e s F i n a n c e s , eft un titre qui ne convient
proprement qu’aux chambres des comptes,
lefqueîles connoifTent feules fouverainement de toutes
lés matières de finance ; cependant il y a quelques
autres compagnies qui prennent ce même titre,
à caufe que le bureau des finances de'la généralité
oh elles font établies, y eft uni : tel eft le parlement
de Pau, auquel la chambre des comptes, cour des
aides & finances font unies : telles font auffi les
chambres des comptes de Rouen & de Dole. Voyez
B u r e a u d e s F i n a n c e s & T r é s o r i e r s d e
F r a n c e . ÇA)
C o u r f o n c i è r e , c ’ e f t l a b a ffe ju ft ic e d u fe i-
g n e u r p o u r le s d ro its fo n c ie r s . Voyez le fiyle de Liege,
ch. xxvj. a u com m e n c em en t. (A )
C o u r f é o d a l e ou f e u d a l e , c’eft la juftice du
feigneur dominant, en laquelle les yaffaux font jugés
parleurs pairs. V. le fiyle de Liege, ch. xxv. ÇA)
C o u r d e F r a n c e . Le parlement eft ainfi nommé
dans plufieurs ordonnances , entr’autres une de
Philippe V . du 1 7Novembre 1318; & dans des lettres
de Charles VI. du mois de Janvier 1392.. {A )
C o u r LAIE fignifie jurifdiction féculiere : çe terme
eft oppofé à celui de cour d'églife. Il eft employé dans
quelques coutumes, comme dans celle de Paris, art.
/ 0 5*. qui porte que-reconvention n’a lieu en cour la'ie9
fi elle, ne dépend-de l’aââon, &c. ÇA')
Cour majeure ou pleniere de Béarn , ap-
pellee anciennement en langage du pays con-major
Bearn, tit. iij. étoit la juftice -Supérieure, que l’on
appelloit ainfi pour-la diftinguer de la cour, ou juftice
inferieure où fubalferneydaijs laquelle la .juftice
s expedioit auffi au nom du prince fouverain de
Bearn. La cour majeure étoit compofée de deuxiévê-
ques, des abbés., & des gentilshommes du pays : on
y traitoit de .toutes les grandes affaires qui regar-
doient l’intérêt général du pays, & les çaufes particulières
y étoient décidées fouverainement par lé
prince, les évêques, & les vaffaux, ou par ceux
d’entre eux que ‘les parties choififtoient ; qui font
appellés lesjurats de la cour dans le for de M orlas, 6t
dans les anciens titres latins , conjùYatores & legitimi
proceres. Voyez au mot Conjure. O.n jugeoit auffi les
appels des cours fubalternes, les matières qui regar-
doient la liberté & la conditïondesperfonnes, & les
matières réelles. M. de Marça, en fon hift. de Béarn|
liv. V. ch. iij. n°. 2. & g . & liv. VI. ch. xxiij. n°. y.
explique comment les fouverains de Béarn convo-r
quoient leur cour majeure. Voyel legloffaire de M. de
Lauriere. ÇA).
Cour des Maréchaux : on donnoit autrefois
ce nom à la jurifdiétion des maréchaux de France ,
qu’on appelle aujourd’hui connétablie & maréchauffée
de France ; un arrêt du parlement du 22 Janvier 1361,
intervenu fur l’appel d’une fentence de cette jurif-
diftion, la qualifie , fentence de l 'audience de la cour,
des maréchaux, Vzye^ le dictionnaire des maréchauffée?
de M. de Beauclas, tome I. au mot connétablie. ÇA)
Cour des Monnoies ; voyez au mot Monnoie ,
où il fera parlé de cette cour à la fuite de ce qui fera
dit fur les monnoies en général. ÇA)
Cour des Morte-mains , c’eft ainfi que la coû*
tume du Hainaut, ch. Ixxxiij. & Lxxxjv. appelle les
plaids du receveur général des main-mortes. Voyez
Main-morte <S* Morte-main. ÇA)
Cour des Pairs ou Parlement de Paris,'
voye^ Parlement.
Cour de Parlement , voyez Parlement.
^ C ou.r Personnelle : on entendoit par-là anciennement
toute juftice oh les parties étoient obligées
de comparoîtré & procéder en perfonne, 6c
non par procureur; çe qui n’étoit pas permis alors
fans lettres du prince. Il en eft parlé dans la çoûtu-
me locale de Saint-Severe, t it.j. art. 22. ÇA )
Cour du petit-scel, à Montpellier. Voyez fe
Martiniere, article de Montpellier, pag. 3 46V • -
C our des Pie s-p o u d r e u x , en Angleterre
CO U R T OF Pl-POUDERS, pedispulverifati curia , eft ■
une jurifdiftion qui fe tient, à Londres en tems de
foire , pour rendre juftice aux marchands forains
defignes fous ce terme de piés-poudreux. Bracconus,
liv. V , traité I. chap. vj. dit : propterperfonas quce celer,
rem debent habere juflitiam ,ficut funt mercatores quibus,
exhibetur juflitia pepoudroux. Voyel les origines de de
Brieux, pag. y 6. ÇA )
Cour du Roi , c’eft ainfi que le parlement eft
qualifié dans plufieurs ordonnances , notamment
dans celle de Charles. V. alors régent du royaume,
du mois de Mars 13.5,6. ÇA) '
Cour DU R o i À Aiguemortes , voyez ci-devant
C our d’Aiguemortes.
Cour royale de Beziers , voyez ci-dey. Cour
de Beziers.
C our des Salines , à la Rochelle étoit une cour
fouveraine qui fut établie par édit du mois de Décembre
1639, pour cojnnoître des procès qui concernent
le fel & lés marais falans : elle fut fuppri-
mée par édit du mois dç Septembre 1643. Voyez, 'te
recueil des ordonnances par Blanchard. ÇA)
' C our Séculière : ce terme comprend toute's
fortes de jurifdiftions laïques, foit cours fouverai-
nes où autres tribunaux inférieurs. Il eft oppofé'à
cour d'églife.‘(A )
' ;Cour du Seigneur , tfeû. {a juftice. Voyez cidevant
COUR FÉODALE.
; C our ordinaire, c’eft ainfi que Fon appelloit
la jurifdiélion royale ordinaire de Nifmes pour'là
diftinguer de celle des conventions. Il en eft parlé
dans un arrêt du parlement du 25 Mai 1341, rapporté
dans le recueil des ordonnances, de la troifie.-
me race, tom. III. pag. GoS. ÇA)
Cour Souveraine, eft un tribunal fupériëür
& du premier .ordre, qui connoît foUvèrairtemeht &
fans appel des matières dont la connoiffance lui eft
attribuée par le Roi, & dont l,es jugemens ne peuvent
être caffés que par le Roi où par fon conferl
tels font les parlemens, le grafid-confeil, les chaili-
bres des comptes, les cours des aidés, les cours des
monnoies , les confeils fupérieurs , établis dans ceri
taipes provinces. ’ .
Si Ces cours ou compagnies dé juftice font appel-
lées fouveraines, ce n’eft pas qu’elles ayent aucune
autorité qui ieur foit propre, car ellés tiennent leïrf
autorité du Roi, & c’eft en fon nom qu’elles rendent
la juftice; ce it parce qu’elles reprefentent la perfonne
^u Roi plus particulièrement que dans les autres
tribunaux, attendu que leurs jügemens font intitulés
de fon nom & qu’il eft cefifé y être préfent
& il vient en effet quelquefois au parlement tenir
fon lit de juftice; enfin toutes ces cours en général
jugent fouverainement & fans appel ; & hors le cas
de caffation, leurs jügemens ont autant de force que
fi c’étoit une loi faite par le Prince même.
Les cours ƒouveraines (ont compofées de magiftrats,
favoir de préfidens & de confeillers pour rendre la
juftice, d’avocats & procureurs généraux pour faire
les réquilitoires convenables ; & de greffiers,, fecré-
taires, huiffiers, & autres officiers, pour remplir les
différentes fondions qui ont rapport à l’adminiftra-
tion de la juftice.
L ’autorité dés cours fouver aines ne s’étend pas au-
delà de leur reffort, ni des matières dont la connoiffance
leur eft attribuée ; elles font indépendantes les
unes des autres, & ont chacune un pouvoir é^al
pour ce qui eft de leur reffort.
S’il arrive un conflit entre deux cours fouveraines,
elles tâchent de fé concilier par la médiation de
quelques-uns de leurs officiers ; s’ils ne s’accordent
pas, il faut fe pourvoir au confeil du Roi en reglement
de juges, pour favoir oh l’on procédera. Voy.
C onflit.
Le pouvoir des cours fouveraines eft plus grand
que celui des autres juges : i° . en ce que les court
fouveraines ne font pas aftraintes à juger toûjours félon
la rigueur de la loi ; elles peuvent juger félon l’équité
, pourvû que leur jugement ne foit point' contraire
à la loi : 20. il n’appartient qu’aux cours fouve-
raines de rendre des arrêts de réglemens qui s’obfer-
vent dans leur reffort fous le bon plaifir du Roi, jiif-
qu’à ce qu’il plaife à fa Majefté d’en ordonner autrement
: 30. les cours fouveraines ont feules droit de
bannir hors du royaume ; les autres juges ne peuvent
bannir chacun que hors de leur reffort.
Les officiers de cour fouveraine joiiiffent de plufieurs
privilèges ; quelques - uns font réputés com-
menfaux de la maifon du Roi. Voyez aux ar‘ticles des
différentes cours, & aux /«o« P rÉSIDENS, CONSEILLERS
, &c. ÇA )
| Cour spirituelle de l’Évêque d’Auxerre,
c’eft la juftice eccléfiaftique ou officialité de cet évêque
: elle eft ainfi/appellee dans des lettres de Char-
les V. du mois de Janvier 1364. Ordonnances de la
troifieme race , tome IV. pag. 5yq.
C o u r s u b a l t e r n e & i n f é r i e u r e , fe dit pour
exprimer une jttrifdiâion inférieure. Le terme de cour
en cette ôccafion ne fignifie autre chofe que jurifdiction
, & non pas une compagnie fouveraine : il eft a'u
'contraire défeftdh à tous jugés inférieurs aüfc cours
fouveraines defè qualifier de cùur. ÇA)
C our supérieure , e'ft la même chofe qué cour
fouveraine. Voyez C o'ur souveraine. ÇA)
C.our de C omté , ÇHifi. mod.) en Angleterre
eft une Co'ur de juftice qui fé tient tous les mois dahs
chaque comté par. le shérif ou fon lieutenant. Voyez
Shérif <S*Oom:t é . • ; - • ■
Cette cour connoiffoit autrefois de matières très-
importantes : mais ‘la gràïîdè charte & les ftatùts
d’Edouard IV. lui en ont beaucoüp retranché. Elle
jyge encore'à-préiènt en matière dé dettes & de délits
, au-deffous de quarante fehelins.
Avant l’établiffement des cours de Weftminfter,’
lés cours de-comtés étoient lés principales jurifdiétions
“du royaume.
- PàniiHes lois du roi Edgar, il y en a tine-Cbhçûè
en ces termes : « Qu’il y ait deux cours de comté par
» an , auxquelles affiftent un évêque & -un aïder-
» man, ou un comte , dont l’on jugera cohïbrmé-
» ment ali droit commun, & Pàùtre fuivant le droit
» eccléfiaftique ». Cette union des detix püiffancés
pour être mutuellement fecbridëe l’une l’autre, eft
auffi ancienne que le gouvernement même d’Angleterre.
Voyez É vêque, & c[
Celui qui les fépara le premier fut Guillaume Iè
Conquérant, qui voulut qu’on portât toutes lès affaires
eccléfiaftiques à un confiftoire qu’il créa pour
cet eSevÇVvyez C onsistoire) , & que les affairés
civiles fiiffent portées au banc du roi. Voyez Banc
du Roi. Ohàmbtrs. ÇG)
C our de la D u ché , ÇFUfi. mod.) c’eft ùne coràr
dans laquelle toutes les matières qtù appârtiennérit
à la duché ou à la comté palatine de Lancaftre, font
décidées pat lé jugement du chahceiier de cétié cottr.
Voyez C o m t é ,.C o u r , C h an c elie r, &cd
Cette cour z pris fort origine du feins du foi Henri
IV. d’Angleterre , qui parvint à la couronne par la
dépofition de Richard IL Comme il avoit par fà naif-
fance le duché de Lancaftre aux droits de fa mère,
il s’en empara comme r o i, & rton pas commé duc ;
de forte que toutes les libertés, franchifes, & jurif-
diôions de ceiite comté, paffoient du roi à fon grand
fceau, fans avoir befoin de l’aéïe qui met en poffef-
fion, ou de celui par lequel on? feconnoît fon feigneur
; comme on le pratiquoit pour la çôinté dè
March , & d’autfes pofl'effions à lui dévolues pair
d’autres feigheurs ïes ancêtres qui n’étoient pas rois.
Henri IV. par l’autorité du parlement, fepara dè
la couronne les poffeffioris & les libertés du duché
de Lancaftre : mais Édouard IV. les rétablit fur l’ancien
pié.
Les officiers de cette cour font un chancelier, un
procureur général, un receveur général, un elère dè
cour, & un meffager, ou un'fergerit, auxquels font
joints encore des affiftàns , tels qu’un procureur en
l’échiquièf, un autre en chancellerie, & quatre edri-
feillers. Voyez C hancelier & Procureur de
la D u ch é.
G vin dit que la duché de Lancaftre fut créée pal*
Édouard III. qui en fit préfent à fon fils Jean dè
Gaunt, en lé revêtant des droits régaliens fembla- ‘
blés à ceux des comtes palatins de Ghefter ; & parce
que dans la fuite ce comté vint à s’éteindrè dans la
perfonne dtï roi Henri IV. qui le réunit à fa couronne
, le même roi fe croyant düc de Lancaftre à plus
jufte titre que roi d’Angleterre, fe détermina à s’àf-
fûrèf folidérftent lès droits qu’il avoit dans ce duché
pour fe mettre à l’abri des inconvénierts qui pou-
voient arriver au royaiinfe. Dans cette idée, il fé