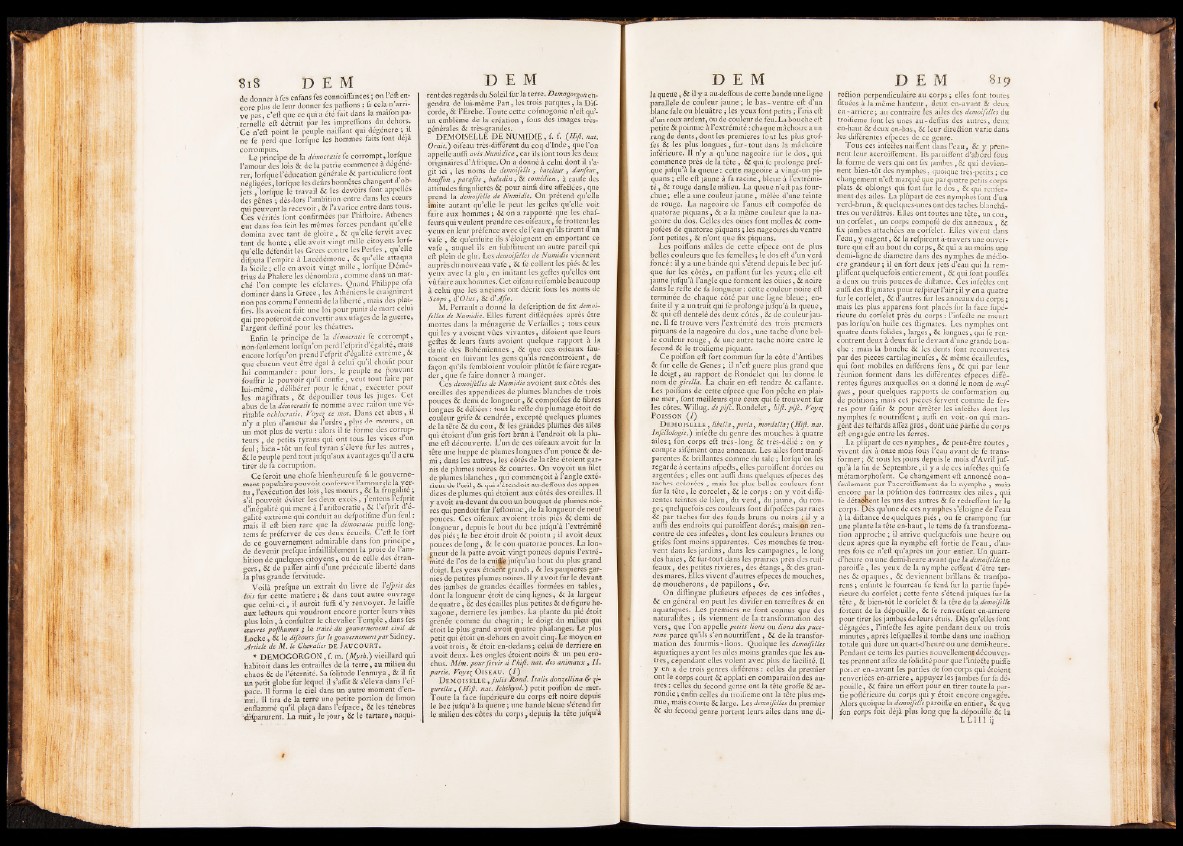
de donner à lés enfans fes connoiffances'; on l’ èfl encore
plus de leur donner fes paffiotts : fi cela n'arrive
pas, c’eft crue ce qui a été fait dans la maifon paternelle
eft détruit par les impreffions du dehors.
Ce n’eft point le peuple naiffant qui dégénéré ; il
ne le perd que lorfque les hommes faits font déjà
corrompus. c
Le principe de la démocratie fe corrompt, torique
l’amour des lois & de la patrie commence à dégénérer,
lorfque l’éducation générale 6c particulière font
négligées, lorfque les defirs honnêtes changent d objets
, lorfdjue le travail 6c les devoirs font appelles
des gênes ; dès-lors l’ambition entre dans les coeurs
qui peuvent la recevoir, & l’avarice entre dans tous;.
Ces vérités font confirmées par l’hiftoire. Athènes
eut dans fon fein les mêmes forces pendant qu elle
domina avec tant de gloire , 6c qu’elle fervit avec
tant de honte ; elle avoit vingt mille citoyens lorf-
qu’elle défendit les Grecs contre les Perfes , qu elle
difpiita l’empire à Lacédémone , 6c qu’elle attaqua
la Sicile ; elle en avoit vingt mille , lorfque Dcme-
trius de Phalere les dénombra, comme dans un marché
l’ôn compte les efclaves. Quand Philippe ofa
dominer dans la Grèce, les Athéniens le craignirent
non pas comme l’ennemi de la liberté, mais des plai-
lirs. Ils avoient fait une loi pour punir de mort celui
qui prOpoferoit de convertir aux ufages de la guerre,
l’argent deftiné pour les théâtres.
Enfin le principe de la démocratie fe corrompt,
non-feulement lorlqu’on p e r d l’efprit d’égalité, mais
encore lorfqu’on prend l’efprit d’égalité extrême, &
que chacun veut être égal à celui qu’il choilit pour
lui commander: pour lors, le peuple ne pouvant
fouflfir le pouvoir qu’il confie , veut tout faire par
lui-même, délibérer pour le fénat, exécuter pour
les magiftrats , 6c dépouiller tous les juges. Cet
abus de la démocratie fe nomme avec raifon une véritable
ochlocratie. Voye{ ce mot. Dans cet abus , il
n’y a plus d’amour de l’ordre, plus de moeurs, en
un mot plus de vertu : alors il fe forme des corrupteurs
, de petits tyrans qui ont tous les vices d’un
feul ; biën - tôt un feul tyran s’élève fur les autres,
& le peuple perd tout jufqu’aux avantages qu’il a cru
tirer de fa corruption.
Ce feroit une chofe bienheureufe fi le gouvernement
populaire pouvoit conferver l’amour dè la vertu
, l’exécution des lois, les moeurs, 6c la frugalité ;
s’il pouvoit éviter les deux excès, j’entens l’efprit
d’inégalité qui mene à l’ariftocratie, & l’efprit d’égalité
extrême qui conduit au defpotifme d un feul :
mais il eft bien rare que la démocratie puifle long-
tems fe préferver de ces deux écueils. C ’eft le fort
de ce gouvernement admirable dans fon principe,
de devenir prefque infailliblement la proie de l’ambition
de quelques citoyens, ou de celle des étrangers
, & de paffer ainfi d’une précieufe liberté dans
la plus grande fervitude.
Voilà prefque un extrait du livre de Yefprit des
lois fur cette matière ; 6c dans tout autre ouvrage
que celui-ci, il auroit fuffi d’y renvoyer. Je laiffe
aux le&eurs qui voudront encore porter leurs vues
plus loin, à confulter le chevalier Temple, dans fes
oeuvres poflhumes ; le traité du gouvernement civil de
Lo ck e , & le difcours fur le gouvernement par Sidney.
Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
* DEMOGORGON, f. m. (Myth.) vieillard qui
habitoit dans les entrailles de la terre, au milieu du
chaos &c de l’éternité. Sa folitude l’ennuya, & il fit
un petit globe fur lequel il s’aflit & s’éleva dans l’ef-
pace. Il forma le ciel dans un autre moment d’ennui.
Il tira de la terre une petite portion de limon
enflammé qu’il plaça dans l’efpace, 6c les ténèbres
'(bfparurent. La nuit , le jour , 6c le tartare , naquirent
des regards du Soleil fur la terre. Demo’gorgon engendra
de lui-même P an le s trois parques, la Discorde,
& l’Erebe. Toute cette cofmogonie n’eft qu’un
emblème de la création , fous des images très-
générales & très-grandes.
DEMOISELLE DE NUMIDIE, f. f. (Hiß. nat.
Omit.) oifeau très-différent du coq d’Inde, que l’on
appelle aufli avis Nurnidica, car ils font tous les deux
originaires d’Afrique. On a donné à celui dont il s’agit
ici , les noms de demoifelle , bateleur, danfeury
bouffon , parafite , baladin , & comédien, à caufe des
attitudes fmgulieres & pour ainfi dire affe&ées, que
prend la demoifelle de Numidie. On prétend qu’elle
imite autant qu’elle le peut les geftes qu’elle voit
faire aux hommes ; & on a rapporté que les chaf-
feurs qui veulent prendre ces oifeaux, fe frottent les
•yeux en leur préfence avec de l’eau qu’ils tirent d’un
vafe , 6c qu’enfuite ils s’éloignent en emportant ce
vafe , auquel ils en fubftituent un autre pareil qui
eft plein de glu. Les demoifelles de Numidie viennent
auprès du nouveau v a fe, &c fe collent les piés 6c les
yeux avec la glu, en imitant les geftes qu’elles ont
vu faire aux hommes. Cet oifeau reffemble beaucoup
à celui que les ançiens ont décrit fous les noms de
Scops, (Y O lus, 6c à’Afio.
M. Perrault a donné la defcription de fix demoifelles
de Numidie. Elles furent difféquées après être
mortes dans la ménagerie de Verlailles ; tous ceux
qui les y avoient vues vivantes, difoient que leurs
geftes & leurs fauts avoient quelque rapport à la
danfe des Bohémiennes , 6c que ces oifeaux fau-
toient en fuivant les gens qu’ils rencontroient, de
façon qu’ils fembloient vouloir plutôt fe faire regarder
, que fe faire donner à manger.
Ces demoifelles de Numidie avoient aux côtés des
oreilles des appendices de plumes blanches de trois
pouces & demi de longueur, 6c compofées de fibres
longues 6c déliées : tout le re'fte du plumage étoit de
couleur grife & cendrée, excepté quelques plumes
de la tête 6c du cou, & les grandes plumes des ailes
qui étoient d’un gris fort brun à l’endroit oii la plume
eft découverte. L’un de ces oifeaux avoit fur la
tête une hüppe de plumes longues d’un pouce & demi
; dans les autres, les côtés de la tête étoient garnis
de plumes noires & courtes. On voyoit un filet
de plumes blanches, qui commençoit à l’angle extérieur
de l’oeil, & qui s’étendoit au-deffous des appendices
de plumes qui étoient aux côtés des oreilles. Il
y avoit au-devant du cou un bouquet de plumes noires
qui pendoit fur l’eftomac, de la longueur de neuf
pouces. Ces oifeaux avoient trois pies 6c demi de
longueur, depuis le bout du bec jufqu’à l’extrémité
des piés ; le bec étoit droit 6c pointu ; il avoit deux
pouces de long, & le cou quatorze pouces. La longueur
de la patte avoit vingt pouces depuis l’extrémité
de l’os de la cui$e jufqu’au bout du plus grand
doigt. Les yeux étoient grands, & les paupières garnies
de petites plumes noires. Il y avoit fur le devant
des jambes de grandes écailles formées en tables,
dont la longueur çtoit de cinq lignes, & la largeur
de quatre, 6c des écailles plus petites & de figure hexagone,
derrière les jambes. La plante du pié étoit
grenée comme du chagrin ; le doigt du milieu qui
étoit le plus grand avoit quatre phalanges. Le plus
petit qui étoit en-dehors en avoit cinq. Le moyen en
avoit trois, & étoit en-dedans ; celui de derrière en
avoit deux. Les ongles étoient noirs & un peu crochus.
Mém. pour fervir à P hiß. nat. des animaux , II.
partie. Koye^ OlSEAU. (/ )
D emoiselle , julis kond. Italis don^ellina & fi-
gurella (H fl. nat. Ichthyol.) petit poiffon de mer.
Toute la face fupérifeure du corps eft noire depuis
le .bec jufqu’à la queue ; une bande bleue s’étend fur
le milieu des côtes du corps, depuis la tête jufqu’à
la queue, & il y a au-deffous de cette bande une ligne
parallele de couleur jaune ; le bas-ventre eft d’un
blanc fale ou bleuâtre ; les yeux font petits ; l’iris eft
d’un roux ardent, ou de couleur de feu. La bouche eft
petite & pointue à l’extrémité : chaque mâchoire a un
rang de dents, dont les premières font les plus greffes
6c les plus longues, fur-tout dans la mâchoire
inférieure. Il n’y a qu’une nageoire fur le dos, qui
commence près de la tête , & qui fe prolonge pref-
,que jufqu’à la queue : cette nageoire a vingt-un pi-
quans ; elle eft jaune à fa racine, bleue à l’extrémité
, 6c rouge dans le milieu. La queue n’eft pas fourchue
; elle a une couleur jaune, mêlée d’une teinte
de rouge. La nageoire de l’anus eft compofée de
quatorze piquans, & a la même couleur que la nageoire
du dos. Celles des oiiies font molles 6c compofées
de quatorze piquans ; les nageoires du ventre
font petites, & n’ont que fix piquans.
Les poiffons mâles de cette efpece ont de plus
belles couleurs que les femelles ; le dos eft d’un verd
foncé : il y a une bande qui s’étend depuis le bec juf-
que fur les côtés, en paffant fur les yeux ; elle eft
jaune jufqu’à l’angle que forment les oiiies, & noire
dans le refte de fa longueur : cette couleur noire eft
terminée de chaque côté par une ligne bleue; en-
fuite il y a un trait qui fe prolonge jufqu’à la queue,
6c qui eft dentelé des deux côtés, 6c de couleur jaune.
Il fe trouve vers l’extrémité des trois premiers
piquans de la nageoire du dos, une tache d’une belle
couleur rouge, & une autre tache noire entre le
fécond 6c le troifieme piquant.
Ce poiffon eft fort commun fur la côte d’Antibes
& fur celle de Genes ; il n’eft guère plus grand que
le doigt, au rapport de Rondelet qui lui donne le
nom de girella. La chair en eft tendre 6c caffante.
Les poiffons de cette efpece que l’on pêche en plaine
mer, font meilleurs que ceux qui le trouvent fur
les côtes. "Willug. de pifc. Rondelet, hiß. p if c. Voyc{_
P o i s s o n ( / )
D e m o i s e l l e , libella, perla, mordélia; (Hiß. nat.
Infeclologie.') infefte du genre des mouches à quatre
ailes; fon corps eft très-long 6c très-délié : on y
compte aifément onze anneaux. Les ailes font tranf-
parentes 6c brillantes comme du talc ; lorfqu’on les
regarde à certains afpetts, elles paroiffent dorées ou
argentées ; elles ont aufli dans quelques efpeces des
taches colorées , mais les plus belles couleurs font
fur la tête, le çorcelet, & le corps : on y voit différentes
teintes de bleu, du verd, du jaune, du rouge
; quelquefois ces couleurs font difpofées par raies
6c par taches fur des fonds bruns ou noirs : il y a
aufli des endroits qui paroiffent dorés; mais on rencontre
de ces infe&es, dont les couleurs brunes ou
grifes font moins apparentes. Ces mouches fe trouvent
dans les jardins, dans les. campagnes, le long
des haies, 6c fur-tout dans les prairies près des ruif
feaux, des petites rivières, des étangs, & des grandes
mares. Elles vivent d’autres efpeces de mouches,
de moucherons, de papillons, &c.
On diftingue plufieurs efpeces de ces infe&es,
6c en général on peut les divifer en terreftres & en
aquatiques. Les premiers ne font connus que des
naturaliftes ; ils viennent de la transformation des
vers, que l’on appelle petits lions ou lions des pucerons
parce qu’ils s’en nourriffent, 6c de la transformation
des fourmis-lions. Quoique les demoifelles
aquatiques ayent les ailes moins grandes que les autres,
cependant elles volent avec plus de facilité. 11
y en a de trois genres différens : celles du premier
ont le corps court 6c applati en comparaifon des autres
: celles du fécond genre ont la tête greffe 6c arrondie
; enfin celles du troifieme ont la tête plus menue,
mais courte 6c large. Les demoifelles du premier
6c du fécond genre portent leurs ailes dans une direôion
perpendiculaire au corps ; elles font toutes
fituées à la même hauteur, deux en-avant & deux
en-arriéré ; au contraire les ailes des demoifelles du
troifieme font les unes au-deflus des autres, deux
en-haut 6c deux en-bas, 6c leur dire&ion varie dans
les différentes efpeces de ce genre.
Tous ces infe&es naiffent dans l’eau, 6c y prennent
leur accroiffement. Ils paroiffent d’abord fous
la forme de vers qui ont fix jambes, 6c qui deviennent
bien-tôt des nymphes, quoique très-petits ; ce
changement n’eft marqué que par quatre petits corps
plats & oblongs qui font fur le dos, 6c qui renferment
des ailes. La plupart de ces nymphe^ font d’un
verd-brun, & quelques-unes ont des taches blanchâtres
ou verdâtres. Elles ont toutes une tête, un cou,
un corfelet, un corps compofé de dix anneaux, 6c
fix jambes attachées au corfelet. Elles vivent dans
l’eau, y nagent, 6c la refpirent à-travers une ouverture
qui eft au bout du corps, 6c qui a au moins une
demi-ligne de diamètre dans des nymphes de médiocre
grandeur ; il en fort deux jets d’eau qui la rem-
pliffent quelquefois entièrement, 6c qui font pouffés
à deux ou trois pouces de diftance. Ces infe&es ont
aufli des ftigmates pour refpirer l’air ; il y en a quatre
fur le corfelet, 6c d’autres fur les anneaux du corps ;
mais les plus apparens font placés fur la face fupérieure
du corfelet près du corps : l’infe&e ne meurt
pas lorfqu’on huile ces ftigmates. Les nymphes ont
quatre dents folides, larges, 6c longues, qui fe rencontrent
deux à deux fur le devant d’une grande bouche
: mais la bouche 6c les dents font recouvertes
par des pièces cartilagineufes, 6c même écailleufes,
qui font mobiles en différens fens, 6c qui par leur
réunion forment dans les différentes efpeces différentes
figures auxquelles on a donné le nom de mafi
ques, pour quelques rapports de conformation ou
de pofition ; mais ces pieces.fervent comme de ferres
pour faifir & pour arrêter les infeûes dont les
nymphes fe nourriffent ; aufli en voit-on qui mangent
des teftards affez gros, dont une partie au corps
eft engagée entre les ferres.
La plupart de ces nymphes, & peut-être toutes ,
vivent dix àonze mois fous l’eau avant de fe transformer
; 6c tous les jours depuis le mois d’Avril jufqu’à
la fin de Septembre, il y a de ces infeôes qui fe
métamorphofent. Ce changement eft annoncé non-
feulement par l’accroiffement de la nymphe , mais
encore par la pofition des fourreaux des ailes, qui
fe détachent les uns des autres & fe redreffent fur le
corps. Dès qu’une de ces nymphes s’éloigne de l’eau
à la diftance de quelques piés, ou fe crampone fur
une plante la tête en-haut, le tems de fa transformation
approche ; il arrive quelquefois une heure ou
deux après que la nymphe eft fortie de l’eau, d’autres
fois ce n’eft qu’après un jour entier. Un quart-
d’heure ou une demi-heure avant que la demoifelle ne
paroiffe, les yeux de la nymphe ceffent d’être ternes
6c opaques, 6c deviennent brillans 6c tranfpa-
rens ; enfuite le fourreau fe fend fur la partie fupérieure
du corfelet ; cette fente s’étend jufques fur la
tête, & bien-tôt le corfelet & la tête de la demoifelle
fortent de la dépouille, 6c fe renverfent en-arriere
pour tirer les jambes de leurs étuis. Dès qu’elles font
dégagées, l’infe&e les agite pendant deux ou trois
minutes, après lefquelles il tombe dans une inaâiqpL
totale qui dure un quart-d’heure ou une demi-heure.
Pendant ce tems les parties nouvellemen®découver-
tes prennent affez de folidité pour que l’infe&e puifle
porter en-avant les parties de fon corps qui étoient
renv'erfées en-arriere, appuyer les jambes fur fa dépouille
, 6c faire un effort pour en tirer toute la partie
poftérieure du corps qui y étoit encore engagée.
Alors quoique la demoifelle paroiffe en entier, & que
fon corps loit déjà plus long que la dépouille 6c la
L L 111 ij