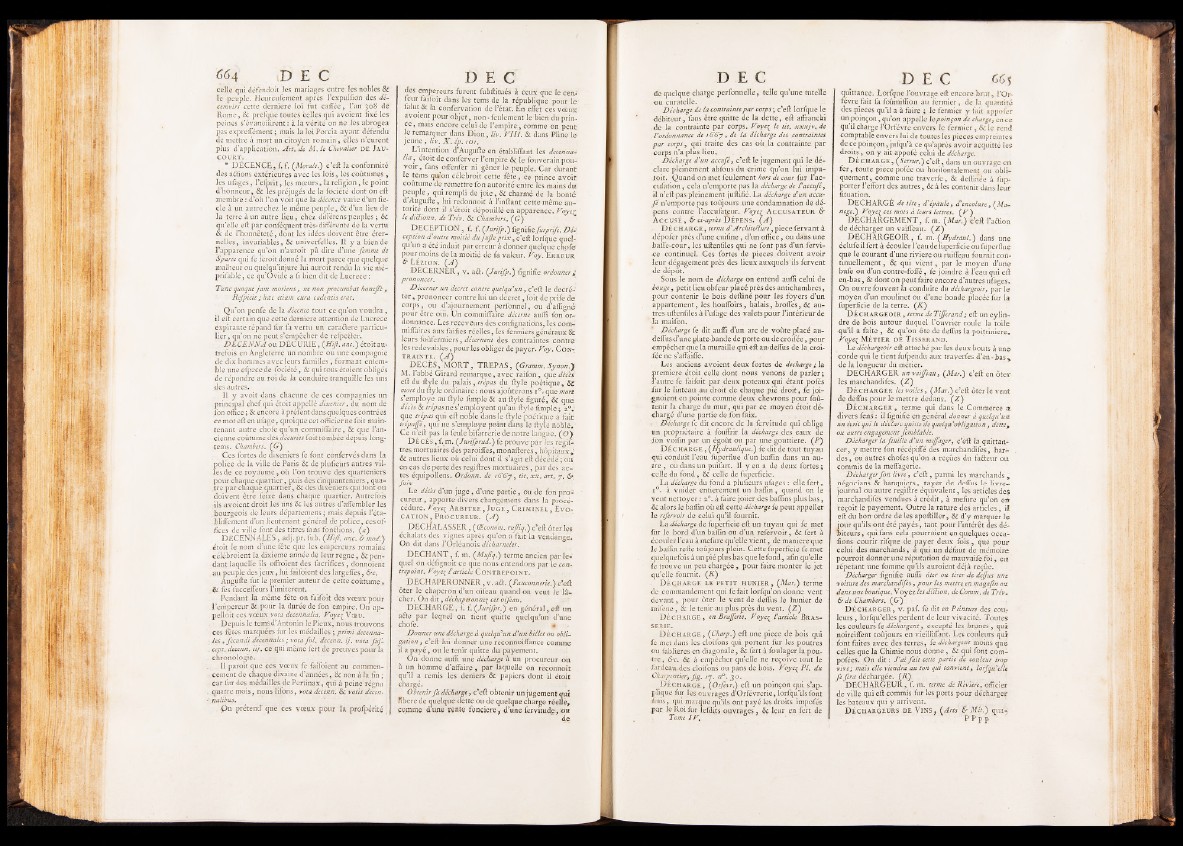
celle qui défcndoit les mariages entre les nobles &
le peuple. Heufëufemént après rexpullicm des décemvirs
cette dernière loi fut caffée, l’an 368 de
Rome, &c prefque toutes celles qui avoient fixé les
peines s’évanoiiirenf : à la vérité on ne les abrogea
pas expreflement ; mais la loi Porcia ayant défendu
de mettre à mort ün citoyen romain, elles n’eurent
plus d’application. Art, de M, le Chevalier DE Jau-
COURTi
* DÉCENCE, f. f. {Morale,') c ’eft la conformité
des adions extérieures avec les lois, les coutumes ,
les ufages, l’efprit, les moeurs, la religion, le point
d’honneur, & les préjugés de la fociété dont on eft
membre : d’où l’on voit que la décence varie d’un fie-
cle à un autre chez le même peuple, & d’un lieu de
la terre à un autre lieu, chez différens peuples ; &
qu’elle eft par conféquent très-différente de la vertu
& de l’honnêteté, dont les idées doivent être éternelles,
invariables, & univerfelles. II y a bien dé
l’apparence qu’on n’auroit pu dire d’une femme de
Sparte qui fe ferait donné la mort parce que quelque
malheur ou quelqu’injure lui attrait rendu la vie mé-
prifable, ce qu’Ovidë a fi bien dit de Lucrèce :
Tune quoque jam moriens , ne non procumbat honeftè ,
Rcfpicit ; hæc etiam cura cadentis erat, '
Qu’on penfe de la décence tout ce qu’on votidra ,
il eft certain que cette derniere attention de Lucrèce
expirante répand fur fa vertu un cara&ere particulier
, qu’on ne peut s’empêcher de refpeéter.
DECENNA ou DÉCURIE, {Hift. anc.) étoit autrefois
en Angleterre un nombre ou une compagnie
de dix hommes avec leurs familles , formant enlem-
ble une efpece.de-fociété, & qui tous étoient obligés
de répondre au roi de la conduite tranquille les uns
jies autres.
Il y avoit dans chacune de ces compagnies un '
principal chef qui, étoit appellé diieenier, du nom de
ion office ; & encore à préfent dans quelques contrées
ce mot eft en ufage , quoique cet officier ne foit maintenant
autre chofe qu’un commiffaire, & que l’ancienne
coûtume des décuries foit tombée depuis long-
îems. Chambers. (G)
Ces fortes de dixeniers fe font confervés dans la
police de la ville de Paris & de plufieürs autres villes
de ce royaume, où l’on trouve des quarteniers
pour chaque quartier, puis des cinquanteniers, quatre
par chaque quartier, & des dixeniers qui font ou
doivent être féize dans chaque quartier. Autrefois
-ils avoient droit les tins & les autres d’affembler les
.bourgeois de leurs départemens ; mais depuis l’éta-
.bliffement d’un lieutenant général de police, ces offices
de ville font des titres fans fondions, (a)
DÉCENNALES, adj. pr. fub. {Hift. anc. & mod.)
étoit le nom d’une fête que les empereurs romains
célébraient la dixième année de leur régné, & pendant
laquelle ils offraient des facrifices, donnoient
au peuple des jeux, lui faifoient des largeffes, &c.
Augufte fut le premier auteur de cette coutume,
& fes fucceffeurs l’imiterent.
Pendant la même fête on faifoit des voeux pour
l ’empereur &.poùr la durée de fon empire. On ap-
pelloit ces voe.ux vota decennalia. Voye£ V(Eu.
Depuis le tems d’Antonin le Pieux,;.nous trouvons !
ces fêtes marquées fur les médailles ; primi décennales
, fecundi décennales ; vota fol. decenn, ij, vota fuf- !
, cept. decenn. iij. ce qui même fert de preuves pour la
chronologie.
Il paraît que ces voeux fe faifoient au commencement
de chaque dixaine d’années, & non à la fin ;
car fur des médailles de Pertinax, qui à peine régna ]
quatre mois, nous lifons, vota decenn. & votis decen-
nalibus.
Qn prétend' que ces voeux pour la profpérité 4
des empereurs furent fubftitués à ceux que le cen-'
feur faifoit dans les tems de la république pour le
falut & la confervation de l’état. En effet ces voeux
avoient pour objet, non - feulement le bien du prince
, mais encore celui de l’empiré , comme on peut
le remarquer dans Dion, liv. VIII. & dans Pline le
jeune ; liv. JC. ép. 101.
L intention d’Augufle en établifîant les decenna-j
Ha, étoit de conferver l’empire & le fouverain pouvoir
, fans offenfer ni gêner le peuple. Car durant
le tems qu’on célébrait cette fête, ce prince avoit
coûtume de remettre fon autorité entre les mains du
peuple, qui rempli de joie, & charmé de la bonté
d Augufte, lui redonnoit à l’inftant cette même autorité
dont il s’étoit dépouillé en apparence. Voyer
le diclionn. de Trév. & Chambers. {G)
DECEPTION, f. f. {.Jurifp.) lignifie furprife. Dé-,
cepiion d'outre moitié dujufteprix, c’eft lorfque quelqu’un
a été induit par erreur à donner quelque chofe'
pour moins de la moitié de fa valeur. Voy. Erreur
& LÉzion. {A)
DECERNER, v . aft. {Jurifp.*) lignifie ordonner
prononcer.
Décerner un decret contre quelqu'un, c’elt le décréter
, prononcer contre lui un decret, foit de prife de
corps, ou d’ajournement perfonnel, ou d’aflîgné
pour être oui. Un commiffaire décerne aulîi fon ordonnance.
Les receveurs des confignatidns, les com-
miffaires aux failles réelles, les fermiers généraux &
leurs foûfermiers , décernent des contraintes- contre
lés redevables, pour les obliger de payer. Voy. C ontrainte.
{A)
DÉCÈS, MORT , ' TREPAS, {Gramm. Synon.y
M. l’abbé Girard remarque, avec raifon, que décèd
eft du ftyle du palais, trépas du ftyle poétique, St
mort du ftyle ordinaire : nous ajouterons i° . que Mort
s’employe au ftyle limple & ait ftyle figtiré, & que
décès & trépas ne s^mployent qu’au ftyle limple ; z°J
que trépas qui eft noble dans le ftyle poétique à fait
trépaffé, qui ne s’employe point dans le ftyle noble.
Ce n’eft pas la feule bifarrerie de notre langue. {Oy
DÉcÉS, f. m. (.Jurifprud.) fe prouve par les regif-
tres mortuaires des paroiffes, monafteres, hôpitaux,'
& autres lieux où celui dont il s’agit eft décédé; ou
en cas de perte des regiftres mortuaires, par des actes
équipollens. Ordonn. de iCCy, tit. x x . art. 7. &
m 1 m m •
Le décès d’un juge, d’une partie, OU de fon procureur
, apporte divers changemens dans la pracé-
cédure. Voye^ Arbitre, Juge, Criminel, Evocation,
Procureur. {A)
DECHALASSER, {OEconom. ruftiq.) c’eft ôter les
échalats des vignes après qu’on a fait- la vendange.
On dit dans l’Orléanois décharneler.
DECHANT, f. m. {Muftq.) terme ancien par le-'
quel dn délignoit ce que nous entendons par le contrepoint.
Voye{ l ’article CONTREPOINT.
DECHAPERONNER, v. aft. (Fauconnerie.) c’eft:
ôter le chaperon d’un oifeau quand on veut le lâcher.
On dit, déchaperonne^ cet oifeau.
DECHARGE, f. f. {Jurifpr.) en général, eft un
a£te par lequel on tient quitte quelqu’un d’une
chofe. «
Donner une décharge à quelqu'un d'un billet ou obligation
, c’eft lui donner une reconnoiffance comme
il a payé, ou le tenir quitte du payement.
On donne auïîi une décharge à un procureur ou
à un homme d’affaire ,, par laquelle on rëconnoît
qu’il a remis les deniers & papiers dont il étoit
chargé.
Obtenir fa décharge , c’eft obtenir un jugement qui
libéré de quelque dette ou de quelque charge réelle,
cojnme d’une rente foncière, d’une fervitude,nu
de
de quelque charge perfonnelle, telle qu’une tutelle
ou curatelle.
Décharge de la contrainte par corps ; c’eft lorfque le
débiteur , fans être quitte de la dette, eft affranchi
• de la contrainte par corps. Voye[ le tit. xxxjv, de
l'ordonnance de iG 6 j , de la déchargé des contraintes
par corps, qui traite des cas où la contrainte par
. corps n’a plus lieu.
Décharge d'un accufé, c’eft le jugement qui le déclare
pleinement abfous du crime qu’on lui impu-
îoit. Quand on met feulement hors de cour fur l’ac-
eufation, cela n’emporte pas la décharge de laccufé,
il n’eft pas pleinement juftifié. La décharge dé un accu-
Je n’emporte pas toujours une condamnation de dépens
contre l’accufatgur. Voye^ Accusateur &
A c cusé , & ci-après D épens. {A )
DÉ CH A R G E , terme d'Architecture, piece fervant à
dépofer près d’une cuifine, d’un office, ou dans une
baffe-cour, les uftenfiles qui ne font pas d’un fervî-
•ce continuel. Ces fortes de pièces doivent avoir
leur dégagement près des lieux auxquelsils fervent
de dépôt.
Sous le nom de décharge on entend aufli celui de
bouge, petit lieu obfcur placé près des antichambres,
pour contenir le bois deftiné poùr les foyers d’un
appartement, les houffoirs, balais, broffes, & aur
très uftenfiles à l’ufage des valets pour l’intérieur de
la maifon.
Décharge fe dit aufli d’un arc de voûte placé au-
deffus d’une plate-bande de porte ou de croifée, pour
empêcher que la muraille qui eft au-deffus de la.croifée
ne s’affaiffe.
. Les. anciens avoient deux fortes de déchargé ; la
première étoit celle dont nous venons de parler ;
l ’autre fe faifoit par deux poteaux qui étant pofés
jfur le linteau au droit de chaque pié droit, fe joi-
•gnoient en pointe comme deux chevrons pour foû-
tenir la charge du mur, qui par ce moyen étoit déchargé
d’une partie de ..fon faix.
Décharge fe dit encore de la.fervitude qui oblige
tin propriétaire à. fouffrir la décharge des eaux de
•fon voifin par un égoût ou par une gouttière. (P)
D écharge , {Hydraulique?) fe dit de tout tuyau
qui conduit l’eau fuperflue d’un baflin dans un autre
, ou dans un puifart. Il y en a de deux fortes ;
celle du fond, & celle, de fuperficie.
La décharge du fond a plufieurs ufages : elle fert,
i° . à Vuider entièrement un baflin, quand on lë
veut nettoyer : z°. à faire joiier des baflins plus bas,
&: alors le baflin où eft cette décharge fe peut appeller
le refervoir de celui qu’il fournit.
La décharge de fuperficie eft un tuyau qui fe met
fur le bord d’un baflin ou d’un refervoir, & fert à
écouler l’eau à mefure qu’elle vient, de maniéré que
le baflin refte toûjours plein. Cette fuperficie fe met
quelquefois à un pié plus bas que le fond, afin qu’elle
fe trouve un peu chargée , pour faire monter le jet
qu’elle fournit. {K)
. Décharge le petit hunier, {Mar.) terme
de commandement qui fe fait lorfqu’on donne vent '
devant, pour ôter le vént de deffus le hunier de
mifene, & le tenir au plus près du vent. (Z )
D É C H A R G E , en Brafferie. Voye^larticle BRASSERIE.
D écharge, {Charp.) eft une piece de bois qui
fe met dans les cloifons qui portent fur les poutres
ou fablieres en diagonale, & fert à foulager la poutre
, &c. & à empêcher qu’elle ne reçoive tout le
■ fardeau, des cloifons ou pans de bois. Voyeç PI. du H H H H j 9BS§B| Déchargé, {Orfèvr.) eft un poinçon qui s’applique
fur les ouvrages d’Orfévrerie, lorfqu’ils font
finis, qui marque qu’ils ont payé les droits impofés
par le Roi fur lefdits ouvrages, & leur en fert de
Tome IV,
quittance. Lorfque l’ouvrage eft encore brut, l’Or-
févre fait fa foûmiflîon au fermier, de la quantité
des pièces qu’il a à faire ; le fermier y fait appofer
un poinçon, qu’on appelle le poinçon de charge, en ce
qu’il charge l’Orfèvre envers le fermier, & le rend
comptable envers lui de toutes les pièces empreintes
de ce poinçon, jufqu’à ce qu’après avoir acquitté les
droits, on y ait appofé celui de décharge.
D é c h a r g e , {Serrur.) c ’e f t , dans u n o u v r a g e en
f e r , -toute p ie c e p o fé e o u h o rifo n ta lem en t o u o b liq
u em e n t , com m e u n e t r a v e r f e , & d e ftiné e à fu p -
p o r te r l ’e ffo r t d e s a u t r e s , & à le s con tenir dans le u r
fitu a t io n .
DECHARGÉ de tête, d'épàule, dé encolure, {Manège.)
Voye^ ces mots à leurs Lettres. {V ) .
DECHARGEMENT, f m. {Mar.) c’eft l’a&ion
de décharger un vaiffeaiu (Z )
DECHARGEOIR, f. m. {îfydraul.) dans une
éclufeil fert à écouler l ’eau de fuperficie ou fuperflue
que le courant d’une riviere ou ruiffeau fournit continuellement
, & qui vient, par le moyen d’une
bufe ou d’un contre-foffé, fe joindre à l’eau qui eft
en-bas, & dont on peut faire encore d’autres ufages.
On.ouvre fouvent la conduite du décliargeoir, par le
moyen d’un moulinet ou d’une bonde placée fur la
fuperficie de la terre. {K)
D e c h a r g e o i r , terme de Tijferandj eft un cylindre
de bois autour duquel l’ouvrier roule la toile
qu’il a faite , & qu’on ôte de deffus la poitriniere.
Voyei M é t i e r d e T i s s e r a n d .
Le dechargeoir eft attaché par les deux bouts à un©
corde qui le tient fufpendii aux traverfes d’en-bas>
de la longueur du métier.
DECHARGER un vaiffeau, {Mar.) c’eft en ôter
les marchandifes. (Z )
D é c h a r g e r les voiles, {Mar.) c’eft ôter le vent
de deffus pour le mettre dedans. (Z )
D é c h a r g e r , terme qui dans le Commerce a 1
divers fens : il lignifie en général donner à quelqu’un
un écrit qui le déclare quitte de quelqu’obligation , dette*
ou autre engagement femblable.
Décharger la feuille d ’un meffager, c’éft la quittancer,
y mettre fon récépiffé des marchandifes, hardes
, ou autres chofes qu’on a reçûes du faêteur ou
commis de la meffagerie.
Décharger fon livre, c’e ft , parmi les marchands ,
négocians & banquiers, rayer de deffus le livre-
journal ou autre regiftre équivalent, les articles deâ
marcfiandifës vendues à crédit, à mefure qu’on ert
reçoit le payement. Outre la rature des articles , il
eft du bon-ordre de les apoftiller, & d’y marquer le
jour qu’ils ont été payés, tant pour l’intérêt des débiteurs,
qui.fans cela pourraient en quelques oeca-
fions courir rifque de payer deux fois, que pour
celui des marchands, à qui,un défaut de mémoire
pourrait donner une réputation de mauvaife fo i, en
répétant une fomme qii’ils auraient déjà reçûe.
Décharger lignifie aufli ôter ou tirer de deffus une
voiture des marchandifes , pour les mettre en magafin ou
dans une boutique. Voyez les diction, de Çomm, de Trév.
& de Chambers. (G)
D é c h a r g e r , v . paf. fe dit en Peinture des couleurs
, lorfqu’elles perdent de leur vivacité. Toutes
les couleurs fe déchargent,, excepté les brunes, qui
noirciffent toûjours en vieilliffant. Les couleurs qui
font faites avec des terres, fe déchargeât moins qué
celles que la Chimie noiis donne, & qui font com-
pofées. On dit : J ’ai fait cette partie de couleur trop
vive; mais elle viendra au ton qui convient, lorfqu'elle
fe fera déchargée. {R) .
DECHARGEUR, f. m. terme de Riviere, officier
de ville qui eft commis fur les ports pour décharger
tes bateaux qui y arrivent.
DÉ CHARGEURS DE VlNS, {Arts & Met.) qua'-
P P p p