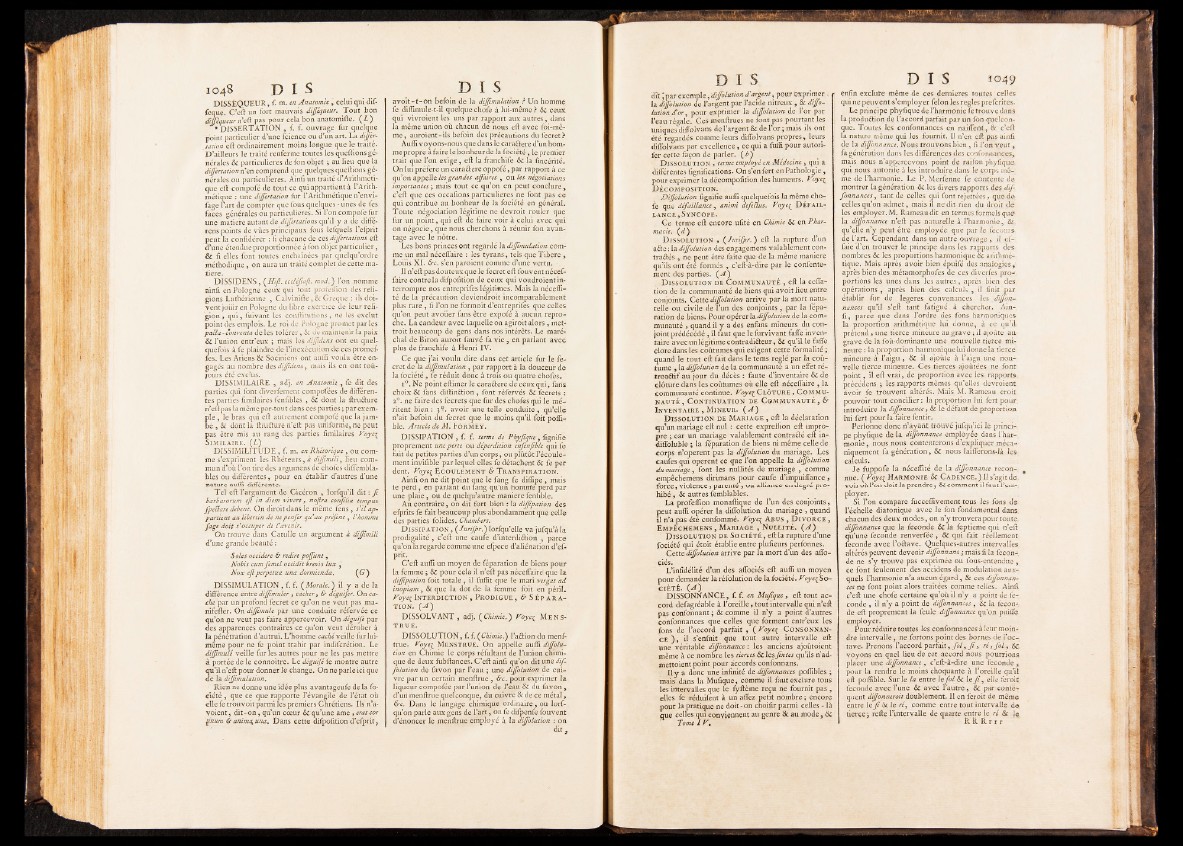
1048 D I S
DISSÉQUEUR, ff m. en Anatomie , celui qui dif-
feque. C’ eft un fort mauvais difféqueur. Tout bon
difféqueur n’eft pas pour cela bon anatomifte. {L )
* DISSERTATION , f. f. ouvrage fur quelque
point particulier d’une fcience ou d’un art. La dijfer-
tadon eft ordinairement moins longue que le traité.
D ’ailleurs le traité renferme toutes les queftions générales
& particulières de fon objet ; au lieu que la
differtation n’en comprend que quelques queftions générales
ou particulières. Ainfi un traité d’Arithmeti-
que eft compofé de tout ce qui appartient à l’Arithmétique
: une dijfertation fur l’Arithmetique n envisage
rart de compter que fous quelques - unes de fes
faces générales ou particulières. Si l’on compofe fur
une matière autant de dijfertations qu’il y a de diffé-
rens points de vûes principaux fous lefquels l’efprit
peut la confidérer : fi chacune de ces dijfertations eft
d’une étendue proportionnée à fon objet particulier,
& fi elles font toutes enchaînées par quelqu’ordre
méthodique, on aura un traite complet de cette matière.
DISSIDENS , {Hijl. eccléjiafl. mod.) l’on nomme
ainfi en Pologne ceux qui tont profeiîion des religions
Luthérienne , Calvinifte,&Greque : ils doivent
jouir en Pologne du libre exercice de leur religion
, qui, fuivant les conllitarionsne les exclut
point des emplois. Le roi de Pologne promet parles
pacla-conventa de les tolérer, & de maintenir la paix
& l’union entr’eux ; mais les dijjidens ont eu quelquefois
à fe plaindre de l’inexécution de ces promef-
fes. Les Ariens & Sociniens ont aufli voulu être engagés
au nombre des dijjidens, mais ils en ont toujours
été exclus.
DISSIMILAIRE , adj. en Anatomie. , fe dit des
parties qui font diverfement compofées de différentes
parties fimilaires fenfibles , & dont la ftruâure
n’eft pas la même par-tout dans ces parties ; par exemple
, le bras qui eft autrement compofé que la jambe
, & dont la ftruâure n’eft pas uniforme, ne peut
pas être mis au rang des parties fimilaires Voye£
S im i l a i r e . (A )
DISSIMILITUDE , f. m. en Rhétorique , ou comme
s’expriment les Rhéteurs, à dijjimili, lieu commun
d’où l’on tire des argumens de chofes diffembla-
bles ou différentes, pour en établir d’autres d’une
nature aufli différente.
Tel eft l’argument de Cicéron , lorfqu’il dit : Ji
barbarorum eji in diem vivere , nojira conjilia tempus
fpeclare debent. On diroitdans le même fens, s'il appartient
au libertin de nepenfer qu'au préfent , l'homme
fage doit s'occuper de l'avenir.
On trouve dans Catulle un argument à dijjimili
d’une grande beauté :
Soles occidere & redire pojfunt,
Nobis cum femel occidit brevis lux ,
Nox ejl perpétua una dormienda. (G )
DISSIMULATION , f. f. {Morale.) il y a de la
différence entre dijjimuler , cacher, & déguifer. On cache
par un profond fecret ce qu’on ne veut pas ma-
nifefter. On dijfimule par une conduite réfervée ce
qu’on ne veut pas faire appercevoir. On déguife par
des apparences contraires ce qu’on veut dérober à
la pénétration d’autrui. L’homme caché veille fur lui-
même pour ne fe point trahir par indifcrétion. Le
djfmulé veille fur les autres pour ne les pas mettre
à portée de le connoître. Le déguifé fe montre autre
qu’il n’eft pour donner le change. On ne parle ici que
de la dijjimulation.
Rien ne donne une idée plus avantageufe de la fo-
ciété , que ce que rapporte l’évangile de l’état où
elle fe trouvoit parmi les premiers Chrétiens. Ils n’a-
voient, d it-on, qu’un coeur & qu’une ame , eratcor
pnum & animOt una. Dans cette difpofition d’efprit,
D I S
avoit-t-on befoin de la dijjimulation ? Un homme
fe diflimule-t-il quelque chofe à lui-même ? & ceux
qui vivroient les uns par rapport aux autres, dans
la même union où chacun de nous eft avec loi-même,
auroient-ils befoin des précautions du fecret?
Aufli voyons-nous que dans le caraâere d’un homme
propre a faire le bonheur de la fociété, le premier
trait que l’on exige, eft la franchife & la fincérité.
On lui préféré un caraâere oppofé, par rapport à ce
qu’on appelle les grandes affaires , ou les négociations
importantes ; mais tout ce qu’on en peut conclure ,
c’eft que ces occafions particulières ne font pas ce
qui contribue au bonheur de la fociété en général.
Toute négociation légitime ne devroit rouler que
fur un point, qui eft de faire voir à celui avec qui
on négocie, que nous cherchons à réunir fon avantage
avec le nôtre.
Les bons princes ont regardé la dijjimulation comme
un mal néceffaire : les tyrans, tels que Tibere ,
Louis X I. &c. s’en paroient comme d’une vertu.
Il n’eft pas douteux que le fecret eft fou vent néceffaire
contre la difpofition de ceux qui voudroient interrompre
nos entreprifes légitimes. Mais la nécefli-
té de la précaution deviendroit incomparablement
plus rare, fi l’on ne formoit d’entreprifes que celles
qu’on peut avouer fans être expofé à aucun reproche.
La candeur avec laquelle on agiroit alors , met-
troit beaucoup de gens dans nos intérêts. Le maréchal
de Biron auroit fauvé fa v ie , en parlant avec
plus de franchife à Henri IV.
Ce que j’ai voulu dire dans cet article fur le fecret
de la dijjimulation , par rapport à la douceur de
la fociété, fe réduit donc à trois ou quatre chofes.
i° .N e point eftimer le caraâere de ceux qui, fans
choix & lans diftinâion , font réfervés & fecrets :
2°. ne faire des fecrets que fur des chofes qui le méritent
bien : 3?. avoir une telle conduite, qu’elle
n’ait befoin du fecret que le moins qu’il foit pofli-
ble. Article de M. ForMEY.
DISSIPATION , f. f. terme de Phyjique, lignifie
proprement une perte ou déperdition infenfible qui fe
fait de petites parties d’un corps, ou plutôt l’écoulement
invifible par lequel elles fe détachent & fe per
dent. Foyer Ecoulement & Transpiration.
Ainfi on ne dit point que le fang fe difîipe , mais
fe perd, en parlant du fang qu’un homnîe perd par
une plaie, ou de quelqu’autre maniéré fenfible.
Au contraire, on dit fort bien : la dijjipation des
efprits fe fait beaucoup plus abondamment que celle
des parties folides. Chambers. Dissipation, {Jurifpr.)lorfqu’elle va jufqu’à la
prodigalité, c’eft une caufe d’interdiétion , parce
qu’on la regarde comme une efpece d’aliénation d’efprit.
C ’eft aufli un moyen de féparation de biens pour
la femme ; & pour cela il n’eft pas néceffaire' que la
dijjipation foit totale , il fuffit que le mari vergat ad
inopiam, & que la dot de la femme foit en péril.
Foye{Interdiction, Prodigue, & Séparation.
(A) DISSOLVANT , adj. {Chimie.) Foye1 Mens-
TRUE.
DISSOLUTION, f .f. {Chimie.) l’aâion du menf-
true. Foye1 Menstrue. On appelle aufli diffolu-
tion en Chimie le corps réfultant de l ’union chimique
de deux fubftances. C ’eft ainfi qu’on dit une dif-
Jolution de favon par l’eau ; une diffolution de cuivre
par un certain menftrue , &c. pour exprimer la
liqueur compofée par l’union de l’eau & du favon,
d’un menftrue quelconque, du cuivre & de ce métal,
&c. Dans le langage chimique ordinaire, ou lorf-
qu’on parle aux gens de l’art, on fe difpenfe fouvent
d’énoncer le menftrue employé à la diffolution : on
D I S
dît 'par exemple, diffolution d'argent, pour exprimer ,
la diffolution de l’argent par l’acide nitreux , & diffolution
Aor, pour exprimer la diffolution de l’or par
l’eau régale. Ces menftrues ne iont pas pourtant les
uniques diffolvans de l’argent & de l’or ; mais ils ont
été regardés comme leurs diffolvans propres > leurs
diffolvans par excellence, ce qui a fuffi pour autori-
fer cette façon de parler. (£ )
D i s s o l u t i o n , terme employé en Médecine > qui a
différentes lignifications. On s’enfert en Pathologie,
pour exprimer la décompofition des humeurs. Foye^
D é c o m p o s i t i o n .
Diffolution fignifie aufli quelquefois la même choie
que défaillance, animi defectus. Voye^ DÉFAILLANCE
, Sy n c o pe ;
Ce terme eft encore ufité en Chimie & en Pharmacie.
{d)
D i s s o l u t i o n , {Jurifpr.) eft la rupture d’un
aâe : la diffolution des engagemens valablement contrariés
, ne peut être faite que de la même maniéré
qu’ils ont été formés , c’eft-à-dire par le confente-
ment des parties. {A )
D i s s o l u t i o n d e C o m m u n a u t é , eft la ceffa-
tion de la communauté de biens qui avoit lieu entre
conjoints. Cette diffolution arrive par la mort naturelle
ou civile de l’un des conjoints , par la fépa-
ration de biens. Pour opérer la diffolution de la communauté
, quand il y a des enfans mineurs du conjoint
prédécédé , il faut que lefurvivant faffe inventaire
avec un légitime contradifteur, & qu’il le faffe
clore dans les coutumes qui exigent cette formalité ;
quand le tout eft fait dans le tems réglé par la coutume
, la diffolution de la communauté a un effet rétroactif
au jour du décès : faute d’inventaire & de
clôture dans les coûtumes où elle eft néceffaire , la
communauté continue. Foye^ C l ô t u r e , C o m m u n
a u t é , C o n t i n u a t i o n d e C o m m u n a u t é , 6*
I n v e n t a i r e , M in e u r . {A )
D i s s o l u t i o n d e M a r i a g e , eft la déclaration
qu’un mariage eft nul : cette expreflîon eft impropre
; car un mariage valablement contracté eft in-
diffohible ; la féparation de biens ni même celle de
corps n’operent pas la diffolution du mariage. Les
caufes qui opèrent ce que l’on appelle la diffolution
du mariage, font les nullités de mariage , comme
empêchemens dirimans pour caufe d’impuiffance,
force, violence, parenté, ou alliance en degré prohibé
, & autres femblables.
La profeflion monaftique de l’un des conjoints,
peut aufli opérer la diffolution du mariage, quand
il n’a pas été confommé. Foyeç A b u s , D i v o r c e ,
E m p ê c h e m e n s , M a r i a g e , N u l l i t é . {A)
D i s s o l u t i o n d e S o c i é t é , eft la rupture d’une
fociété qui étoit établie entre plufieurs perfonnes.
C e t t e diffolution a r r iv e p a r l a m o r t d ’u n d e s a f fo -
ç ié s .
L ’ in fid é lité d’u n d e s a ffo c ié s e ft a u fli u n m o y e n
p o u r d em an d er la r é fo lu t io n d e la f o c ié té . Voye^So-
C IÉ T É . {A)
DISSONNANCE, f. f . en Mujique , e f t to u t a c c
o r d d e fa g ré a b le à l’ o r e i l l e , to u t in te r v a lle q u i n ’e ft
p a s co n fo n n a n t ; & com m e i l n ’ y a p o in t d ’a u t r e s
c o n fo n n a n c e s q u e c e lle s q u e fo rm e n t e n t r ’e u x le s
fo n s d e l ’ a c c o r d p a r fa i t , ( F oyeç C o n s o n n a n -
c e ) , i l s ’en fu it q u e t o u t a u t r e in te r v a lle e ft
u n e v é r i ta b le diffonnance : le s an c ie n s a jo û to ie n t
m êm e à c e n om b re le s tierces & le s Jixtes q u ’ils n ’ad-
m e t to ie n t p o in t p o u r a c co rd s co n fo n n a n s .
Il y a d o n c u n e in fin ité d e diffonnances p o flib le s ;
m a is dan s l a M u f iq u e , com m e i l fa u t e x c lu r e to u s
le s ir ite r v a lle s q u e le f y f t èm e r e ç u n e fo u rn it pas
e lle s f e r éd u ifen t à u n a ffe z p e t it nom b re ; e n co r
p o u r la p ra tiq u e ne d o i t - o n ch o ifir p a rm i c e lle s - là
q u e c e lle s q u i c o n v ie n n e n t a u g en re & a u m o d e , &
Tome I F .
D I S 1049
enfin exclure même de ces demieres toutes celles
qui ne peuvent-s’employer félon les réglés prefcritcs.
Le principe phyfique de l’harmonie le trouve dans
la produâion de l’accord parfait par un fon quelconque.
Toutes, les confonnances en naiffent, & c’eft
la nature même qui les fournit. Il n’en eft pas ainfi.
de la diffonnance. Nous trouvons bien, fi l’on veut ,
fa génération dans les différences des confonnances,
mais nous n’appercevons point de raifon phyfique,
qui nous autorife à les introduire dans le corps même
de l’harmonie. Le P. Merfenne fe contente de
montrer la génération & les divers rapports des diffonnances
, tant de celles qui font rejettées , que de
celles qu’on admet, mais il ne dit rien du droit dé
les employer. M. Rameau dit en termes formels que'1
la diffonnance n’eft pas naturelle à l’harmonie, &.
qu’elle n’y peut être employée que par le fecours-
de l ’art. Cependant dans un autre ouvrage , il el-
faie cl’cn trouver le principe dans les rapports des
nombres & les proportions harmonique & arithmé-,
tique. Mais après avoir bien épuifé des analogies $!
après bien des métamorphofes de ces diverfes proportions
les unes dans les autres, après bien des
opérations , après bien des calculs , il finit par
établir fur de legeres convenances les diffonnances
qu’il s’eft tant fatigué. à chercher. Ainfi
, parce que dans l’ordre des fons harmoniques
la proportion arithmétique lui donne, à ce qu’il
prétend, une tierce mineure au grave ; il ajoute ait
grave de la fou-dominante une nouvelle tierce mineure
: la proportion harmonique lui donne la tiercé
mineure à l’aigu , & il ajoute à l’aigu une nouvelle
tierce mineure. Ces tierces ajoûtées ne font
point, il eft vrai, de proportion avec les rapports,
précédens ; les rapports mêmes qu’elles devroient
avoir fe trouvent altérés. Mais M. Rameau croit
pouvoir tout concilier : la proportion lui fert pour,
introduire la diffonnance, & le défaut de proportion
lui fert pour la faire fentir.
Perfonne donc n’ayant trouvé jufqu’ici le principe
phyfique de la diffonnance employée dans l’har-,
monie, nous nous contenterons d’expliquer mécaniquement
fa génération, & nous laifferons-là les
calculs.
Je fuppofe la néceflité de la diffonnance reconnue.
( Foye[ H a r m o n i e & C a d e n c e . ) II s’agit dé.
voir où l’on doit la prendre, & comment il faut l’em-,
ployer.
Si l’on compare fucceflivement tous les fons de
l’échelle diatonique avec le fon fondamental dans
chacun des deux modes, on n’y trouvera pour toute
diffonnance que la fécondé & la feptieme qui n’eft
qu’une fécondé renverfée, & qui fait réellement
fécondé avec l’oftave. Quelques-autres intervalles
altérés peuvent devenir diffonnans ; mais fi la fecon-,
de ne s’y trouve pas exprimée ou fous-entendue ,
ce font feulement des accidens de modulation aux-*
quels l ’harmonie n’a aucun égard, & ces diffonnances
ne font point alors traitées comme telles. Ainfi
c’eft une chofe certaine qu’où il n’y a point de fécondé
, il n’y a point de diffonnances , & la fecon-,
de eft proprement la feule diffonnance qu’on puiffe
employer.
Pour réduire toutes les confonnances à leur moindre
intervalle, ne fortons point des bornes de l’octave.
Prenons l’accord parfait, f o f J i s ré, fol,, &c
voyons en quel lieu de cet accord nous pourrions
placer une diffonnance, c’eft-à-dire une fécondé ,
pour la rendre le moins choquante à l’oreille qu’il
eft poflible. Sur le la entre le fo l & 1 ej î , elle feroit
fécondé avec l’une & avec l’autre, & par confé*
quent dijfonneroit doublement. Il en feroit de même
entre ley? & le ré, comme entre tout intervalle de
tierce ; refte l’intervalle de quarte entre le ré & le
R R R r r r
■