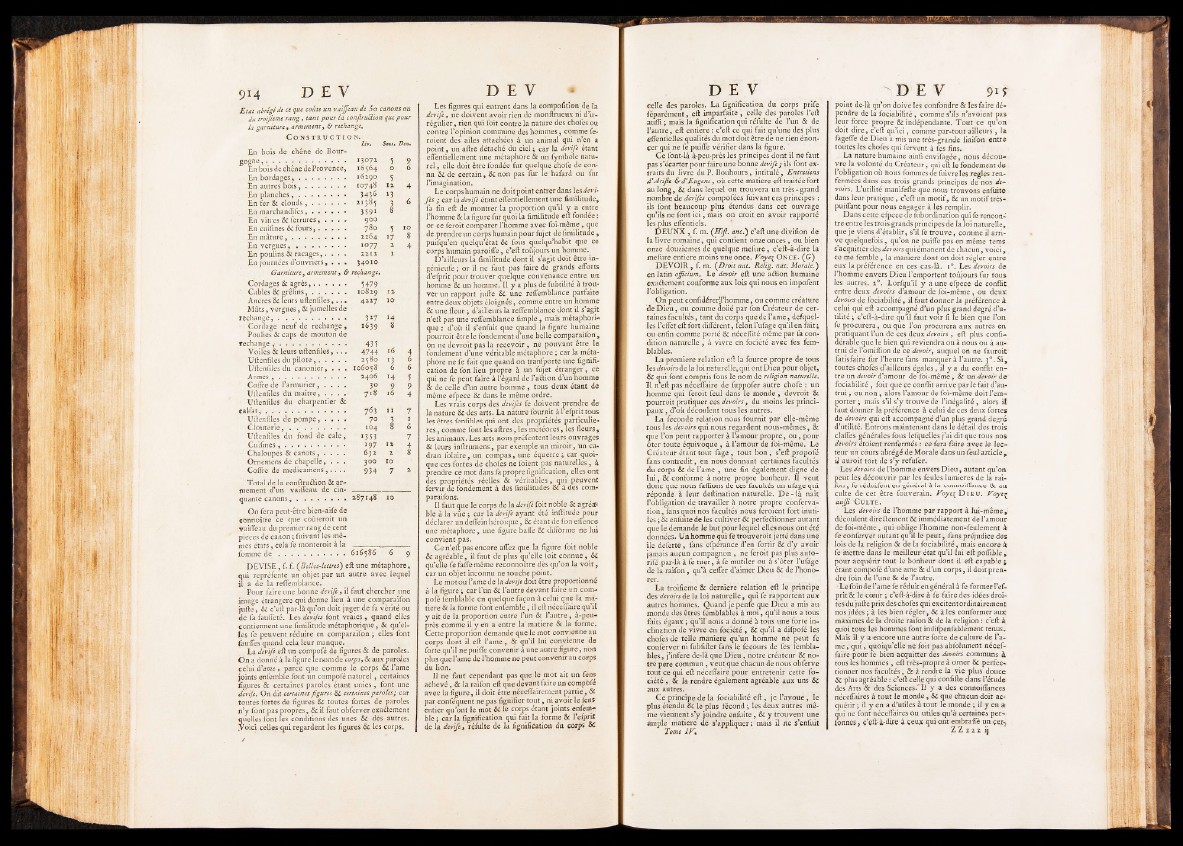
9M D E V
Etat abrégé de ce que coûte un vaijfeau de 60 canons ou
du tro 'tjteme rang, tant pour la conflruclion que pour
la garniture, armement, & rechange.
C o n s t r u c t i o n .
Liv. S$us. Den.
En bois de chêne de Bourfiogne,
13072 5 9 En bois de chêne de Provence, 16564 O 6
En borda g es ,......................... 16290 5 En autres bois, ..................... 10748 12 4 - En planches, .............. ... 343$ 13 En fer & clouds m m 11385 3 6
En marchandifes 35 91 8
Én vitres & ferrures, . . . . 900
En cuifines 8c fours, ............... 780 5 10
En mâture, . ......................1 2264 *7 8
En vergues, . . . . . . . . 1077 2 4 En poulins & racages, . . . . 2212 i
En journées d’ouvriers, . . . 34010
Garniture, armement, & rechange.
Cordages & agrès, ................. 5479 i Câbles & grêlins, . . . . . . 10829 12
Ancres 8c leurs uftenfiles, . . .
Mâts, vergues, & jumelles de
rechange, . . . . . . . . . . .
4227 10
3*7 14
• Cordage neuf de rechange , 1639 8
Poulies & caps de mouton de
rechange .................................... 435
Voiles & leurs uftenfiles , . . . 4744 16 4 Uftenfiles du pilote, . . . . . 2580 13 6
Uftenfiles du canonier, . . B 106058 6 6
Armes . . . . . . . 2406 M 5
Coffre de l’armurier, . . . . 30 9 9 Uftenfiles du maître, . . . . 718 16 4 Uftenfiles du charpentier &
calfat, .......................................... 7« 3 11 7 Uftenfiles de pompe, . . . . 7O 3 i
Clouterie, .............................. IO4 8 6
Uftenfiles du fond de cale, >139537 7 12 4 632 . 2 8
Ornemens de chapelle, . . . 300 10
Coffre de medicamens, . . .. 934 7 2
Total de la conftruâion & armement
d?un vaiffeau de cinquante
canons , ...................... .
On fera peut-être bien-aile de
eorinoître ce que coûterait un
yaifféau du premier rang de cent
pièges de canon ; fuivant les mêmes
états, cela fe monteroit à la
lomme d e ............................
287148 10
616586 6 9
DEVISE, f. f. (Belles-lettres) eft une métaphore,
qui repréfente un objet par un autre avec lequel
il a de la reffemblance.
Pour faire une bonne devife , il faut chercher une
image étrangère qui donne lieu à une comparaifon
jufte, 8c c’eft par-là qu’on doit juger de fa vérité ou
de fa fauffeté. Les devifes font vraies , quand elles
contiennent une fimilitude métaphorique, & qu’elles
fe peuvent réduire en comparaifon ; elles font
faillies quand cela leur manque.,
La devife eft un compofé de ligures & de paroles.
On a donne à la ligure le nom de corps, & aux paroles
celui d’ame ,. parce que comme le corps 8c l’ame
joints enfemble font un compofé naturel, certaines
figures & certaines paroles étant unies, font une
devife. On dit certaines figures 8c certaines paroles; car
toutes fortes de ligures 8c toutes fortes de paroles
n’y font pas propres, 8c il faut obferver exactement
quelles font les conditions des unes 8c dés autres.
Voici celles qui regardent les ligures 8c les corps.
D E V
Les ligures qui entrent dans la compofition de la
devife, ne doivent avoir rien de monftrueux ni d’irrégulier
, rien qui foit contre la nature des chofes ou
contre l’opinion commune des hommes, comme feraient
des ailes attachées à un animal qui n’en a
point, un aftre détaché du ciel ; car la devife étant
effentiellement une métaphore & un fynibole naturel
, elle doit être fondée fur quelque chofe de connu
8c de certain, 8c non pas fur le hafard ou fur
l’imagination.
Le corps humain ne doit point entrer dans les devi*
Jes ; car la devife étant elTentiellement une limilitude,
fa fin eft de montrer la proportion qu’il y a entre
l’homme & la figure fur quoi la limilitude eft fondée :
or ce ferait comparer l’homme avec foi-même, que
de prendre un corps humain pour fujet de limilitude ,
puifqu’en quelqu’état 8c fous qüelqu’habit que ce
corps humain paroiffe, c’eft toujours un homme.
D ’ailleurs la limilitude dont il s’agit doit être in-
génieufe ; or il ne faut pas faire de grands efforts
d’efprit pour trouver quelque convenance entre un
homme 8c un homme. Il y a plus de fubtilité à trouver
un rapport jufte 8c une reffemblance parfaite
entre deux objets éloignés, comme entre un homme
8c une fleur- ; d’ailleurs la reffemblance dont il s’agit
n’eft pas une reffemblance fimple, mais métaphorique
: d’oii il s’enfuit que quand la figure humaine
pourrait être le fondement d’une belle comparaifon ,
on ne devrait pas la recevoir, ne pouvant être le
fondement d’une véritable métaphore ; car la métaphore
ne fe fait que quand on tranfporte une lignification
de fon lieu propre à un fujet étranger, ce
qui ne fe peut faire à l’égard de l’a&ion d’un homme
& de celle d’un autre homme ,■ tous deux étant dé
même efpece 8c dans le même ordre.
Les vrais corps des devifes fe doivent prendre de
la nature 8c des arts. La nature fournit à l’efprit tous
les êtres fenfibles qui ont des propriétés particulières
, comme font les aftres, les météores, les fleurs *
les animaux. Les arts nous préfentent leurs ouvrages
& leurs inftrumens, par exemple un miroir, un cadran
folair.e, un compas, une équerre ; car quoique
ces fortes de chofes ne foient pas naturelles, à
prendre ce mot dans fa propre lignification, elles Ont
des propriétés réelles & véritables, qui peuvent
fervir de fondement à des limilitudes 8c à des com-
paraifons.
Il faut que .le corps de la devife foit noble & agréa2
ble à la vûe ; car la devife ayant été inftituée pour
déclarer un deffein héroïque, Si étant de fon effence
une métaphore, une figure baffe 8c difforme ne lui
convient pas.
Ce n’eft pas encore affez que. la figure foit noble
& agréable, il faut de plus qu’elle loit connue , 8c
qu’elle fe faffe même reconnoître dès qu’on la v o it ,
car un objet inconnu ne touche point.
Le mot ou l’ame de la devije doit être proportionné
à la figure ; car l’un 8c l’autre devant faire un compofé
femblable en quelque façon à celui que la matière
& la forme font enfemble, il eft néceffaire qu’il
y ait de la proportion entre l’un & l’autre , à-peu-
près comme il y en a entre la' matière & la forme.
Cette proportion demande que le mot convienne au
corps dont il eft l’ame, & qu’il lui convienne de
forte qu’il nepuiffe convenir à une autre figure, non
plus que l’ame de l’homme ne peut convenir au corps
du lion.
Il rie faut cependant pas que le mot ait un fens
achevé, & la raifon eft que devant faire un compôfe
avec la figure, il doit être néceffairement partie , &
par conféquent ne pas fignifier tout, ni avoir le fens-
entier qu’ont le mot & le corps étant joints enfemble
; car la fignification qui fait la forme & l’efprit
de la devife, réfulte de la fignification du corps 8c
D E Y
celle des paroles. La fignification du corps prife
féparement, eft imparfaite , celle des paroles l’eft
aufli ; mais la fignification qui réfulte de l’un & de
l’autre, eft entière : c’eft ce qui fait qu’une dçs plus
effentielles qualités du mot doit être de ne rien énoncer
qui ne fe puiffe vérifier dans la figure. '
Ce font-là à-peu-près les principes dont il ne faut
pas s’écarter pour faire une bonne devife ; ils font extraits
du livre du P. Bouhours, intitulé, Entretiens
d’A rifle & d'Eugene, où cette matière eft traitée fort
au long, 8c dans lequel on trouvera un très-grand
nombre de devifes compofées fuivant ces principes :
ils font beaucoup plus étendus dans cet ouvrage
qu’ils ne font ic i , mais on croit en avoir rapporté
les plus effentiels.
DEUNX , f. m. ( Hifl. ancl) c’eft une divifion de
la livre romaine, qui contient onze onces, ou bien
onze douzièmes de quelque mefure, c’eft-à-dire la
mefure entière moins une once. Voye^ Onc e. (G)
DEVOIR , f. m. (Droit nat. Relig. nat. Morale.)
en latin officium. Le devoir eft une a&ion humaine
exactement conforme aux lois qui nous en impofent
l’ôbligation.
On peut conlidérerH’homme, ou comme créature
de D ieu, ou comme doiié par ion Créateur de certaines
facultés, tant du corps que de l’ame, defquel-
les l’effet eft fort différent, félon l’ufage qu’il en fait ;
ou enfin comme porté & nécefîité même par fa condition
naturelle , à vivre en fociété avec fes fem-
blables.
La première relation eft la fource propre de tous
les devoirs de la loi naturelle, qui ont Dieu pour objet,
8c qui font compris fous le nom de religion naturelle.
Il n’eft pas néceffaire de fuppofer autre chofe : un
homme qui ferait feul dans le monde , devrait &
pourrait pratiquer ces devoirs, du moins les principaux
, d’où découlent tous les autres.
La fécondé relation nous fournit par èlle-même
tous les devoirs qui nous regardent nous-mêmes, &
que l’on peut rapporter à l’amour propre, o u , pour
ôter toute équivoque , à l’amour de loi-même. Le
Créateur étant tout fage, tout bon, s’eft propofé
fans contredit, en nous donnant certaines facultés
du corps 8c de l’ame , une fin également digne de
lu i, 8c conforme à notre propre bonheur. Il veut
donc que nous faflions de ces facultés un ufage qui
réponde à leur deftination naturelle. D é - là naît'
l’obligation de travailler à notre propre conferva-
tion, fans quoi nos facultés nous feraient fort inutiles
; 8c énfuite de les cultiver 6c perfectionner autant
que le demande le but pour lequel elles nous ont été
données. Un homme qui fe trouverait jette dans une
île deferte, fans efpérance d’en fortir 8c d’y avoir
jamais auçun compagnon , ne ferait pas plus aiifo-
rifé.par-là à fe tuer, à fe mutiler ou à s’ôter l’ufage
de la raifon, qu’à ceffer d’aimer Dieu 8c de l’hono-
rer.L
a troifieme & derniere relation eft le principe
des devoirs de la loi naturelle, qui fe rapportent aux
autres hommes. Quand je penfe que Dieu a mis au
monde dès êtres fembtables à moi, qu’il nous a tous
faits égaux ; qu’il'nous^"a' donné à tous une forte inclination
de vivre en fociété , & qu’il a difpofé les
chpfes de telle maniéré qu’un homme ne peut fe
conferver ni fubfifter fans le fecours de fes fembla-
bles, j’infere de-là que D ieu , notre créateur 8c notre
pere commun, veut que chacun de nous obferve
tout ce qui eft néceffaire pour entretenir cette fociété
, & la rendre également agréable aux uns &
aux autres.
Ce principe de la fociabilité e f t , je l’avoue , le
plus éténdù 8c le plus fécond ; les deux autres même
viennent s’y joindre ehfuite, 8c y trouvent une
ample matière dé s’appliquer; mais il de s’enfuit
Tome IV%
' D E V m
point de-là qu’on doive les confondre & les faire dépendre
de la fociabilité, comme s’ils n’avoient pas
leur force propre & indépendante. Tout ce qu’on
doit dire, c’eft qu’ic i, comme par-tout ailleurs , la
fageffe de Dieu a mis une très-grande liaifon entre
toutes les chofes qui fervent à fes fins.
La nature humaine ainfi envifagée, nous découvre
la volonté du Créateur, qui eu le fondement de
1 obligation où hous fommes de fuivre les réglés renfermées
dans ces trois grands principes de nos devoirs.
L’utilité manifefte que nous trouvons enfuite
dans leur pratique, c’eft un motif, & un motif très-
puiffant pour nous engager à les remplir.
Dans cette efpece de ftibordination qui fe rencontre
entre les trois grands principes de la loi naturelle,
que je viens d’établir, s’il fe trouve, comme il arrive
quelquefois, qu’on ne puiffe pas en même tems
s’acquitter des devoirs qui émanent de chacun, voici,
ce me femble, la maniéré dont on doit régler entre
eux la préférence en ces cas-là. i°. Les devoirs de
l’homme envers Dieu l’emportent toûjours fur tous
les autres. 20. Lorfqu’il y a une efpece de conflit
entre deux devoirs d’amour de foi-même , ou deux
devoirs de fociabilité, il faut donner la préférence à
celui qui eft accompagné d’un plus grand degré d’utilité
; c’eft-à-dire qu’il faut voir fi le bien que l’on
fe procurera, ou que l’on procurera aux autres en
pratiquant l’un de ces deux devoirs , eft plus confi-
dérable que le bien qui reviendra ou à nous ou à autrui
de l’omiflion de ce devoir, auquel on ne fauroit
fatisfaire fur l’heure fans manquer à l’autre. 30. S i,
toutes chofes d’ailleurs égales, il y a du conflit entre
un devoir d’amour de foi-même, & un devoir de
fociabilité , foit qué ce conflit arrive parle fait d’autrui
, ou non, alors l’amour de foi-même doit l’emporter
; mais s’il s’y trouve de l’inégalité , alors il
faut donner la préférence à celui de ces deux fortes1
de devoirs qui eft accompagné d’un plus grand degré
d’utilité. Entrons maintenant dans le détail des trois
clàffes générales fous lefquelles j’ai dit que tous nos
devoirs'étùlent renfermés : ee fera faire avec le lecteur
un côiirs abrégé de Morale dans un feul article ,
il aûrpit tort de s’y refufer.
Les devoirs de l’homme envers Dieu, autant qu’on
peut les découvrir par les feules lumières de la raifon,
fe réduifent en général à la connoiffance & au
culte de cet être fouverain. Foye^ D ie u . Foyer
auffi 'C u l t e .
■ Les devoirs de l’homme par rapport à lui-même %
découlent directement 8c immédiatement de l’amour
de foi-même , qui oblige l’homme non-feulement à
fé conferver autant qu’il le peut, fans préjudice des
lois de la religion & de la fociabilité, mais encore à
fe mettre dans le meilleur état qu’il lui eft poflible ,
pour acquérir tout le bonheur dont il eft capable ;
étant compofé d’une ame & d’un corps, il doit pren-
dfè foin de l’une & de l’autre.
Le foin de l’ame fe réduit en général à fe former l’ef-
prit & le coeur ; c’ëft-à:dire à fe faire des idées droites
du jufte prix des chofes qui excitent ordinairement
nos idées ; à les bien régler -, 8c à les conformer aux
maximes de là droite raifon & de la religion : c’eft à
quoi tous les hommes font indifpenfablement tenus.
Mais il: y a encore une autre forte de culture de l’a-
me, qui, 'quoiqu’elle ne foit pas abfolument néceffaire
pour le bien acquitter des devoirs communs à
tous les hommes , eft très-propre à orner 8c perfectionner
nos facultés, & à rendre la vie plus douce
8c plus agréable : c’eft celle qui conlifte dans l’étude
des Arts & des Sciences^! y a des connoiffances
néceffaires à tout le monde, & que chacun doit acquérir
; il y en a d’utiles à tout le monde ; il y en a
qui ne font néceffaires ou utiles qu’à certaines personnes
> c’eft'à-dire à ceux qui ont embraffé un çer^