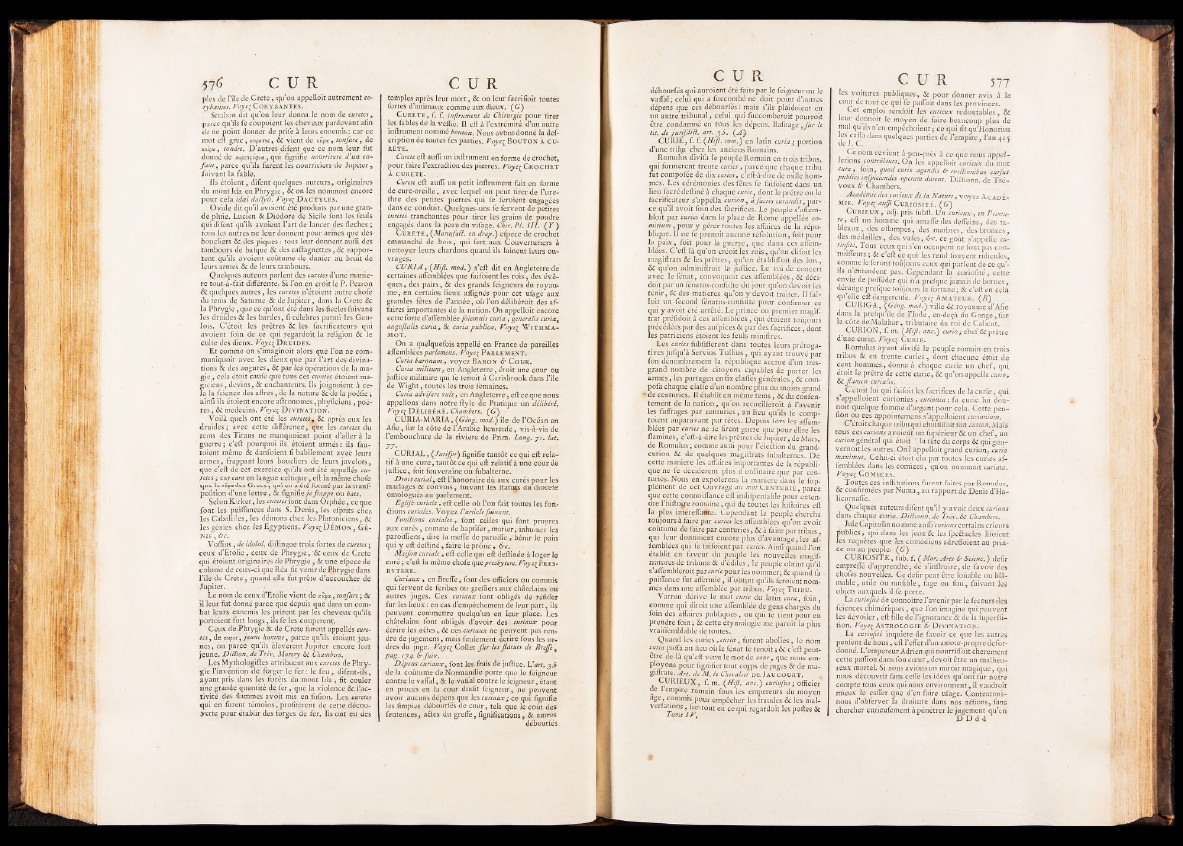
pies de l’île de Crete, qu’on appelloit autrement co-
rybantes. Foye^ CORYBANTES.
Strabon dit qu’on leur donna le nom de curetes,
parce qu’ils fe coupoient les cheveux pardevant afin
de ne point donner de prife à leurs ennemis : car ce
mot eft grec, xapunc, & vient'de « :Sp» , tonfure, de
xtipa, tondre. Dmitres difent que ce nom leur fut
donné de Knporpoip/ct, qui lignifie nourriture d'un enfant,
parce qu’ils furent les nourriciers de Jupiter,
fuivant la fable.
Ils étoient, difent quelques auteurs, originaires
du mont Ida en Phrygie, & on les nommoit encore
pour cela idai dacfyli. Foyei D a c t y l e s .
Ovide dit qu’il avoient été produits par une grande
pluie. Lucien & Diodore de Sicile font les feuls
qui difent qu’ils avoient l’ art de lancer des fléchés ;
tous les autres ne leur donnent pour armes que dés
boucliers 6c des piques : tous leur donnent aufli des
tambours de bafque & des caftagnettes, & rapportent
qu’ils ayoient coutume de danfer au bruit de.
leurs armes 6c de leurs tambours.
Quelques auteurs parlent des curetes d’une maniéré
tout-à-fait différente. Si l’on en croit le P. Pezron
& quelques, autres, les curetes n’étoient autre chofe
du tems de Saturne 8c de Jupiter, dans la Crete 6c
la Phrygie ,que ce qu’ont été dans les fiecles fuivans
les druides 8c les bardes, fi célébrés parmi les. Gaulois.,
C ’étoit les prêtres 6c les facrificateurs qui
avoient foin de ce qui regardoit la religion 6c le
culte des dieux. Foye^ D ruides.
Et comme on s’imaginoit alors que l’on ne com-
mumquoit avec les dieux que par l’art des divinations
8c des augures, 6c par les opérations de la mag
ie , cela étoit caufe que tous ces curetes étoient magiciens,
devins, 8c enchanteurs. Ils joignoient à cela
la fcience des aftres, de la nature 6c de la poéfie ;
ainfi ils étoient encore aftronomes, phyficiens, poètes
, 6c médecins. Foye{ D iv in a t io n .
Voilà quels ont été les curetes9 6c après eux les
druides; avec cette différence y que lestcuretes du
tems des Titans ne manquoient point d’aller à la
guerre; c’eft pourquoi ils étoient armés: ils fau-
toient même 6c danfoient fi habilement avec leurs
armes,, frappant leurs boucliers de leurs javelots,
que c’eft de cet exercice qu’ils ont été appellés cu-
yetes ; car euro en langue celtique, eft la même chofe
que le *5pw des Grecs, qui en a été formé par la tranf-
pofition d’une lettre, 6c fignifie je frappe ou bats.
Selon Kirker j les curetes font dans Orphée, ce que
font les puiffances dans S. Denis, les efprits chez
les Cabaliftes, les démons chez les Platoniciens, 6c
les génies chez les Egyptiens. Foye{ DÉ MON, Gén
ie , «Sv.
Voflîus, de idolol. diftingue trois fortes de curetes ;
ceux d’Etolie, ceux de Phrygie, & ceux de Crete
qui étoient originaires de Phrygie, 8c une èfpece de
colonie de ceux-ci que Réa fit venir de Phrygie dans
l ’île de Crete, quand elle fut prête d’accoucher de
Jupiter..
Le nom de ceux d’Etolie vient de y.Spa, tonfure ; 8c
il leur fut donné parce que depuis que dans un combat
leurs ennemis les prirent par les cheveux qu’ils
portôient fort longs, ils fe les coupèrent.
Ceux de Phrygie 8c de Crete furent appellés curetes,
de y-upoç, jeune homme, parce qu’ils étoient jeunes,
ou parce qu’ils ëleverent Jupiter encore fort
jeune. Diction, de Trév. Morery 6c Chambers.
Les Mythologiftes attribuent aux curetes de Phrygie
l’invention de forger le fer : le feu , difent-ils,
ayant pris dans les forêts du mont Ida, fit couler
une grande quantité de fer, que la violence & l’activité
des flammes avoir mis en fufion. Les curetes
qui en furent témoins i profitèrent de cette décou-
yerte pour établir des forges de fer. Iis ont eu des
temples après leur mort, & oh leur facrifioit toutes
fortes d’animaux comme aux dieux. (G)
C u rete, f. f. injlrumeht de Chirurgie pour tirer
les fables de la veffie. Il eft à l’extrémité d’un autre
infiniment nommé bouton. Nous avons donné la def-
cription de toutes fes parties. Voye{ Bouton à curete.
Curete eft aufli un infiniment en forme de crochet,
pour faire l’extraftion des pierres. Foyer C rochet
À CURETE.
Curete eft aufli un petit infiniment fait en forme
de cure-oreille, avec lequel on peut tirer de l’ure-
thre des petites pierres qui fe feroient engagées
dans ce conduit. Quelques-uns fe fervent de petites
curetes tranchantes pour tirer les grains de poudre
engagés dans la peau du vifage. Chir. PI. III. ( T )
C u rete, (Manufact. en drapj) efpece de crochet
emmanché de bois, qui fert aux Couverturiers à
nettoyer leurs chardons quand ils lainent leurs ouvrages.
CU R IA , (Hijl. mod. ) s’eft dit en Angleterre de
certaines aflemblées que faifoient les rois, des évêques
, des pairs, 6c des grands feigneurs du royaume,
en certains lieux aflignés pour cet ufage aux
grandes fêtes de l’année, où l’on délibéroit des a f faires
importantes de la nation. On appelloit encore
cette forte d’affemblée folemnis curia, generalis curia%
auguflalis curia, 8c curia publica« Foyeç W lT H M A -
M O T .
On a quelquefois appellé en France de pareilles
aflembléesparlemens. Foyeç PARLEMENT*
Curia baronum., voyez Baron & COUR.
Curia militum, en Angleterre, étoit une cotir ou
juftice militaire qui fe tenoit à Carisbrook dans l’île
de "Wight, toutes les trois femaines*
Curia advifare vult, en Angleterre, eft ce que nous
appelions dans notre ftyle de Pratique un délibéré.
D É L IB É R É . Chambers. (G )
CURIA-MARIA, ( Géog. mod.y île de l’Océan en
Afie, fur la côte de l’Arabie heureufe, vis-à-vis de
l’embouchure de la riviere de Prim. Long. y i. lac.
77-C
URIAL, fJurifpry fignifie tantôt ce qui eft relatif
à une cure, tantôt ce qui eft relatif à une cour de
juftice, foit fouVeraine ou fubalterne.
Droit curial, eft l’honoraire dû aux curés pour les
mariages 6c convois, fuivant les ftatugis du diocefe
omologués au parlement.
Eglifer-curiale, eft celle où i’on fait toutes les fondions
curiales. Voyez l'article fuivant.
Fonctions curiales, font celles qui font propres
aux curés, comme de baptifer, marier, inhumer les
paroiflîens, dire la meffe de paroiffe , bénir le pain
qui y eft deftiné, faire le prône , &c.
Maifon curiale, eft celle qui eft deftinée à loger le
curé ; c’eft la même chofe que presbytère, Presb
y tère.
Curiaux, en Breffe, font des officiers ou commis
qui fervent de feribes ou greffiers aux châtelains on
autres juges. Ces curiaux font obligés de réfider
fur les lieux : en cas d’empêchement de leur part, ils
peuvent commettre quelqu’un en leur place. Les
châtelains font obligés d’avoir des curiaux pour
écrire les a&es, 6c ces curiaux ne peuvent pas rendre
de jugemens, mais feulement écrire fous les ordres
du juge. Foye^ Collet fur les Jiatuts de Breffe ,
Paë- ‘74 & f ‘ûv. .
Dépens curiaux , font les frais dé juftice. L'art. g S
de la coutume de Normandie porte que le feigneur
contre le vaffal, & le vaffal contre le feigneur, étant
en procès en la cour dudit feigneur, ne peuvent
avoir aucuns dépens que les curiaux ; ce qui fignifie
les fimples débourfés de cour, tels que le coût des
fentences, aéles du greffe , lignifications, & autres
débourfés
débourfés qui auroient été faits par le feigneur ou le
vaffal ; celui qui a fuccombé ne doit point d’autres
dépens que ces débourfés : mais s’ils plaidoient en
tin autre tribunal, celui qui fuccomberoit pourroit
être condamné en tous les dépens. Bafnage ,J'ur le
tit. de jurifdicl. art. $5. (Ay
CURIE, f. f. (Hiß. rom.y en latin curia; portion
d’une tribut chez les anciens Romains.
Romuliis divifa le peuple Romain en trois tribus,
qui formèrent trente curies, parce que chaque tribu
fut compofée de dix curies, c’eft-à-dire de mille hommes.
Les cérémonies des fêtes fe faifoient dans un
lieu facré deftiné à chaque curie, dont le prêtre ou,1e
facrificateur s’appella curion, à facris curandis, par-/ <
ce qu’il avoit foin des facrifîces. Le peuple s’affem-
bloit par curies dans la place de Rome appellée co-
mitium, pour y gérer toutes les affaires de la république.
Il ne fe prenoit aucune réfolution, foit pour
la paix, foit pour la guerre, que dans ces aflèm-
blées. C ’eft là qu’on créoitles rois, qu’on élifoit les.
rnagiftrats & les prêtres, qu’on établiffoit des lois,
& qu’on adminifiroit la juftice. Le roi de concert
avec le fénat, convoquoit ces aflemblées, & déci-
doit par un fénatus-confultedu jour qu’on devoit les
tenir, & des matières qu’on y devoit traiter. Il falloir
un fécond fénatus-confuite pour confirmer ce
qui y avoit été arrêté. Le prince ou premier magif-
trat préfidoit à ces aflemblées, qui étoient toujours
précédées par des aufpices & par des facrifîces, dont
les patriciens étoient les feuls miniftres.
Les curiesfubfifterent dans toutes leurs prérogatives
jufqu’à Servius Tullius , qui ayant trouvé par
fon dénombrement la république accrue d’un très-
grand nombre de citoyens capables de porter les
armes, les partagea en fix clafles générales, 6c com-
pofa chaque clafiè d’un nombre plus ou moins grand
» de centuries. Il établit en même tems, & du confen-
tement de la nation, qu’on recueilleroit à l’avenir
les fuffrages par centuries, au lieu qu’ils fe comp-
toient auparavant par têtes. Depuis lors les affem-
blées par curies ne fe firent guere que pour élire les
flamines, c’eft-à-dire les prêtres de Jupiter, de Mars,
de Romulus ; comme auiii pour l’éleètion du grand-
curion & de quelques rnagiftrats fubalternes. De
cette maniéré lés affaires importantes de la république
ne fe décidèrent plus .d'ordinaire que par centuries.
Nous en expoferons la maniéré dans le fup-
plément de cet Quvrage au mot C enturie, parce
que cette connoiffance eft indifpenfable pour entendre
rhiftoÿ-e romaine, qui de toutes les hiftoires eft
la plus intéreffa#te. Cependant le peuple chercha
toujours, à faire par curies les aflemblées qu’on avoit
coutume de faire par centuries, & à faire par tribus
qui leur donnoient encore plus d’avantage les aflemblées
qui fe faifoient par curies. Ainfi quand l’on
établit en faveur du peuple les nouvelles marif-
tratures de tribuns & d’édiles, le peuple obtint qu’il
s’aflèmbleroit par curie pour les nommer; & quand fa
puiffance fut affermie, il'obtint qu’ils feroient nommés
dans une affemblée par tribus. Foye? T ribu.
Varron dérive le mot curie du latin cura,Toin,
comme qui diroit une affemblée de gens chargés du
foin des affaires publiques, ou qui le tient pour en
prendre foin ; & cette étymologie me paroît la plus
vraiffemblable de toutes.
Quand les curies , curia, furent abolies, le nom
curia paffa au lieu où le fénat fe tenoit ; & c’eft peut-
etre de-là qu’efl venu le mot de cour, que nous employons
pour fignifier tout corps de juges 8r de ma-
giftrats. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT .
CURIEUX, f. m. (Hift. anc.y curiofus ; officier
de empire romain fous les empereurs du moyen
age , commis pour empêcher les fraudes & les mal-
verfations, fur-tout en ce qui regardoit les polies Ôt
les voitures publiques, 8c pour donner avis à la
cour de tout ce qui fe paffoit dans les provinces.
Cet emploi rendoit les curieux redoutables, &
leur donnoit le moyen de faire beaucoup plus de
mal qu ils n’en empechoient ; ce qui fit qu’Honorius
d J^C^ ^3nS ^ue^ ues Part^es l ’empire, l’an 415
Ce nom revient à-peu-près à ce que nous appel-
lenovs .contrôleurs. On les appelloit curieux du mot
cura , foin, quod curis agendis & evecliônibus curfus,
. publiciinfpiciendis operam durent. Diftionn. de Tré-
• voux & Chambers.
Academie des.curieux de la Nature , voyez ACADÉMIE.
Foye^aufli C u riosité. (G) •
Cu r ieu x , adj. pris fubft. Un curieux, en Peinture,
eft un homme qui amaffe des deffeins, des tableaux,
des eftampes, des marbres, des bronzes,
des médaillés, des vafes, &c. ce goût s’appelle cu-
. riojite. Tous ceux qui s’en occupent ne font pas con-
■ noiffeurs ; 8c c’eft ce qui les rend fouvent ridicules,
I comme le feront toujours ceux qui parlent de ce qu’ils
n Entendent pas. Cependant la curiofité, cette
envie de poffeder qui n’a prefque jamais de bornes,
dérangé prefque toujours la fortune ; 8c c’eft en celâ
qu’elle eft dangereule. Foye^ Amateur. (A)
CURIGA, (Géog. mod.y ville & royaume d’Afie
dans la prefqu’île de l’Inde, en-deçà du Gange, fur
la cote de Malabar, tributaire du roi de Calicut.
9 CURIQN, f. m. (Ififl. anc.y curio; chef 6c prêtre
d’une curie. Foye^ C urie.
Romulus ayant divifé le peuple romain en trois
tribus 8c en trente curies, dont chacune étoit de
cent hommes, donna à chaque curie un chef, qui
: etoit le prêtre de cette curie, & qu’on appella curio> s
Sc flamen curialis.
C etoit lui qui faifoit les facrifîces de la curie, qui
s’appelloiênt curionies:,^ cûrionia : fa curie lui donnoit
quelque fomme d’argent pour cela. Cette pen-
fion qu ces appointemens s’appelloient curionium.
C’étoit chaque tribu qui choififfoit fon curion. Mais
tous ces curions avoient un fupérieur & un chef, un
curion general qui étoit la tête du corps & qui gou-
vernoitles autres. On 1 appelloit grand curion, curio
maximus. .Celui-ci étoit élu par toutes les curies af-
femblées dans les comices, qu’on nommoit curiatai
Foye^ C om ice s .
Toutes ces inftitutions furent faites par Romulus,
6c confirmées par Numa, au rapport de Denis d’Ha-
, lica’rnaffe.
Quelques auteurs difent qu’il y avoit deux curions
dans chaque curie. Diclionn. de Frév. & Chambers.
Jule Capitolin nomme aufli 'curions certains crieurs
publics, qui dans les jeux & les fpe&acles lifoient
les requêtes que les comédiens adreffoient au prince
ou au peuple. (G)
. CURIOSITÉ, fub. f. ( Mor. Arts & Scienc. ) defir
empreffe d’apprendre, de s’inftruire, de favoir des
chofés nouvelles. Ce defir peut être loiiable ou blâmable,
utile ou nuifiblé, fage ou fou, fuivant les
objets auxquels il fe porte.
La curiofité dé connoître l’avenir par le fecours des
fciences chimériques, que l’on imagine qui peuvent
les dévoiler, eft fille de l’ignorance & de la fuper.fti-
tion. Foye^ Astrologie G Divinatio n.
La curiofité inquiété de favoir ce que les autres
penfent de nous, eft l’effet d’un amour-propre defor-
donné. L ’empereur Adrien qui nourriffoit chèrement
cette paflîon dans fon coeur, devoit être un malheureux
mqrtel. Si nous avions un miroir magique, qui
nous découvrît fans ceflè les idées qu’ont fur notre
compte tous ceux qui nous environnent, il vaudroit
mieux le caffer que d’en faire ufage. Contentons-
nous d’obferver la droiture dans nos allions, fans
chercher curieufement à pénétrer le jugement qu’en
D D d d