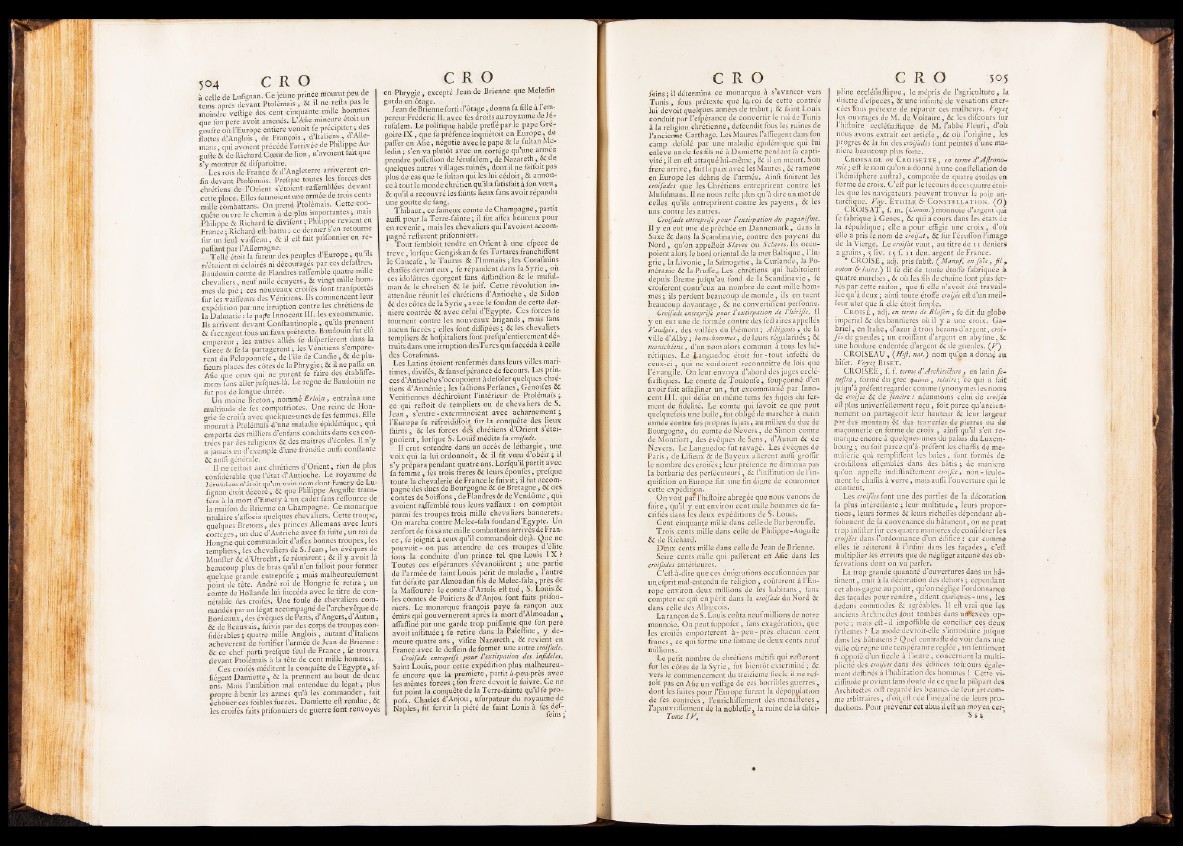
à celle de Lufignan. Ce jeûne prince moumt peu de
teins après devant Ptolémaïs , & il ne relia pas le
moindre veftige des cent cinquante mille hommes
que fonpcre avoit amenés. L’Afie mineure etoit un
eoufre où l’Europe entière venoit fe précipiter ÿ des
flottes d?Angldis , de François , d’Italiens , dAlle-
mans, qui avoient précédé l’arrivée de Philippe Augufte
& de Richard Coeur delion, n’avoient fait que
s’y montrer & difparoître.
Les rois de France & d’Angleterre arrivèrent enfin
devant Ptolémaïs. Prefque toutes, les forces des
chrétiens de d’Orient s’étoient raffemblees devant
cette place. Elles formoient une armée de trois cents
mille cômbattans. On prend Ptolémaïs. Cette conquête
ouvre le chemin à de plus importantes ; mais
.Philippe & Richard fe divifent ; Philippe revient en
France ;,Richard eft battu ; ce dernier s’én retourne
fur un feul vaiffeau, & il efl: fait prifonmer en re-
.paffant p'ar l’Allemagne. - '■ !
Telle étoit la fureur, des peuples d'Europe, qu ils
n’étoient ni éclairés ni découragés par ces defaftres.
Baudouin comte de Flandres raffemble quatre mille
chevaliers, neuf mille écuyers, & vingt mille hom- ,
•mes de pié ; ces nouveaux croifés font tranfportes
fur.-les vaiffeaux des Vénitiens. Ils commencent leur
expédition par une irruption contre les chrétiens de
la Dalmatie : le pape Innocent III. les excommunie.
Ils arrivent devant Conftantinople , qu’ils prennent
& faccagent fous un-faux prétexte. Baudouin fut élu
empereur; les autres alliés fe difperferent dans la
Grèce & fe là partagèrent; les Vénitiens s’emparèrent
du Peloponnefe , de file de Candie, &. de plu-
fieurs placés.des côtes de la Phrygie ; & il ne paffa en
Afie que ceux qui ne purent fe faire des etabhfle-
mens fans allerjufquesdà. Lë régné de Baudouin ne
fi.it pas de longue durée.
Un moine Breton, nommé Erloin, entraîna une
multitude de fes compatriotes. Une reine de Hongrie
fe croifa avec quelques-unes de fes femmes. Elle
mourut à Ptolémaïs-d’une maladie épidémique, qui
emporta des milliers d’enfans conduits dans ces contrées
par des religieux & des maîtres d ecoles. Il n y
a jamais eu d’exemple d’une frénéfie. auffi confiante
& auffi générale. • .
Il ne reftoit aux chrétiens d’Orient, rien de plus
confidérable que l’état d’Antioche. Le royaume de
Jérufalem n’étoit qu’un vain nom dont Emery de Lu-
fignan étoit décore, & que Philippe Augufte transféra
à la mort d’Emery à un cadet fans reffource de,
la maifon de Brienne en Champagne. Ce monarque
titulaire s’aflocia quelques chevaliers. Cette troupe,
quelques Bretons, des princes Allemans avec leurs
cortèges, un duc d’Autriche avec fa fuite, un roi de
Hongrie qui commandoit d’affez bonnes troupes, les
templiers, les chevaliers de S. Jean, les évêques de
Munfter & d’Utrecht, fe réunirent ; & il y avoit là
beaucoup plus de bras qu’il n’en falloit pour former
quelque grande entreprife ; mais malheureufement
point de tête. André roi de Hongrie fe retira ; un
comte de Hollande lui fuccéda avec le titre de connétable
des croifés. Une foule de chevaliers commandés
par un légat accompagné de l’archevêque de
Bordeaux, des évêques de Paris, d’Angers, d’Autun,
& de Beauvais, fuivis par des corps de troupes con-
fidérables ; quatre mille Anglois, autant d’Italiens
achevèrent de fortifier l’armée de Jean de Brienne :
& ce chef parti prefque feul de France, lie trouva
devant Ptolémaïs à la tête de cent mille hommes.
| Ces, croifés méditent la conquête de l’Egypte, af-
fiégent Damiette , & la prennent au bout de deux
ans. Mais l’ambition mal entendue du légat, plus
propre à bénir les armes qu’à les commander, fait
échouer ces foibles fuccès. Damiette eft rendue, &
les croifés faits prifonniers de guerre font renvoyés
•en Phrygié, excepté Jeah-de Brienne que Melediri
garda-en.-otage. , r t , - -
Jean.de Brienne forti d’otage, donna fa fille à î empereur
Frédéric II. avec fes droits au royaume de Jé-
rufalem. Le politique habile preffé par le pape Grégoire
IX , qpe fa préfence inquiétoit. en Europe, de
palier en Afie, négotie avec le pape & le fultan Me-r
ledin ; s’en va plutôt avec lin cortège qu’une armee
prendre poffelfion de Jérufalem, de Nazareth, & de
quelques autres villages ruinés, dont il ne faifoitpas
plus de cas que le fultan qui les lui cédoit, & annonce
à tout le monde chrétien qu’il a fatisfait à fon voeu ,
& qu’il a recouvré les faints lieux fans avoir répandu
une goutte de fang.
Thibaut, ce fameux comte de Champagne, partit
auffi pour la Terre-fainte ; il fut affez heureux pour
en revenir, mais les chevaliers qui l’avoient accompagné
refterent prifonniers.
Tout fembloit tendre en Orient à une efpece de
treve, lorfque Gengiskan & fesTartares franchifient
le Gaucafe , le Taurus & l’Immaiis ; :les Corafmins
chafles devant eux, fe répandent dans laSyrie, où
ces idolâtres égorgent fans diftinétion & le muful-
' man & le chrétien & le juif. Cette révolution inattendue
réunit les* chrétiens d’Antioche , de Sidon
& des côtes de la Syrie, avec le foudan de cette dernière
contrée & avec celui,d’Egypte. Ces forces fe
tournent contre les nouveaux brigands, mais fans
aucun fuccès ; elles font diffipees ; & lë s chevaliers
templiers 8c hofpitaliers font prefqu’entierement détruits
dans une irruption desTurcs qui fuccéda à celle
des Corafmins.
Les Latins étoient renfermés dans leurs villes maritimes,
divifés, &fansefpérance de fecours. Les princes
d’Antioche s’occupoient à defoler quelques chrétiens
d’Arménie ; les faétiôns Perfanes, Génoifes &
Vénitiennes, déchiroient l’intérieur de Ptolémaïs ;
ce qui reftoit de templiers ou de chevaliers de S.
Jean , s’entre - exterminoïent avec acharnement ;
l’Europe fe rèfroidiffoit fur la conquête des lieux
faints, 8c les forces dès chrétiens d’Orient s’étei-
gnoient, lorfque S. Loui? médita fa croifade.
Il crut entendre dans un accès de léthargie, une
voix qui la lui ordonnoit, 8c il fit voeu d’obeir ; il
s’y prépara pendant quatre ans. Lorfqu’il partit avec
fa femme, fes trois freres 8c leurs époufes, prefque
toute la chevalerie de France le fuivit ; il fut accompagné
des ducs de Bourgogne 8c de Bretagne, 8c des
comtes de Soiffons, deFlandres & de Vendôme, qui
avoient rafiemblé tous leurs vaflaux : on comptoit
parmi fes troupes trois mille chevaliers bannerets.
On marcha contre Melec-fala foudan d’Egypte. Un
renfort de foixante mille cômbattans arrivés de France
, fe joignit à ceux qu’il commandoit déjà. Que ne
pouvoit - on pas attendre de ces troupes d’élite
fous la conduite d’un prince tel que Louis IX ?
Toutes ces efpérances s’évanoiiirent ; une partie
de l’armée de faint Louis périt de maladie, l’autre
fut défaite par Almoadan fils de Melec-fala, près de
la Mafloure : le comte d’Artois eft tué, $. Louis &
les comtes de Poitiers & d’Anjou font faits prifonniers.
Le monarque françois paye fa rançon aux
émirs qui gouvernèrent après la mort d’Almoadan ,
afiaffiné par une garde trop puiffante que fon pere
avoit inftituée ; fe retire dans la Paleftine, y de-
meurequatre ans, vifite Nazareth, & revient en
France avec le deffein de former une autrecroifade.
Croifade entreprife pour Vextirpation des infidèles.
Saint Louis, pour cette expédition plus malheureu-
fe éneore que la première, partit à-peu-près avec
les mêmes forces ; fon frere devoit le fuivre. Ce ne
fut point la conquête de la Terre-fainte qu’il fe pro-
pofa. Charles d’Anjou, ufurpateur du royaume de
Naples, fit fervir la piété de faint Louis à fes def-
,feins ;
feins ; il détermina ce monarque à s’avancer vers
Tunis, fous prétexte que lq^roi de cette contrée
lui devoit quelques années de tribut ; 8c faint Louis
conduit par l’efpérance de convertir le roi de Tunis
à la religion chrétienne, defeendit fous les ruines de
l ’ancienne Carthage. Les Maures l’affiegent dans fon
camp defolé par une maladie épidémique qui lui
enleve un de fesfîis né à Damiette pendant fa captivité
; il en eft attaqué lui-même, & il en meurt. Son
frere arrive, fait la paix avec les Maures, & ramene
en Europe les débris de l’armée. Ainfi finirent les
croifades que les Chrétiens entreprirent contre les
Mufulmans. Il ne nous relie plus qu’à dire un mot de
celles qu’ils entreprirent contre les payens, 8c les
uns contre les autres.
Croifade entreprife pour Vextirpation du paganifme.
Il y en eut une de prêchée en Dannemark, dans la
Saxe 8c dans la Scandinavie, contre des payens du
Nord , qu’on appelloit Slaves ou Sclaves. Iis occu-
poient alors le bord oriental de la mer Baltique, l’In-
grie, la L ivonie, la Sa’mogetie, la Curlande, la Poméranie
8c la Prude.» Les .chrétiens qui habitoient
depuis Breme jufqu’au fond de la Scandinavie , fe
croiferent contr’eux au nombre de cent mille hommes
; ils perdent beaucoup de monde, ils en tuent
beaucoup davantage, 8c ne convertiffent perfonne.
Croifade entreprife pour Vextirpation de fliêrêfie. Il
y en eut une de formée contre des feftaires appellés
Vaudpis, des vallées du Piémont ; Albigeois, de la
ville d’Alby ; bons-hommes, de leurs régularités ; 8c
manichéens, d’un nom alors commun à tous les hérétiques.
Le Jhangitedoc étoit fur - tout infeâé de
ceux-ci, qui ne vouloient reconnoître de lois que
l ’évangile. On leur envoya d’abord des juges ecclé-
fiaftiques.- Le comte deTouloufe, foupçonné d’en
avoir fait aflaffiner un, fut excommunié par Innocent
III. qui délia en même tems fes fujets -du ferment
de fidelité. Le comte qui favoit ce que peut
quelquefois une bulle, fut obligé de marcher à main
armée contre fes propres fujets, au milieu du duc de
Bourgogne, du comte de Nevers, de Simon comte
de Montfort, des évêques de Sens, d’Autun & de
Nevers. Le Languedoc fut ravagé. Les évêques de
Paris, de Lifieux & de Bayeux allèrent auffi groffir
le nombre des croifés ; leur préfence ne diminua pas
la barbarie des perfécuteurs, & l’inftitution de l’in-
quifition en Europe fut une fin digne de couronner
cette expédition.
On voit par l’hiftoire abrégée que nous venons de
faire,'qu’il y eut environ cent mille hommes de fa-
crifiés dans les deux expéditions de S. Louis.
Cent cinquante mille dans celle de Barberouffe.
Trois .cents mille dans celle de Philippe-Augufte
& de Richard.
D’eux cents mille dans celle de Jean de Brienne.
Seize cents mille qui pafferent en Afie dans les
croifades antérieures.
' C ’eft-à-dire que ces émigrations occafionnées par
un.efprit mal-entendu de religion , coûtèrent à l’Europe
environ deux millions de fes habitans, fans.
compter ce qui en périt dans la croifade du Nord &
dans celle des Albigeois.
La rançon de S. Louis coûta neuf millions de notre
monnoie. On peut fiippofer, fans exagération, que
les croifés emportèrent à-peu-près chacun cent
francs, ce qui forme une fomme de deux cents neuf
millions.
Le petit nombre de chrétiens métifs qui refterent
fur les côtes de la Syrie, fut bientôt exterminé ; &
vers le commencement du treizième fiecle il ne reftoit
pas en Afie un veftige de ces horribles guerres,
dont les fuites pour l’Europe furent la dépopulation
de fes contrées , l’enrichiffement des monafteres ,
l ’apauvriftement de la nobleffe, la ruine de la difci-
Tome l r %
pline eccléfiaftique ; le mépris de l’agriculture, la
dilette d’efpecës, & une infinité de vexations exercées
fous prétexte de réparer ces malheurs. A'oye^
les ouvrages de M. de Voltaire, & les difeours fur
Thiftoire eccléfiaftique de M; l’abbé Fleuri, d’oii
ndus avons extrait cet article où l’origine, les
progrès & la fin des croifades font peintes d’une maniéré
beaucoup plus forte.
C r o i s a d e ok C r o i s e t t e , en terme d'Ajlrono-
mie; eft le nom qu’on a donné à une conftellation de
l’hémifphere aliftral, compofée de quatre étoiles en
forme de croix. C ’eft par le fecours de ces quatre étoiles
que les navigateurs peuvent trouver le pôle ait-
tarâique. Voy. É t o ï l e & C o n s t e l l a t i o n . ( 0 )
CROISAT, f. m. (Comm.) monnoie d’argent qui
fe fabrique à Genes, & qui a cours dans les états de
la république; elle a pour effigie une croix, d’où
elle a pris le nom de croifat, & fur l’écuflbn l’image
de la Vierge. Le croifat vaut, au titre de 11 deniers
2 grains, 5 liv. 15 f. 11 den. argent de France.
* CROISÉ, adj. pris fubft. ( Manuf en foie, f i l ,
coton & laine.') Il fe dit de toute étoffe fabriquée à
quatre marches, & où les fils de chaîne font plus ferres
par cette raifon, que fi elle n’avoit été travaillée
qu’à deux; ainfi toute étoffe croijée eft d’un meilleur
u(èr qiie fi elle étoit fimple.
C r o i s e , âdj. en terme de Êlafoh, fe dit du globe
impérial & des bannières où il y a une croix; Gabriel
, en Italie, d’azur à trois bezans d’argent, croi-
fés de gueules ; un croiffant d’argent en abyfme, 8e
une bordure endentée d’argent & de gueules. ( V)
CROISEAU , ( Hifi. nat?) nom qu!gn a donng au
b ife t . Voye{ B i s e t .
CROISÉE, f. f. terme d,'Architecture , en latin fe-
ntfira, formé du grec <pa.lvuv, reluire ; ce qui a fait
julqu’à préfent regarder comme lynonymes les noms
de croijée & de fenêtre : néanmoins celui de croijée
eft plus univerfellement reçu, foit parce qu’ancien-
nement on partageoit leur hauteur & leur largeur
par des montans & des traverfes de pierres ou de~
maçonnerie en forme de croix , ainfi qu’il s’en remarque
encore à quelques-unes, du palais du Luxembourg
; ou foit parce qu’à-préfent les chaffis de me-
nuiferie qui rempliffent les baies, font formés de
croifillons affemblés dans des bâtis ; de maniéré
qu’on appelle indiftin&ement croijée, non - feulement
le chaffis à verre, mais auffi l’ouverture qui le
contient.
Les croifées font une des parties dé la décoration
la plus intéreffante ; leur multitude, leurs proportions
, leurs formes & leurs richeffes dépendant ab-
folument de la convenance du bâtiment, on ne peut
trop infifter fur ces quatre maniérés de confidérer les
croifées dans l’ordonnance d’un édifice : car comme
elles le réitèrent à l’infini dans les façades, c’eft
multiplier les erreurs que de négliger aucune des ob-
fervations dont on va parler.
La trop grande quantité d’ouvertures dans un bâtiment
, nuit à la décoration des dehors ; cependant
cet abus gagne au point, qu’on néglige l’ordonnance
des façades pour rendre, difent quelques-uns, les
dedans commodes & agréables. Il eft vrai que les
anciens Architectes font tombés dans urfèexcès op-
pol’é ; mais eft-il impoffible de concilier ces deux
lÿftemes ? La mode devroit-elle s’introduire jufque
dans les bâtimens ? Quel contrafte de voir dans une
ville où régné une température réglée , un fentiment
fi oppofé d’un fiecle à l’autre, concernant la multiplicité
des croifées dans des édifices toûjours également
deftinés à l’habitation des hommes ! Cette vi-
ciffitude provient fans doute de ce que là plûpart des
Architeftes ont regardé les beautés de leur art comme
arbitraires, d’où^eft née l’inégalité de leurs productions.
Pour prévenir cet abus il eft un moyen cer