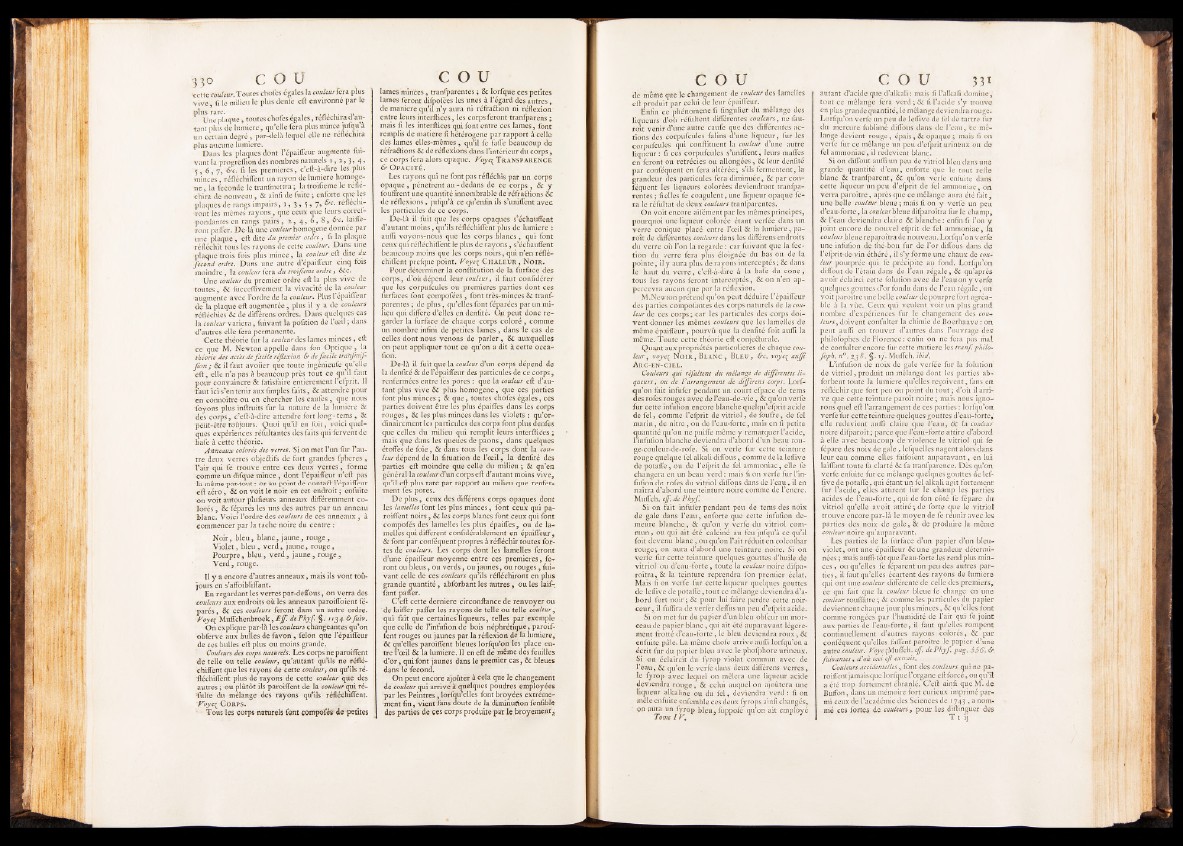
•cctic-coulcur. Toutes chofes égales la couleur (en plus
v iv e , fi le milieu le plus denl'e cil environné par le
plus rare. f . . , .
Une plaque -, toutes chofes égalés, réfléchira d autant
plus de lumière, qu’elle fera plus mince jufqu’à
iin certain degré, par-delà lequel elle ne réfléchira
plus aucune lumière*
Dans les plaques dont l’épaiffeur augmenté fui-
vant la progreflion des nombres naturels i , a , 3, 4 ,
5 , d , 7, &c. fi les premières, c’eft-à-dire les plus
minces, réfléchiffent un rayon de lumière homogène,
la fécondé le tranfinettra ; latroifieme le réfléchira
de nouveau, & ainfi de fuite ; enforte que les
plaques de rangs impairs, 1 , 3 , 5 , 7, &c. réfléchiront
les mêmes rayons, que ceux que leurs correl-
•pondantes en rangs pairs , 2 , 4 , 6 , 8, laifle-
ronr pafl'er. De-là une couleur homogène donnée par
une plaque, eft dite du premier ordre , fi la plaque
réfléchit tous les rayons de cette couleur. Dans une
plaque trois fois plus mince, la couleur eft dite du
fécond ordre. Dans une autre d’épaiffeur cinq fois
moindre, la couleur fera du troifeme ordre, 8c c.
Une couleur du premier ordre eft la plus vive de
toutes, 8c fucceflivement la vivacité de la couleur
augmente avec l’ordre de la couleur. Plus 1 epaiffeur
de la plaque eft augmentée, plus il y a de couleurs
réfléchies 8c de différens ordres. Dans quelques cas
la couleur variera, fuivant la pofition de l’oeil 3 dans
d’autres elle fera permanente.
Cette théorie fur la couleur des lames minces, eft
ce que M. Newton appelle dans fon Optique, la
théorie des accès de facile réflexion & de facile trdhfmift
fton ; 8c il faut avoiier que toute ingénieufe qu’elle
eft, elle n’a pas à beaucoup près tout ce qu’il faut
pour convaincre & fatisfaire entièrement l’efprit. Il
faut ici s’en tenir aux Amples faits, 8c attendre pour
en connoître ou en chercher les caufes, que nous
■ foyons plus inftruits fur la nature de la lumière &
des corps, c’eft-à-dire attendre fort long-tems , &
peut-être toujours. Quoi qu’il en foit, voici quelques
expériences réfultantes des faits qui fervent de
bafe à cette théorie.
Anneaux colorés des verres. Si on met l’un fur l’autre
deux verres objeâifs de fort grandes fpheres ,
l ’air qui fe trouve entre ces deux verres, forme
■ comme un difque mince , dont l’épaiffeur n’eft pas
la même par-tout : or au point de contaft l’épaiffeur
eft zéro 8c on voit le noir en cet endroit ; enfuite
o n voit autour plufieurs anneaux différemment colorés
, 8c féparés les uns des autres par un anneau
blanc. Voici l’ordre des couleurs de ces anneaux, à
commencer par la tache noire du centre :
Noir, bleu, blanc, jaune, rouge,
Violet, bleu, verd, jaune, rouge,
Pourpre, bleu, verd, jaune, rouge,
Verd, rouge.
Il y a encore d’autres anneaux, mais ils vont toû-
jours en s’affoibliffant.
En regardant les verres par-deffous, on verra des
couleurs aux endroits où les anneaux paroiffoient féparés,
8c ces couleurs feront dans un autre ordre.
Poye^ Muffchenbroek, Ejf. dePhyf. § . 1134 &fuiv.
On explique par-là les couleurs changeantes qu’on
obferve aux bulles de favon , félon que l’épaiffeur
de ces bulles eft plus ou moins grande.
Couleurs des corps naturels. Les corps ne paroiffent
de telle ou telle couleur, qu’autant qii’ils ne réfléchiffent
que les rayons de cette couleur, ou qu’ils ré-
■ fléchiffent plus de rayons de cette couleur que des
autres ; ou plutôt ils paroiffent de la couleur qui résulte
du mélange des rayons qifils réfléchiffent.
yoyei C orps.
Tous les corps naturels font compofés de petites
lames minces, tranf^arentes ; 8c lorfque ces petites
lames feront difpofées les unes à l’égard des autres,
de maniéré qu’il n’y aura ni réfra&ion ni réflexion-
entre leurs interftices, les corps feront tranfparens ;
mais fi les interftices qui font entre ces lames, font
remplis de matière fi hétérogène par rapport à celle
des lames elles-mêmes , qu’il fe faffe beaucoup de
réfraôions 8c de réflexions dans l’intérieur du corps *
ce corps fera alors opaque. Voye^ Transparence
& Opacité.
Les rayons qui ne font pas réfléchis pât un corps
opaque, pénètrent au - dedans de ce corps , 8c y
fouftrent une quantité innombrable de réfraftions 8c
de réflexions, jufqu’à ce qu’enfin ils s’uniffent avec
les particules de ce corps.
De-là il fuit que les corps opaques sféchaùffent
d’autaht moins, qu’ils réfléchiffent plus de lumière t
aufli voyons-nous que les corps blancs , qui font
ceux qui réfléchiffent le plus de rayons, s’échauffent
beaucoup moins que les corps noirs, qui n’en réfléchiffent
prefque point. Voyez Chaleur , Noir.
P(?ur déterminer la conftitution de la furface des
corps, d’où dépend leur couleur, il faut confidérer
que les corpufcules ou premières parties dont ces
furfaces font compofées, font très-minces 8c transparentes
; de plus, qu’elles font féparées par un mi-*
lieu qui différé d’elleS en denfité. On peut donc regarder
la furface de chaque corps coloré, comme
un nombre infini de petites lames, dans 'le cas de
celles dont nous venons de parler, 8c auxquelles
on peut appliquer tout ce qu’on a dit à cette occaj
lion.
De-là il fuit que la couleur d’un corps dépend de
la denfité & de l’epaiffeur des particules de ce corps,
renfermées entre fes pores : que la couleur eft d’autant
plus vive & plus homogène, que ces parties
font plus minces ; & que, toutes chofes égales, ces
parties doivent être les plus épaiffes dans les corps
rouges, 8c les plus minces dans les violets : qu’or-
dinairement les particules des corps font plus aenfes
que celles du milieu qui remplit leurs mterftic'es ;
mais que dans les queues de paons, dans quelques
étoffes de foie, & dans tous les corps dont la couleur
dépend de la fituation de l’oe il, la denfité des
parties eft moindre que celle du milieu ; & qu’en
général la couleur d’un corps eft d’autant moins vive,
qu’il eft plus rare par rapport au milieu que renferment
fes pores.
De plus, ceux des différens corps opaques dont
les lamelles font les plus minces, font ceux qui pa-
roifl'ent noirs, & les corps blancs font ceux qui font
■ compofés des lamelles les plus épaiffes, ou de lamelles
qui different confidérablement en épaiffeur,
& font par conféquent propres à réfléchir toutes fortes
de couleurs. Les corps dont les lamelles feront
d’une épaiffeur moyenne entre ces premières, feront
ou bleus, ou verds, ou jaunes, ou rouges, fuivant
celle de ces couleurs qu’ils réfléchiront en plus
grande quantité, abforbant les autres, ou les laif-
fant palier.
C ’eft cette derniere circonftance de renvoyer ou
de laiffer paffer les rayons de telle ou telle couleur,
qui fait que certaines liqueurs, telles par exemple
que celle de l’infiifion de bois néphrétique, paroiffent
rouges ou jaunes par la réflexion de la lumière,1
8c qu’elles paroiffent bleues lorfqu’on les place entre
l’oeil 8c la lumière. Il en eft de même des feuilles
d’o r , qui font jaunes dans le premier cas, & bleues
dans le fécond.
On peut encore ajpûter à cela que le changement
de couleur qui arrive à quelques poudres employées
par les Peintres, lorfqti*elles font broyées extrêmement
fin, vient fans doute de la diminution fenfible
des parties de ces corps produite par le broyemen.t^
de même que le changement de couleur des lamelles
eft produit par celui ae leur epaiffeur. ^
Enfin ce phénomène fi fingulier du mélange des
liqueurs d’où réfultent différentes couleurs, ne fau-
roit venir d’une autre caufe que des différentes actions
des corpufcules falins d’une liqueur, fur les
corpufcules qui conftituent la couleur d’une autre
liqueur : fi ces corpufcules s’uniffent, leurs maffes
en feront ou rétrécies ou allongées, 8c leur denfité
par conféquent en fera altérée ; s’ils fermentent, la
grandeur des particules fera diminuée, 8c par conféquent
les liqueurs colorées deviendront tranfpa-
rentes ; fi elles fe coagulent, une liqueur opaque fera
le réfultat de deux couleurs tranfparentes.
On voit encore aifément par les mêmes principes,
pourquoi une liqueur colorée étant verfée dans un
verre conique placé entre l’oeil & la lumière, pa-
roît de différentes couleurs dans les différens endroits
du verre où l’on la regarde : car fuivant que la fec-
tion du verre fera plus éloignée du bas ou de la
pointe, il y aura plus de rayons interceptés ; 8c dans
le haut du verre, c’eft-à-dire à la bafe du cône,
tous les rayons feront interceptés, 8c on n’en ap-
percevra aucun que par la réflexion.
M.Newton prétend qu’on peut déduire l’épaiffeur
des parties compofantes des corps naturels de la couleur
de ces corps ; car les particules des corps doivent
donner les mêmes couleurs que les lamelles de
même épaiffeur, pourvu que la denfité foit aufli la
même. Toute cette théorie eft conje&urale.
Quant aux propriétés particulières de chaque couleur
, voyei Noir, Blanc , Bleu, &c. voyeç aufjî
Arc-en-ciel.
Couleurs qui réfultent du mélange de différentes liqueurs
, ou de P arrangement de différens corps. Lorfqu’on
fait infufer pendant un court efpace de tems
des rofes rouges avec de l’eau-de-vie, 8c qu’on verfe
fur cette infufion encore blanche quelqu’efprit acide
de fel, comme l’efprit de vitriol, de îbufre, de fel
marin, de nitre, ou de l’eau-forte, mais en fi petite
quantité qu’on ne puiffe même y remarquer l’acide,
l’infufion blanche deviendra d’abord d’un beau rou-
ge-couleur-de-rofe. Si on verfe fur cette teinture
rouge quelque fel alkali diffous, comme de la leflive
de potaffe, ou de l’efprit de fel ammoniac, elle fe
changera en un beau verd : mais fi on verfe fur l’in-
fufion de rofes du vitriol diffous dans de Peau, il en
naîtra d’abord une teinture noire comme de l’encre.
Muffch. e[f. de Phyf.
Si on fait infufer pendant peu de tems des noix
de gale dans Peau, enforte que cette infufion demeure
blanche, & qu’on y verfe du vitriol commun
, ou qui ait été calciné au feu jufqu’à ce qu’il
foit devenu blanc, ou qu’on l’ait réduit en colcothar
rouge; on aura d’abord une teinture noire. Si on
verte fur cette teinture quelques gouttes d’huile de
vitriol ou d’eau-forte , toute la couleur noire difpa-
roîtra, & la teinture reprendra fon premier éclat.
Mais fi on verfe fur cette liqueur quelques gouttes
de leflive de potaffe, tout ce mélange deviendra d’abord
fort noir ; 8c pour lui faire perdre cette noirceur,
il fuflira de verfer deffusun peu d’efprit acide.
Si on met fur du papier d’un bleu obfcur un morceau
de papier blanc, qui ait été auparavant légèrement
frotté d’eau-forte, le bleu deviendra roux, 8c
enfuite pâle. La même chofe arrive aufli lorfqu’on a
écrit fur du papier bleu avec le phofphore urineux.
Si on éclaircit du fyrop violât commun avec de
l’eau, 8c qu’on le verfe dans deux différens verres,
le fyrop avec lequel on mêlera une liqueur acide
deviendra rouge, 8c celui auquel on ajoutera une
liqueur alkaline ou du fe l, deviendra verd : fi on
mele enfuite enfemble ces deux fyrops ainfi changés,
' on aura un fyrop bleu, fùppofé qu’on ait employé
autant d’acide que d’alkali: mais fi l’alkali domine,"
tout ce mélange fera verd ; 8c fi l’acide s’y trouve
en plus grande quantité, le mélange deviendra rouge.
Lorfqu’on verfe un peu de leflive de fel de tartre fur
du mercure fublimé diffous dans de l ’eau, t e mélange
devient rouge, épais, 8c opaque ; mais fi on
verfe fur ce mélange un peu d’efprit urinÊux ou de
fel ammoniac, il redevient blanc.
Si on diffout aufli un peu de vitriol bleu dans une
grande quantité d’eau, enforte que le tout refte
blanc 8c tranfparent, 8c qu’on verfe enfuite dans
cette liqueur un peu d’efprit de fel ammoniac, on
verra paroître, après que ce mélange aura été fait,
une belle couleur bleue ; mais fi on y verfe un peu
d’eau-forte, la bleue difparoîtra fur le champ,
8c l’eau deviendra claire 8c blanche : enfin fi l’on y
joint encore de nouvel efprit de fel ammoniac, fa
couleur bleue reparoîtra de nouveau. Lorfqu’on verfe
une infufion de thé-bou fur de l’or diffous dans de
l’efprit-de-vin éthéré, il s’y forme une chaux de cou->
leur pourprée qui fe précipite au fond. Lorfqu’on
diffout de l’étain dans de l’eau régale, 8c qu’après
avoir éclairci cette folution avec de l’eau on y verfe
quelques gouttes d’or fondu dans de l’eau régale ,'on
voit paroître une belle couleur de pourpre fort agréable
à la vue. Ceux qui veulent voir un plus grand
nombre d’expériences fur le changement des cou->
leurs, doivent confulter la chimie de Boerhaave : on
peut aufli en trouver d’autres dans l’ouvrage desr
philofophes de Florence : enfin on ne fera pas mal
de conlulter encore fur cette matière les (ranf. philo-
foph. n°. 238. §. vj. Muffch. ibid.
L’infufion de noix de gale verfée fur la folution
de vitriol, produit un mélange dont les parties ab-.
forbent toute la lumière qu’elles reçoivent, fans en
réfléchir que fort peu ou point du tout ; d’où il arrive
que cette teinture paroît noire ; mais nous ignorons
quel eft l’arrangement de ces parties : lorfqu’on
verfe fur cette teinture quelques gouttes d’eau-forte,1
elle redevient aufli claire que l ’eau, 8c la couleur
noire difparoît ; parce que l’eau-forte attire d’abord
à elle avec beaucoup de violence le vitriol qui fe
fépare des noix de gale, lefquelles nagent alors dans
leur eau comme elles faifoient auparavant, en lui
laiffant toute fa clarté 8c fa tranfparence. Dès qu’on
verfe enfuite fur ce mélange quelques gouttes de lef-
five de potaffe, qui étant un fel alkali agit fortement
fur l’acide, elles attirent fur le champ les parties
acides de l’eau-forte, qui de fon côté fe fépare du
vitriol qu’elle avoit attiré ; de forte cjue le vitriol
trouve encore par-là le moyen de fe reunir avec les
parties des noix de gale, & de produire la même
couleur noire qu’auparavant.
Les parties de la furface d’un papier d’un bleu-
violet, ont une épaiffeur 8c une grandeur déterminées
; mais aufli-tôt que l’eau-forte les rend plus minces,
ou qu’elles fe féparent un peu des autres parties,
il faut qu’elles écartent des rayons de lumière
qui ont une couleur différente de celle des premiers,
ce qui fait que la couleur bleue fe change en une
couleur rouffâtre ; 8c comme les particules du papier
deviennent chaque jour plus minces, 8c qu’elles font
comme rongées par l’humidité de l’ air qui fe joint
aux parties de l’eau-forte, il faut qu’elles rompent
continuellement d’autres rayons colorés, 8c par
conféquent qu’elles faffent paroître le papier d’une
autre couleur. VoyeiMuffch. eff. dePhyf. pag. 656. &.
fuiv antes, d’où ceci eft. extrait.
Couleurs accidentelles, font des couleurs qui ne paroiffent
jamais que lorfque l’organe eft force, ou qu’il
a été trop fortement ébranlé. C ’eft ainfi que M. de
Buffon, dans un mémoire fort curieux imprimé parmi
ceux de l’académie des Sciences de 1743 , a nommé
ces fortes de couleurs, pour les diftinguer des