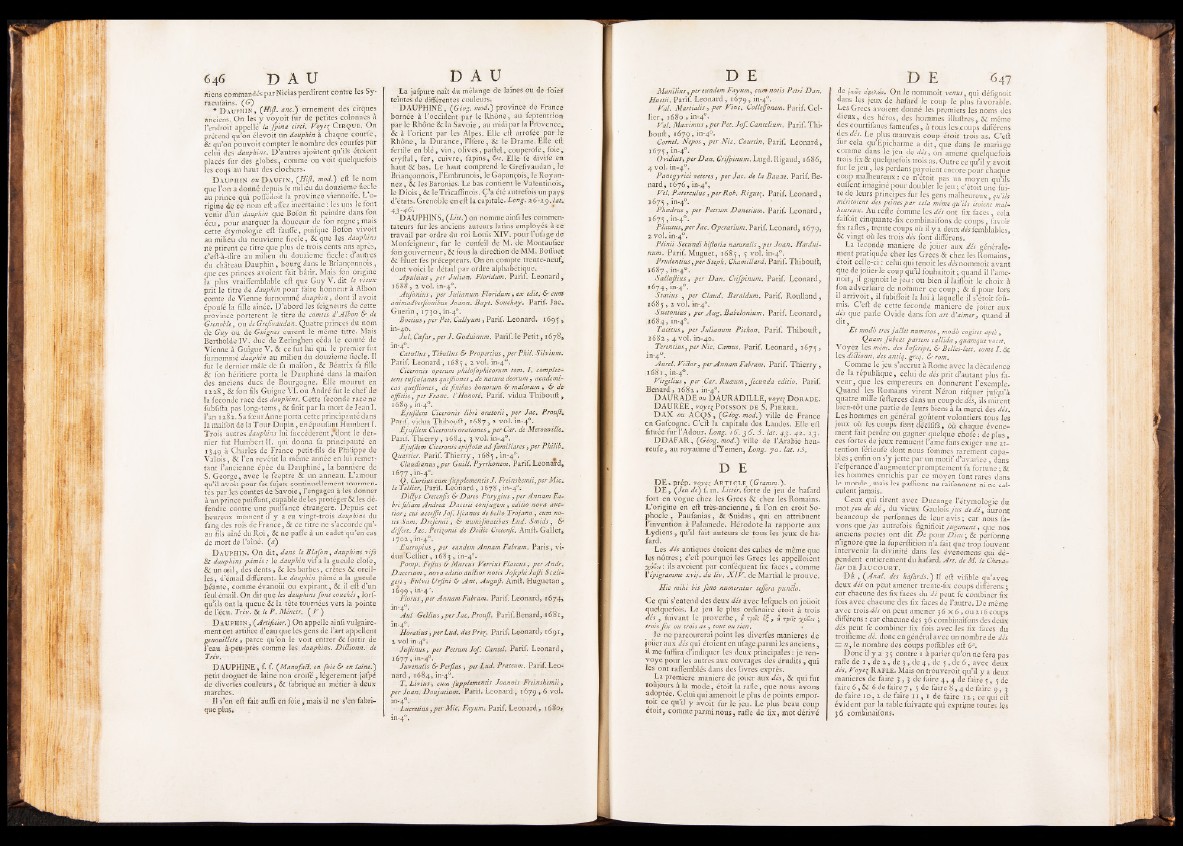
niéns commandés parNicias perdirent contre les Sy-
racufains. (G) v , .
* D auphin , (Hifl. ane.) ornement des cirques
anciens. On les y voyoit fur de petites colonnes à
l’endroit appelle la fpina circi. Voyc{ C i r q u e . On
prétend qu’on élevoit un dauphin à chaque courfe,
& qu’on pouvoit compter le nombre des courfes par
celui des dauphins. D ’autres ajoutent qu’ils étoient
placés for des globes, comme on voit quelquefois
les coqs au haut des clochers. .
D a u p h in o b D a u f i n , (Hifl. mod.) eft le nom
que l’on a donné depuis le milieu du douzième fiecle
au prince qui poffédoit la province viennoife. L’origine
de ce nom eft allez incertaine : les uns le font
venir d’un dauphin que Bofon fit peindre dans fon
écu pour marquer la douceur de fon régné ; mais
cette étymologie eft fauffe, puifque Bofon vivoit
au milieu du neuvième fiecle, & que les dauphins
ne prirent ce titre que plus de trois.cents ans après,
c’eft-à-dire au milieu du douzième fiecle : d’autres
du château Dauphin, bourg dans le Briançonnois,
que ces princes avoient fait bâtir. Mais fon origine
la' plus vraiffemblable eft que Guy V . dit le vieux
prit le titre de dauphin pour faire honneur à Aibon
comte de Vienne furnommé dauphin, dont il avoit
époufé la fille aînée. D ’abord les feigneurs de cette
province portèrent le titre de comtes d'Albon & de
Grenoble, ou de Grefivauian. Quatre princes du nom
de Guy où de Guignes eurent le même titre. Mais
Bertholde IV. duc de Zeringhen céda le comté de
Vienne à Guigue V. & ce fut lui qui le premier fut
furnommé dauphin au milieu du douzième fiecle. Il
fut le dernier mâle de fa maifon, & Béatrix fa fille
& fon héritière porta le Dauphiné dans la maifon
des anciens ducs de Bourgogne. Elle mourut en
i z z8 , & fon fils Guigne VI. ou André fut le chef de
la fécondé race des dauphins. Cette fécondé race ne
fubfifta pas long-tems, & finit par la mort de Jean I.
l’aii i z8z. Sa feeur Anne porta cette principauté dans
ia maifon de la Tour-Dupin, en époufant Humbert I.
Trois autres dauphins lui foccéderent ,*xlont le dernier
fut Humbert II. qui donna fa principauté en
1349 à Charles de France petit-fils de Philippe de
Valois, & l’en revêtit la mêmë année en lui remettant
l’ancienne épée du Dauphiné, la bannière de
S. George, avec le feeptre & un anneau. L’amour
qu’il avoit pour fes fojets continuellement tourmentés
par les comtes de Savoie, l’engagea à les donner
à un prince puiffant, capable de les protéger &: les défendre
contre une puiffance étrangère. Depuis cet
heureux moment il y a eu vingt-trois dauphins du
fang des rois de France, & ce titre ne s’accorde qu’au
fils aîné du Roi, & ne paffe à un cadet qu’en cas
de mort de l’aîné. (a)
D a u p h in . On dit, dans le Blafon, dauphins vifs
& dauphins pâmés : le dauphin v if a la gueule clofe,
& un oe il, des dents, & les barbes, crêtes & oreilles,
d’émail différent. Le dauphin pâmé a la gueule
béante, comme évanoui ou expirant, & il eft d’un
feul émail. On dit que les dauphins font couchés, lorf-
qu’ ils ont la queue & la tête tournées vers la pointe
de l’écu. Trév. & le P . Ménetr. ( V )
D a u p h in , (Artificier.') On appelle ainfi vulgairement
Oet artifice d’eau que les gens de l’art appellent
genouillère, parce qu’on le voit entrer & fortir de
l ’eau à-peu-près comme les. dauphins. Diclionn. de
Trév.
DAUPHINE, f. f. (Manufacl. en foie & en laine.)
petit droguet de laine non croifé, légèrement jafpé
de diverfes' couleurs, & fabriqué au métier à deux
marches.
Il s’en eft fait aufli en foie, mais il ne s’en fabrique
plus.
La jafpure naît du mélange de laines ou de foie?
teintes de différentes couleurs,
DAUPHINÉ, (Géog. mod.) province dé France
bornée à l ’occident par le Rhône, au feptentrion
par le Rhône & la Savoie, au midi par la Provence,
& à l’orient par les Alpes. Elle eft arroféè par le
Rhôné, la Durance, l’Ifere, & le Drame. Elle eft
fertile en blé, v in , olives, paftel, couperole, foie ,
cryftal, fer, cuivre, fapins, 6-c. Elle fe divife en
haut & bas. Le haut comprend le Grefivaudan, le
Briançonnois,l’Embrunois, leGapançois, le Royan-
nez, & les Baronies. Le bas contient le Valentinois,
le Diois, & leTricaflinois. Ç*a été autrefois un pays
d’états. Grenoble en eft la capitale. Long. xC-iÿ.lat.
43-4G:
DAUPHINS, ( Litt.) on nomme ainfi les commentateurs
fur les anciens auteurs latins employés à ce
travail par ordre du roi Louis XIV. pour l’ufage de
Monfeigneur, fur le confeil de M. de Montàufier
fon gouverneur, & fous la direftion de MM. Boffuet
& Huet fes précepteurs. On en compte trente-neuf,
dont voici le détail par ordre alphabétique;
Apuleius, per Julian. Floridum. Parif. Leonard 3
1688, 2'vol. in-40.
Aufonius , per Julianum Floridum , ex edit:- & cum
animadàerjionibus Joann. B apt. Souchay. Parif. Jac,
Guerin, 1730, in-40.
Boetius, per Pet. Callyum, Parif. Leonard. 1695 ,
in-40.
Jul. Ccefar, per J . Goduinum. Parif. le Petit, 1678,
in-40.
Catullus, Tibullus & Propertius, per Phil. Silvium.
Parif. Leonard , 1685,2 vol. in-40.
Ciceronis operum philofophicorum tom. I. complec-
tens tufculanas quejliones , de natura deorum , academi-
cas quejliones, de finibus bonorum & malorum , & de
ojficiis, per Franc. VHonoré. Parif. vidua Thibouft ,
1689, in-40.
Ejufdem Ciceronis libri oratorii, per Jac. Proufl.
Parif. vidua Thibouft, 1687, 2 vol.ln-4^'-/;YEjufdem
Ciceronis orationes, per Car. de Merouville.
Parif. Thierry, 1684, 3 vol. in-40.
Ejufdem Ciceronis epiflolce ad familiar es , per Philib.
Quartier. Parif. Thierry, 1685, in-40;
Claudianus yper Guill. Pyrrhonem. Parif. Leonard,
1677, in-40.
Q. Curtiûs cuni fupplementis J . Freinshemiiyper Mic.
le Tellier. Parif. Leonard, 1678, in-40;
Diclys Cretenjis & Dares Phrygius , per Annum Fa-
bri filiam Andrece Dacerii conjugem , editio nova auc-
tior ; cui accejjit Joj\ Ijcanus de bello Trojano , cum no-
tis Sam. Drejemii , & numifmatibus Lud. Smids , 6*
dijfert. Jac. Peri^omi de DicTie Cretenji. Amft. Galiet,
1702 j in-40;
Eutropius , per eandem Annàm Fabram. Paris, vi-
dua*Cellier, 1683, in-40. v
Pomp. Fefius & Marcus Verrius Flaccus, per Andr.
Dacerium , nova editio auclior notis Jofephi Jufli Scali-
gèri, Fulvii Urjini & Ant. Augujl. Amft. Huguetan,
1699 , in-4'.
Florus', per Annum Fabram. Parif. Leonard, 1674,
in-40. . : . ' • , ■ • - '
Aul Gellius t per Jac. Proufl. Parif. Benard, 1681,
in-40.
Horatius, per Lud. des Pref. P a r i f ; Leonard, 1691,
2 vol in-40;
Jujlinus, per Petrum Jof. Cantel. Parif. Leonard j
1677; in-40.
Juvenalis & Perjius, per Lud. Prateum. Parif. Leonard
, 1684, in-40.
T. Livius cum Jiipplementis Joannis Freinshemii ,
per Joan. Doujatium. Paril. Leonard', 16 79 ,6 vol.
in-40.
Lucretius , per Mic\ Fayum. Parif. Leonard , 1680,
in-40.
Manilius ,per eundem Fayum, cutnnotis Pétri Dan.
Huetii. Parif. Leonard, 1679, in-40.
Val. Martialis, per Vinc. Collejfonem. Parif. Cellier
, 1680 , in-40.
Val. Maximus, per Pet. Jof. Cantelium. Parif. Thibouft,
1679, in_4°*
Cornet. Nepos, per Nie. Cour tin. Parif. Leonard,
1675, in-40.
Ovidius, per Dan. Ctifpinüm. Lugd. Rigaud, 1686,
4 vol. in-40.
Panegyrici veteres , per Jac. de la Baune. Parif. Benard,
1676, in-40,
Vil. Paterculus , per Rob. Rigue?. Parif. Leonard ,
16 75 , in-40.
Phadrus , per Petrum Danetium. Parif. Leonard,
i 675,in-4°.
PlautuSyper Jac. Operarium. Parif. Leonard, 1679,
2 vol. in-40.
Pltnii Secundi hifloria naturalis, per Joan. Hardui-
num. Parif. Muguet, 1685, 5 v °l- in-40.
Prudentius yper Steph. Chamillard. Parif. Thibouft,
1687, in-40.
Salluflius, per Dan. Crifpinum. Parif. Leonard,
.1Ç74, in-40.
Statius y per Claud. Beraldum. Parif. Roulland,
16 8 5 ,2 vol. in-40.
Suetonius, per Aug. Babelonium. Parif. Leonard;
1684, in-40.
Tacitus, per Julianum Pichon. Parif. Thibouft,
1682 , 4 vol. in-40.
Terentius, per Nie. Camus. Parif. Leonard, 1675,
in-40.
Aurel. Victor, perAnnamFabram. Parif. Thierry,
il681, in-40.
Virgilius, per Car. Ruceum, fecunda editio. Parif.
Benard , 1682, in-40.
DAURADE ou DAURADILLE, voyeç D o r a d e .
DAURÉE, voye^P o i s s o n d e S. P i e r r e .
D A X ou ACQS , ( Géog. mod.) ville de France
en Gafcogne. C ’eft la capitale des Landes. Elle eft
fituée furl’Adour. Long. / 6. 3 6. 5. lat. 43. 42. 23.
D DAFAR, (Géog. mod.) ville de l’Arabie heu-
reufe, au royaume d’Yemen, Long. yo. lat. i5.
D E
D E , prép. voyei A r t i c l e (Gramm.).
D É , (Jeu de) f. m. Littér. forte de jeu de hafard
fort en vogue chez les Grecs & chez les Romains.
L’origine en eft très-ancienne, fi l’on en croit Sophocle
, Paufanias, & ‘Suidas , qui en attribuent
l ’invention à Palamede. Hérodote la rapporte aux
Lydiens, qu’il fait auteurs de tous les jeux de hafard.
Les dés antiques étoient des cubes de même que
les nôtres ; c’eft pourquoi les Grecs les appelloient
yy£oi : ils avoient par conféquent fix faces, comme
Vépigramme xvij. du liv. X IV . de Martial le prouve.
Hic mihi bis feno numeratur tejfera puncto.
Ce qui s’entend des deux dés avec lefquels on joiioit
quelquefois. Le jeu le plus ordinaire étoit à trois
dés y fuivant le proverbe, » rpiïc t f , « rpeïç xvCoi ;
trois f ix ou trois as , tout ou rien.
Je ne parcourerai point les diverfes maniérés de
jouer aux dés qui étoient en ufage parmi les anciens,
il me fuffira d’indiquer, les deux principales : je renvoyé
pour les autres aux ouvrages des érudits, qui
les ont raffemblés dans des livres exprès.
La première maniéré de joiier aux dés9 & qui fut
toujours à la mode, étoit la rafle, que nous avons
adoptée. Celui qui amenoit le plus de points empor-
toit ce qu’il y avoit fur le jeu. Le plus beau coup
ctoit, comme parmi nous, rafle de fix, mot dérivé
de puâiç àtptxdv. On le nommoit venus, qui défignoit
dans les jeux de hafard le coup le plus favorable.
Les Grecs avoient donné les premiers les noms des
dieux, des héros, des hommes illuftres, & même
des courtifanes fameufes, à tous les-.coups différens
des des. Le plus mauvais coup étoit trois as. C ’eft
lur cela qu’Epicharme a dit, que dans le mariage
comme dans le jeu de dés, on amene quelquefois
trois fix & quelquefois trois as. Outre ce qu’il y avoit
fur le jeu , les perdans payoient encore pour chaque
coup malheureux : ce n’étoit pas un moyen qu’ils
euflent imaginé pour doubler le jeu ; c’étoit une fuite
de leurs principes fur les gens malheureux, quils
meritoient des peines par cela même qu'ils étoient mal-
heureux. Aurefte comme les dés ont fix faces, cela
faifoit cinquante-fix combinaifons de coups, favoir
fix rafles, trente coups où il y a deux dés femblables,
& vingt où les trois dés font différens.
La fécondé maniéré de joiier aux dés généralement
pratiquée chez les Grecs & chez les Romains,
etoit celle-ci : celui qui tenoit les dés nommoit avant
que de joiier le coup qu’il fouhaitoit ; quand il I’ame-
noit, il gagnoit le jeu: ou bien il laiffoit le choix à
fon adverfaire de nommer ce coup ; & fi pour lors
il arrivoit, il fubiffoit la loi à laquelle il s’étoit fournis.
C eft de cette fécondé maniéré de joiier aux
des que parle Ovide dans fon art d’aimer 3 quand il
dit,
Et modb très jactet numéros, modb cogitet aptè ,
Quam fubeat partem callida , quamque vocet.
Voyez Les mèm. des înfeript. & Belles-lett. tome I. &
les dictionn. des antiq. greq. & rom.
Comme le jeu s’accrut à Rome avec la décadence
de la republique, celui de dés prit d’autant plus faveur
, que les empereurs en donnèrent l’exemple,.
Quand les Romains virent Néron rifquer jufqu’à
quatre mille fefterces dans un coup de dès3 ils mirent
bien-tot une partie de leurs biens à la merci des dés.
Les hommes en général goûtent volontiers tous les
jeux ou les coups font décififs, où chaque événement
fait perdre ou gagner quelque choie : de plus ,
ces fortes de jeux remuent l’ame fans exiger une attention
férieufe dont nous fommes rarement capables
; enfin on s’y jette par un motif d’avarice , dans
l’efpérance d’augmenter promptement fa fortune ; &
les hommes enrichis par ce moyen font rares dans
le monde, mais les pallions ne raifonnent ni ne calculent
jamais.
Ceux qui tirent avec Ducange l’étymologie du
mot jeu de de, du vieux Gaulois ju s de dé, auront
beaucoup de perfonnes de leur avis ; car nous fa-
vons que jus autrefois fignifioit jugement, que nos
anciens poètes ont dit De pour Dieu ; & perfonne
n’ignore que la fuperftition n’a fait que trop fouvent
intervenir la divinité dans les évenemens qui dépendent
entièrement du hafard. Art. de M. le Chevalier
de Jaucourt.
DÉ , (Anal, des hafards. ) Il eft vifible qu’avec
deux dés on peut amener trente-fix coups différens ;
car chacune des fix faces du dé peut fe combiner fix
fois avec chacune des fix faces de l’autre. De même
avec trois dés on peut amener 36 X 6 , ou 216 coups
différens : car chacune des 3 6 combinaifons des deux
dés peut fe combiner fix fois avec les fix faces du
troifieme dé. donc en général avec un nombre de dés
== rty le nombre des coups polfibles eft 6".
Donc il y a 3 j contre 1 à parier qu’on ne fera pas
rafle de 1 , de 2 , de 3 , de 4 , de 5, de 6 , avec deux
dés. Voyei Rafle. Mais on trôuveroit qu’il y a deux
maniérés de faire 3 , 3 de faire 4 , 4 de faire 5;, ç de
faire 6 , & 6 de faire 7 , 5 de faire 8 ,4 de faire 9 ,3
de faire 10, 2 de faire 1 1 , 1 de faire 12 ; ce qui eft
évident par la table fuivante qui exprime toutes les
36 combinaifons.