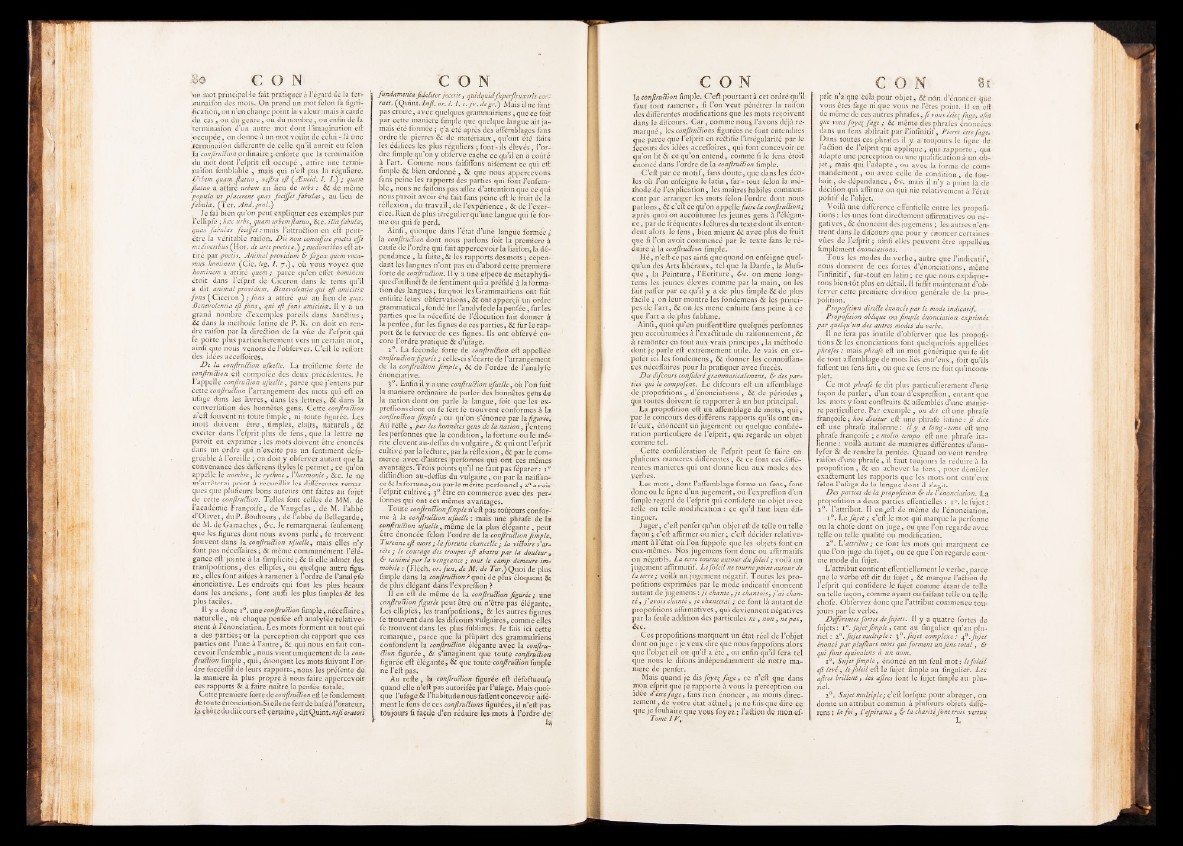
\ih mot principaHe fait pra'tiquèr à l’égard dè la terminaifon
des mots. On prend un mot félon fafigni-
frcatiôn, on n’en change point la valeur :mais à caufe
du cas ^pu du, genre, ou du nombre-, ou enfin de la
terminaifon d’un autre mot dont l ’imagination eft
occupée, on.donne à un mot voifin de celui-là une
.terminaifon differente de celle qu’il auroit eu félon
\a'conflruclion ordinaire ; enfôrte que la terminaifon
du mot dont l’efprit eft occupé , attire une ’terminaifon
femblable , mais qui n’eft pas la régulière.
Urbem quam flatuo, veflfa efl (Æneid. I. ƒ.) ; quant
flatuo a attiré urbem au Ii,eu de urbs : &c de même
populo ùt placèrent quas fecijfet fabulas -, au lieu de
fabula. (Ter. And. prol.j
Je fai bien qu’on peut expliquer ces exemples par
î ’ellipfc ; hcec urbs, quant urbemflatuo, &c. ilia fabula',
quas fabulas fecijfet : mais l’attrafrion en eft peut-
être la véritable raifon. DU non conceffere poetis effe
mediocribus (Hor. de arec poetica.) ; mediocribus eft attire
par poetis. Animal providum & fagax qüem voca~
miis hominem (Ci'c. leg. J. 7 . ) , où vous voyez que
hominem a attiré quem ; parce qu’en effet hominem
étoit dans l’efprit de Cicéron dans le tems qu’il
a dit animal providum. Benevolentia qui ejl amicitia
fons ( Cicéron ) ; forts a attiré qui au lieu de quai
Benevolentia efl. fons, qui efl fons amicitia. Il y a un
grand nombre d’exemples pareils dans Sanfrius ;
& dans la méthode latine de P. R. on doit en rendre
raifon par la direfrion de la vue de l’efprit qui
fe porte plus particulièrement vers un certain mot,
ainfi que nous venons de l’obferver. C ’eft le refiort
des idées accefloires.
De la conflruclion ufuelle. La troifieme forte de
conflruclion eft compofée des deux précédentes. Je
l ’appelle conflruclion ufuelle, parce que j’entenspar
cette conflruclion l’arrangement des mots qui eft en
iifagé dans.les livres, dans les lettres, & dans la
converlatipn des honnêtes gens. Cette; conflruclion
n’eft fouvent ni toute fimple, ni toute figurée. Les
mots doivent être , fimples, clairs, n a tu re ls&
exciter dans l’efprit plus de fens, que la lettre ne
paroît en exprimer ; les mots doivent être énoncés
dans un ordre qui n’excite pas un fentiment defa-
gréable à l’oreille ;.on doit y obferver autant que la
convenance des différens ftyle.s le permet ; ce qu’On
appelle le nombre, le rythme , l’harmonie, &c. Je ne
m’arrêterai point à recueillir les differentes remarques
que plufieurs bons auteurs ont faites au fujet
de cette conflruclion. Telles font celles de MM. de
l’académie Françoife, de Vaugelas , de M. l’abbé
d'Olivet, du P. Bouhours, de' l’abbé de Bellegarde,
de M. de Gamaches, &c. Je remarquerai feulement
que les figures dont nous avons parlé, fe trouvent
fouvent dans la conflruclion ufuelle, mais elles n’y
font pas néceffaires ; & même communément l’élégance
eft jointe à la fimplicité ; & li elle admet des
tranfpofitions, des ellipfes, ou quelque autre figure
, elles font aifées à ramener à l’ordre de l’asnalÿfe
énonciative. Les endroits qui font les plus beaux
dans les anciens, font aulli les plus fimples & les
plus faciles*
Il y a donc i°. une conflruclion fimple, néceffaire ,.
naturelle, où chaque penfée eft analyfée relativement
à rénonciation. Les mots forment un tout qui
a des parties ; or la perception du rapport que ces
parties ont l’une à l’autre, & qui nous en fait concevoir
l’enfemble,. nous vient uniquement de la con-
firuclion fimple, qui, énonçant les mots fuivant l’ôr-.
dre fucceflifde leurs rapports,nous.les préfente de
la maniéré la plus propre à nous faire appercevoir
«es rapports & à faire naître la penfée totale.
Cette première forte de conflruclion eft le fondement
de toute ertonciation.Si elle ne ferf de bafé àl’orateur,
i» chute du difcçurs eft certaine, dit Quint, nifioratorï
fundatnenta fideliter jecerit, quidquidfuperflruxerit cdrï
ruet. (Quint./«/?, or. 1.1. c. jv . degr. j Mais il ne faut
pas croire, ayec quelques grammairiens, que ce foit
par cette maniéré fimple que quelque.langtie ait jamais
été formée ; ç’a été après des affemblages fans
ordre de pierres & de matériaux , qu’ont été faits
les édifices les plus réguliers ; font - ils élevés, l’ordre
fimple qu’on y obfervè cache ce qu’il en à coûté
à l’art. Comme nous faififlons aifément de qui eft
fimple & bieh ordonne , & que nous appefcevons
fans peine les rapports des parties qui font l’enfem-
ble, nous ne faifons.pâs affez d’attention que ce qui
nous paroît avoir été fait fans peine eft le fruit de la
reflexion, du travail, de l’expérience, & de l’exercice.
Rien de plus irrégulier qu’iine langue qui fe forme
ou qui fe perd.
Ainfi, quoique daiis l’étât d’uhè lahgüe formée
là conflruclion dont nous parlons foit la première à
caufe de l’ordre qui fait appercevoir la liaifon, la dépendance
, la fuite, & les rapports des mots ; cependant
les langues n’ont pas eu d’abord cette première
forte de conflruclion. Il y a une efpece de métaphyfi-
que d’inftinfr & dé fentiment qui a préfidé à la formation
des langues ; furqtioi les Grammairiens ont fait
enfuitè leurs observations, & ont apperçu un Ordre
grammatical, fondé fur I’analyfe de la penfée, fur les
parties que' la néceflité de l’élocution fait donner à
la penfée, fur les lignes de ces parties, & fur le rapport
& le fervice de ces lignes. Us ont obfervé encore
l’Ordrè pratique & d’ufage:
z°. La fécondé forte de conflruclion eft appèlléé
conflruclion figurée ; celle-ci s’écarte de l’arrangement
de la conflruclion fimple, & de l’ordre de l’analyfe
énonciative.
3°. Enfin il y a une conflruclion ufuelle, Où Ton fuit
la maniéré ordinaire de parler des honnêtes gefts de
la nation dont on parle la langue, foit que les ex-
preffions dont on fe fert fe trouvent conformes à la
conflruclion fimple ; ou qu’on s’énonce par la figurée
Au refte , par les honnêtes gens de la nation, j’entens
les pérfonnes que la condition , la fortune ou le mérite
élevent au-defliis du vulgaire, & qui ont l’efprit
cultivé par la leôure; parla réflexion, & par le commerce
avec d’autres îperfonnes qui ont ces mêmes
avantages. Trois points qu’il ne faut pas féparer : i°
diftinfrion au-deffus du vulgaire, ou par la naiffan-
ce & la fortune, ou par le mérité perfonnel ; ±° avoir
l’efprit cultivé; 30 être en commerce avec des per-;
fonnes qui ont ces mêmes avantages.
Toute conflruclion fimple n’e ft pas toujours conforme
à la cohflruclion ufuelle : mais Unè phtafè de lai
conflruclion ufuelle, même de la plus élégante, peut
être énoncée félon l’ordre de la conflruclion fimple.
Turenne efl mort ; la fortune chancelle ; la victoire s’arrête
; le courage des troupes efl abattu par la douleur,
& ranimé par la vengeance ; tout le camp demeure immobile
: (Fléch. or.- fun. de M. de Tur.) Quoi de plus
fimple dans la conflruclion ? quoi dé plus éloquent &
de plus élégant dans l’expreflion ?
Il en eft de même de la conflruclion figurée ; une
cOnflfuction figurée peut être ou n’être pas élégante»
Les ellipfe’S, les tranfpofitions, & les autres figures
. fe trouvent dans les difcoûrs vulgaires, comme elles
fe trouvent dans les plus fùblimes. Je fais ici cette
remarque, parce que la plupart des grammairiens
confondent la conflruclion élégante avec la conflru-
ftion figurée, & s’imaginent que toiite conflruclion
figurée eft élégante, & que toute conflruclion fimple
: ne l’eft pas.
Au refte, la conflruclion figurée eft défe&ueufe
quand elle n’eft pas autorifée par l’ufage. Mais quoique
l’ufage & l’habitude nous faflent concevoir aifément
le fens de ces conftruclions figurées, il n’eft pas
toujours fi facile d’en réduire les mots à l’ordre de
* ‘ 1^
la conflruclion fimple. C ’eft pourtant à cét ordre qu’il
faut tout ramener, fi l’on veut pénétrer la raifon
des differentes modifications que les mots reçoivent
dans le difcoûrs. C a r , comme nou^ l’avons déjà remarqué
, les conflruclions figurées ne font entendues
que parce que l’efprit en reélifie l’irrégularité par le
iecours des idées accefloires, qui font concevoir ce
qu’on lit & ce qu’on entend, comme fi le fens étoit
énoncé dans l’ordre de la conflruclion fimple»
C ’eft par ce motif, fans doute, que dans les écoles
où l’on enfeigne le latin, fur - tout félon la méthode
de l’explication, les maîtres habiles commencent
par arranger les mots félon l’ordre dont nous
parlons, & c’eft ce qu’on appelle faire la conflruclion;
après quoi on accoûtume les jeunes gens à l’élégance
, par de fréquentes leftures du texte dont ils entendent
alors le fens, bien mieux & avec plus de fruit
que fi l’on avoit commencé par le texte fans le réduire
à la conflruclion fimple.
Hé, n’eft-ce pas ainfi que quand on enfeigne quelqu’un
des Arts libéraux, tel que la D anfe, la Mufi-
que , la Peinture, l’Écriture, &c. on mene long-
tems les jeunes éleves comme par la main, on les
fait pafler par ce qu’il y a de plus fimple & de plus
facile ; on leur montre les fondemens & les principes
de l’art, & on les mene enfuite fans peine à ce .
que l’art a de plus fublime.
Ainfi, quoi qu’en puiflentHire quelques perfonnes
peu accoutumées à l’exa&itude du ràiionnement, &
à remonter en tout aux vrais principes, la méthode
dont je parle eft extrêmement utile. Je vais en ex-
pofer ici les fondemens, & donner les connoiflan-
ces néceffaires pour la pratiquer avec fuccès.
Du difcoûrs confédéré grammaticalement, & des parties
qui le compofent. Le difcoûrs eft un affemblage
de propofitions, d’énonciations , & de périodes ,
qui toutes doivent fe rapporter à un but principal.
La propofition eft un affemblage de mots, qui,
par le concours des différens rapports qu’ils ont en-
tr’eux, énoncent un jugement ou quelque confidé-
ration particulière de l’efprit, qui regarde un objet
comme tel.
Cette confidération de l’efprit peut fe faire en
plufieurs maniérés différentes, & ce font ces différentes
maniérés qui ont donné lieu aux modes des
.verbes.
Les mots, dont l’affemblage forme un fens, font
donc ou le figne d’un jugement, ou l’expreflion d’un
fimple regard de l’efprit qui confidere un objet avec
telle ou telle modification : ce qu’il faut bien distinguer.
Juger, c’eft penfer qu’un objet eft de telle ou telle '
façon ; c’eft affirmer ou nier ; c’eft décider relativement
à l ’état où l’on fuppofe que les objets font en
eux-mêmes. Nos jugemens font donc ou affirmatifs
ou négatifs. La terre tourne autour du foleil; voilà un
jugement affirmatif. Le foleil ne tourne point autour de
la terre; voilà un jugement négatif. Toutes les propofitions
exprimées par le mode indicatif énoncent
autant de jugemens : je chante, je chamois, j ’ai chanté
, j ’avois chanté, je chanterai ; ce font là autant de
propofitions affirmatives, qui deviennent négatives
par la feule addition des particules ne , non , ne pas, ,
& c .
Ces propofitions marquent un état réel de l ’objet
dont on juge : je veux dire que nous fuppofons alors
que l’objet eft ou qu’il a été , ou enfin qu’il fera tel
que nous le difons indépendamment de notre ‘maniéré
de penfer.
Mais quand je dis foyeç fage , ce n’eft que dans
mon efprit que je rapporte à vous la perception ou
idee d'être fage, fans rien énoncer, au moins directement
, de votre état aéhiel ; je ne fais que dire ce
que je fouhaite que yous foyez ; l’afrion de mon ef-
Tome IP ,
p’fît n’à que céla pour objet, 61 non d’énoncer qtiè
; vous êtes fage ni que vous ne l’êtes point. Il en eft
de même de ces autres phrafes, f i yous étie^fage, afin
que vous foye^fage ; & même des phrafes énoncées
dans un fens abftrait par l’infinitif, Pierre être fagei.
Dans toutes ces phrafes il y à toujours le figne dô
l’aôion de l’efprit qui applique, qui rapporte qui
adapte une perception ou une qualification à un obje
t, mais qui l’adapte, ou avec la forme de commandement
, ou avec celle de condition, de fou-
hait, de dépendance, &c. mais il n’y a point là de
décifion qui affirme ou qui nie relativement à l’état
pofitif de l’objet.
I Voilà une différence effentielle .entre les propofi-
tiôns : les unes font direftement affirmatives ou négatives
, & énoncent des jugemens ; les autres n’entrent
dans le difcôurs que pour y énoncer certaines
vûes de ,l’efprit ; ainfi elles peuvent être appellées
fimplemeftt énonciations»
Tous les modes du verbe, autre que l’indicatif,
nous donnent de ces fortes d’énonciations, même
l’infinitif, fur-tout en latin ; ce que nous expliquerons
bien-tôt plus en détail. Il fuffit maintenant d’ob-
ferver cette première divifion générale de- la pro-
pofition.
Propofition directe énoncée par le mode indicatif
Propofition oblique ou fimple énonciation exprimée
par quelqu'un des autres modes du verbe »
Il ne fera pas inutile d’obferver que lés propofitions
& les énonciations font quelquefois appellées
phrafes : mais phrafe eft un mot générique qui fe dit
de tout affemblage de mots liés entr’eux, foit qu’ils
faflent un fens fini, ou que ce fens ne foit qu’incomplet.
Ce mot phrafe fe dit plus particulièrement d’une
façon de parler, d’un tour d’expreffion, entant que
les mots y font conftruits & affemblés d’une maniéré
particuliere. Par exemple , on dit eft une phrafe
françoife; hoc dicitur eft une phrafe latine : f i dict
eft une phrafe italienne : il y a lûng-tems eft une
phrafe françoife ; e molto tempo eft une phrafe italienne
: voilà autant de maniérés différentes d’ana-
lyfer & de rendre la penfée. Quand on veut rendre
raifpn d’une phrafe , il faut toujours la réduire à la
propofition, & en achever le fens , pour démêler
exa&ement les rapports que les mots ont entr’eux
félon l’ufage de la langue dont il s’agit.
Des parties de la propofition & de l'énonciation. La
propofition a deux parties effentielles : i° . le fujet :
a°. l’attribut. Il en.eft de même de l’énonciation.
i° . Le fujet ; c’eft le mot qui marque la perfonne
ou la chofe dont on juge, ou que l’on regarde avec
telle ou telle qualité ou modification.
i° . Vattribut ; ce font les mots qui marquent ce
que l’on juge du fujet, ou ce que l’on regarde comme
mode du fujet.
L’attribut contient effentiellement le verbe, parce
que le verbe eft dit du fujet, & marque l’a fri on de
refprit qui confidere le fujet comme étant de telle
ou telle façon, comme ayant ou faifant telle ou telle
chofe. Obfervez donc que l’attribut commence toujours
par le verbe.
Différentes fortes defujets. Il y a quatre fortes de
fujets: i°. fujetfimpie, tant au fingulier qu’au pluriel:
iP. fujet multiple : f i . fujet complexe: f i . fujet
énoncé par plufieurs mots qui forment un fens total, &
qui font équivalens a un nom.
i°. Sujet fimple, énoncé en un feui mot : lefoleil
efl levé, lé foleil eft le fujet fimple au fingulier. Lès
aflres brillent, les affres font le fujet fimple au pluriel
.2
°. Sujet multiple; c’eft lorfqüe pour abréger, on
donne un attribut commun à plufieurs objets différens
; lu foi » l'ejpérance , & la charité font trois vertus
L