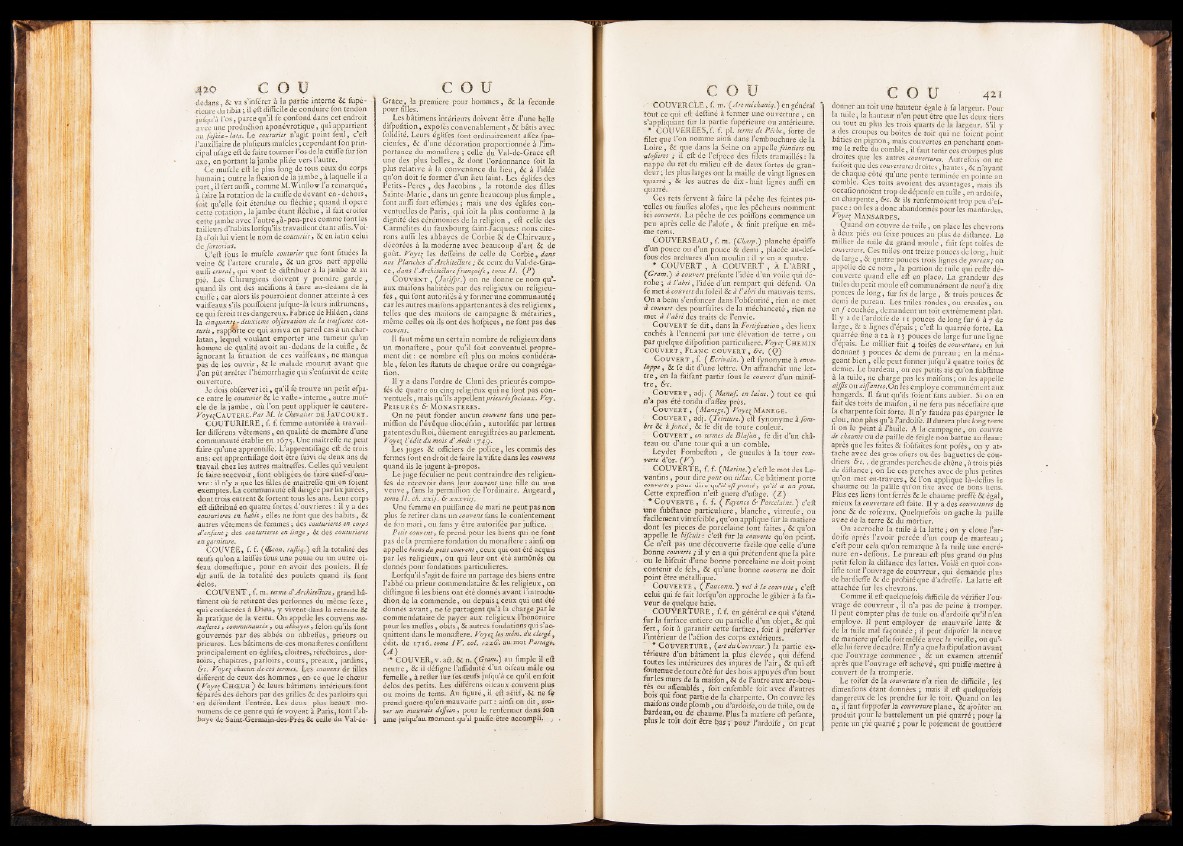
•dedans & va s’inférer à la partie interne & fupé-
rieure du tibia ; il eft difficile de conduire fon tendon
jufqu’à l’os, parce qu’il fe confond dans cet endroit
avec une production aponév-rotique, qui appartient
au fajcia-Lata. Le couturier n’agit point feul, c’eft
l’auxiliaire de plufieurs mufcles ; cependant fon principal
ufage eft de faire tourner l’os de la cuiffe fur fon
axç, en portant la jambe pliée vers l’autre.
Ce mufçle eft le plus long de tous ceux du corps
humain ; outre la flexion de la jambe, à laquelle il a
.part, il fert aufli, comme M. Winflow l’a remarque,
à faire lu rotation de la cuiffe de devant en - dehors,
qû’çlle foit étendue ou fléchie ; quand il opéré
cette rotation, la jambe étant fléchie, il fait croifer
cette jambe avec l’autre, à-peu-près comme font les
tailleurs d’habits lorfqu’ils travaillent étant aflis. Voilà
d’çfli lui vient le nom de couturier, 6c en latin celui
de fartorius. r
Ç ’eft fous le mufcle couturier que font fituees la
veine î’artere crurale, 6c un gros nerf appelle
aufli cruralx qui vont fé diftribuer à la jambe & au
pié. Les, Chirurgiens doivent y prendre garde ,
quand ils ont des inçifions à faire au-dedans de la
cuiffe ; car alors ils pourroient donner atteinte à ces
vaiffeaux s’ils pouffoient jufquq-là leurs inffrumens,
ce qui fefoit très-dangereux, Fabrice de Hilden, dans
la cinquante^ deuxieme observation de La trofierne centurie
, rappwte ce qui arriva en pareil cas à un charlatan,
lequel voulant emporter une tumeur qu’un
homme de qualité avoit au-dedans de la cuiffe, 6c
ignorant la fituation de ces vaiffeaux, ne manqua
pas de leç ouvrir, 6c le malade mourut avant que
l ’on put arrêter l ’hémorrhagie qui s’enfuivit de cette
ouverture,
Je dois, obferveriçi, qu’il.fe trouve un petit efpa-
ce entre le. couturier 6c le vaffe - interne, autre mufcle
de la jambe, QU l’on peut appliquer le cautere.
FojeiC^UTERE.Par M. Le Chevalier D.E JAUCOURT.
COUTURIERE, f. f. femme- autorifée à travailler
différens. vêtemens , en qualité de membre d’une
communauté établie en 1675. ^ ne maîtreffe ne. peut
faire qu’une apprentiffe'. L’apprentiflagé efl de trois
ans,: cet apprentiffage doit être fuivi de, deux ans de
travail chez les autres maîtreffes. Celles qui veulent
fe faire recevoir , font obligées de faire chef-d’oeuvre
: il n’y a que les filles de maîtreffe qui en foient
exemptes. La communauté eft dirigée par fix jurées,
do.nt trois entrent & fortent tous les ans. Leur corps
eft diftribué en quatre fortes, d’ouvrieres : il y a des
couturières en. habit, elles ne font que des habits, 6c
autres vêtemens de; femmes, ; des couturières en corps
d'enfant ; des couturières, en linge , & des. couturières
en garniture.
COUVÉE, f. f. ( Güçon. rufiiqS) eft la totalité des
oeufs qu’on a laifles fous une poule ou un. autre, oi-
feau domeftique, pour en avoir des, poulets. U fe
dit aufli de la. totalité des poulets quand ils. font
éclos.
COUVENT, f. m. terme- d'Architecture y grand bâtiment
où fe-retirent des perfonnes du même fexe ,
qui confaci-ées à Dieu., y vivent dans la retraite 6c
la pratique de la vertu. On appelle, les couvens mo-
nafleres, communautés , ou abbayes y félon qu’ils font
gouvernés par des abbés ou abbeffes, prieurs, ou
prieures. Les bâtimens de ces monafteres confiftent
principalement en églifes, cloîtres, réfe&oires, dortoirs,
chapitres, parloirs, cours, préaux, jardins-,
&c. Voye^ chacun de-ces termes. Les couvens de filles
different de ceux- des hommes , en- ce que le1 choeur
( VoyetK'- C h oe u r ) 6c. leurs bâtimens intérieurs-font
feparés des dehors par des grilles & des parloirs qui
■ en défendent - l’entrée. Les deux plus beaux mo-
numens de ce genre qui fe voyent à Paris , font l’abbaye
de Saint-Germa|n-des-Prés 6c celle du Val-de-
Grâce, la premiers pour hommes, & la fécondé
pour filles.
Les bâtimens intérieurs doivent être d’une belle
difpofition, expofés convenablement, 6c bâtis avec
fohdité. Leurs églifes font ordinairement affez fpa-
cieufes, 6c d’une décoration proportionnée à l’importance
du monaftere ; celle du Vabde-Grace eft
une des plus belles, 6c dont l’ordonnance foit la
plus relative à la convenance du lieu, & à l’idée
qu’on doit fe former d’un lieu faint. Les églifes des
Petits -Pere.s , des Jacobins , la rotonde des filles
Sainte-Marie, dans un genre Beaucoup plus Ample ^
font aufli fort eftimées ; mais une des églifes conventuelles
de Paris, qui foit la plus conforme à la
dignité des cérémonies de la religion , eft celle des
Carmélites du fauxbourg faint-Jacques : nous citerons
aufli les abbayes de Corbie & de Clairvaux,
décorées à la moderne avec beaucoup d’art 6c de
goût. Voye^ les deffeins de celle de Corbie, dans
nos'Planches d'Architecture ; 6c ceux du Val-de-Gra-
c e , dans VArchitecture françoife , tome II. (T)
C o u v e n t , (’Juriflpr.) on ne donne ce nom qu’aux
maifons habitées par des religieux ou religieu-
fes, qui font autorifés à y former une communauté;
caries autres maifons appartenantes à des religieux,
telles que des maifons de campagne & métairies,
même celles où ils ont des hofpices, ne font pas des
couvens.
Il faut même un certain nombre de religieux dans
un monaftere, pour qu’il foit conventuel proprement
dit : ce nombre eft plus ou moins confidéra-
ble, félon les ftatuts de chaque ordre ou congrégation.
Il y a dans l’ordre de Cluni des prieurés compo-
fés de quatre ou cinq religieux qui ne font pas conventuels
, mais qu’ils appellent prieurés faciaux. Voy+
P r i e u r é s 6* M o n a s t è r e s .
Qn ne peut fonder aucun couvent fans une per-
miflion de l’évêque diocéfain, autorifée par lettres
patentes du Roi, clûement enregiftrées au parlement.
Voye{ L'édit du mois d'Août 174$.
Les juges & officiers de police, les commis des
fermes font en droit de faire la vifite dans les couvens
quand ils le jugent à-propos.
Le juge féculier ne peut contraindre des religieu-
fes de recevoir dans leur couvent une fille ou une
veuve , fans la permiflîon de l’ordinaire. Augeard ,
tome, II. ch,, x x ij. & xxxviij.
Une femme en puiffance de mari ne.peut pas nom
plus fe retirer dans un couvent fans le confentement
de fon mari, ou fans, y être autorifée par juftice.
Petit couvent, fe prend pour les biens qui ne font
pas de-la première fondation du monaftere : ainfî ou
appelle biens du petit couvent, ceux qui ont été acquis
par les religieux, ou qui leur ont étéaumônés ou
donnés pour fondations particulières.
Lorfqu’il s’agit de faire un partage des biens entre
l’abbé ou prieur commendataire & le s religieux, on
diftingue files biens ont été donnés avant l’introdiir
étiouae la commende,. ou depuis ; ceux qui ont été
donnés avant, ne fe partagent qu’à la charge par le
commendataire de payer aux religieux l’honoraire
pour les meffes, obits, & autres, fondations qui s’acquittent
dans le monaftere. Voye^ Les mèm. du clergé ,
édit, de 1716. tome IV . col. 122G. au.mot Partagée
(A )
m COUVER, v .aft. 6c n.(Gram.) au Ample il eft
neutre, 6c il défigne l’afliduité d’un oifeau mâle ou
femellie, à relier lur fes oeufs jufqu’à ce qu’il en foit
éclos, des petits. Les différens oileaux couvent plus
ou moins de tems. Au figuré , il eft a â if , 6c ne fe
prend guere qu’en mauvaife part : ainfi on dit,. couver
un mauvais dejfein, pour le renfermer dans fou
ame jufqu,’au moment, qu’il puiffe.être accompli. >
- COUVERC LE, f. tn. (A n rhéchaniq) èn général
tout ce qui eft deftiné à fermer une ouverture , en
s’appliquant fur la partie fupérieure ou antérieure.
* COUVERÉES, f. f . pl. terme de Pêche, forte de
filet que l’on nomme ainfi dans l’embouchure de la
Loire, 6c que dans la Seine on appelle feintiers ou
■ alojieres ; il eft de l’efpece des filets tramaillés : la
nappe du ret du milieu eft de deux fortes de grandeur
; les plus larges ont la maille de vingt lignes en
■ quarré , & les autres de dix - huit lignes aufli en
quarré.
Ces rets fervent à faire là pêche des feintes pu-
xrelles ou fauffes alofes, que les pêcheurs nomment
ici couverts. La pêche de ces poiffons commence un
peu après celle de l’alofe, & finit prefque en même
tems.
COUVERSEAU, f. m. (Charp.') planche épaiffe
d’un pouce ou d’un pouce & demi, placée au-def-
fous dés archures d’un moulin : il y en a quatre.
* COUVERT , À COUVERT * À L ’ABRI ,
{Gram.') à couvert préfente l’idée d’un voile qui dérobe
; à L'abri, l’idée d’un rempart qui défend. On
■ fe met à couvert du foleil & à L'abri du mauvais tems.
On a beau s’enfoncer dans l’obfeurité, rien ne met
■ à couvert des pourfuites dé la méchanceté, rien ne
met à l'abri des traits de l’envie.
C o u v e r t fe dit, dans là Fortification, des lieux
cachés à l’ennemi par une élévation de terre , ou
par quelque difpofition particulière. Voye^ C h e m in
c o u v e r t , F l a n c c o u v e r t , &c. (Q )
C o u v e r t , f . ( Ecrivain. ) eft fynonyme à enveloppe
, & fe dit d’une lettre. Ori affranchit une lett
re , en la faifant partir fous le couvert d'un minif-
tre , &c.
C o u v e r t , adj. ( Manuf. en laine. ) tout ce qui
n’a pas été tondu d’affez près.
C O U V E R T , ( Manege. ) Voye^ M a n e g e .
C o u v e r t , adj. (Teinture.) eft fynonyme àfam-
hre & à foncé, & fe dit de toute couleur.
C o u v e r t , en termes de Blafon, fe dit d’un château
ou d’une tour qui a un comble.
Leydet Fombefton , de gueules à la tour couverte
d’or. (V )
COUVERTE, f. f. (Marine.) c’eft le mot des Levantins
, pour dire pont ou tilldc. C e bâtiment porte
■ couverte, pour dire qu’i/ efl ponté -y qu'il a un pont.
Cette expreflion n’eft guere d’ufage. (Z )
' * C o u v e r t e , f. f. (Fayence G Porcelaine.) c’eft
tine fubftance particulière, blanche, vitreufè, ou
facilement vitrefcible, qu’on applique fur la matière
dont les pièces de porcelaine font faites, & qu’on
appelle le bifeuit ; c’eft fur la couverte qu’on peint.
Ce n’eft pas une découverte facile que celle d’une
bonne couverte ; il y en a qui prétendent que la pâte
bu le bifeuit d’une bonne porcelaine ne doit point
contenir de feis, & qu’une bonne couverte ne doit
point être métallique.
C O U V E R T E , (Fauconn.) vol à la couverte, c’eft
celui qui fe fait lorfqn’on approche le gibier à la faveur
de quelque haie.
COUVERTURE, f. f. en général ce qui s’étend
fur la furface entière ou partielle d’un objet, & qui
fert, foit à garantir cette furface, foit à préferver
l ’intérieur de l’aâion des corps extérieurs.
* C o u v e r t u r e , (art du Couvreur.) la partie extérieure
d’un bâtiment la plus élevée, qui défend
toutes les intérieures des injures de l’air, & qui eft
foutenue de tout côté fur des bois appuyés d’un bout
furies murs de la maifon, & de l’autre aux arc-boutés
ou affemblés , foit enfemble foit avec d’autres
bois qui font partie de la charpente. On couvre lès
maifons oude plomb ,ou d’ardoife, ou de tuile, ou de
bardeau, ou de chaume. Plus la matière eft pefante,
plus le toit doit' être bas ;'pont l’ardoife, on peut
donner àu toit une hauteur égale à fa largeur. Pour
la tuile, la hauteur n’en peut être que les deux tiers
ou tout au plus les trois quarts de la largeur. S’il y
a des croupes ou boîtes de toit qui ne foient point
bâties enpignon, mais couvertes en penchant comme
le refte du comble, il faut tenir ces croupes plus
droites que les autres couvertures. Autrefois on ne
faifoit que des couvertures droites, hautes, & n-ayant
de chaque côté qu’une pente terminée en pointe au
comble. Ces toits avôient des avantages, mais ils
occafionhbient trop dedépenfe en tuile, en ardoife,
en charpente, &c. & ils renfermOient trop peu d’ef-
pace : oh les a donc abandonnés pour les manfardesi
Voye{ M a n s a r d e s .
Quand on couvre de tuile, on place lès chevrons
à deux piés ou feize pouces au plus de diftance. Le
millier de tuile du grand moule, fait fept toifes de
couverture. Ces tuiles ont treize pouces de long, huit
de large, & quatre pouces trois lignes de pureau; on
appelle de ce nom, la portion de tuile qui refte découverte
quand elle eft en place. La grandeur des
tuiles du petit moule efl: communément de neuf à dix
pouces de long, fur flx de large, & trois pouces ÖC
demi de pureau. Les tuiles rondes, ou creufes, ou
en J couchée, demandent un toit extrêmement plat-.
Il y a cle i’ardoife de 11 pouces de long fur 6 à 7 de
large, & 2 lignes d’épais ; c’eft la quarrée forte. La
quarrée fine a 12 à 13 pouces de large fur une ligne
d’epais. Le millier fait 4 toifes de couverturey en lui
donnant 3 pouces & demi de pureau ; en la ménageant
bien, elle peut former jufqu’à quatre toifes èc
demie. Le bardeau, ou ces petits àis qu’on fubftitue
à la tuile, ne charge pas les maifons; on les appelle
aijfls ou aiflantes.On les employé communément aux
hangards. Il faut qu’ils foient fans aubier. Si On en
fait des toits de maifon, il ne fera pas néceffaire que
la charpente foit forte. Il n’y faudra pas épargner le
clou, non plus qù’à l’ardoife. Il durera plus long tems
fi on le peint à l'huile. A la campagne, on couvre
de chaume oit de paille de feigle non battue au fléau :
après que les faîtes & foûfaîtes font pofés, on y attache
avec dés gros ofiers ou des baguettes de coudriers
& c .. de grandes perches de chêne, à trois piés
de diftance ; on lie ces perches avec de plus petites
qu’on met en-travers, 6c l’on applique là-deffus le
chaume ou la paille qu’on fixe avec de bóns liens.
Plus ces liens lont ferrés & le chaume preffé & égal,
mieux la couverture eft faite. Il y a des couvertures de
jonc & de rofeaux. Quelquefois on gâche la paille
avec de la terre & du mortier.
On accroché la tuile à la latte ; on y cloue l’ar-
doife après l’avoir percée d’un coup de marteau ;
c’eft pour cela qu’on remarque à la tuile une encré-
nure en -deffous. Le pureau eft plus grand ou plus
petit félon la diftance des lattes. Voilà en quoi con-
lifte tout l’ouvrage de couvreur, qui demande plus
de hardieffe & de probité que d’adreffe. La latte eft
attachée fur les chevrons.
Comme il eft quelquefois difficile de vérifier l’ouvrage
de couvreur, il n’a pas de peine à tromper.
Il peut compter plus de tuile ou d’ardoife qu’il n’en
employé. Il peut employer de mauvaife latte &
de la tuile mal façonnée ; il peut dilpofer la neuve
de maniéré qu’elle foit mêlée avec la vieille, ou qu’elle
lui ferve de cadre. Il n’y a que la ftipitlation avant
que l’ouvrage commence , & un examen attentif
après que l ’ouvrage eft achevé, qui puiffe mettre à
couvert de la tromperie.
Le toifer dé la couverture n’a rien de difficile , leS
dimenfions étant données ; mais il eft quelquefois
dangereux de les prendre fur le toit. Quand on les
a , il faut fuppofer la couverture plane, & ajouter au
produit pour le battelement un pié quarré; pour la
pente un pié quarré ; pour le pofement de gouttière