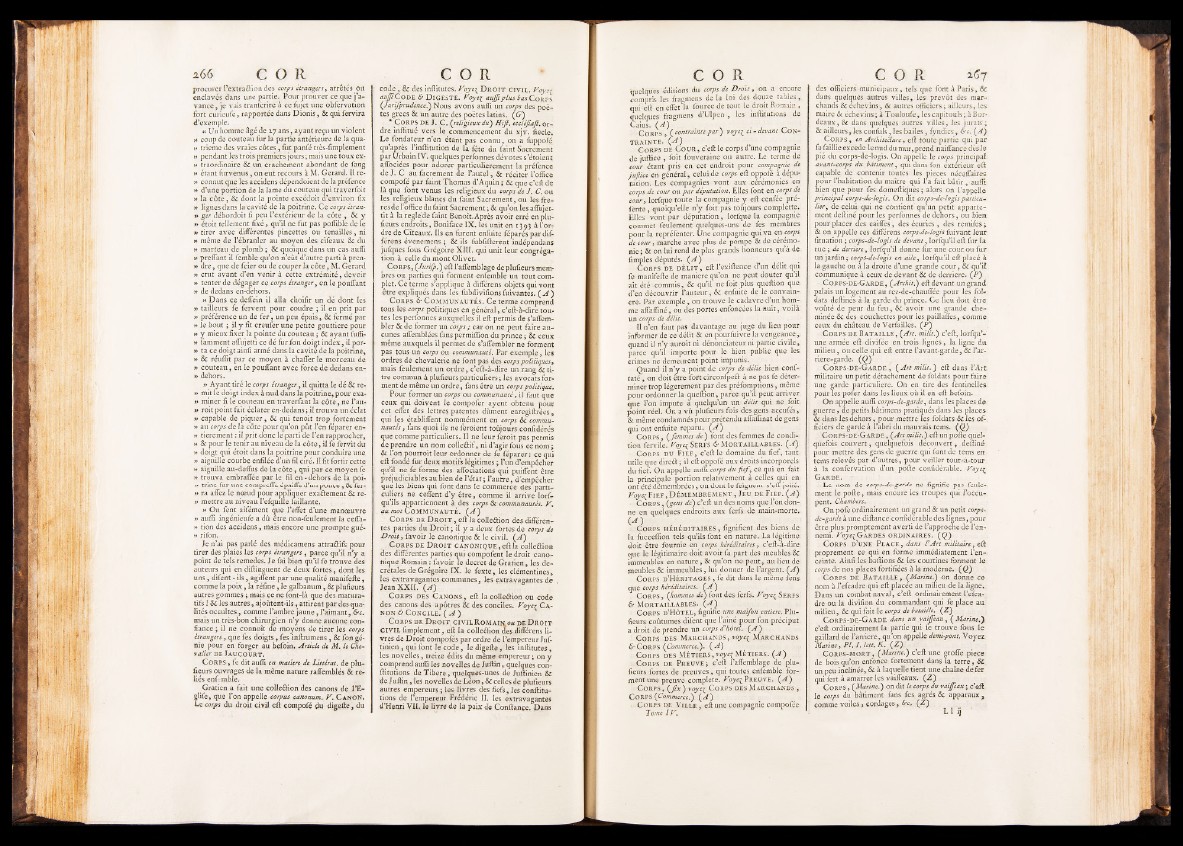
procurer l’extraftion des corps étrangers, arrêtés ou
enclavés dans une partie. Pour prouver ce que j’avance
, je vais tranlcrire à ce fujet une obfervation
fort curieufe, rapportée dans Dionis, & qui fervira
d’exemple.
« Un homme âgé de 27 ans, ayant reçu un violent
» coup de couteau fur la partie antérieure de la qua-
» trieme des vraies côtes, fut panfé très-fimplement
w pendant les trois premiers jours ; mais une toux ex-
» traordinaire & un crachement abondant de fang
» étant furvenus, on eut recours à M. Gérard. Il re-
» connut que les accidens dépendoient de lapréfence
» d’une portion de la lame du couteau qui traverfoit
» la côté, & dont la pointe excédoit d’environ fix
» lignes dans la cavité de la poitrine. Ce corps étran-
y> ger débordoit li peu l’extérieur de la côte , & y
» étoit tellement fixé , qu’il ne fut pas pofiiblè de le
» tirer avec différentes pincettes ou tenailles, ni
r> même de l’ébranler au moyen des cifeaux & du
» marteau de plomb ; & quoique dans un cas aufii
» preffant il femble qu’on n’eût d’autre parti à pren-
» dre, que de feier ou de couper la côte, M. Gérard
» crut avant d’en venir à cette extrémité, devoir
» tenter de dégager ce corps étranger, en le pouffant
» de dedans en-dehors.
» Dans ce deffein il alla choifir un dé dont les
» tailleurs fe fervent pour coudre ; il en prit par
» préférence un de fe r , un peu épais, & fermé par
» le bout ; il y fit creufer une petite gouttière pour
»> y mieux fixer la pointe du couteau ; & ayant fuffi-
»> famment affujetti ce dé fur fon doigt index, il por-
» ta ce doigt ainfi armé dans la cavité de la poitrine,
» & réuffit par ce moyen à chaffer le morceau de
» couteau, en le pouffant avec force de dedans en-
» dehors.
» Ayant tiré le corps étranger, il quitta le dé & re-
» mit le doigt index à nud dans la poitrine, pour exa-
» miner li le couteau en traverfant la côte, ne l’au-
» roit point fait éclater en-dedans ; il trouva un éclat
» capable de piquer, & qui tenoit trop fortement
» au corps de la côte pour qu’on pût l’en féparer en-
» tierement : il prit donc le parti de l’en rapprocher,
» & pour le tenir au niveau de la côte, il fe fervit du
» doigt qui étoit dans la poitrine pour conduire une
» aiguille courbe enfilée d’un fil ciré. II fit fortir cette
»> aiguille au-deffus de la cô te , qui par ce moyen fe
» trouva embraffée par le fil en - dehors de la poi-
» trine fur une compreffe épaiffe d’un pouce, & fer-
» ra affez le noeud pour appliquer exaétement &c re-
» mettre au niveau l’efquille taillante.
» On fent aifément que l’effet d’une manoeuvre
» aufii ingénieufe a dû être non-feulement la ceffa-
» tion des accidens, mais encore une prompte gué-
» rifon.
Je n’ai pas parlé des médicamens attractifs pour-
tirer des plaies les corps étrangers , parce qu’il n’y a
point de tels remedes. Je fai bien qu’il fe trouve des
auteurs qui en diftinguent de deux fortes, dont les
uns, difent - ils, agiflent par une qualité manifefte,
comme la poix, la réfine, le galbanum, & plufieurs
autresgommes ; mais ce ne font-là que des matura-
tifs I & les autres, ajoûtent-ils, attirent par des qualités
occultes, comme l’ambre jaune, l’a im an t&c.
mais un très-bon chirurgien n’y donne aucune confiance
; il ne connoît de moyens de tirer les corps
étrangers, que fes doigts, fes inftrumens, & fort génie
pour en forger au befoin. Article de M. le Chevalier
de Jaucourt.
Corps , fe dit aufii en matière de Littéral, de plufieurs
ouvrages de la même nature raffemblés & reliés
enf.mble.
Gratien a fait une collection des canons de l ’E-
glife, que l’on appelle corpus canonum. V. Canon.
Le corps du droit ciyil eft compofé du digefte, du
code, ôc des inflitutes. Voye^ D r o it civil, Foyer
auffiCode & D igeste. Voye{ auffiplus bas Corps
(Jurifprudence.) Nous avons aufii un corps des poètes
grecs & un autre des poètes latins. (G)
* Corps DE J. c . (religieuxdu) Hijft. eccléfiaft. ordre
inftitué vers le commencement du xjv. fiecle.
Le fondateur n’en étant pas connu, on a fuppofé
qu’après l’inftitution de la fête du faint Sacrement
par Urbain IV. quelques perfonnes dévotes s ’étoient
affociées pour adorer particulièrement la préfence
de J. C au facrement de l’autel, & réciter l’office
compofé par faint Thomas d’Aquin 5 &; que c’eft de
là que font venus les religieux du corps de J. C. ou
les religieux blancs du faint Sacrement, ou les frères
de l’office du faint Sacrement ; & qu’on les affujet-
tit à la réglé de faint Benoît. Après avoir erré en plufieurs
endroits, Boniface IX. les unit en 1393 à l’ordre
de Cîteaux. Ils en furent enfuite féparés par dif-
férens évenemens ; & ils fubfifterent indépendans
jufques fous Grégoire XIII. qui unit leur congrégation
à celle du mont Olivet.
Corps, (Jurifp.) efi l’affembiage de plufieurs membres
ou parties qui forment enfemble un tout complet.
Ce terme s’applique à différens objets qui vont
être expliqués dans les fubdivifions fuivantes. ( A )
Corps 6* C ommunautés. Ce terme comprend
tous les corps politiques en général, c’eft-à-dire toutes
les perfonnes auxquelles il efi permis de s’affem-
bler & de former un corps; car on ne peut faire aucunes
affemblées fans permiflion du prince ; & ceux
même auxquels il permet de s’affembler ne forment
pas tous un corps ou communauté. Par exemple, les
ordres de che valerie ne font pas des corps politiques,
mais feulement un ordre, c’efl-à-dire un rang & titre
commun à plufieurs particuliers ; les avocats forment
de même un ordre, fans être un corps politique.
Pour former un corps ou communauté, il faut que
ceux qui doivent le compofer ayent obtenu pour
cet effet des lettre^ patentes dûment enregiftrées,
qui les établiffent nommément en corps & communautés
, fans quoi ils ne feroient toûjours confidérés
que comme particuliers. Il ne leur feroit pas permis
de prendre un nom collectif, ni d’agir fous ce nom ;
& l’on pourroit leur ordonner de fe féparer : ce qui
efi fondé fur deux motifs légitimes ; l’un d’empêcher
qu’il ne fe forme des affociations qui puiffent être
préjudiciables au bien de l ’état ; l’autre, d 'empêcher
que les biens qui font dans le commerce des partir
culiers ne ceffent d’y être, comme il arrive lorsqu'ils
appartiennent à des corps & communautés. V\
au mot Communauté. (A )
Corps de Dro it , efi la collection des différentes
parties du Droit ; il y a deux fortes de corps de
Droit, favoir le canonique & le civil. (A )
Corps de Dro it canonique , efi la collection
des différentes parties qui compofent le droit canonique
Romain : favoir le decret de Gratien, les décrétâtes
de Grégoire IX. le fexte;, les clémentines ,
les extravagantes communes, les extravagantes de
Jean XXII. (A )
Corps des Canons » efi la collection ou code
des canons des apôtres & des conciles. Voye^ Canon
& Concile. ( A )
Corps de D ro it , civil Romaik^ok de Dr o it
Civ il Amplement, efi la collection des différens livres
de Droit compofés par ordre de l’empereur Juf-
tinien, qui font le code, 1e digefte, les inflitutes ,
les novelles, treize édits du même empereur ; on y
comprend aufii les novelles de Juftin, quelques con-
fiitutions de Tibere, quelques-unes de Juftinien &
de Juftin, tes novelles de Léon, & celtes de plufieurs
autres empereurs ; les livres des fiefs, tes conftitu-
tions de l’empereur Frédéric II. les extravagantes
d’Henri V II. 1e livre de la paix de Confiance. Dans
quelques éditions du corps de Droit, -on a encore
compris les fragmens de là loi des douze tables.,
qui-efi en effet la fource de tout 1e droit Romain ,
quelques fragmens d’Ulpen , tes inftitutions de
Caius. (A ) I - CORPS , ( contrainte par) voye£ ci-devant CONTRCAINTE.
(A ) . orps de Cour , c’eft 1e corps d une compagnie
de juftice , foit fouveraine ou autre. Le terme de
cour étant pris en cet endroit pour compagnie de
juftice en général , celui de corps eft oppofé à députation.
Les compagnies vont aux cérémonies en
corps de cour ou par députation. Elles font en corps de
cour, lorfque toute la compagnie y efi cenfée pré-
fente, quoiqu’elle n’y foit pas toûjours complette.
Elles vont par députation, lorfque la compagnie
commet feulement quelques-uns de fes membres
pour la repréfenter. Une compagnie qui va en corps
de cour, marche avec plus de pompe & de cérémonie;
& on lui rend de plus grands honneurs qu’à de
fimples députés. (A )
: C orps de délit , efi l’exiftence d’un délit qui
fe manifefle de maniéré qu’on ne peut douter qu’il
ait été- commis, & qu’il ne foit plus queflion que
d’en découvrir l’auteur, & enfuite de 1e convaincre.
Par exempte, on trouve 1e cadavre d’un homme
affafliné, ou des portes enfoncées la nuit, voilà
un corps de délit.
Il n’en faut pas davantage au juge du lieu pour
informer de ce délit & en pourfuivre la vengeance,
quand il n’y auroit ni dénonciateur ni partie civile,
parce qu’il importe pour 1e bien public que tes.
crimes ne demeurent point impunis.
Quand il n’y a point de corps de délit bien conf-
faté, on doit être fort circonfpeCt à ne pas fe déterminer
trop légèrement par des préfomptions, même
pour ordonner la queflion , parce qu’il peut arriver,
que l’on impute à quelqu’un un1 délit, qui ne foit*
point réel. On a vû plufieurs fois des gens acçufés,
& même condamnés pour prétendu affaflinat de gens ,
qui ont enfuite reparu. (A ) Corps., (.femmes de ) font des femmes de condi-j
tion fervile. Voye^ Serfs & Mortaillables. (A).
■ Corps du Fie f , c’eft 1e domaine du fief, tant,
utile que direét ; il efi oppofé aux droits incorporels
du fief. On appelle aufii corps du fief., ce qui en fait
la principale portion relativement à celles qui en
ont été démembrées, ou dont le feigneur s’eft joué.
Foyei Fief , D émembrement , Jeu de Fie f. (A):.
■ Corps , (gens de) c’eft un des noms que l’on donne
en quelques endroits aux ferfs;;de main-morte.
y ) ;
- C orps héréditaires , fignifient des biens de
la fucceflion tels qu’ils font en nature. La légitime
doit être fournie en corps héréditaires, c’eft-a-dire
que le légitimaire doit avoir fa part des meubles &
immeubles en nature, & qu’on ne: peut, au lieu de
meubles & immeubles, lui donner de l’argent. (A)
Corps d’Héritages , fe dit dans le même lens.
que corps héréditaires. ( A )
Corps , (hommes de) font des ferfs. Voye^ Seres
& Mortaillables. (A )
■ CORPS D’Hôtel, fignifie une maifon endere. Plufieurs
coutumes difent que l’aîné pour fon préciput
a droit de prendre un corps d'hôtel. (A ) Corps des Marchands, voye^ Marchands
& Corps (Commerce.). (A ) Corps des Métiers, voye^Métiers. (A ) Corps de Preuve; c’eft l’affembiage de plufieurs
fortes de preuves , qui toutes, enfemble forment
une preuve complété. Voye^ Preuve. (A ) Corps, (fix)voye^ Corps des Marchands ,
Corps (Commerce.) (A ). • . : C orps dæ Vil le, eftune compagnie compofée
Tome I F’,
des officiers municipaux, tels que font à Paris, &
dans quelques autres villes, les. prévôt des marchands
& eche-vins, & autres officiers ; ailleurs, tes
maire & échevins ; à Touloufe, tes capitouls ; à Bordeaux
, & dans quelques autres villes, tes jurats ;
& ailleurs, tes eonfuls, tes bailes, fyndics, &c. (A)
Corps , en Architecture, efi toute partie qui par
fa faillie excede le nud du mur, prend naiffance dès le
pié du corps-de-logis. On appelle 1e corps principal
avant-corps du bâtiment, qui dans fon extérieur eft
capable de contenir toutes tes pièces néceffaires
pour l’habitation du maître qui l’a fait bâtir, aufii
bien que pour fes-domeftiquès ; alors on l’appelle
principal corps-de-logis. On dit.corps-de-logis particulier,
de celui- qui ne contient qu’un petit appartement
deftiné pour tes perfonnes de dehors, ou bien
pour placer des caifles, des écuries , des remifes ;
& on appelle ces différens corps-de-logis fuivant leur
fituation ; corps-de-logis de devant, lorfqu’il eft fur la
rue ; de derrière, lorfqu’il donne fur une cour., ou fur
un jardin ; corps-de-logis en aile, lorfqu’il eft placé à
la gauche ou à la droite d’une grande cour, & qu’il
communique à ceux de devant & de derrière. (P)
- Corps-de-Garde, (Archit.) eft devant un grand
palais un logement au rez-de-chauffée pour les fol-
dats deftinés à la garde du prince. Ce lieu doit être
voûté de peur du feu, & avoir une grande cheminée
& des couchettes pour tes paillaffes, comme
ceux du château de Verfailles. (P) Corps de Bataille, (Art. milit.) c’eft, lorfqu’-'
une armée eft divifée en trois lignes, la ligne du
milieu, ou celte qui eft entre l’avant-garde, & l’ar-
riere-garde. (Q)
. Corps-de-Garde , ( Art milit. ) eft dans l’Art
militaire un petit .détachement de foldats pour faire
une garde particulière. On en tire des fentinelles-
pour les pofer dans les lieux oit il eh eft befoin.
On appelle aufii corps-de-garde, dans tes places de
guerre, de petits bâtimens pratiqués dans tes places
& dans les:dehors, pour mettre les foldats &Ies of*.
liciers de garde à l’abri du irçauvais tems. (Q) Corps-de-Garde, (Are milit.) eft un pofte quelquefois
couvert, quelquefois découvert, .deîliné
pour mettre des gens de guerre qui font de tems en
tems relevés par d’autres, pour veiller tour-à-tour.
à la confervation d’un pofte confidérable. Voye^
Garde, f
Le nom de corps-de-garde ne fignifie pas feulement
le pofte, mais encore tes troupes qui l’occupent.
Chambers.
On pofe ordinairement un grand & un petit corps-,
de-garde à une diftance confidérable des lignes, pour
être plus promptement averti de l’approche de l’ennemi.
Voye[Gardes ordinaires. (Q)
. Corps d’une Place, dans l'Art militaire, eft
proprement ce qui en forme immédiatement l’en-,
ceinte. Ainfi les baftions & les courtines forment le
corps de nos places fortifiées à la moderne. (Q) Corps de Bataille,.{Marine.) on donne ce
nom à l’efcadre qui eft placée au milieu de la,ligne,.
Dans un combat naval, c’eft ordinairement,1’efca-;
dre ou la divifion du commandant qui fe place au
milieu, & qui fait le. corps de bataille. (Z) CorpS-DE-Garde dans un yaiffeau, ( Marine.)
c’eft ordinairement la partie qui fe trouve fous, le
gaillard de Parrieré, qu’on appelle demi-pont Voyez:
Marine, PI. I. lett K . (Z ) ^ Corps-mort , (Marine.) c’eft une groffe piece
de bois qu’on enfonce fortement dans la terre, &
un peu inclinée, & à laquelle tient une chaîne de fer
qui fert à amarrer tes vaiffeaux, (Z ) CORPS, (Marine.) on dit le corps du vaijfeau ; c’eft
le corps du bâtiment fans fes. agrès ôc apparaux ,
comme voiles., cordages, &c. CZ) L 1 ij