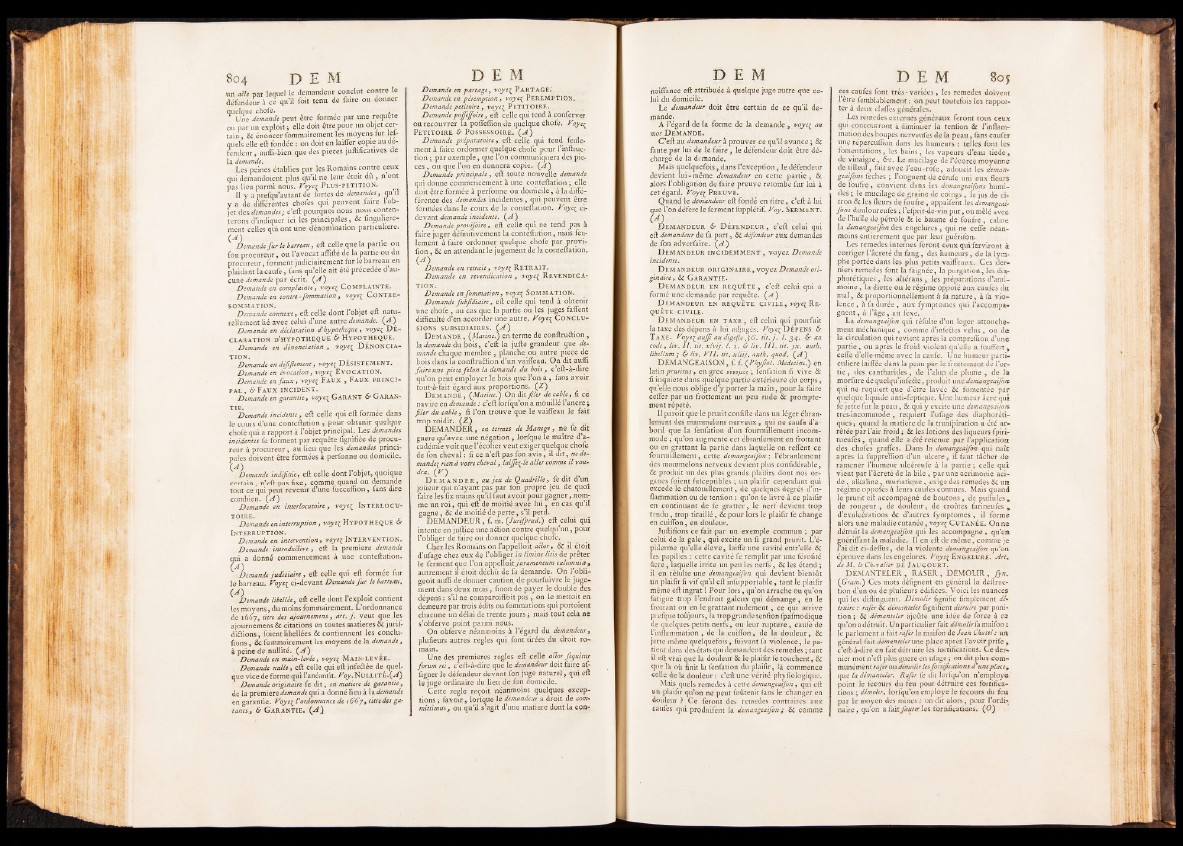
un a3e par lequel le demandeur conclut contre le
défendeur à ce qu’il foit tenu de faire ou donner
quelque chofe. - , a.
Une demande, peut être formée par une requête
ou par un exploit ; elle doit être pour un objet certain
, & énoncer fommairement les moyens fur lesquels
elle eft fondée : on doit en laifler copie au defendeur
, aufli-bien que des pièces juftificatives de
la demande.
Les peines établies par les Romains contre ceux
qui demandoient plus qu’il ne leur étoit dû , n ont
pas lieu parmi nous. Voye%. Plus-pet itio n.
Il y a prefqu’ autant de fortes de demandes, qu il
y a de différentes chofes qui peuvent taire 1 objet
des demandes; c’eft pourquoi nous nous contenterons
d’indiquer ici les principales, & finguhere-
ment celles qui ont une dénomination particulière.
ÇA)
Demande fur le barreau, eft celle que la partie ou
fon procureur, ou l’avocat aflifte de la partie ou du
procureur, forment judiciairement fur le barreau en
plaidant la caufe, fans qu’elle ait été précédée d’aucune
demande par écrit. {A )
Demande en complainte, voyei C omp lainte.
Demande en contre -fommation, voye{ CoNTRE-
SOMMATION.
Demande connexe, eft celle dont l’objet eft naturellement
lié avec celui d’une autre demande, pgajjl
Demande en déclaration d'hypotheque , voye£ DECLARATION
d’hypotheque 6* Hy po theq u e.
Demande en dénonciation , voye[ DÉNONCIATION.
Demande en défiflement, voye[ DESISTEMENT.
Demande en évocation, voyeç ÉVOCATION.
Demande en faux, voyeç Faux , FAUX PRINCIPAL,
& Faux in ciden t.
Demande en garantie, voye[ GARANT & GARAN-
TIE. . ' J
Demande incidente, eft celle qui eft formée dans
le cours d’une conteftation , pour obtenir quelque
chofe qui a rapport à l’objet principal. Les demandes
incidentes fe forment par requête fignifîée de procureur
à procureur, au lieu que les demandes principales
doivent être formées à perfonne ou domicile.
ÇA)
Demande indéfinie, eft celle dont l’objet, quoique
certain, n’eft pas fixe, comme quand on demande
tout ce qui peut revenir d’une fucceflion, fans dire
combien. ÇA')
Demande en interlocutoire, voye£ INTERLOCUTOIRE.
Demande en interruption , voye[ HYPOTHEQUE O*
Interruption.
Demande en intervention, voyq Interv ent ion.
Demande introductive , eft la première demande
qui a donné commencement à une conteftation.
^ Demande judiciaire, eft celle qui eft formée fur
le barreau. Voye{ ci-devant Demande fur le barreau.
Demande libellée, eft celle dont l’exploit contient
les moyens, du moins fommairement. L’ordonnance
de 1667, titre des ajournemens, art. j . veut que les
ajournemens & citations en toutes matières & jurif-
diélions, foient libellées & contiennent les conclu-
iions, & fommairement les moyens de la demande ,
à peine de nullité. ÇA)
Demande en main-levée, voye£ MAIN-LEVÉE.
Demande nulle , eft celle qui eft infe&ée de quelque
vice de formequi l’anéantit. Voy. Nu l l it é .(yf)
Demande originaire fe dit, en matière de garantie,
de la première demande qui a donné lieu à la demande
en garantie, Voye^ l'ordonnance de 166J , titre df s garants.,
& G a ran tie, ÇA)
Demande en partage, voyc%_ PARTAGE*
Demande en péremption , voye[ PEREMPTION.
Demande petitoire , voye£ PETITOIRE.
Demande poffeffoire, eft celle qui tend à conferver
ou recouvrer la pofleffionde quelque chofe. Voyt^_
Pet ito ir e & Possessoire. ÇA)
Demande préparatoire, eft celle qui tend feulement
à faire ordonner quelque chofe pour l’inftruç-
tion ; par exemple, que l’on communiquera des pièces
, ou que l’on en donnera copie. ÇA )
Demande principale, eft toute nouvelle demand,e
qui donne commencement à une conteftation ; elle
doit être formée à perfonne ou domicile, à ladiffé-
férence des demandes incidentes, qui peuvent être
formées dans le cours de la conteftation. Vyyeç ci-
devant demande incidente. ÇA )
Demande provifoire, eft celle qui ne tend pas à
faire juger définitivement la conteftation, mais feulement
à faire ordonner quelque chofe par provi-
fion, & en attendant le jugement de la conteftation.
ÇA )
Demande en retrait, voyeç Re t r a it .
Demande en revendication , voye{ REVENDICATION.
■ .
Demande en fommation, voyeç SOMMATION.
Demande fubjidiaire, eft celle qui tend à obtenir
une chofe, au cas que la partie ou les juges faffent
difficulté d’en accorder une autre. Voye{ C onclusions
subsidiaires. ÇA)
D emande , ÇMarine.) en terme de conftru&ion,
la demande du bois, c’eft la jufte grandeur que demande
chaque membre , planche ou autre piece de
bois dans la conftru&ion d’un vaifleau. On dit auffi
faire une piece félon la demande du bois, c’eft-à-dire
qu’on peut employer le bois que l’on a , fans avoir
tout-à-fait égard aux proportions,. ÇZ)
DEMANDE, ÇMarine.) On dit filer de cable, fi ce
navire en demande : c’eft lorfqu’on a mouillé l’ancre ;
filer du cable, fi l’on trouve que le vaifleau le fait
trop roidir. ÇZ)
DEMANDER, en termes de Manège , ne fe dit
guere qu’avec, une négation, lorfque le maître d’académie
voit que l’écolier veut exiger quelque chofe
de fon cheval : fi ce n’eft pas fon avis , il ait, ne demande^
rien à votre cheval, laiffe^le aller comme i l voudra.
çv) ’■ \ . : -
D e m a n d e r , au jeu de Quadrille, fe dit d’un
joueur qui n’ayant pas par fon propre jeu de quoi
faire les fix mains qu’il faut avoir pour gagner, nomme
un ro i, qui eft de moitié avec lu i, en cas qu’il
gagne, & de moitié de perte, s’il perd.
DEMANDEUR, f. m. ÇJurifprud.) eft celui qui
intente en juftice une a&ion contre quelqu’un, pour
l’obliger de faire ou donner quelque chofe.
Chez les Romains on l’appelloit aclor, & il étoit
d’ufage chez eux de l’obliger in limine litis de prêter
le ferment que l’on appellent juramentum calumnioe,
autrement il étoit déchu de fa demande. On l’obli-
geoit aufli de donner caution de pourfuivre le jugement
dans deux mois, finon de payer le double des
dépens : s’il ne comparoifloit pas , on le mettoit en
demeure par trois édits ou fommations qui portoient
chacune un délai de trente jours ; mais tout cela ne
s’obferve point parmi nous.
On obferve néanmoins à l’égard du demandeur,
plufieurs autres réglés qui font tirées du droit romain.
Une des premières réglés eft celle aclor fequitur
forum rei, c’eft-à-dire que le demandeur doit faire af-
figner le défendeur devant fon juge naturel > qui eft
1 le juge ordinaire du lieu de fon domicile.
Cette réglé reçoit néanmoins quelques exceptions
; favoir, lorfque le demandeur a droit de com*
mittimus, ou qü’il s^agit d’une matière dont là connoiflance
eft attribuée à quelque juge autre que celui
du domicile.
Le demandeur doit être certain de ce qu’il demande.
A l’égard de la forme de la demande , voyeç au
mot D emande.
C’eft au demandeur à prouver ce qu’il avance ; &
faute j)ar lui de le faire, le défendeur doit être décharge
de la demande,
Mais quelquefois, dans l’exception, le défendeur
devient lui-même demandeur en cette partie, &
alors l’obligation de faire preuve retombe fur lui à
cet égard. Voye% Preuve.
Quand le demandeur eft fondé en titre, c’eft à lui
que l’on déféré le ferment fupplétif. Voy. Serment. — I I D emandeur & D efendeur , c’eft celui qui
eft demandeur de fa part, 6c défendeur aux demandes
de fon adverfaire. ÇA )
Demandeur incidemment , voyez Demande
incidente.
D emandeur originaire , voyez Demande originaire,
& Garantie.
D emandeur en requête , c’eft celui qui a
formé une demande par requête. Ça )
D emandeur en requête civile, voyei Requête
civile.
D emandeur en tax e , eft celui qui pourfuit
la taxe des dépens à lui adjugés. Voye^ D épens &
Taxe. Vyye^ aujji au digejle j 6~. t it.j. I. 3 4 . & au
code, liv. II. tit. xlvij. I. 2. & liv. III. tit. jx . auth.
libellum ; & liv. VII. tU.xUij. auth. quod. ÇA)
DEMANGEAISON, f. f. ÇPhyfiol. Médecine.) en
latin pruritus, en grec mm/aos ; fenfation fi vive &
fi inquiété dans quelque partie extérieure du corps,
qu’elle nous oblige d’y porter la main, pour la faire
cefler par un frottement un peu rude & promptement
répété.
Il paroît que le prurit confifte dans un léger ébranlement
des mammelons nerveux , qui ne caufe d’abord
que la fenfation d’un fourmillement incommode
; qu’on augmente cet ébranlement en frottant
ou en grattant la partie dans laquelle on relient ce
fourmillement, cette demangeaifon : l’ébranlement
des mammelons nerveux devient plus confidérable,
& produit un des plus grands plailirs dont nos organes
foient fufceptiblès ; un plaifir cependant qui
excede le chatouillement, de quelques degrés d’inflammation
ou de tenfion : qu’on fe livre à ce plaifir
en continuant de fe gratter, le nerf devient trop
tendu, trop tiraillé, & pour lors le plaifir fe change
en cuiflon, en douleur.
Juftifions ce fait par un exemple commun ; par
celui de la gale, qui excite un fi grand prurit. L’épiderme
qu’elle éleve, laifîe une cavité entr’elle &
les papilles : cette cavité fe remplit par une férofité
âcre, laquelle irrite un peu les nerfs, & les étend ;
il en rélulte une demangeaijon qui devient bientôt
un plaifir fi v if qu’il eft infupportable, tant le plaifir
même éft ingrat ! Pour lors, qu’on arrache ou qu’on
fatigue trop l ’endroit galeux qui démange, en lé
frottant ou en le grattant rudement, ce qui arrive
prefque toûjours, la trop grande tenfion fpafmodique
de quelques petits nerfs, ou leur rupture, caufe de
l’inflammation , de la cuiflon, de la douleur, &
jette même quelquefois, fuivant fa violence, le patient
dans des états qui demandent des remedes ; tant
il eft vtai que la douleur & le plaifir fe touchent, &
que là ôii finit la fenfation du plaifir, là commence
celle de la douleur : c’eft une vérité phyfiologique.
Mais quels remedes à cette demangeaifon, qui eft
un plaifir qu’on ne peut foütenir fans le changer en
douleur ? Ce feront de* remedes contraires aux
CAïues qui produifent la demangeaifon ; Ôc comme
ces catifes font très - variées , les remedes doivent
l’être femblablement : on peut toutefois les rapporter
à deux clafles générales,
Les remedes externes généraux feront tous ceux
qui concourront à diminuer la tenfion & l’inflammation
des houpes nerveufes de la peau, fans caufe?
une répereuflion dans les humeurs : telles font les
fomentations, les bains, les vapeurs d’eau tiede,
de vinaigre, & c . Le mucilage de l’écorce moyenne
de tilleul, fait avec l’eau-rofe, adoucit les deman-
geaifons feches ; l’onguent de cérufe uni aux fleurs
de foufre, convient dans les demangeaifons humides
; le mucilage.de graine de coings , le jus de citron
& les fleurs de foufre, appaifent les demangeaifons
douloureufes ; l’efprit-de-vin pur, ou mêlé avec
de l’huile de pétrole & le baume de foufre , calme
la demangeaifon dès engelures , qui ne cefle néanmoins
entièrement que par leur guérifon.
Les remedes internes feront ceux qui ferviront à
corriger i ’âcreté du fang, de$ humeurs, de la lymphe
portée dans les plus petits vaifleaux. Ces .derniers
remedes font la faignée, la purgation, lès dià-
phorétiques , les altéfans , les préparations d’antimoine
, la diette ou le régime oppolé aux caufes du
mal, & proportionnellement à fa nature, à fa violence
, à fa durée , aux fymptomes qui. l’accompagnent
j à l’âge, au fexe.
La demangeaifon qui réfulte d’un leger attouchement
méchanique , comme d’infe&es velus , ou de
la circulation qui revient après la compreflion d’une
partie, ou après le froid violent qu’elle a fouffert ,
cefle d’elle-même avec la caufe. Une humeur particulière
laiflee dans la peau par le frottement de l’ortie
, des cantharides, de l’aluji de plume , de la
morfure de quelqu’infecte, produit une demangeaifon
qui ne requiert que d’être lavée & fomentée par
quelque liquide anti-feptique. Une humeur âcre qut
fe jette fur la peau, & qui y excite une demangeaijon
très-incommode , requiert l’ufage des diaphoniques
, quand la matière de la tranfpiration a été arrêtée
par l’air froid ; & les lotions des liqueurs fpiri-
tueufes , quand elle a été retenue par l’application
des chofes grades. Dans la demangeaifon qui naît
après la fuppre’flion d’un ulcéré, il faut tâcher de
ramener l’humeur ulcéreufe à la partie ; celle qui
vient par l’âcreté de la bile , par une acrimonie acid
e, alkaline, muriatique, exige des remedes & un
régime oppofés à leurs caufes connues. Mais quand
le prurit eft accompagné de boutons , de pullules p
de rougeur , de douleur, de croûtes farineufes „
d’exulcerations & d’autres fymptomes , il forme
alors une maladie cutanée, voye^ C u t a n é e . On ne
détruit la demangeaifon qui les accompagne, qu’en
guériflant la maladie. Il en eft de même, comme je
l’ai dit ci-defliis, de la violente demangeaifon qu’on
éprouve dans les engelures. Foye^ E n g e l u r e . Art*
de M. le Chevalier DE J AU COURT.
DÉMANTELER , RASER , DÉMOLIR , fyn*
ÇGram.) Ces mots défignent en général la deftruc-
tion d’un ou de plufieurs édifices, Voici les nuances
qui les diftinguent. Démolir lignifie Amplement détruire
: rafer & démanteler lignifient détruire par punition
; & démanteler ajoûte une idée de force à ce
qu’on a détruit. Un particulier fait démolir!à raaifon z
le parlement a fait rafer la maifon de Jean Chatel; un
général fait démanteler une place après l ’avoir prife ,
c’eft-à-dire en fait détruire les fortifications. Ce dernier
mot n’eft plus guere en ufage ; on dit plus Communément
rafer ou démolir les fortifications d'une place„
que la démanteler. Rafer fe dit lorfqu’on n’employe
point le lecours du feu pour détruire ces fortifications
; démolir, lorfqu’on employé le fecours du feu
par le moyen des mines : on dit alors, pour l’ordinaire
, qu’on a fait J'auta- les fortifications. (U)