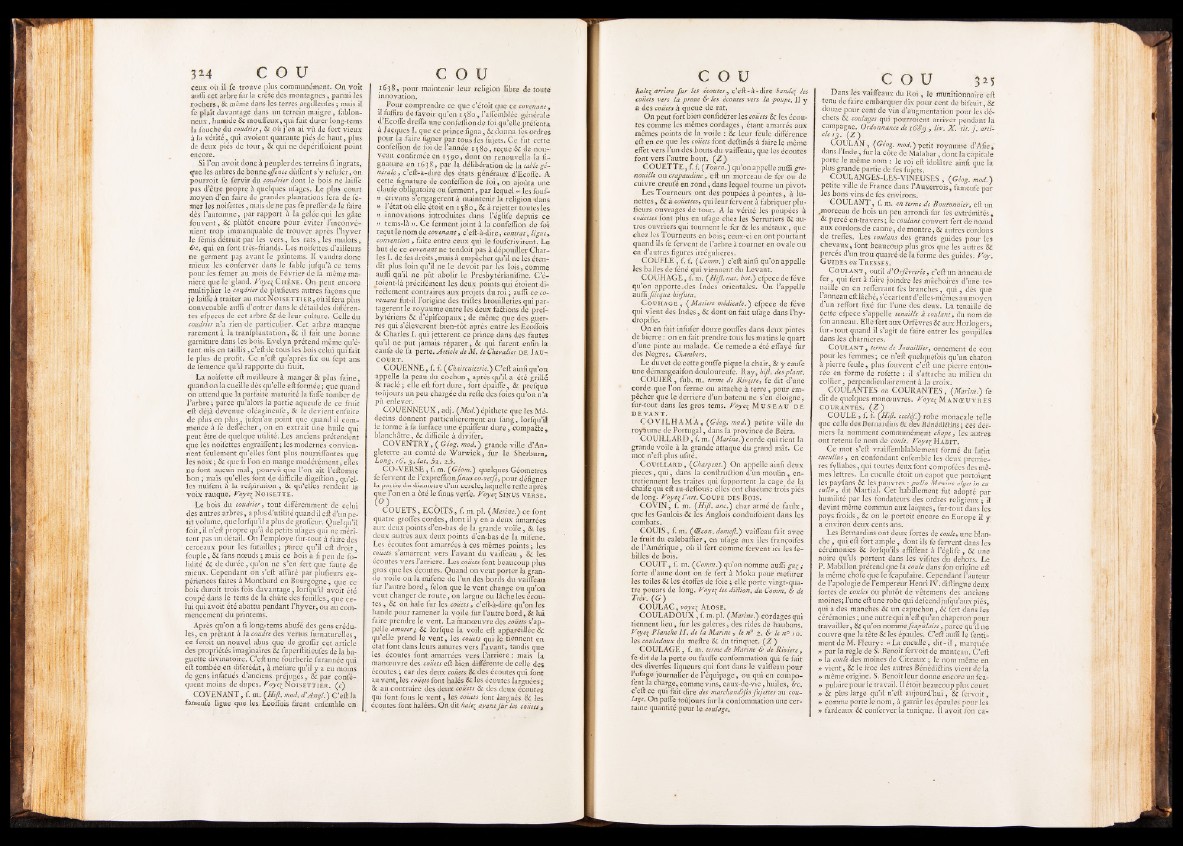
ceux ofi il fe trouve plus communément. On voit
aufli c,et arbre fur la crête des montagnes, parmi les
r.ochers, & même dans les terres argilleufes ; mais il
fe plaît davantage dans un terrein maigre, fablon-
neux, humide 8c moufleux, qui fait durer long-tems
la fouche du coudrier, & p ù j’en ai vu de fort vieux
à la vérité, qui avoi.ent quarante pies çle haut, plus
de deux pies de tour, & qui ne dépériflbient point
encore.
Si l’on avoit donc k peupler des terrains fi ingrats,
que les arbres de bonne cffence duflent s’y refufer, on
pourrait fe fervir du coudrier dont le bois ne laifle
pas d’être propre à quelques ufages. Le plus court
moyen d’en faire de grandes plantations fera dç fe-
mer les noifettes, mais de ne pas fe preffer de Je faire
dès l’automne, par rapport à la gelée qui les gâte
fouvent, .& plutôt encore pour éviter l’inconvénient
trop immanquable de trouver après l’hyver
le fénÙS détruit par les vers, les rats , le$ mulots,
&c. qui en font très-friands. Les noifettes d’ailleurs
ne germent pas avant le printems. II vaudra donc
mieux les conferver dans le fable jufqu’à ce tems
pour les femer au mois de Février de la même maniéré
que le gland. Voye^ C hêne. On peut encore
multiplier le coudrier de plufieurs autres façons que
je laifle à traiter au motNpiSETTiER,oùilfera plus
convenable aufli d’entrer dans le détail des différentes
efpeces de cet arbre 8c de leur culture. Celle du
coudrier n’a rien de particulier. Cet arbre manque
rarement à la tranfplantation, & il fait une bonne
garniture dans les bois. Evelyn prétend même qu’étant
mis en taillis, c’eft de tous les bois celui qui fait
le plus de profit. Ce n’eft qu’après fix ou fept ans
de femence qu’il rapporte du fruit.
La noifette eft meilleure à manger & plus faine,
quand on la cueille dès qu’elle eft formée ; que quand
on attend que la parfaite maturité la fafle tomber de
l ’arbre ; parce qu’alors la partie aqueufe de ce fruit
eft déjà devenue oléagineufe, & le devient enfuite
de plus en plus, jufqu’au point que quand il commence
à fe deffécher, on en extrait une huile qui
peut être de quelque utilité. Les anciens prétendent
que les noifettes engraiflent ; les modernes conviennent
feulement qu’elles font plus nourriflantes que
les noix ; 8c que li l’on en mange modérément, elles
ne font aucun mal, pourvû que l’on ait l’eftomac
bon ; mais qu’elles font de difficile digeftion, qu’elles
nuifent à la refpiration , & qu’elles rendent la
voix rauque. Voye^ Noisette.
Le bois, du coudrier, tout différemment de celui
des autres arbres, a plus d’utilité quand il eft d’un petit
volume, que lorfqu’il a plus de groffeur. Quelqu’il
fôit, il n’eft propre qu’à de petits ufages qui ne méritent
pas un détail. On l’employe fur-tout à faire des
cerceaux pour les futailles ; pterce qu’il eft droit
fouple, 8c fans noeuds ; mais ce bois a fi peu de fo-
lidité 8c de durée, qu’on ne s’en fert que faute de
mieux. Cependant on s’eft aflîiré par plufieurs expériences
faites à Montbard en Bourgogne, que ce
bois duroit trois fois davantage, lorfqu’il avoit été
coupé dans le tems de la chûte des feuilles, que celui
qui avoit été abattu pendant l’hyver, ou au commencement
du printems.
Après qu’on a fi long-tems abufé des gens crédules
, en prêtant à la coudre des vertus furnaturelies
ce feroit un nouvel abus que de groflir cet article
des propriétés imaginaires 8c fuperftitieufes de la baguette
divinatoire. C’eft une fourberie furannée qui
eft tombée en diferédit, à mefure qu’il y a eu moins
de gens infatués d’anciens préjugés, 8c par confisquent
moins de dupes. Voye^ Noîsettier. (c)
CO VENANT, f. m. (Hift. mod. déAngl.) C ’eft la
fameufe ligue que les, Ecoflois firent enfemhfe en
.1638, pour maintenir leur religion libre de toute
innovation.
Pour comprendre qe que c’étoit que ce covenant,
il fuffira defavoir qu’en 1580, l’ affemblée générale
d Eçoffe drefla une confeflion de foi qu’elle préfenta
à Jacques I, que ce prince figna, & donna fes ordres
P°ur la faire ligner par tous fes fujets. Ce fut cette
confeflion de foi de 1 année 1 ç 80, reçue 8c de nouveau
confirmée en 1590, dont on renouvella la fi^
gnatiij-e en 163 8 , par la délibération de la table générale
, c’eft-k-dire des états généraux d’Ecoffe. A
çette fignature de confeflion de fo i, on ajouta une
çlaufe obligatoire o.u ferment, par lequel « les fouf-
>i çrivaus s’engagèrent à maintenir la religion -dans
» l’état où elle étoit en 15 80, 8c à rejetter toutes les
» innovations introduites dans l’églife depuis ce
» tems-là ». Ce ferment joint à la confeflion de foi
reçut le nom de covenant, ç’eft-à-dire, contrat, ligue,
convention , faite entre ceux qui le fouferivirent. Le
but de ce covenant ne tendoit pas à dépouiller Charles
I. de fes droits, mais à empêcher qu’il ne les étendît
plus loin qu’il ne le devoit par les lois, comme
aufli qu’il ne put abolir le Presbytérianifme. C ’é-
^toient-là préçifément le.s deux points qui étoient directement
contraires aux projets du roi ; aufli ce co-
venant fut-il l’origine des triftes brouilleries qui partagèrent
le royaume entre les deux faÇtions de presbytériens
8c d’épifeopaux ; de même que des guerres
qui s’élevèrent bien-tôt après entre les Ecoflois
& Charles I. qui jetterent çe prince dans des fautes
qu’il ne put jamais réparer, & qui furent enfin la
caufe de fa perte. Article de M. le Chevalier de Jau-
ÇOURT.
COUENNE, f. f. ( Chaircuiterie.) C ’eft ainfi qu’on
appelle la peau du cochon, après qu’il a été grillé
& raclé ; elle eft fort dure, fort épaiffe, & prefque
toujours un peu chargée du refte des foies qu’on n’a
pu enlever.
COUENNEUX, adj. (Med.) épithete que les Médecins
donnent particulièrement au fang, lorfqu’il
fe forme à fa furface une épaiffeur dure, compacte ,
blanchâtre, 8c difficile à divifer.
COVENTRY, ( Géog. mod. ) grande ville d’Angleterre
au comté de Warwick, fur le Sherburn,
Long. 1Ç. 3. lat. 5z , zô.
CO-VERSE, f. m. ( Glom.) quelques Géomètres
fe fervent de rexpreflionfinus co-verfe, pour çléfigner
la partie du diamètre d’un cercle, laquelle refte après
ue l’on en a ôté le finus verfe. Voyez Sinus verse. H WÊÊÊ COUE TS, ECOITS, f. m. pl. (Marine.) ce font
quatre groffes cordes, dont il y en a deux amarrées
aux deux points d’en-bas de la grande v o ile, & les
deux autres aux deux points d’en-bas de la milène.
Les écoutes font amarrées à çes mêmes points ; les
coiiets s’amarrent vers l’avant du vaifleau , 8c les
écoutes vers l’arriere. Les coiiets font beaucoup plus
gros que les écoutes. Quand on veut porter la grande
voile ou la mifene de l’un des bords du vaifleau
fur l’autre bord, félon que le vent change ou qu’on
veut changer de route, on largue ou lâche les écoutés
, 8c on haie fur les coiiets, c’eft-à-dire qu’on les
bande, pour ramener la voile fur l’autre bord, & lui
faire prendre le vent. La manoeuvre des coiiets s’appelle
amurer; 8c lorfque la voile eft appareillée 8c
qu’elle prend le vent, les coiiets qui le tiennent en
état font dans leurs amures vers l’avant, tandis que
les écoutes font amarrées vers l’arriere : mais la
manoeuvre des coiiets eft bien différente de celle des
écoutes ; car des deux coiiets 8c des écoutes qui font
gu vent, les coiiçts font halés 8c les écoutes larguées ;
& au contraire des deux coiiets & des deux écoutes
qui font fous le vent, les coiiets font largués 8c les
écoutes font halées. On dit hale^ ayant fur les coiiets ,
hale^ arriéré fur les écoutes, c’eft-à-dire bande( les
coiiets vers la proue •& les écoutes vers la poupe. Il y
a des coiiets à queue de rat.
On peut fort bien confidérer les coiiets 8c les écoutes
comme les mêmes cordages, étant amarrés aux
mêmes points de la voile : 8c leur feule différence
eft en ce que les coiiets font deftinés à faire le même
effet vers l’un des bouts du vaifleau , que les écoutes
font vers l’autre bout. (Z )
COUE TTE , f. f. (Tourné) qu’on appelle aufli grenouille
ou crapaudine, eft un morceau de fer ou de
cuivre creufé en rond, dans lequel tourne un pivot.
Les Tourneurs ont des poupées à pointes, à lunettes
, 8c à couettes, qui leur fervent à fabriquer plufieurs
ouvrages de tour. A la vérité les poupées à
couettes font plus en ufage chez les Serruriers & autres
ouvriers qui tournent le fer & les métaux, que
chez les Tourneurs en bois ; ceux-ci en ont pourtant
quand ils fe fervent de l’arbre à tourner en ovale ou
en d’autres figures irrégulières.
COUFLE , f. f. (Comm.) c’eft ainfi qu’on appelle
les balles de féné qui viennent du Levant.
COUHAGE, f. m. (Hijl.nat. bot.) efpece de fève
qu’on apporte.des Indes orientales. On l’appelle
aufli filiqua hirfuta.
Couhage , ( Matière médicale.) efpece de fève
qui vient des Indes, & dont on fait ufage dans l’hy*
cropifie.
On en fait infufer douze gOuffes dans deux pintes
de bierre : on en fait prendre tous les matins le quart
d’une pinte au malade. Ce remede a été effaye fur
des Negr.es. Chambers.
Le duvet de cette gouffe pique la chair, & y caufe
une démangeaifon douloureufe. Ray, hifi. des plant.
COUIER, fub. m* terme de Rivière, fe dit d’une
corde que l’on ferme ou attache à terre, pour empêcher
que le derrière d’un bateau ne s’en éloigne,
fur-tout dans les gros tems. Voyez Mu s e a u de
d e v a n t .
C O V IL H A M À , (Géog. mod.) petite ville du
royaume de Portugal, dans la province de Beira.
COUILLARD, f. m. (Marine.) corde qui tient la
grande voile à la grande attaque du grand mât. Ce
mot n’eft plus ufite.
Couillard , (Charpenté) On appelle ainfi deux
pièces, qui, dans la conftru&ion d’ün moulin , entretiennent
les traites qui fupportent Ja cage de la
chaife qui eft au-deffous : elles ont chacune trois piés
de long. Voye^l'art. Coupe des Bois.
CO VIN, f. m. (Hift- anc.) char armé de faulx,
que les Gaulois & les Anglois conduifoient dans les
combats.
COUIS, f. m. (ÜEcon. domeft.) vaifleau fait avec
le fruit du ealebaflier, en ufage aux îles françoifes
de l’Amérique, où il fert comme fervent ici les fe-
billes de bois.
CO U IT , f. m. (Comm.) qu’on nomme aufli guz;
forte d’aune1 dont on fe fert à Moka pour mefiirer
les toiles & les étoffes de foie ; elle porte vingt-quatre
pouars de long. Voye^ les diction, du Comm. & de
Triv. (G )
COULAC, voyeç Alose.
COULADOUX, f. m. pl. (Marine.) cordages qui
tiennent lieu, fur les galeres, des rides de haubans.
Voyez Planche II. de la Marine, le n° 2. & le n° / o.
les couladoux du meftre & du trinquet. (Z )
COULAGE, f. m. terme de Marine & de Riviere ,
fe dit de la perte ou fauflè confommation qui fe fait
des diverfes liqueurs qui font dans le vaifleau pour
l’ufage journalier de l ’équipage, ou qui en eompo-
fent la charge, comme vins, eaux-de-vie, huiles, &ci
c eft ce qui fait dire dès marchandifeS fujettes au coulage.
On pafle toftjours fur la confommation une certaine
quantité pour le coulage.
Dans les vaiffeaux du R o i, le munîtiôhnaîre eft
tenu de faire embarquer dix pour cent de bifcùit, 8c
douze pour cent de vin d’augmentation pour les déchets
& coulages qui pourraient arriver pendant la
campagne. Ordonnance de KPSa , liv. X . tit. /. artl-
cle,3 . ( Z )
COULAN , (Géog. niodé) petit royaume d’Afie *’
dans 1 Inde, fur la côte de Malabar, dont la capitale
porte le même nom : le roi eft idolâtre ainfi que la
plus grande partie de fes fujets.
COULANGES-LES-VINEUSES , (Géog. mod.)
petite ville de France dans l’Auxerrois, fameufe par
les bons vins de fes environs.
COULANT, f. m. en terme de Boutonhier, eft un
^morceau de bois un peu arrondi fur fes extrémités ,
& perce en-travers; le coulant couvert fert de noeud
aux cordons de Canne, de montre, & autres cordons
de treffes. Les coulans des grands guides pour les
chevaux, font beaucoup plus gros que les autres 8c
perces d un trou quarré de la forme des guidés. Voy.
Guides ou Tresses^
C oulant , outil dé Orfèvrerie, c’eft un arinéau de
fer, qui fert à faire joindre les mâchoires d’une tenaille
en en refferrant fes branches, qui j dès que
1 anneau eft lâché, s’écartent d’elles-mêmes au moyen
d’un reffort fixé fur l’une des deux. La tenaille de
cette efpece s’appelle tenaille à coulant, du nom de
fon anneau. Elle fert aux Orfèvres & aux Horlogers;
fur-tout quand il s’agit de faire entrer les goupilles
dans les charnières;
Coulant , terme de JouailUer, ornemeht de cou
pour les femmes; ce n’eft quelquefois qu’un chaton
à pierre feule, plus fouvent c’eft une pierre entourée
en forme de rofette : il s’attache au milieu du
collier, perpendiculairement à la croix.
COULANTES ou COURANTES, (Marinié) fe
dit de quelques manoeuvres. Voye^ Manoeuvres
COURANTES. ( Z )
CO ULE, f. f. (Hift. eccléf.) robe monacale telle
que celle des Bernardins & des Bénédictins ; ces derniers
la nomment communément chape, les autres
ont retenu le nom de coule. Voyez Habit.
Ce mot s’eft vraiffemblablement formé du latin
cucullus, en confondant enfemble les deux premières
fyllabes, qui toutes deux font compofées des mêmes
lettres. La cuculle étoit un capot que portoient
les payfans 8c les pauvres : pullo Moevius algst in cu-
cullo, dit Martial. Cet habillement fut adopté par
humilité par les fondateurs des ordres religieux ; il
devint même commun aux laïques, fur-tout dans les
pays froids , & on le portoit encore en Europe il y
a environ deux cents ans.
Les Bernardins ont deux fortes de coule, une blanche
? qui eft fort ample, dont ils fe fervent dans les
cérémonies 8c lorfqu’ils aflïftent à I’églife, & une
noire qu’ils portent, dans les vifites du dehors. Le
P. Mabillon prétend que la coule dans fon origine eft
la même chofe que le fcapulaire. Cependant l’auteur
de l’apologie de l’empereur Henri IV. diftingùe deux
fortes de coules ou plutôt de vêtemens des anciens
moines; l’une eft une robe qui defcendjufqu’auxpiés,
qui a des manches 8c un capuchon, 8c fert dans les
cérémonies ; une autre qui n’eft qu’un chaperon pour
travailler, 8c qu’on nomme fcapulaire, parce qu’il ne
couvre que la tête & les épaules. C ’eft aufli le fenti-
mènt de M. Fleury: « La cuculle, d i t - i l , marquée
» par la réglé de S. Benoît fervoit de manteau. C ’eft
» la coule des moines de Cîteaux ; le nom même en
» vient, & le froc des autres Bénédictins vient de la
» même origine. S. Benoît leur donne encore un fea-
» pulaire pour le travail. Il étoit beaucoup plus court
» & plus large qu’il n’eft aujourd’hui, & fervoit,
» comme porte le nom, à garnir les épaules pour les
» fardeaux 8c conferver. la tunique. Il avoit fon ca