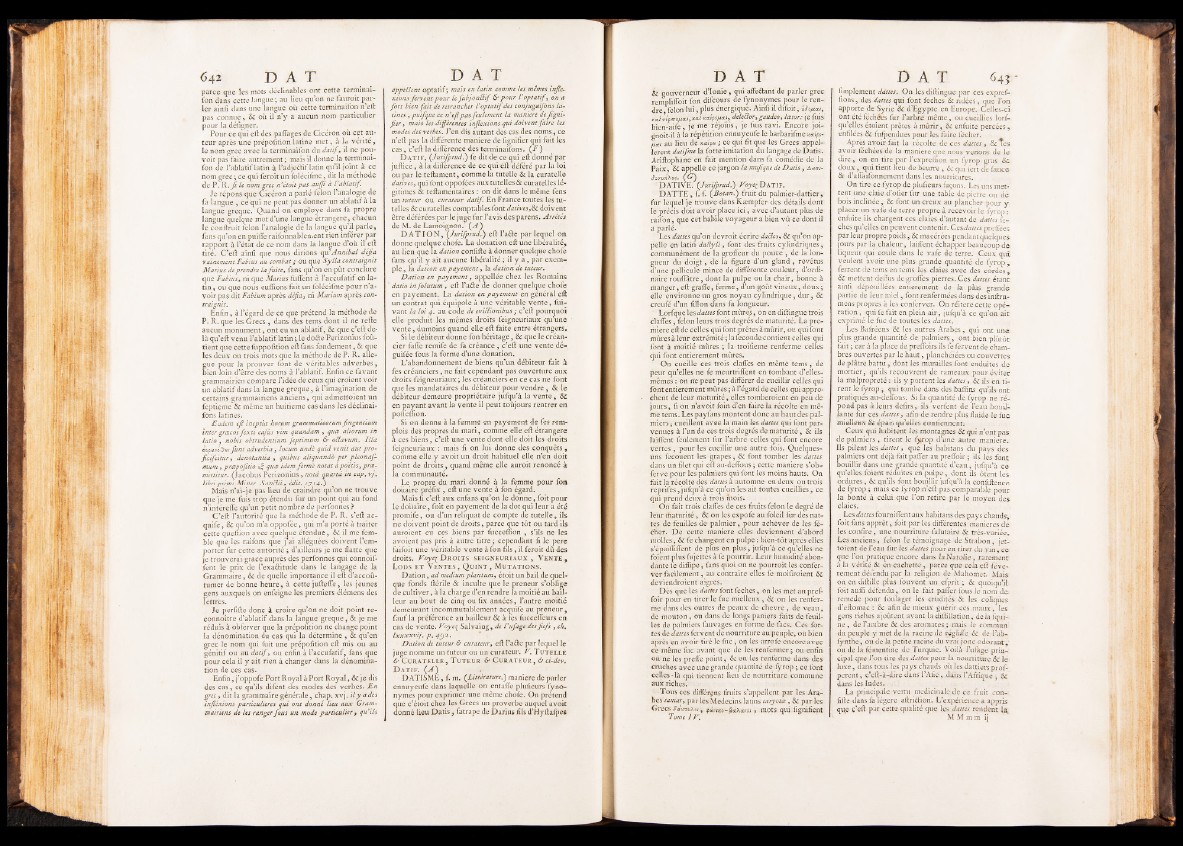
parce que les mots déclinables ont cette terminaison
dans cette langue; au lieu qu on ne fauroit parler
ainli dans une langue où cette temfinaifon n’eft
pas connue, & où il n’y a aucun nom particulier
pour la déligner.
Pour ce qui eft des paffages de Cicéron où cet auteur
après une prépofition latine met, à la vente,
le nom grec avec la terminaifon du datif, il ne pou-
voit pas faire autrement ; mais il donne la terminaifon
de l’ablatif latin à l’adjettif latin qu’il joint à ce
nom grec ; ce qui feroit un folécifme, dit la méthode
de P. R. f i le nom grec n ’étoitpas aujji à l ’ablatif.
Je répons que Cicéron a parlé félon l’analogie de
fa langue , ce qui ne peut pas donner un ablatif à la
langue greque. Quand on employé dans fa propre
langue quelque mot d’une langue étrangère, chacun
le conftruit félon l’analogie de la langue qu’il parle,
fans qu’on en puiffe raisonnablement rien inférer par
rapport à l’état de ce nom dans la langue d’où il ell
tiré. C ’eft ainfi que nous dirions cyCAnnibal défia
vainement Fabius au combat ; ou que S y lia contraignit
Marius de prendre la fuite, fans qu’on en pût conclure
que Fabius, ni que Marius fuffent à l’accufatif en latin
, ou que nous eulîions fait un folécifme pour n’avoir
pas dit Fabium après défia > ni Marium après contraignit.
Enfin, à l’égard de ce que prétend la méthode de
P. R. que les Grecs , dans des tems dont il ne refte
aucun monument, ont eu un ablatif, & que c’eft delà
qu’eft venu l’ablatif latin ; le dotte Perizonius foû-
tient que cette fuppofition eft fans fondement, & que
les deux ou trois mots que la méthode de P. R. allégué
pour la prouver font de véritables adverbes,
bien loin d’être des noms à l’ablatif. Enfin ce favant
grammairien compare l’idée de ceux qui croient voir
un ablatif dans la langue greque, à l’imagination de
certains grammairiens anciens, qui admettoient un
feptieme & même un huitième cas dans les déclinais
fons latines.
Eadem efi ineptia horum grammaticorum fingentium
inter grtecos fexti cafûs yim quandam , qua aliorum in
Latio , nobis obtruâentium feptimum 6* oclavum. Ilia
ovùtLvôSiv funt adverbia , locum undl quid venit aut pro-
ficifcitur, denotantia , quibus aliquandb per pleonaf-
murn , prapofido quoe idem fermé notât à poètis, pr<z-
mittitur.fJacobus Perizonius, nota quartâ in cap. vj,
libriprimi Miner. Sanclii, édit, /y/4.)
Mais n’ai-je pas lieu de craindre qu’on ne trouve
que je me fuis trop étendu fur un point qui au fond
n’intéreffe qu’un petit nombre de perfonnes ?
C ’eft l’autorité que la méthode de P. R. s’eft ac-
quife, & qu’on m’a oppofée, qui m’a porté à traiter
cette queftion avec quelque étendue, & il me fem-
ble que les raifons que j’ai alléguées doivent l’emporter
fur cette autorité ; d’ailleurs je me flatte que
je trouverai grâce auprès des perfonnes qui connoif-
fent le prix de l’exattitude dans le langage de la
Grammaire, & de quelle importance il eft d’accoutumer
de bonne heure, à cette jufteffe, les jeunes
gens auxquels on enfeigne les premiers élémens des
lettres.
Je perfifte donc à croire qu’on ne doit point re-
eonnoître d’ablatif dans la langue greque, & je me
réduis à obferver que la prépofition ne change point
la dénomination du cas qui la détermine , & qu’en
grec le nom qui fuit une prépofition eft mis ou au
génitif ou au datif, ou enfin à l’accufatif, fans que
pour cela il y ait rien à changer dans la dénomination
de ces cas.
Enfin, j’oppofe Port Royal à Port Royal, & je dis
des cas, ce qu’ils difent des modes des verbes. En
grec, dit la grammaire générale, chap. xvj. il y a des
infléxions particulières qui ont donné lieu aux Grammairiens
de les ranger fous un mode particulier y qu'ils
appellent optatif ; mais en latin comme les mêmes inflexions
fervent pour le fubjonclif & pour l'optatif, on a
fort bien fait de retrancher l'optatif des conjugaifons latines
, puifque ce ne fl pas feulement la maniéré de figni-
fier , mais les différentes inflexions qui doivent faire les
modes des verbes. J’en dis autant des cas des noms, ce
n’eft pas la différente maniéré de fignifier qui. fait les
cas, c’eft la différence des terminaifons. (P1)
Datif, ( Jurifprud.) fe dit de ce qui eft donné par
juftice, à la différence de ce qureft déféré par la loi
ou par le teftament, comme la tutelle & la curatelle
datives, qui font oppofées aux tutelles & curatelles légitimes
& teftamentaires : on dit dans le même fens
un tuteur ou curateur datif. En France toutes les tutelles
& curatelles comptables font d a t iv e s ,doivent
être déférées par le juge fur l’avis des parens. Arrêtés
de M. de Lamoignon.' (A')
D A T IO N , (Jurifprudf) eft l’atte par lequel on
donne quelque chofe. La donation eft une libéralité,
au lieu que la dation confifte à donner quelqùe chofe
fans qu’il y ait aucune libéralité ; il y a , par exemple
, la dation en payement, la dation de tuteur.
Dation en payement, appellée chez les Romains
’ datio in folutum , eft l’a£te de donner quelque chofe
en payement. La dation en payement en général eft
un contrat qui équipole à une véritable vente, fui-
vant la loi 4. au code.de evictionibus ; c’eft pourquoi
elle produit les mêmes droits feigneuriaux qu’une
vente, dumoins quand elle eft faite entre étrangers.
Si le débiteur donne fon héritage, & que le créancier
faffe remife de fa créance, c’eft une vente dé-
guifée fous la forme d’une donation.
L’abandonnement de biens qu’un débiteur fait à
fes créanciers, ne fait cependant pas ouverture aux
droits feigneuriaux ; les créanciers en ce cas ne font
que les mandataires du débiteur pour vendre, & le
débiteur demeure propriétaire jufqu’à la vente, &
en payant avant la vente il peut toûjours rentrer en
poffeflion.
Si on donne à la femme en payement de fes remplois
des propres du mari, comme elle eft étrangère
à ces biens, c’eft une vente dont elle doit les droits
feigneuriaux : mais fi on lui donne des conquêts ,
comme elle y avoit un droit habituel elle n’en doit
point de droits, quand même elle auroit renoncé à
la communauté.
Le propre du mari donné à la femme pour fou
doiiaire préfix , eft une vente à fon égard.
Mais fi c’eft aux enfans qu’on le donne, foit pour
le doiiaire, foit en payement de la dot qui leur a été
promife, ou d’un reliquat de compte de tutelle, ils
ne doivent point de droits, parce que tôt ou tard ils
auroient eu ces biens par fuccemon , s’ils ne les
avoient pas pris à autre titre ; cependant fi le pere
faifoit une véritable vente à fon fils, il feroit dû des
droits. Voyt{ Droits seigneuriaux, Vente,
Lods et Ventes , Quint , Mutations.
Dation, ad medium plantum, étoit un bail de quelque
fonds ftérile & inculte que le preneur s’oblige
de cultiver, à la charge d’en rendre la moitié au bailleur
au Bout de cinq ou fix années, l’autre moitié
demeurant incommutablement acquife au preneur,
fauf la préférence au bailleur & à les fucceffeurs en
cas de vente. Voye£ Salvaing, de l'ufage des fiefs , ch.
Ixxxxvij. p. 492.
Dation de tuteur & curateur, eft l’àtte par lequel le
juge nomme un tuteur ou un curateur. F. T utelle
& Curatelle, T uteur & Curateur, & ci-dev.
D atif. {A ) .*
DATISME, f. m. (.Littérature.) maniéré de parler
ennuyeufe dans laquelle on entaflè plufieurs fyno-
nymes pour exprimer une même chofe. On prétend
que c’étoit chez les Grecs un proverbe auquel avoit
donné lieu Datis, fatrape de Darius fils d’Hyftafpes
& gouverneur d’Ionie, qui affettant de parler grec
rempliffoit fon difcours de fynonymes pour le rendre
félon lui, plus énergique. Ainfi il difoit, îié'opa.i,
TipnzopcLi, **'1 deleclor, gaudeo, loetor: je fuis
bien-aife, je me réjoiiis, je fuis ravi. Encore joi-
gnoit-il à la répétition ennuyeufe le barbarifme zcdpo-
pai au lieu de r.aiptà ; ce qui fit que les Grecs appel-!
lerent datifme la fotte imitation du langage de Datis.
Ariftophàne en fait mention dans fa comédie de la
Paix, & appelle ce jargon lamufique de Datis, a«t/-
S'ocrpixoç. (GJ
D A T1VE. (Jurifprudf) Foye^ Datif.
D A T T E , f. f. (Botan.) fruit du palmier-dattier,
fur lequel je trouve dans Kæmpfer des détails dont?
le précis doit avoir place ic i, avec d’autant plus de
raifon, que çét habile voyageur a bien vû ce dont il
a parlé.
Les dattes qu’on devroit écrire doctes, & qu’on appelle
en latin daclyli, font des fruits cylindriques ,
communément de la groffeur du pouce , de la longueur
du doigt, de la figure d’un gland, revêtus
d’une pellicule mince de différente couleur, d’ordinaire
rouffâtre, dont la pulpe ou la chair, bonne à
manger, eft graffe, ferme, d’un goût vineux, doux ;
elle environne un gros noyau cylindrique, dur, &
creufé d’un fillon dans fa longueur.
Lorfque les dattes font mûrejs, on en diftingue trois
claffes, félon leurs trois degrés de maturité. La première
eft de celles qui font prêtes à mûrir, ou qui font
mûres à leur extrémité ; la fécondé contient celles qui
font à moitié mûres ; la troifieme renferme celles
qui font entièrement mûres.
On cueille ces trois claffes en même tems, de
peur qu’elles ne fe meurtriffent en tombant d’elles-
mêmes : on ne peut pas différer de cueillir celles qui
font entièrement mûres ; à l’égard de celles qui approchent
de leur maturité, elles tomberoient en peu de
jours, fi on n’avoit foin d’en faire la récolte en même
tems. Les payfans montent donc au haut des palmiers
, cueillent avec la main les dattes qui font parvenues
à l’un de ces trois degrés de maturité, & ils
laiffent feulement fur l’arbre celles qui font encore
vertes , pour les cueillir une autre fois. Quelques-
uns fecouent les grapes, & font tomber les dattes
dans un filet qui eft au-deffous ; cette maniéré s’ob-
ferve pour les palmiers qui font les moins hauts. On
fait la récolte des dattes à automne en deux ou trois •
reprifës, jufqu’à ce qu’on les ait toutes cueillies, ce
qui prend deux à trois mois.
On fait trois claffes de ces fruits félon le degré de
leur maturité, & on les expofe au foleil fur des nattes
de feuilles de palmier, pour achever de les fé-
ch'er. De cette maniéré elles deviennent d’abord
molles, & fe changent en pulpe : bien-tôt après elles
s’épaifliffent de plus en plus, jufqu’à ce qu’elles ne
foient plus fujettes à fe pourrir. Leur humidité abondante
fe diflipe, fans quoi on ne pourroit les confer-
ver facilement, au contraire elles fe moifiroient &
deviendroient aigres. '
Dès que les dattes font feches, on les met au pref-
foir pour en tirer le fuc mielleux, & on les renferme
dans des outres de peaux de chevre, de veau,
de mouton , ou dans de longs paniers faits de feuilles
de palmiers fauvages en forme de facs. Ces fortes
de dattes fervent de nourriture au peuple, ou bien
après en avoir tiré le fuc, on les arrofe encore avec
ce même fuc avant que de les renfermer ; ou enfin
on ne les preffe point, & on les renferme dans des
cruches avec une grande quantité de fyrop ; ce font
celles-là qui tiennent lieu de nourriture commune
aux riches.
Tous ces différons fruits s’appellent par les Arabes
Az/nar, par les Médecins latins caryotoe, & par les
Grecs JWruXo/, <piii'iKO-&dxctvoi i mots qui fignifient
Tome IF ,
Amplement dattes. On les diftingue par èes expref-
fions, des dattes qui font feches & ridées, que l’on
apporte de Syrie & d’Egypte en Europe. Celles-ci
ont été féchées fur l’arbre même, ou cueillies lorf-
qu elles étoient prêtes à mûrir, & enfuite percées,
enfilées & fufpendues pour les faire fécher.
Après avoir fait la réçolte de ces dattes, &*fes
avoir féchées de la maniéré que nous venons de le
dire , on en tire par l’expreffion un fyrop ■ gras .&
doux, qui tient lieu de beurre , & qui fert de faucc
& d’affaifonnément dans les nourritures.
On tire, ce fyrop de plufieurs façons. Les uns mettent
une claie d’ofier fur une table de pierre ou de
bois inclinée, & font un creux au plancher pour y
placer un vafe de terre propre à recevoir le fyrop :
enfuite ils chargent ces claies d’autant de dattes feches
qu’elles en peuvent contenir.. Ces dattes preffées
par leur propre poids ,• & macérées pendant quelques
jours par la chaleur, laiffent échapper beaucoup de
liqueur, qui coule dans le vafe de terre. Ceux qui
veulent avoir une plus grande quantité de fyrop ,
ferrent de tems en tems les claies avec des cordes ,
& mettent deffus de grôffes pierres. Ces dattes étant
ainfi dépouillées entièrement de la plus grande
partie de leur miel, font renfermées dans des inftru-
mens propres à les conferver. On réitéré cette opération
, qui fe fait en plein air, jufqu’à ce qu’on ait
exprimé le fuc de toutes les dattes.
Les Bafréens & les autres Arabes, qui ont une
plus grande quantité de palmiers, ont bien plûtôtr
fait ; car à la place de preffoirs ils fe fervent de chambres
ouvertes par le haut, planchéïées ou couvertes
de plâtre battu, dont les murailles font enduites de
mortier, qu’ils recouvrent de rameaux pour éviter
la malpropreté : ils y portent les dattes, & ils en tirent
le fyrop, qui tombe dans des baflins qu’ils ont
pratiques au-deffous. Si la quantité dè fyrop ne répond
pas à leurs defirs, ils verfent de l’eau bouillante
fur ces dattes, afin de rendre plus fluide le fuc
mielleux & épais qu’elles contiennent.
Ceux qui habitent les montagnes & qui n’ont pas
de palmiers., tirent le fyrop d’une autre maniéré-
Ils pilent les dattes, que les habitans du pays des
palmiers ont déjà fait paffer au preffoir ; ils les font
bouillir dans une grande quantité d’eau, jufqu’à ce
qu’elles.foient réduites en pulpe , dont ils ôtent les
ordures, ôc qu’ils font bouillir jufqu’à la confidence
de fyrop ; mais ce fyrop .n’eft pas comparable pour
la bonté à celui que l’on retire par le moyen des
claies.
Les dattes fourniffent aux habitans des pays chauds,
foit fans apprêt , foit par les différentes maniérés de
les confire, une nourriture falutaire & très-variée.
Les anciens 3 félon le témoignage de Strabon, jet--
toient de l’eau furies dattes pour en tirer du vin, ce
que l’on pratique encore dans la Natolie, rarement
à la vérité & en cachette , parce que cela eft féve-
rement défendu par la religion de Mahomet. Mais
on en diftille plus fouvent un efprit ; & quoiqu’il-
foit auffi défendu, on le fait paflér fous le nom de.
remede pour foülager les crudités .& les coliques
d’eftomac : & afin de mieux guérir ces maux, les
gens riehes ajoûtent avant la diftiliation, delàlqui-
ne , de l’ambre ôt des aromates.; mais le commun,
du peuple y met de la racine de régliffc & de l’ab-
fynthe, ou de la petite racine du vrai jonc odorant ,-
ou de la fémentine de Turquie. Voilà l’ufage principal
que l’on tire des dattes pour la nourriture & le
luxe, dans tous les pays chauds où les dattiers prof-
perent, c’eft-à-dire dans l’Afie , .dans l’Afrique , Sc
dans les Indes. .
La principale vertu médicinale de ce fruit confifte
dans fa légère aftrittion. L’expérience a appris
que c’eft par cette qualité que les dattes rendent la
M M m m ij