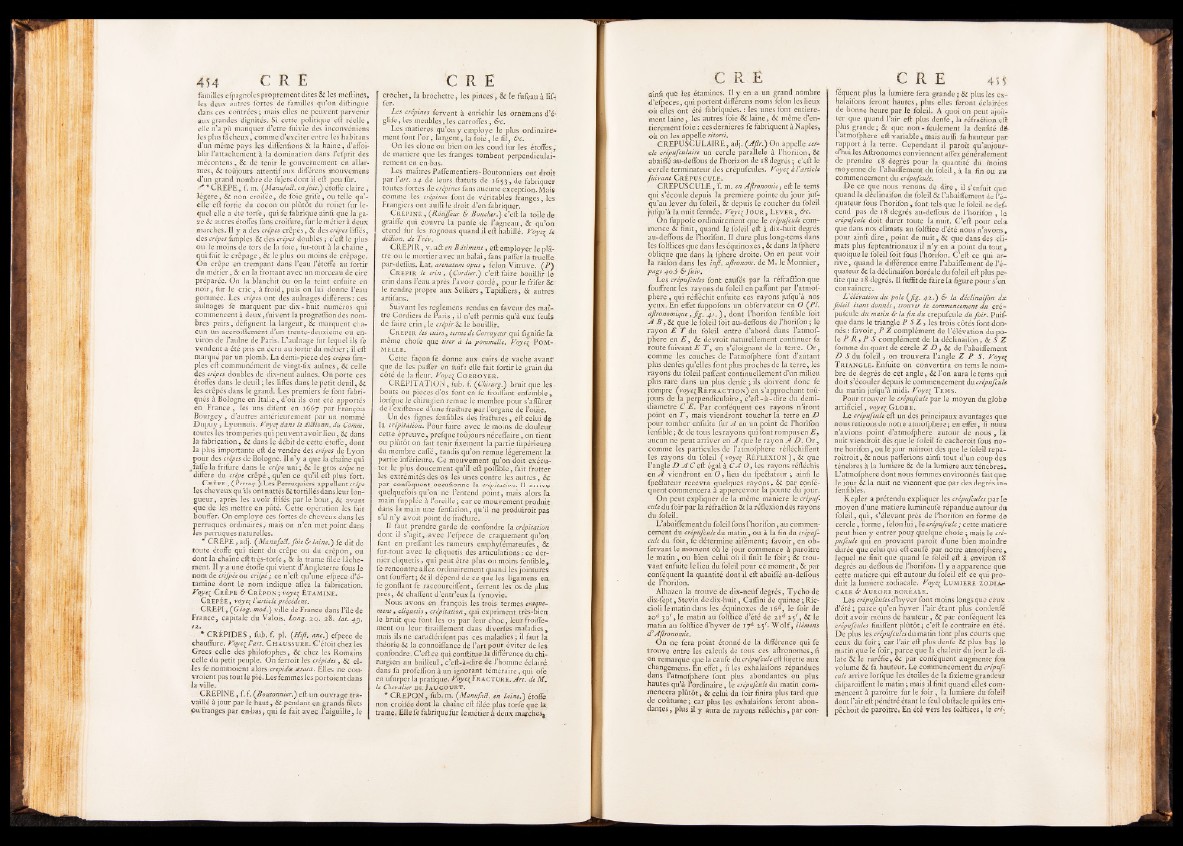
familles efpagnoles proprement dites & les mèftihés,
les deux autres fortes de familles qu’on diftingue
dans ces contrées ; mais elles ne peuvent parvenir
aux grandes dignités. Si cette politique eft réelle,
elle n’a pu manquer d’etre fuivie des incorivéniens
les plus fâcheux, comme d’exciter entre les habitans
d’un même pays les diffenfions & la haine, d’affoi-
blir l’attachement à la domination dans l’efprit des
mécontens, & de tenir le gouvernement en allar^
mes 3 & toujours attentif aux différens mouvemens
d’un grand nombre de fujets dont il eft peu fur.
A * CRÊPE, f, m. (Manufacl. en foie.') étoffe claire ,
légère, & non croifée, de foie grife, ou telle qu’elle
eft fortie du cocon ou plutôt du roiiet fur lequel
elle a été torfe, qui fe fabrique ainli que la gaze
& autres étoffes fans croifure, fur le métier à deux
marches. Il y a des crêpes crêpés, & des crêpes liftes,
des crêpes fimples & des crêpes doubles ; c’eft le plus
ou le moins de tors de la foie, fur-tout à la chaîne,
qui fait le crêpage, & le plus ou moins de crêpage.
On crêpe en trempant dans l’eau l’étoffe au fortir
du métier, & en la frottant avec un morceau de cire
préparée. On la blanchit ou on la teint enfuiîe en
noir, fur le c ric, à froid, puis on lui donne l’eau
gommée. Les crêpes ont des aulnages différens : ces
aulnages fe marquent par dix - huit numéros qui
commencent à deux,fuivent laprogrefliondes nombres
pairs, défignent la largeur, & marquent chacun
un accroiffement d’un trente-deuxieme ou environ
de l’àulne de Paris. L’aulnage fur lequel ils fe
vendent a été pris en écru au fortir du métier ; il eft
marqué par un plomb. La demi-piece des crêpes fimples
eft communément de vingt-fix aulnes, & celle
des crêpes doubles de dix-neuf aulnes. On porte ces
étoffes dans le deuil ; les liffes dans le petit deuil, &
les crêpés dans le grand. Les premiers fe font fabriqués
à Bologne en Italie, d’où ils ont été apportés
en France , les uns difent en 1667 par François
Bourgey, d’autres antérieurement par un nommé
Dupuy, Lyonnois. Voye\ dans le diclionn. du Comm.
toutes les tromperies qui peuvent avoir lieu, & dans i
la fabrication, & dans le débit de cette étoffe, dont
la plus importante eft de vendre des crêpes de Lyon
pour des crêpes de Bologne. Il n’y a que la chaîne qui
piaffe la frifure dans le crêpe uni ; & le gros crêpe ne
différé du crêpe crêpé, qu’en ce qu’il eft plus fort.
C r e p e , (Perruq.) Les Perruquiers appellent crêpe
les cheveux qu’ils ont nattés & tortillés dans leur longueur,
après les avoir frifés parle bout, & avant
que de les mettre en pâté. Cette opération les fait
bouffer. On employé ces fortes de cheveux dans les
perruques ordinaires y maison n’en met point dans
les perruques naturelles.
* CRÊPÉ, adj. (Manufacl. foie & laine.) fe dit de
toute étoffe qui tient du crêpe ou du crépon, ou
dont la chaîne eft très-torfe, & la trame filée lâchement.
Il y a une étoffe qui vient d’Angleterre fous le
nom de crifpée ou crifpé; ce n’eft qu’une efpece d’étamine
dont le nom indique affez la fabrication.
y p l | C r ê p e & C r é p o n ; voye[ É t a m i n e .
CR E P E E , voye[ l'article précédent.
CREPI, ( Géog. mod.) ville de France dans Pîle de
France, capitale du Valois. Long. 20.. 28. lat. 4^.
!2.
* CRÊPIDES, fub. f. pl. (Hiß. anc.) efpece de
chauffure. Vcye^ l'art. C h a u s s u r e . C ’étoit chez les
Grecs celle des philofophes, & chez les Romains
celle du petit peuple. On ferroit les crépides, & elles
fe riommoient alors crepidoe aratoe. Elles ne cou-
vroient pas tout le pié. Les femmes les portoient dans
la ville.
CREPINE, f. f. (Boutonnier.) eft un ouvrage travaillé
à jour par le haut, & pendant en grands filets
ou franges par en-bas, qui fe fait avec l’aiguille, le
c r o c h e t , la b r o c h e t t e , le s p in c e s , êc le fu fe a u à li f- i
fe r .
Les crépines fervent à enrichir les ornemens d’é-
glife, les meubles, les carroffes , &c.
Les matières qu’on y employé le plus ordinairement
font l’o r , largent, la foie, le fil, &c.
On les cloue ou bien on les coud fur les étoffes,'
de maniéré que les franges tombent perpendiculairement
en en-bas.
Les maîtres Paffementiers-Boutonniers ont droit
par l'art. 24 de leurs ftatuts de 165}, de fabriquer
toutes iortes de crépines fans aucune exception. Mais
comme les crépines font de véritables franges, les
Frangiers ont aufli le droit d’en fabriquer.
C r e p in e , (Rôtijfeur & Boucher.) c’eft la toile de
graiffe qui couvre la panfe de l’agneau, & qu’on
étend fur les rognons quand il eft habillé* Voyez U
diction, de Trév.
CREPIR, v. aft en Bâtiment, eft employer le plâtre
ou le mortier avec un balai; fans paffer la truelle
par-defliis. Lat. arenatum opus , félon Vitruve. (P )
C r é p ir le crin, (Cordier.) c’eft faire bouillir le
crin dans l’eau après l’avoir cordé, pour le frifer &
: le rendre propre aux Selliers, Tapifliers, & autres
artifans.
Suivant les reglemens rendus en faveur des maître
Cordiers de Paris , il n’eft permis qu’à eux feuls
de faire crin, le crépir & le bouillir.
C r é p i r les cuirs, terme de Corroyeur qui fignifie l a
meme choie que tirer à la pommelle. Voye^ P o m m
e l l e .
Cette façon fe donne aux cuirs de vache avant*
que de les paffer en l'uif : elle fait fortir le grain du
côté de la fleur. Voye\ C o r r o y e r .
CRÉPITATION, lub. f. (Chirurg.) bruit que les-
bouts ou pièces d’os font en fe froiffant enfembie ,
lorfque le chirugien remue le membre pour s’affûrer
. de l’exiftence d’une fraêture par l’organe de l’oüie.
Un des fignes fenfibles des fra&ures, eft celui de
la crépitation. Pour faire avec le moins de douleur
; cette épreuve, prefque toujours néceffaire, on tient
ou plutôt on fait tenir fixement la partie fupérieure
du membre cafte, tandis qu’on remue légèrement la
partie inférieure. Ce mouvement qu’on doit exécu-
- ter le plus doucement qu’il eft poflible, fait frotter
les extrémités des os les unes contre les autres, &
par conféquent occafionne la crépitation. Il arrive
quelquefois qu’on ne l’entend point, mais alors la
main fupplée à l’oreille; car ce mouvement produit
dans la main une fenfation, qu’il ne produiroit pas
s’il n’y avoît point de fra&ure.
Il faut prendre garde de confondre la crépitation
dont il s’agit, avec l’efpece de craquement qu’on
fent en preffant les tumeurs emphyfémateufes, &
fur-tout avec le cliquetis des articulations: ce dernier
cliquetis, qui peut être plus ou moins fenfible,
fe rencontre affez ordinairement quand les jointures
ont fouffert ; & il dépend de ce que les ligamens en
fe gonflant fe raccourciffent, ferrent les os de plus
près, & chaffent d’entr’eux la fynovie.
Nous avons en françois lesstrois termes craquement
9 cliquetis, crépitation, qui expriment très-bien
le bruit que font les os par leur choc, leur froidement
ou leur tiraillement dans diverfes maladies,
mais ils ne caradiérifent pas ces maladies ; il faut la
théorie & la connoiffance de l’art pour éviter de les
confondre. C ’eft ce qui conftitue la différence du chirurgien
au bailleul, c’eft-à-dire de l’homme éclairé,
dans fa profeflion à un ignorant téméraire, qui ofe
en ufurperla pratique. Voye^ F r a c t u r e .^ / y . de M.
le Chevalier DE Ja u cOURT.
* CREPON, fub.m. (Manufacl. en laine.) étoffe
non croifée dont la chaîne eft filée plus torfe que la.
trame. Ellefe fabriquefur iemétier à deux mafchesj
ainfi que les étamines. Il y en a un grand nombre
fl’efpeces, qui portent différens noms félon les lieux
où elles ont été fabriquées. : les unes font entièrement
laine, les autres foie & laine, & même d’en-
tierement foie : ces dernieres fe fabriquent à Naples,
où on les appelle ritorti.
CREPUSCULAIRE, adj. (4 (lr.) On appelle cer*
•cle crépufculaire un cercle parallèle à i’horifon, &
abaifle au-deffous de l’horizon de 18 degrés ; c’eft le
cercle terminateur des crépufcules. Voye^ a l'article
fuivant CRÉPUSCULE*
CREPUSCULE, f. m. en Aflronomie > eft le tems
qui s’écoule depuis la première pointe du jour juf-
qu’au lever du foleil, & depuis le coucher du foleil
jufqu’à la nuit fermée. Voye^ Jour, Lever , &c.
On fuppofe ordinairement que le crépufcule commence
& finit, quand le foléil eft à dix-huit degrés
au-deflbus de l’horifon. Il dure plus long-tems dans
lès folftices que dans les équinoxes, & dans la fpherë
oblique que dans la fphere droite. On en peut voir
la raifon dans les inf. afironom. de M. le Monnier.,
page 405 & fu b . '
Les crépufcules font caüfés par la reffaftion que
fouffrent les rayons du foleil en paffant par l’atmof-
phere , qui réfléchit enfuite ces rayons jufqu’à nos
yeux. En effet fuppofons un obfervateur en O (Pl.
agronomique 3fig. 41. ) , dont l’horifon fenfible foit
A B , & que le foleil loit au-deffous de l’horifon ; lè
rayon E T du foleil entre d’abord dans l’atmof-
phere e n £ , & devroit naturellement continuer fa
route fiüivantE T , en s’éloignant de la terre. Or,
comme les couches de Patmofpherè font d’aùtant
plus déniés qu’elles font plus proches de la terre, les
rayons du foléil paffent continuellement d’un milieu
plus rare dans un plus denfè ; ils doivent donc fé
rompre (voye^R é f r a c t i o n ) en s ’approchant toû-
jours de la perpendiculaire, c’eft-à-dire du demi-
diametre C E. Par conféquent ces rayons n’iront
point en T , mais viendront toucher la terre en D
poür tomber enfuite fur A eh Un point dé l’horifôn
fenfible ; & de tous les rayons qui font rompus en E ,
aucun ne peut arriver en A que le rayon A D . O r ,
comme les particules de l’atmofphere réfléchiffent
les rayons du foleil (voye^ R é f l e x i o n ) , & que
l’angle D A C eft égal à CA O, les rayons réfléchis
en A viendront en O , lieu du fpe£tateur ; ainfi le
fpe&ateur recevra quelques rayons, & par conféquent
commencera à appercevoir la pointe du jour.
On peut expliquer de la même maniéré le crépufcule
du foir par la réfraétion & la réflexion des rayons
du foleil.
L’abaiffement du foleil fous l'horifon, au commencement
du crépùfcule du matin, ou à la fin du crépufcule
du foir, fe détermine aifément; fa voir, en ob-
fervant le moment Où le jour commence à paroître
le matin , ou bien celui où il finit le foir ; & trouvant
enfuite le lieu du foleil pour ce moment, & par
conféquent la quantité dont il eft abaifle aü-deffous
de l’horifon.
Alhazen la trouve de dix-neüfdegrés, Tycho de
dix-fept, SteVin de dix-huit, Caflini de quinze ; Ric-
cioli le matin dans les équinoxes de i6 d, le foir de
20 d 30', le matin aü folftice d’été de z t d z 5 ,& l e
matin au folftice d’hyver dé Ï7d 25'. "Wolf, élémens
d'Aflronomie.
On ne fera point étonné de la différence qui fe
trouve entre les calculs de tous ces aftronomes,fi
On remarque quelacaufe du crépufcule eft fujette aux
changemens. En effet, fi les exhalaifons répandues
dans l’atmôfphere font plus abondantes Ou plus
hautes qu’à l’ordinaire, le crépufcule du matin commencera
plutôt, & celui du foir finira plus tard que
de coûtume ; car plus les exhalaifons feront abondantes
, plus il y aura de rayons réfléchis, par conféquertt
plus la lumière fera grande ; & plus les ex-
halaifons feront hautes, plus elles feront éclairées
de bonne heure par le foleil. A quoi on peut ajouter
que quand l’air eft plus dénié, la réfraction eft
plus grande ; & que non - feulement la denfité dë-
1 atmofphere eft variable, mais au (fi fa hauteur pac-
rapport à la terre. Cependant il paroît qu’aujour-
d hui les Aftronomes conviennent affez généralement
de prendre 18 degrés pour la quantité du moins
moyenne de l’abaiffement du foleil, à la fin ou au
commencement du crépufcule.
De ce que nous venons de dire, il s’enfuit que
quand la déclinaifon du foleil & l’abaiffement de l’équateur
fous l’horifon, font, tels que le foleil ne def-
cend pas d e 18 degrés au-deffous de l ’horifon , le
crépufcule doit durer toute la nuit. C ’eft pour cela
que dans nos climats au folftice d’été nous n’avons ,
pour ainfi dire, point de nuit, & que dans des climats
plus feptentrionaux il n’y en a point du tout,
quoique le foleil foit fous l’horifon. Ç ’eft ce qui arrive,
quand la différence entre l ’abaiffement de l’équateur
& la déclinaifon boréale du foleil eft plus petite
que 18 degrés. Il fuflit de faire la figure pour s’en
convaincre.
L'élévation du pôle (fig. 42.) & la déclinaifon du
foleil étant donnés, trouver le commencement du cré—
pufcule du matin & la fin du crépufcule du foir. Puif-
que dans le triangle P S Z , les trois côtés font donnés
: favoir, P Z complément de l ’élévation du po- 1 e P R , P S complément de la déclinaifon, & S Z
fomme du quart de cercle Z D , & de l’abaiffement
D S du foleil > on trouvera l’angle Z P S. Voyeç
T riangle. Enfuite on convertira en tems le nombre
de degrés de cet angle, & l’on aura le tems qui
doit s’écouler depuis le commencement du crépufcule
du matin jufqu’à midi. Voye£ T ems.
Pour trouver le crépufcule par le moyen du globe
artificiel, voyeq_ Globe.
Le crépufcule eft un des principaux avantages que
nous retirons de notre atmofphere; en effet, fi nous
n’avions point d’atmofphere autour de nous , là
nuit viendroit dès que le foleil fe cacheroit fous notre
horifon, ou le jour naîtroit dès que le foleil repa-
roîtroit, & nous pafferions ainfi tout d’un coup des
ténèbres à la .lumière ôt de la lumière aux ténèbres,
L’atmofphere dont nous fommes environnés fait que
le jour éc la nuit ne viennent que par des degrés in-
fenfibles.
Kepler a prétendu expliquer les crépufcules par le
moyen d’une matière lumineufe répandue autour du
foleil, qui, s’élevant près de l’horifon en forme dè
cercle, forme, félon lui, le crépufcule ; cette matière
peut bien y entrer pour quelque chofe ; mais le crépufcule
qui en provient paroît d’une bien moindre
durée que celui qui eft caufé par notre atmolphere ,
lequel ne finit que quand le foleil eft à environ 18
degrés au-deffous de l’horifon. Il y a apparence que
cette matière qui eft autour du foleil eft ce qui produit
ia lumierè zodiacale* Voye^ Lumière zodiac-
cale & Aurore boréale.
Les crépufcules d’hy vèr font moins longs que céux •
d’été ; parce qu’en hyver l’air étant plus condenfé
doit avoir moins de hauteur, & par cônféqüeht les
crépufcules finiffent plutôt ; c’eft le contraire en été.
De plus les crépufcules du mâtin lbnt plus courts que
ceux du foir ; car l’air eft plus denfe & plus bas le
matin que le foir, parce que la chaleiir du jour le dilate
&: le raréfie, & par conféquent augmente foa
Volume & fa hauteur. Le commencement du crépufcule
arrive lorfque les étoiles de la fixieme grandeur
difparoiffent le matin ; mais il finit quand elles commencent
à paroître fur le foir, la lumière du foleil
dont l’air eft pénétré étant le feul obftacle qui les em-
pêchoit de paroître. En été vers lés folftices, le cré