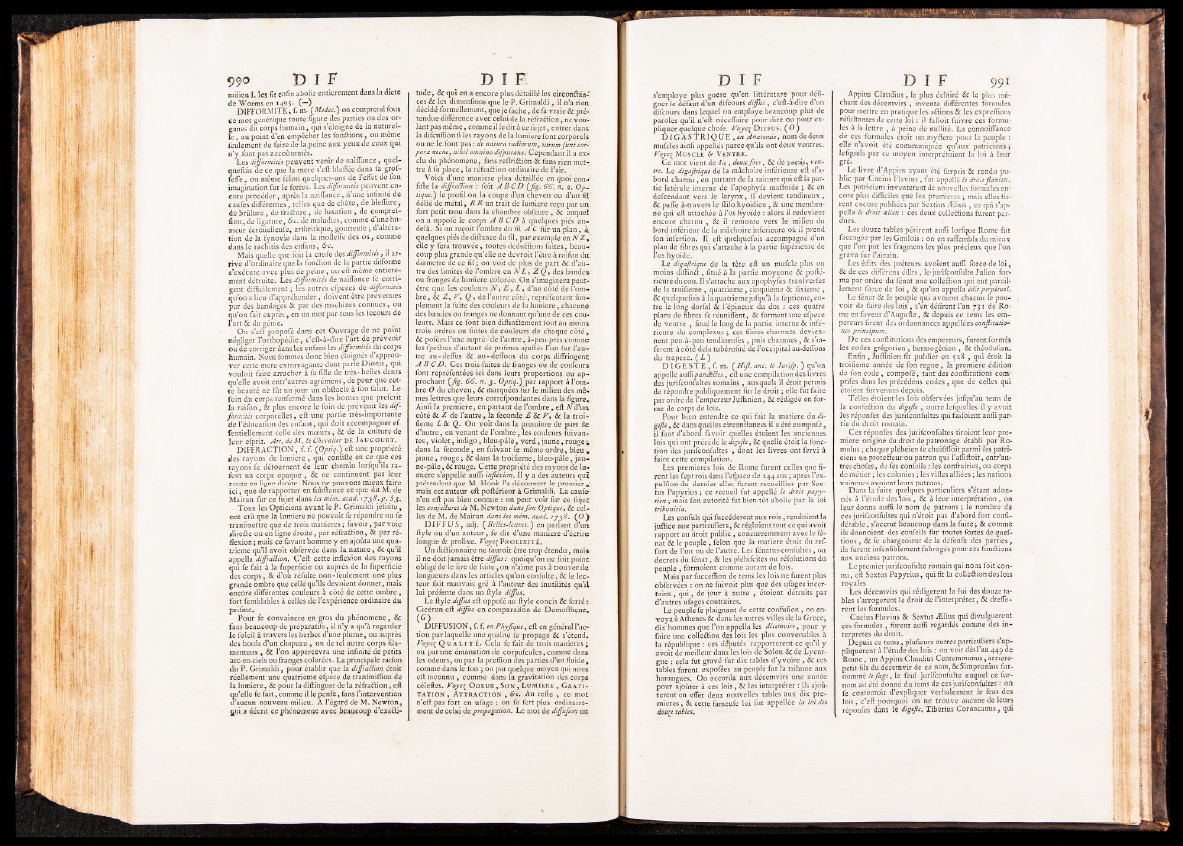
99° D I F milieu I. les fit enfin abolir entièrement dans la dicte
de Worms en 1495* (“ ) x . .
DIFFORMITÉ, f. m. (Medec.j on comprend ions
ce mot générique toute figure des parties ou .des organes
du corps -humain, qui s’éloigne de la naturelle
, au point d’en .empêcher les fondions, ou même
feulement de faire de la .peine aux yeux de ceux qui
n’y font pas accoutumés.
Les difformités peuvent venir de naiflauce, quelquefois
de ce que la mere s’eft blefiee dans fa grof-
fofle, ou même félon quelques-uns de l’effet de fon
imagination fur le foetus. Les difformités peuvent encore
procéder, après la naiffance, d’une infinité de
caufes differentes, telles que de chute, de bleffure,
de brûlure, de fraaure, de luxation, de compref-
fion, de ligature, &c. de maladies, comme d’une humeur
écroiielleufe, arthritique, goutteufe ; d’altération
de la fynovie dans la molleffe des o s , comme
dans le rachitis des enfans, &c.
Mais quelle que foit la caufe des difformités, il arrive
d’ordinaire que la fonction de la partie difforme
s’exécute, avec plus de peine, ou eft même entièrement
détruite. Les difformités de naiffance fe corrigent
difficilement ; les autres efpeces de difformités
qu’on a lieu d’appréhender, doivent être prévenues
par des bandages & par des machines connues, ou
qu’on fait,exprès, en un mot par tous les lecours de
l’art & du génie. ^
On s’eft propofé dans cet Ouvrage de ne point
négliger l’orthopédie, c’eft-à-dire l’art de prévenir
ou de corriger dans les enfans les difformités du corps
Humain. Nous fommes donc bien éloignés d’approuver
cette mere extravagante dont parle D ionis, qui
vouloit faire arracher à fa fille de très - belles dents
qu’elle avoit entr’autres agrémens, de peur que cette
beauté ne fut un jour un obftacle à fon falut. Le
foin du corps renfermé dans les bornes que prefcrit
la raifon, & plus encore le foin de prévenir les difformités
corporelles, eft une partie très-importante
de l’éducation des enfans, qui doit accompagner ef-
fentiellement celle des moeurs, & de la culture de
leur efprit. Art. de M. le Chtvalier DE JAU COURT.
DIFFRACTION, f. f. (<Optiq.) eft une propriété
des rayons de lumière , qui confifte en ce que ces
rayons fe détournent de leur chemin lorfqu’ils raient
un corps opaque , 6c ne continuent pas leur
route en ligne droite. Nous ne pouvons mieux faire
ic i, que de rapporter en fubftance ce que dit M. de
Mairan fur ce fujet dans les mém. acad. 1738.p. 63.
■ Tous les Opticiens avant le P. Grimaldi jéfuite,
ont crû que la lumière ne pouvoit fe répandre ou fe
îranfmettre que de trois maniérés ; favoir, par voie
direéle ou en ligne droite, par réfraûion, & par réflexion
; mais ce favant homme y en ajoûta une quatrième
qu’il avoit obfervée dans la nature, 6c qu’il
appella diffraction. C’eft cette inflexion des rayons
qui fe fait à la fuperficie ou auprès de la fuperficie
des corps, 81 d’où réfulte non-feulement une plus
grande ombre que celle qu’ils dévoient donner, mais
encore différentes couleurs à côté de cette ombre,
fort femblables à celles de l’expérience ordinaire du
prifme.
Pour fe convaincre en gros du phénomène, 6c
fans beaucoup de préparatifs, il n’y a qu’à regarder
le foleil à travers les barbes d’une plume, ou auprès
des bords d’un chapeau , ou de tel autre corps filamenteux,
6c l’on appercevra une infinité de petits
arc-en-ciels ou franges colorées. La principale raifon
du P. Grimaldi, pour établir que la diffraction étoit'
réellement une quatrième efpece de tranfmiflion de
la lumière, 6c pour la diftinguer de la réfraction, eft
qu’elle fe fait, comme il le penfe, fans l’intervention
d’aucun nouveau milieu. A l’égard de M. Newton,
gui a décrit ce phénomène avec beaucoup d’exaétit
«de, 6c qui en a encore plus détaillé les circonftân-
ces 8c les dimenfions que le P. Grimaldi, il n’a rien
décidé formellement, que je fâche, de fa vraie 6c prétendue
différence avec celui de la réfraction, ne voulant
pas même, commeil le dit à ce fujet, entrer dans,
la difcuflion fi les rayons de la lumière font corporels
ou ne le font pas :dc naturaradiorumyutrum funtcor-'
pora mené y nihil omnino difputahs. Cependant il a ex-'
clu du phénomène > fans reftriétion & fans rien mettre
à fa place, la réfraétion ordinaire de l’air.
Voici d’une maniéré plus détaillée en quoi con-:
fille la diffraction : foit A B CD (fig. (f<f. n. z . Optique:.)
le profilou la coupe d’un cheveu ou d’un fil
délié de métal, R R -un trait de lumière reçu par un
fort petit trou dans la chambre obfcure, 8c auquel*
on a oppofé le corps A B C D à quelques piés au-
delà. Si on reçoit l’ombre du fi [ A C fur Un plan, à.
quelques piés de diftance du fil, par exemple en N Z f
elle y fera trouvée, toutes déductions faites, beaucoup
plus grande qu’elle ne devroit l’être à raifon du
diamètre de ce fil ; on voit de plus de part 6c d’autre
des limites de l’ombre en N L , Z Q , des bandes
ou franges de lumière colorée. On s’imaginera peut-
être que les couleurs N , E , L , d’un côté de l’ombre
, 6c Z y V, Q , de l’autre côté, repréfentent fim-
plement la fuite des couleurs de la lumière, chacune
des bandes ou franges ne donnant qu’une de ces couleurs.
Mais ce font bien diftinCtement tout au moins
trois ordres ou fuites de couleurs de chaque côté,
6c pofées l’une auprè. de l’autre, à-peu-près comme
les fpeCtres d’autant de prifmes ajuftés l’un fur l’autre
au-defliis 6c au-deflbus du corps diffringent
A B CD . Ces trois -fuites de franges ou de couleurs
font repréfentées ici dans leurs proportions ou approchant
(fig- C6. n. 3 . Optiq.') par rapport à l’ombre
O du cheveu, 6c marquées fur le milieu des .mêmes
lettres que leurs correfpondantes dans la figure.
Ainfi la première, en partant de l’ombre, eft N d’un
côté & Z de l’autre, la fécondé E 6c V> 6c la troi-
fieme L 8t Q. On voit dans la première de part 6c
d’autre, en venant de l’ombre, les couleurs fuivan-
tes, violet, indigo, bleu-pâle, verd, jaune, rouge ;
dans la fécondé, en fuivant le même ordre, bleu ,
jaune, rouge; 6c dans la troifieme, bleu-pâle, jaune
pâle , 6c rouge. Cette propriété des rayons de lumière
s’appelle aufli infléxion. Il y a des auteurs qui
prétendent que M. Hook l’a découvert le premier ^
mais cet auteur eft poftérieur à Grimaldi. La caufe
n’en eft pas bien connue : on peut voir fur ce fujet
les conjectures de M. Newton dans fon Optique, 8c celles
de M. de Mairan dans les mém. acad. 1738. (O )
D I F F U S , adj. ( Belles-lettres.) ftyle ou d’un auteur, fe dit d’une meann piéarréla dn’té cdr’iurne longue & prolixe. Voye^ Prolixité.
Un di&ionnaire ne fauroit être trop étendu, mais
il ne doit jamais être diffus: quoiqu’on ne foit point
obligé de le lire de fuite, on n’aime pas à trouver de
longueurs dans les articles qu’on confulte, 6c le lecteur
fait mauvais gré à l’auteur des inutilités qu’il
lui préfente dans un ftyle diffus.
Le ftyle diffus eft oppofé au ftyle concis 6c ferré :
Cicéron eft diffus en comparaifon de Demofthene.
(G)D
IFFUSION, f. f. en Phyjlque, eft en général l’a o
tion par laquelle une qualité fe propage 8c s’étend.
Voye^ Quali T É. Cela fe fait de trois maniérés ;
ou par une émanation de corpufcules, comme dans
les odeurs, ou par la prefljon des parties d’un fluide,
comme dans le fon ; ou par quelque moyen qui nous
eft inconnu , comme dans la gravitation des corps
céleftes. Voye^ Odeur , Son , Lumière , Gravitation
, Attraction , &c. Au refte , ce mot
n’eft pas fort en ufage : on fe fert plus ordinairement
de celui de propagation. Le mot de dffufon no
s’employe plus guere qu’en littérature pour defi-
gner le défaut d’un difcoürs diffus , c’eft-à-dire d’un
difeours dans lequel on employé beaucoup plus de
paroles qu’il n’eft néceflaire pour dire ou pour expliquer
quelque chofe. Foye^ D iffus. ( O )
D IG A S T R IQ U E ,« » Anatomie, nom de deux
mufcles ainfi appellés parce qu’ils ont deux ventres.
Voye%_ Muscle 6* V entre.
Ce mot vient de J'iç, deux fois , ÔC de yetç-np, ventre.
Le digaßrique de la mâchoire inférieure eft d’abord
charnu , en partant de la rainure qui eft la partie
latérale interne de l’apophyfe maftoïde ; 8c en
defeendant vers le larynx, il devient tendineux,
8c pafle à-travers le ftilo-hyoïdien , 6c une membrane
qui eft attachée à l’os hyoïde : alors il redevient
encore charnu , 6c il remonte vers le , milieu du
bord inférieur de la mâchoire inférieure où il prend
fon infertion. Il eft quelquefois accompagné d’un
plan de fibres qui s’attache à la partie fupérieure de
l’os hyoïde.
Le digaßrique de la tête eft un mufcle plus ou
moins diftinét , fitué à la partie moyenne 8c pofté-
rieure du cou. Il s’attache aux àpophyfes tranfverfes
de la troifieme , quatrième, cinquième & fixieme ,
6c quelquefois à la quatrième jufqu’à la feptieme, entre
le long dorfal & l ’épineux du dos : ces quatre
plans de fibres fe réunifient, & forment une efpece
de ventre , fitué le long de la partie interne 8t inférieure
du complexus ; ces fibres charnues deviennent
peu-à-peu tendineufes , puis charnues, 8c s’in-
ferent à côté delà tubérofité de l’occipital au-deflous
du trapeze. ( L )
D IG E S T E , f. m. ( Hiß. anc. & Jurifpi j qu’on
appelle auflipanàtcles, eft une compilation des livres
des jurifconfultes romains , auxquels il étoit permis
de répondre publiquement fur le droit ; elle fut faite
par ordre de l’empereur Juftinien, 6c rédigée en forme
de corps de lois.
Pour bien entendre ce qui fait la matière du di-
geße, 6c dans quelles circonftances il a été compofé,
il faut d’abord favoir quelles étoient les anciennes
lois qui ont précédé le digeße, 6c quelle étoit la fonction
des jurifconfultes , dont les livres ont fervi à
faire cette compilation.
Les premières lois de Rome furent celles que firent
les fept rois dans l’efpace de 244 ans ; après l’ex-
pulfîon du dernier elles furent recueillies par Sex.
tus Papyrius ; ce recueil fut appellé le droit papy-
rien ; mais fon autorité fut bien-tôt abolie par la loi
tribunitia.
Les confiils qui fuccéderent aux rois, rendoient la
juftice aux particuliers, ôcrégloient tout ce qui avoit
rapport au droit public , concurremment avec le fé-
nat 6c le peuple , félon que la matière étoit du ref-
fort de l’un ou de l’autre. Les fénatus-confultes, ou
decrets du fénat, 8t les plébifcites ou réfolutions du
peuple , formojent comme autant de lois.
Mais par fucceflion de tems les lois ne furent plus
obfervées : on ne fuivoit plus que des ufages incertains
, qui, de jour à autre , étoient détruits par
d’autres ufages contraires.
Le peuple fe plaignant de cette confofion, on envoya
à Athènes 6c dans les autres villes de la Grece;
dix hommes que l’on appella les décemvirs, pour y
Faire une collection des lois les plus convenables à
la république : ces députés rapportèrent ce qu’il y
avoit de meilleur dans les lois de Solon 6c de Lycurgue
: cela fut gravé fur dix tables d’yvoire , 6c ces
tables furent expofées âu peuple fur îa tribune aux
harangues. On accorda aux décemvirs une année
pour ajoûter à ces lois, 8c les interpréter : ils ajoutèrent
en effet deux nouvelles tables aux dix premières
, & cette fameufe loi fut appellée là loi des
doute tables.
Appuis Clatidius , le plus éclairé 6c le plus méchant
des décemvirs , inventa differentes formules,
pour mettre en pratique les avions 8t les exprefîions
réfultantes de celte loi : il falloit fuivre ces formules
à la lettre , à peine de nullité. La connoiflance
de ces formules étoit un myftere pour le peuple :
elle n’avoit été communiquée qu’aux patriciens ;
lefcjuels par ce moyen interprétoient la loi à leur gré- . I
Le livre d’Àppius ayant été furpris 8t rendu public
par Cneius Flavius, fut appellé le droitflavien.
Les patriciens inventèrent de nouvelles formules encore
plus difficiles que les premières ; mais elles forent
encore publiées par Sextius Ælius , ce qui s’ap^
pella le droit <zlien : ces deux collerions furent perdues.
Les douze tables périrent aufli Iorfque Rome fiit
faccagée par les Gaulois : on en raflembla du mieux
que l’on put les fragmèns les plus précieux que l’on
grava fur l’airain.
Les édits des préteurs àvoient aufli force de lo i,
6c de ces diffefens édits , le* jtirifconfulte julien forma
par ordre du fénat une collêâion qui eut pareillement
force de lo i, 6c qu’on appella édit perpétuel.
Le fénat 6c le peuple qui avôient chacun le pouvoir
de faire des lois , s’en défirent l’an 731 de Rome
en faveur d’Augufte, 8c depuis ce teins les empereurs
firent des ordonnancés appelléeS conflitutio*
nés principum.
De ces conftitutions des empereurs, forent formés
les codes grégorien, hermogénien , 6c thèodofien.
Enfin, Juftinien fit publier en 528 , qui étoit la
troifieme année de fon régné , la première édition
de fon code , compofé, tant des conftitutions com-
prifes dans les précédens codes , que de celles qui
étoient furvenues depuis.
Telles étoient les lois obfervées jufqu’au tems dé
la confection du digelie , outre lefquelles il y avoit
les réponfes des jurilconfultes quifaifoient aufli partie
du droit romain.
Ces réponfes des jurifconfultes tiroient leur première
origine du droit de patronage établi par Ro-
mulus chaque plébeïen fe choififloit parmi les patriciens
un prote&eur ou patron qui l’aflïftoit, entriau-
tres chôfes, de fes confeils : les Confiâmes, où corps
de métier ; les colonies ; lés villes alliées ; les nations
vaincues avoient leurs patrons.
Dans la fuite quelques particuliers s’étant adonnés
à l’étude des lois , 6c à leur interprétation, on
leur donna aufli le nom de patrons ; le nombre dé
ces jurifconfultes qui n’étoit pas d’abord fort confi-
dérable, s’accrut beaucoup dans la fuite; & comme
ils donnoient des confeils fur toutes fortes dé quef-
tlons, 6c fe chargement de la défenfê des parties,
ils furent infénfiblement fubrogés pour cès fondions
aux anciens patrons.
Le premier jurifconfulte romain qui.nous foit connu
, eft Sextus Papyrius, qui fit la colleâion des lois
royales
Les décemvirs qui rédigèrent la loi des douze fables
s’arrogèrent le droit de l’interpréter, 6c drefle-
rent les formules.
cesC fnoerimusu lFesla ,v ifuusr e8nct Sextus Ælius qui divulguèrent àufli regardés Comme des interprètes
du droit.
Depuis ce tems, plufieurs autres particuliers s’appliquèrent
à l’étude des lois : on Voit dès l’an 449 de
Rome, un Appiiis'Claudiiis Céntemmanus, arriere-
petit-fils du décemvir de ce nüfn, 6c Simpronius fur-
nommé le fage, le feiil jürifoônfulte auquel cé fur-
nom ait été.donné du tems de ces jurifcOnfultès : oh
fe contentoit d’expliquer verbalement le fens des
lois, c’eft pourquoi oh ne trouve aucune de leurs
réponfes dans le digtjle, Tibérius Cofuncamis, qifi