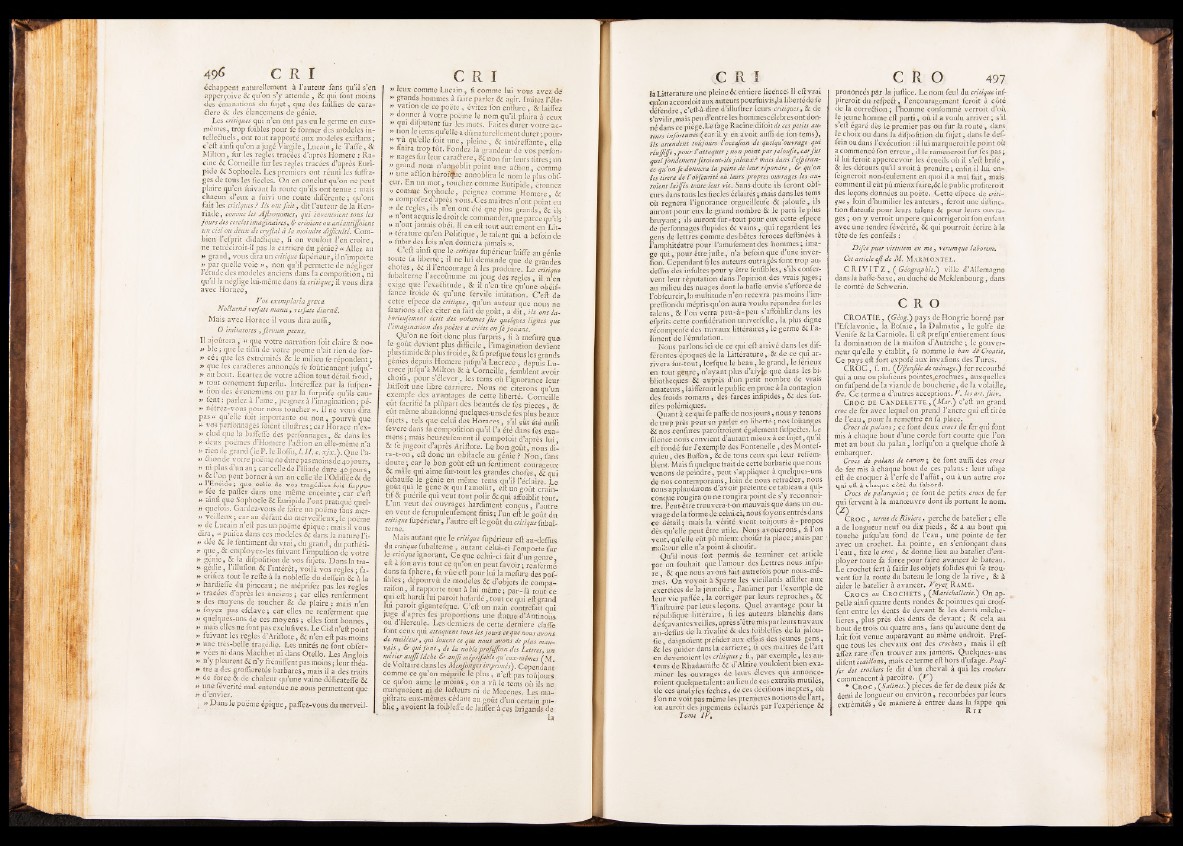
échappent naturellement à l’auteur fans qu’il s’en
apperçoive & qu’on s’y attende , & qui font moins
des émanations du fujet, que des faillies de cara-
ftere & des élancemens de génie.
Les critiques qui n’en ont pas eu le germe en eux-
mêmes, trop foibles pour fe former des modèles in-
telle&uels, ont tout rapporté aux modèles exiftans ;
c ’eft ainfi qu’on a jugé Virgile, Lucain, le Taffe, &
Milton, fur les réglés tracées d’après Homere : Racine
& Corneille fur les réglés tracées d’après Euripide
& Sophocle. Les premiers ont réuni les fuffra-
ges de tous les fiecles. On en conclut qu’on ne peut
plaire qu’en fuivant la route qu’ils ont tenue : mais
chacun d’eux a fuivi une route différente ; qu’ont
fait les critiques ? Ils ont fait, dit l’auteur de la Hen-
riade, comme les Afronomes, qui inventoient tous les
jours des cercles imaginaires, & créoient ou anéantiffoient
un ciel ou deux de cryjlal à la moindre difficulté. Combien
l’efprit didactique, fi on vouloit l’en croire,
ne retréciroit-il pas la carrière du génie ? « Allez au
» grand, vous dira un critique fupérieur, il n’importe
» ^par quelle voie » , non qu’il permette de négliger
l’étude des modèles anciens dans la compofition, ni
qu’il la néglige lui-même dans fa critique; il vous dira
avec Horace,
Vos exemplaria greeca
Noclurnâ verfate manu, verfatc diurnâ.
Mais avec Horace il vous dira .auffi,
O imitatores , fervum pecus.
Il ajoutera, « que votre narration foit claire & no-
» b le ; que le tiffu de votre poëme n’ait rien de for-
» ce ; que les extrémités & le milieu fe répondent ;
» que les cara&eres annoncés fe foûtiennent jufqu’-
» au bout. Ecartez de votre aCtion tout détail froid ,
» tout ornement fuperflu. Intéreffez par la fufpen-
» lion des évenemens ou par la furprife qu’ils cau-
» fent : parlez à l’ame, peignez à l’imagination ; pé-
» nétrez-vous pour nous toucher ». Il ne vous dira
pas « qu’elle foit importante ou non , pourvû que
» vos'perfonnages foient illuftres ; car Horace n’ex-
» clud que la baffeffe des perfonnages, & dans les
» deux poemes d’Homere l’aCtion en elle-même n’a
» rien de grand (le P. le Boffu, /. II. c. x jx .). Que l’a-
» Ctionde votre poëme ne dure pasmoins de 40 jours,
» ni plus d un an ; car celle de l’Iliade dure 40 jours,
» & l’on peut borner à un an celle 'de l’Odiffée & de
» l’Enéide; que celle de vos tragédies foit fuppo-
» fée fe paffer dans une même enceinte ; car c’eft
» ainfi que Sophocle & Euripide l’ont pratiqué quel-
» quefois. Gardez-vous de faire un poëme fans mer-
» veilleux ; car au défaut du merveilleux, le poëme
» de Lucain n eft pas unpoeme épique : mais il vous
dira, « puifez dans ces modèles & dans la nature l’i-
» dée & le fentiment du vrai, du grand, du pathéti-
» que , & employez-îes fuivant l’impulfion de votre
» génie, & la difpofition de vos fujets. Dans la tra-
» gédie, l’illufion & l’intérêt, voilà vos réglés ; fa-
» criiez tout le refie à la nobleffe du deffein & à la
» hardieffe du pinceau ; ne méprifez pas les réglés
» tracées d’après les anciens ; car elles renferment
» des moyens de toucher & de plaire : mais n’en
» foyez pas efclave ; car elles ne renferment que
>> quelques-uns de ces moyens ; elles font bonnes ,
» mais elles ne font pas exclufives. Le Cid n’eft point
» fuivant les réglés d’Ariftote, & n’en eft pas moins
» une très-belle tragédie. Les unités ne font obfer-
» vées ni dans Machbet ni dans Otello. Les Anglois
» n’y pleurent & n’y frémiffent pas moins ; leur théa-
» tre a des groftîeretés barbares, mais il a des traits
>> de force & de chaleur qu’une vaine délicateffe & •
» une fe vérité mal entendue ne nous permettent que
» d’envier. I
I % Dans le poëme épique, paffez-vous du merveil-
» leux tomme Lucain, fi comme lui vous avez dé
» grands hommes à faire parler & agir. Imitez l’éle-
» vation de ce poëte , évitez fon enflure, & laiffez
» donner à votre poëme le nom qu’il plaira à ceux
» qui difjputent fur les mots. Faites durer votre ac-
» tion leyems qu’elle a dû naturellement durer - pour-
» vu qu elle foit une, pleine, & intéreffante, elle
» finira trop tôt. Fondez la grandeur de vos perfon-
» nages fur leur caraftere, & non fur leurs titres ; un
» gland nom n annoblit point une aCtion, comme
| une action héroïque annoblira le nom le plus obf-
cur. En un mot, touchez comme Euripide, étonnez
» comme Sophocle, peignez comme Homere &
» compofez d’après vous. Ces maîtres n’ont point eu
» de réglés, ils n’en ont été que plus grands, & ils
» n’ont acquis le droit de commander,que parce qu’ils j
» n ont jamais obéi. II en eft tout autrement en Lit-
» térature qu’en Politique, le talent qui a befoin de
» fubir des lois n’en donnera jamais ».
C ’eft ainfi que \e-critique fupérieur Jaiffe au génie
toute fa liberté ; il ne lui demande que de grandes
choies, & il l’encourage à les produire. Le critique
fubalterne l’accoutume au joug des réglés, ilm’en
exige que 1’exaûitude, & il n’en tire qu’une obéif-
fance froide & qu’une fervile imitation. C ’eft de
cette efpece de critique, qu’un auteur que nous ne
faurions allez citer en fait de goût, a dit, ils ont la-
borieufement écrit des volumes fur quelques lignes que
l'imagination des poètes a créées en fe jouant.
Qu’on ne foit donc plus furpris, fi à mefure que
le goût devient plus difficile, l’imagination devient
plus timide & plus froide, & fi prefque tous les grands
génies depuis Homere jufqu’à Lucrèce, depuis Lucrèce
jufqu’à Milton & à Corneille, femblent avoir
choifi, pour s’élever, les tems où l’ignorance leur
laiffoit une libre carrière. Nous ne citerons qu’un
exemple des avantages de cette liberté. Corneille
eût facrifîé la plûpart des beautés de fes. pièces &
eut même abandonné quelques-uns de fes plus beaux
fujets, tels que celui des Horaces, s’il eût été aufli
fevere dans fa compofition qu’il l’a été dans fes examens;
mais heureufement il compofoit d’après lui
& fe jugeoit d’après Ariftote. Le bon goût, no-us dira
t-on , eft donc un obftacle au génie ? Non fans
doute; car le bon goût eft un fentiment courageux
& mâle qui aime fur-tout les grandes chofes, & qui
échauffe le génie en même tems qu’il l’éclaire. Le
goût qui le gêne & qui l’amollit, eft un goût craint
if & puérile qui veut tout polir & qui affaiblit tout.
L’un veut des ouvrages hardiment conçus, l’autre
en veut de fcrupuleulemerit finis ; l’un eft le goût du
critique fupérieur, l’autre eft le goût du critique fubalterne.
Mais autant que le critique fupérieur eft au-deffus
du critique fubalterne , autant celui-ci l’emporte fur
le critique ignorant. Ce que celui-ci fait d’un genre,
eft à fon avis tout ce qu’on en peut favoir ; renferml
dans fa fphere, fa vue eft pour lui la mefure des pof-
fibles ; dépourvû de modèles & d’objets de comparaison
, il rapporte tout àiui même; par-là tout ce
qui eft hardi lui paroit hafardé, tout ce qui eft grand
lui paroît gigantefque. C ’eft un nain contrefait qui
juge^ d’après fes proportions une ftatiie d’Antinoiis
ou d’Hercule. Les derniers de cette derniere claffe
font ceux qui attaquent tous les jours ce que nous avons
de meilleur, qui louent ce que nous avons de plus mauvais
, & qui font, de la noble profeffion des Lettres, un
mener auffi lâche & auffiméprifable qu'eux-mêmes f M.
de Voltaire dans les Menfonges imprimés}. Cependant-
comme ce qu’on méprife le plus , n’eft pas toûjours
ce qu’on aime le moins , on a vû le tems où ils ne
manquoient ni, de le&eurs ni de Meçenes. Les ma-
»iftrats eux-mêmes cédant au goût d’un certain public,
ayoient la foibleffede laiffer. à ces brigands de
la Littérature une pleine & entière licence'. Il eft vrai
quion accordoit aux auteurs pour.fuivis,la liberté de fe
défendre c’eft-à-dire d’illuftrer leurs critiques, & de
s’avilir mais peu d’entre les hommescélebres ont donné
dans*ce piège.Lé fage Racine difoit de ces petits au-
tiurs infortunés -(cartily en a voit auffi de fon tems),
ils attendent toujours l'occafion de quelqu ouvrage qui
réuffijfe, pour L'attaquer non point par jaloufie, car fur
quel fondement Jeroient-ils jaloux? mais dans l'efpéran-
ce qu'on Je donnera la peine de leur répondre, & qu'on
les tirera de Vdbfcuritê où leurs propres ouvrages les auraient
laiffés toute'leur vie. Sans doute ils feront obf-
curs dans tous les fiecles éclairés j mais dans les tems
où régnera l’ignorance orgueilleufe & jaloufe, ils
auront pour eux Je grand nombre & le parti le plus
bruyant ; ils auront fur-tout pour eux cettç efpece
de perfonnages ftupides & vains, qui regardent les
gens de lettres comme des-bêtes féroces deftinçes à
l ’amphitéatre pour l’amufement de& hommes ; jma-
ge qui, pour être jufte, n’a befoin que d’une inver-
fion. Cependant fi les auteurs outrages font trop au-
deffus des infultes pour y être fenfibles, s’ils confer-
vent leur réputation dans l’opinion des vrais juges;
au milieu dés nuages dont la baffe;envie s’efforce de
l’obfcurcir, la multitude n’en recevra pas moins l’im-
prefîiondu mépris qu’on aura voulu répandre fur ies
talens, & l’on verra peu.^à-peu s’affoiblir dans les
efprits cette confidération univerfellè, la plus digne
récompenfe des travaux littéraires, le germe & 1 a-
liment de l’émulation. : ^
Nous parlons ici de ce qui eft arrivé dans les différentes
époques de la L itté ra tu re& de ce qui arrivera
fur-tout, lorfque le beau, le.grand, le férieux
en tout genre, n’ayant plus d’aiylp que dans les bibliothèques
& auprès d’un petit nombre de vrais
amateurs, laifferontle public en proie à la contagion
des froids romans, des farces infipides, & des fot-
tifes polémiques.
Quant à ce qui fe pafte de noSijours,. nous y tenons
de trop près pour en parler en liberté ; nos loiianges
& nos cenfures paroitroient également fufpecles. Le
filence nous convient d’autant mieux à ce fujet, qu’il
eft fondé fur l’exemple des Fontenelle , des Montef-
quieu , ’des Buffon, & de tous ceux qui leur reffem-
blent. Mais fi quelque trait de cette barbarie que nous
venons de peindre, peut s’appliquer à quelques-uns
de nos contemporains, loin de nous retraâer, nous
nous applaudirons d’avoir prefente ce tableau à quiconque
rougira ou ne rougira point de s’y re.connoî-
tre. Peut-être trouvera-ton mauvais que dans un ouvrage
de la forme de celui-ci, nous foyons entres dans
ce détail; mais la vérité vient toûjours à-propos
dès qu’elle peut être utile. Nous avouerons, fi l’on
veut, qu’elle eût pû mieux choifir fa place; mais par
malheur elle n’a point à choifir.
Qu’il nous foit permis de terminer cet article
par un fouhait que l’amour des Lettres nous infpi-
re , & que nous avons fait autrefois pour nous-mêmes.
On voyoit à Sparte les vieillards afîifter aux
exercices de la jeuneffe, l’animer par l’exemple de
leur viepaffée, la corriger par leurs reproches, &
l ’inftruire par leurs leçons. Quel avantage pour la
république littéraire, fi les auteurs blanchis dans
delçavantes veilles, après s’être mis parleurs travaux
au-deffus de la rivalité & des foibleffes de la jaloufie
daienoient préfider aux effais des jeunes, gens,
& les guider dans la carrière;; û ces maîtres de 1 art
en devenoient les critiques ; fi, par exemple, les auteurs
de Rhadamifte & d’Àlzire vouloient bien examiner
les ouvrages de leurs eleves qui annonce-
iroient quelque talent : au lieu de ces extraits mutiles,
de ces analyfes feches, de c!es; decifions ineptes, ou
l ’on ne voit pas même les premières notions.de l art,
on auroit des jugemens éclairés par l’experience &
Tome IF,
prononcés par la juftice. Le nom feul du critique inf-
pireroit du refjjeét, l’encouragement feroit à côté
de la corre&ion ; l’homme confommé verroit d’où
le jeune homme eft parti, où il a voulu arriver ; s’il
s’eft égaré dès le premier pas ou fur la route, dans,
le choik ou dans la difpofition du fujet, dans le deffein
ou dans l’exécution : il lui marqueroi t le point où
a commencé fon erreur, il le rameneroit fur fes pas ;
il lui feroit appercevoir les écueils où il s’eft brifé ,
& les détours qu’il avoit à prendre ; enfin il lui en-,
feigneroit non-feulement en quoi il a mal fait, mais
comment il eût pû mieux faire,& le public profiteroit
des leçons données au poëte. Cette efpece de critique
, loin d’humilier les auteurs , feroit une diftinc-
tion flateufe pour leurs talens & pour leurs ouvrages
; on y verroit unpere qui corrigeroit fon enfant
avec une tendre févérité, 6c qui pourroit écrire à la
tête de fes confeils :
Difce puer virtutem ex me, verumque labo rem.
Cet article ejl de M. MARMONTEL.
C R I V I T Z , ( Géographie.) ville d’Allemagne
dansla bâffe-Saxe, au duché de Meklenbourg, dans
le comté de Schwerin.
C R O
CROATIE, ([Géog.) pays de Hongrie borné par
l’Efclavonie, la Bofnie, la Dalmatie , le golfe de
Venife &. la Carniole. Il eft prefqu’entierement fous
la domination de la maifon d’Autriche ; le gouverneur
qu’elle y établit, fe nomme le ban de Croatie.
Ce pays eft fort expofé aux invafions des Turcs. -
CROC , f. m. (U f enfile de ménage.) fer recourbé
qui a une ou plufieurs pointes^crochues, auxquelles
on fufpend de la viande de boucherie, de la volaille,
&c. Ce terme a d’autres acceptions. V. lesart.fuiv.
C r o c d e C a n d e l e t t e , (Mar.) c’eft un grand
croc de fer avec lequel on prend l ’ancre qui eft tirée
de l ’eau, pour la remettre en fa place.
Crocs de palans ; ce font deux crocs de fer qui font
mis à chaque bout d’une corde fort courte que l’on
met au bout du palan , lorfqu’on a quelque chofe à
embarquer.
Crocs de palans de canon ; ce font auffi des crocs
de fer mis à chaque bout de ces palans : leur ufage
eft de croquer à l’erfe de l’affût, ou à un autre croc
qui eft à chaque côté du fabord.'
Crocs de palanquin ; ce font de petits crocs de fer
qui fervent à la manoeuvre dont ils portent le nom.
(Z)C
r o c , terme de Riviere, perche de batelier ; elle
a de longueur neuf ou dix pieds, & a au bout qui
touche jufqu’au fond de l’eau, une pointe de fer
avec un crochet. La pointe, en s’enfonçant dans
l ’eau fixe le croc, &c donne lieu au batelier d’employer
toute fa force pour faire avancer le bateau.
Le crochet fert à faifir les objets folides qui fe trouvent
fur la route du bateau le long de la riv e, & à
aider le batelier à avancer. Voye1 R a m e .
C r o c s ou C r o c h e t s , ('Maréckallerie.) On appelle
ainfi quatre dents rondes & pointues qui croif-
fent entre les dents de devant & les dents mâche-
lieres, plus près des dents de devant ; & cela, ait
bout de trois ou quatre ans, fans qu’aucune dent de
lait foit venue auparavant au même endroit. Prefque
tous les chevaux ont des crochets, mais il eft
affez rare d’én trouver aux jumens. Quelques-uns
difent écaillons, mais ce terme eft hors d’ufage. Pouffer
des crochets fe dit d’un cheval à qui les crochets
commencent à paroître. (V )
* C r o c , (Salines.) pièces de fer de deux piés &
demi de longueur ou environ, recourbées par leurs
extrémités, de maniéré à entrer dans la fappe qui
R r r