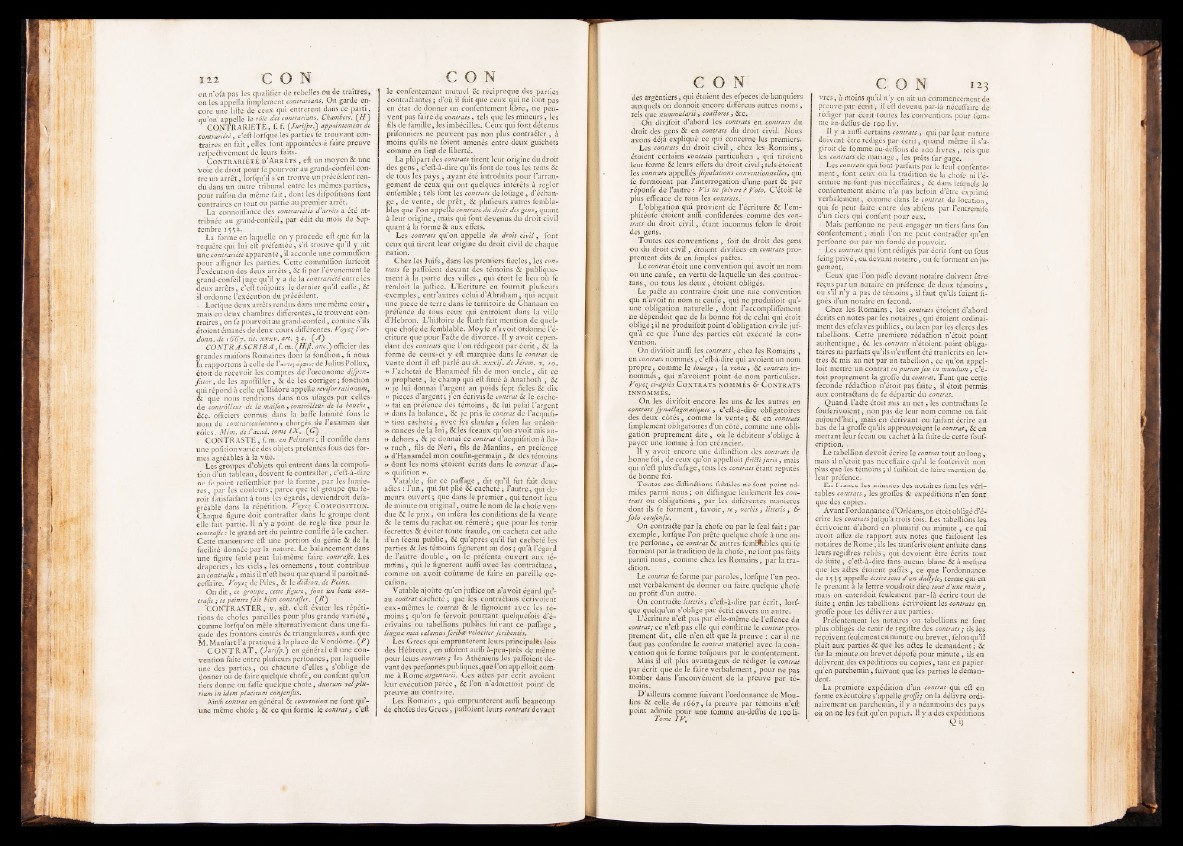
on n’ofa pas les qualifier de rebelles on les appella Amplement ou de traîtres, contrarians. On garde encore
une lifte de ceux qui entreront dans ce parti,
qu’on appelle le rôle des contrarians. Charniers. (#)
CONTRARIÉTÉ, fi fi (Jurifpr.) appointement de
c o n t r a r ié t é, c’eft lorfque les parties le trouvant contraires
en fait, elles font appointées-à faire .preuve
refpeftivement de leurs faits.
C o ntr ariété d’Arrêts , eft un moyen & une
voie de droit pour fe pourvoir au grand-confeil contre
un arrêt, lorfqu’il s’en trouve un précédent rendu
dans un autre tribunal entre les memes .parties,
pour raifon du même fait, dont les difpofitions font
conLtara icroensn oeinf tfoauntc eo ude psa rtie au premier arrêt. ^ contrariétés d'arrêts a été attribuée
au grand-confeil., par -édit du mois de SeptemLbar
ef o1r5m5e1 .en laquelle on y procédé eft que fur la
requête qui lui eft préferilée, s’il trouve qu’il y ait
une contrariété apparente, il accorde une commifîion
pour afligner les parties. Cette commilfion furfeok
l’exécution des d’eux arrêts ; & fi par l’evenèment le
grand-confeil juge qu’il y a de la contrariété entre les
deux arrêts, c’eft toujours le dernier qu’-il cafte, &
il ordonne l’exécution du précédent.
• Lorfque deux arrêts rendus dans une même cour,
mais en deux chambres différentes ,.fe trouvent contraires
, on fe pourvoit au grand-confeil, comme s’ils
étoient émanés de deux cours différentes. Voyei l'or-
donn. de \66j . tit. xxxv. art. 3 4. (A)
CONTRA-SCR1B A , fi m. (Hift. anc.') officier dés
grandes maifons Romaines dont la fondtion, fi nous
la rapportons à celle de Y ctrnycLfçtuç de Julius Pollux,
étoit de recevoir les comptes de l’oeconome difpen-
fator, de les apoftiller, & de les corriger ; fonftion
qui répond à celle qu’Ifidore appelle revifor rationum, &de que nous rendrions dans nos ufages par celles- contrôlleur de la maifon y<ontrôlleur de la bouche, &c. officiers connus dans la bafle latinité fous le
nom de contrarotulatores, chargés de l’examen des
rôles. Mém. de L'acad. tome IX. (fx) , CONTRASTE, fi m. en Peinture ; il confifte dans
line pofition variée des objets présentés fous des formeLse
asg rgéraobulpese,s àd ’loab vjeutes. qui__ entrenty .d- ans la compofi.-
tion d’un tableau, doivent fe contrafter, c’eft-à-dire
ne fe point reflembler par la forme, par les lumières
, par les couleurs ; parce que tel groupe qui fe-
roit fatisfaifant à tous les égards, deviendroit defa-
gréable dans la répétition. Voye{ C omposit ion. Chaque figure doit contrafter dans le. groupe dont
elle fait partie. Il n’y a point de réglé fixe pour le
contrafle : le grand art du peintre confifte à le cacher.
Cette manoeuvre eft une portion du génie & de la
facilité donnée par la nature. Le balancement dans
une figure feule peut lui-même faire contrafle. Les
draperies, les cièls , les ornemens, tout contribue
au contrafle, mais il n’eft beau que quand il parokné-
ceflaire. Voye^ de Piles, & le diction, de Peint. On dit, ce groupe, cette figure, font un beau contrafle
; ce peintre fait bien contrafter. (i?) • CONTRASTER, v. act. c’eft éviter les répétitions
de chofes pareilles pour plus grande variété.,
comme lorfqu’on mêle alternativement dans une façade
des frontons cintrés &c triangulaires, ainfi que
M. Manfart l’a pratiqué à la place de Vendôme. ( P ) C O N T R AT, - (.J u r i fp.) en général eft une convention
faite entre plufieurs perfonnes, par laqüelle
une des parties, ou chacune d’elles , s’oblige de
donner où de faire quelque chofe, ou confient qu’un
tiers donne ou fafle quelque chofe, d u o rum v e l p l u -
r ium in id em p la c i tu m c o n j e n ju s .
Ainfi contrat en général & convention ne font qu’une
même chofe ; & ce qui forme lè contrat, c’eft
le confentement mutuel & réciproque des parties
contractantes ; d’où il fuit que ceux qui ne font pas-
en état de donner un confentement libre, ne peuvent
pas faire de contrats y tels que les mineurs, les
fils de famille, les imbécilles. Ceux qui font détenus
prifonniers ne peuvent pas non plus contracter, à
moins qu’ils ne fioient amenés entre deux guichets
comme en liejl de liberté.
La plupart des contrats tirent leur origine du droit
des gens, c’eft-à-dire qu’ils font de tous les tems &
de tous les pays., ayant été introduits pour l’arrangement
de ceux qui ont quelques intérêts à régler
enfemble ; tels font les contrats de loiiage, d’échange
, de vente, de prêt, & plufiçurs autres fembla-
bles que l’on appelle contrats du droit des gens, quant
à leur origine, mais qui font devenus du droit civil
quant à la forme & aux effets.
Les contrats qu’on appelle du droit civil, font
ceux qui tirent leur origine du droit civil de chaque
nation.
Chez les Juifs , dans les premiers iiecles, les contrats
fe pafloient devant des témoins & publiquement
à la porte des v ille s , qui étoit le lieu où fe
rendoit la juftice. L’Ecriture en fournit plufieurs
-exemples, entr’autres celui d’Abraham, qui acquit
une pièce de terre dans le territoire de Chanaan en
•préfence de tous-ceux qui entroient dans la ville
d’Hebron. L’hiftoire de Ruth fait mention de quelque
chofe de femblable. Moyfe-n’avoit ordonné l’écriture
que pour l’aCte de divorce. Il y avoit cependant
des contrats que l ’on rédigeoit par écrit, & la
forme de ceux-ci y eft marquée dans le contrat de
vente dont il eft .parlé au ch. xxxij. de Jérem. y. 10.
*< J’achetai de Hanaméel fils de mon oncle, dit ce
» prophète , le champ qui eft fitué à Anathoth , &
» je lui donnai l’argent au poids fept ficles & dix
» pièces d’argent ; j’en écrivis le contrat & le cache-
» tai en préfence des témoins, & lui pefai l ’argent
» dans la balance, & je pris le contrat de l’acquifi-
» tion cacheté -, avec fes claufes, félon les ordon-
» nances de ‘la lo i, & les fceaux qu’on avoit mis au-
» dehors , & je donnai ce contrat d’acquifition à Ba-
» ruch, fils de Neri, fils de Manfias, en préfence
:» d’Hanaméel mon coufin-germain, & des témoins
» dont les noms étoient écrits dans le contrat d’ac-
» quifition ».
Vatable, fur ce paflage, dit qu’il fut fait deux
afles : l’un, qui fut plié & cacheté ; l’autre, qui demeura
ouvert ; que dans le premier, qui tenoit lieu
de minute ou original, outre le nom de la chofe vendue
& le prix, on inféra les conditions de la vente
& le tems du rachat ou réméré ; que pour les tenir
■ fecrettes & éviter toute fraude, on cacheta cet aâe
d’un fceau public, & qu’après qu’il fut cacheté les
parties & les témoins lignèrent au dos ; qu’à l’égard
de l’autre double, on le préfenta ouvert aux témoins,
qui. le lignèrent aulïï avec les contraflans,
comme on avoit coutume de faire en pareille oc-
cafton.: ...
Vatable ajoute qu’en juftice on n’avoit égard qu’au
contrat cacheté ; que les contra&ans écrivoient
eux-mêmes le. contrat & le fignoient a vec les témoins
; qu’on fe.fervoit pourtant quelquefois d’écrivains
ou tabellions publics fuivant ce paflage ,
lingua mea calamus feribee velociter feribentis.
Les Grecs qui empruntèrent leurs principales lois
des Hébreux, en ufoi'ent aufli à-peu-près de même
pour leurs contrats ; les Athéniens les pafloient devant
des perfonnes publiques,que l’on appelloit comme
à Rome argentarii. Ces : aftes par écrit avoient
leur exécution parée, & l’on n’admettoit point de
preuve au contraire. ;
Les Romains, qui empruntèrent aufli beaucoup
de chofes des Grecs, pafloient leurs contrats deyant
des argentiers, qui étoient des efpeces de banquiers
auxquels on donnoit encore différens autres noms,
tels que nummulafù.» coaclores, &c.
; On divjfoitd’abordles contrats en contrats du
droit des gens & en contrats du droit civil. Nous
avons .déjà expliqué ce qui concerne les premiers.
Les 'contrats du droit c iv il, : chez les .iRoniains'-,
étoient certains contrats .particuliers , qui tiro'ient
leur forme & leurs effets du droit civil tels étoient
les contrats appellés flipulations conventionnelles, qui.
fe. formoient par l’interrogation d’une part & par
réponfe de l’autre : Vis ne folvere ? Volo. C ’étoit -le
plus efficace de fous les contrats. ■
L’obligation qui provient de l’écriture & l’em-
phitéofe étoient aufli confiderées comme des corir;
trats du droit c iv il, étant inconnus félon le droit
des gens.
Toutes ces conventions , foit du,droit des gens
ou du droit c iv il, étoient divifées en contrats proprement
dits & en fimples paâes.
Le contrat étoit une convention qui avoit un nom.
011 une caufe, en vertu de laquelle un de.s contrac-'
tans, ou tous les d eux, étoient obligés.
Le paâe au contraire étoit une nue convention
qui n’avoit ni nom ni caufe, qui ne produifoit qu’une
obligation naturelle , dont l’aceompliflement
ne dépendoit que de la bonne foi de celui qui étoit
obligé ; il ne produifoit point d’obligation civile juf-
qu’à ce que l’une des parties eût exécuté la convention.
On divifoit aufli les.contrats, chez les Romains ,
en contrats nommés, c’eft-à-dire qui avoient un nom
propre, comme le louage, la vente, & contrats innommés
, qui n’avoient point de nom particulier.
Voye{ ci-aprls Contrats NOMMÉS & CONTRATS-
INNOMMÉS.
On les divifoit encore les uns & les autres en
contrats Jynallagmatiques , c’eft-à-dire obligatoires
des deux côtés, comme la vente ; & en contrats
Amplement obligatoires d’un côté, comme une obligation
proprement dite , où le débiteur s’oblige à
payer une femme à fon créancier.
Il y avoit encore une diftin&ion des contrats de
J>onne foi, de ceux qu’on appelloit ftricli juris, mais
qui n’eft plus d’ufage, tous les contrats étant réputés
de bonne foi.
, Toutes ces diftin&ions fubtiles ne font point ad-
mifes parmi nous ; on diftingue feulement les contrats
ou obligations , par les différentes maniérés
dont ils fe forment, favoir, re , verbis , litteris, &
folo çonfenfu. . .
On contrafle par la chofe ou par le feul fait : par
exemple, lorfque l’on prête quelque chofe à une autre
perfonne, ce contrat & autres femtffcibles qui fe
ferment par la tradition de la chofe, ne font pas faits
parmi nous, comme chez les Romains, par la tradition.
Le contrat fe forme par paroles, lorfque l’un pro-,
met. verbalement de donner ou faire quelque chofe
au profit d’un autre.
On contrafle litteris, c’eft-à-dire par écrit, lorfque
quelqu’un s’oblige par écrit envers un autre.
L’ecriture n’eft pas par elle-même de l’eflence du
contrat; ce n’eft pas elle qui conftitue le contrat proprement
dit, elle n’en eft que la preuve : car il ne
faut pas confondre le contrat matériel avec la convention
qui fe forme toujours par le confentement.
Mais il eft plus avantageux de rédiger le contrat
par écrit que de le faire verbalement, pour ne pas;
tomber dans l’inconvénient de la preuve par témoins.
D ’ailleurs comme fuivant l’ordonnance de Moulins
& celle de 1667, la preuve par témoins n’eft
point admife pour une femme au-defliis de 100 li-
Tome IV ,
vrés, à moins qu’il n’y-en ait un commencement de
preuve par éorit, il eft devenu par-là néceflaire de
rédiger par écrit toutes les conventions pour femme
au-deflus de 100 liv.
Il y a aufli certains contrats , qui par leur nature
doivent être rédigés par écrit, quand même il s’a-
giroit de femme, au-deffoiis de 100 livres , tels que
les contrats de mariage, les prêts fur gage.
I Les contrats qui font parfaits par le leul confentement,
font ceux, où la tradition de la chofe ni l’écriture
ne, font pas néeeffaires , éc dans iefquels le
confentement même n’a pas befoin d’être exprimé,
verbalement, comme dans lé contrat de location
qui fe peut faire entre des abfens par l ’entremife
d’un tiers qui “confent pour eux.
■ Mais perfonrî.e ne peut engager un tiers fans fon
confentement ; ainfi l’on ne peut contrafter qu’en
perfonne ou par un fondé de pouvoir.
J Les contrats qui font rédigés par écrit font ou fous
féing privé,.ou devant notaire, ou fe forment en ju-,
gement.
Ceux que Ton pafle devant notaire doivent être
reçus par un notaire en préfence dè deux témoins ,
ou s’il n’y a pas de témoins, il faut qu’ils foient lignes
d’un-notaire en fécond.
Chez les Romains , les contrats étoient d’abord
écrits en notes par les notaires, qui étoient ordinai-
me;nt des efçla ves publics, ou bien par les clercs des
tabellions. Cette première rédaftion n’étoit point
authentique, & les contrats n’étoient point obligatoires
ni parfaits qu’ils n’euffent été tranferits en lettres
& mis au net par un tabellion, ce qu’on appel-,
lpit mettre un contrat in purum feu in mundum , c’é-
toit proprement la grofle du contrat. Tant que cette
fécondé rédaftion n’étoit pas faite, il étoit permis,
aux contraflans de fe départir du contrat.
Quand..fade étoit mis au net, les contraflans le
feufcriy.oient, non pas de leur nom comme on fait
aujourd’hui, mais en écrivant ou faifant écrire au
bas de la grofle qu’ils approuvoient le contrat, & en
mettant leur fcèau ou cachet à la fiiite.de cette foufi-
cription. (
Le tabellion devoit écrire le contrat tout au long ,
mais il n’étoit pas néceflaire qu’il le fouferivît non
plus que les témoins ; il fuflifoit.de faire mention de,
leur préfence.
En France les minutes des notaires font les véritables
contrats, les groffes & expéditions n’en font
que des copies.
Avant l’ordonnance d’Orléans,on étoit obligé d’écrire
les contrats jufqu’à trois fois. Les tabellions les
écrivoient d’abord en plumitif ou minute , ce qui
avoit affez de rapport aux notes que faifoient les
notaires de Rome ; ils les tranferivoient enfuite dans
leurs regiftres reliés, qui dévoient être écrits tout
de fuite, ç’eft-à-dire fans aucun blanc & à mefure
que les afles étoient pafles, ce que l’ordonnance-
de 1535 appelle écrire tout d’un daayle, terme qui en
le prenant à la lettre voudroit dire tout d'une main ,
mais on entendoit feulement par-là écrire tout de
fuite ; enfin les tabellions écrivoient les contrats en
grofle pour les délivrer aux parties.
Préfentement les notaires ou tabellions ne font
plus obligés de tenir de regiftre des contrats ; ils les
reçoivent feulement en minute ou brevet, félon qu’il
plaît aux parties & que les aftes le demandent; &
fur la minute ou brevet dépofé pour minute , ils en
délivrent des expéditions ou copies, tant en papier
qu’en parchemin, fuivant que les parties le demandent.
La première expédition d’un contrat qui eft en
forme exécutoire s’appelle grofle; on la délivre ordinairement
en parchemin, il y a néanmoins des pays
où on ne les fait qu’en papier. Il y a des expéditions
,Q ;i