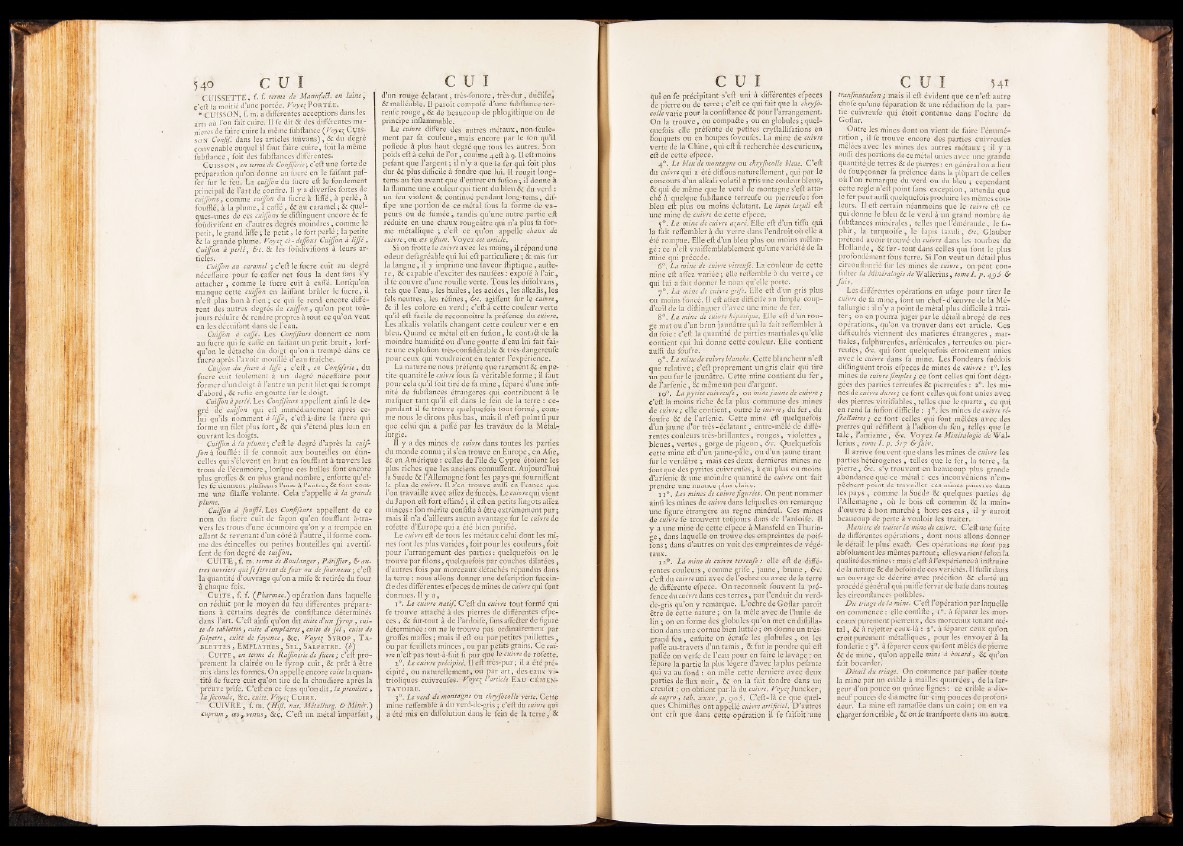
540 c u i
CUISSETTE, f. f. terme de Manufact. en laine,
c ’ e ft la moitié d ’une p o r té e . Voy.e^ P o r t é e .
* CUISSON, 1'. m. a différentes acceptions dans les
arts oii l’on fait cuire. Il fe dit & des différentes maniérés
de faire cuire la même fubftance (Voye^ Cuisson
Confif. dans les articles fuivans), & du degré
convenable auquel il faut faire cuire, foit la même
fubftance, foit de§ fubftances différentes.
C u i s s o n , en terme de Confiferie ; c’eft une forte de
préparation qu’on donne au lucre en le faifant paffer
fur le feu. La cuijfon du lucre eft le fondement
principal de l’art de confire. Il y a diverfes fortes de
cuijfons, comme cuijfon du fucre à liffe, à perle, à
foufflé, à la plume, à cafte, & au caramel ; & quelques
unes de ces cuijfons fe diftinguent encore & fe
foûdivifent en d’autres degrés moindres, comme le
petit, le grand liffe ; le petit, le fort perlé ; la petite
& la grande plumé. Voye{ ci-dejfous Cuijfon à liffé,
Cuijfon à perlé, &c. & les foûdivifions à leurs articles.
Cuijfon au caramel ; c’eft le fucre cuit au degré
néceffaire pour fe caffer net fous la dent fans s’y
attacher , comme le fucre cuit à caffé. Lorfqu’on
manque cette cuijfon en laiffant brûler le fucre, il
n’eft plus bon à rien ; ce qui le rend encore différent
des autres degrés de cuijfon, qu’on peut toujours
réduire & rendre propres à tout ce qu’on veut
en les décuifant dans de l’eau.
Cuijfon à caffé. Les Confifeurs donnent ce nom
au fucre qui fe caffe en faifant un petit bruit, lorfqu’on
le détache du doigt qu’on a trempé dans ce
lucre après l’avoir mouillé d’eau fraîche.
Cuijfon du fucre à liffé ; c’eft , en Confiferie, du
fucre cuit feulement à un degré néceffaire pour
former d’un doigt à l’autre un petit filet qui fe rompt
d’abord, &c refte en goutte fur le doigt.
Cuijfon à perlé. Les Confifeurs appellent ainfi le degré
de' cuijfon qui eft immédiatement après celui
qu’ils nomment à liffé, c’eft-à-dire le fucre qui
forme un filet plus fort, & qui s’étend plus loin en
ouvrant les doigts.
Cuijfon à la plume ; c’eft le degré d’après la cuif-
fon à foufflé : il fe connoît aux bouteilles ou étincelles
qui s’élèvent en haut en foufflant à-travers les
trous de L’écumoire, lorfque ces bulles font encore
plus groffes & en plus grand nombre, enforte qu’elles
fe tiennent plufieurs l’une à l’autre, & font comme
une filaffe volante. Cela s’appelle à la grande
plume. # ■ f : ■ ' " "• . “
Cuijfon à foufflé. Les Confifeurs appellent de ce
nom du fucre cuit de façon qu’en foufflant à-travers
les trous d’une écumoire qu’on y a trempée en
allant &c revenant d’un côté à l’autre, il forme cont
me des étincelles ou petites bouteilles qui avertif-
fent de fon degré de cuijfon.
CU ITE, f. m. terme de Boulanger, Pâtiffier, 6* autres
ouvriers qui fe fervent de four ou de fourneau ; c’eft
la quantité d’ouvrage qu’on a mife & retirée du four
à chaque fois.
C u i t e , f. f. (Pharmac.) opération dans laquelle
on réduit par le moyen du feu différentes préparations
à. certains degrés de confiftance déterminés
dans l’art. C ’eft ainfi qu’on dit cuite d’un Jyrop, cuite
de tablettes , cuite d'emplâtres, cuite de f e l , cuite de
falpetre, cuite de fayence , &c. Voye{ SYROP , T a b
l e t t e s , E m p l â t r e s , S e l , S a l p ê t r e , (fi)
. C u i t e , en terme de Raffinerie de fucre; c’eft proprement
la clairée ou le fyrop cuit, & prêt à être
mis dans les formes. On appelle encore cuite la quantité
de fucre cuit qu’on tire de la chaudière après la
preuve prife. C’eft en ce fens qu’on dit, la première ,
la fécondé? &c. cuite. Voyt7^ CuiRE.
CUIVRE, f. m. (fiJifi. ndt. Métallurg. & Minér.)
tuprum, oes-yvenus, &ç. C’eft un métal' imparfait,
d’un rouge éclatant, très-fonore, très-dur, du&ile*
& malléable; Il paroît compofé d’une fubftance ter*
reufe rouge, Sc de beaucoup de phlogiftique ou de!
principe inflammable. '
Le cuivre différé des autres métaux, non-feulement
par fa couleur, mais encore par le fon qu’il
poffede à plus haut degré que tous les autres. Son
poids eft à celui de l’o r , comme 4 eft à 9. Il eft moins
pefant que l’argent ; il n’y a que le fer qui foit plus
dur & plus difficile à fondre que lui. Il rougit long-
tems au feu avant que d’entrer en fufion ; il donne à
la flamme une couleur qui tient du bleu & du verd :
un feu violent & continué pendant long-tems, dif-
fipe une portion de ce métal fous la forme de vapeurs
ou de fumée, tandis qu’une autre partie eft
réduite en une chaux rougeâtre qui n’a plus fa forme
métallique ; c’eft ce qu’on appelle chaux de
cuivre •, ou ces ufium. Voyez cet article.
Si on frotte le cuivre avec les mains, il répand une
odeur defagréable qui lui eft particulière ; & mis fur
la langue, il y imprime une faveur ftiptique, aufte-
re , & capable d’exciter des naufées : expofé à l’air ,
il fe couvre d’une rouille verte. Tous les diffolvans,
tels que l’eau, les huiles, les acides, les alkalis, les
fels neutres, les réfines, &c. agiffent fur le cuivre,
& il les colore en verd ; c’eft à cette couleur verte
qu’il eft facile de reconnoître la préfence du cuivre.
Les alkalis volatils changent cette couleur ver e en
bleu. Quand ce métal eft en fufion, le contaft de la
moindre humidité ou d’une goutte d’eau lui fait faire
une explofion très-confiderable & très-dangereufe
pour ceux qui voudroient en tenter l’expérience.
La nature ne nous préfente que rarement & en petite
quantité le cuivre fous fa véritable forme ; il faut
pour cela qu’il foit tiré de fa mine, féparé d’une infinité
de fubftances étrangères qui contribuent à le
mafquer tant qu’il eft dans le fein de la terre : cependant
il fe trouve quelquefois tout formé , comme
nous le dirons plus bas, mais il n’eft point fi pur
que celui qui a paffé par les travaux de la Métallurgie.
Il y a des mines de cuivre dans toutes les parties
du monde connu ; il s’en trouve en Europe, en Afie,
en Amérique : celles de l’île de Cypre étoient les
plus riches que les anciens connuffent. Aujourd’hui
la Suede & l’Allemagne font les pays-qui fourniffent
le plus de cuivre. Il s’en trouve aufii en France que
. l’on travaille avec affez de fuccès. Le cuivre qui vient
du Japon eft fort eftimé ; il eft en petits lingots affez
minces : fon mérite confifte à être extrêmement pur;
mais il n’a d’ailleurs aucun avantagé fur le cuivre de
rofette d’Europe qui a été bien purifié.
Le cuivre eft de tous les métaux celui dont les mi-r
nés font les plus variées, foit pour les couleurs, foit
pour l’arrangement des parties : quelquefois on le
trouve par filons, quelquefois par couches dilatées,
d’autres fois par morceaux détachés répandus dans
la terre : nous allons donner une defcription fuccin-
fte des différentes efpeces de mines de cuivre qui font
connues. Il y a ,
1 °. Le cuivre natif. C ’eft du cuivre tout formé qui
fe trouve attaché à des pierres de différentes efpeces
, & fur-tout à de l’ardoife, fans affefter de figuré
déterminée : on ne le trouve pas ordinairement par
groffes maffes ; mais il eft ou par petites paillettes ,
ou par feuillets minces, ou par petits grains. Ce cuivre
n’eft pas tout-à-fait fi pur que le cuivre de rofette. 20. Le cuivre précipité. Il eft très-pur ; il a été précipité
, ou naturellement, ou par art, des eaux vr*
trioliques cuivreufes. V.oye^ l'article Eau cémentât
o ire.
30. Le verd de montagne ou chryfocolle verte. Cette
mine reffemblè à du verd-de-gris ;■ c’eft du cuivre qui
a été mis en diffolution dans le fein de la terre, &
tjtii en fe précipitant s’eft uni à différentes efpeces
de pierre ou de terré ; c’eft ce qui fait que la chryfocolle
varie pour la confiftance & pour l’arrangement.
On la trouve, ou compacte, ou en globules ; quelquefois
elle préfente de petites cryftaliifations en
bouquets ou en houpes foyeufes. La mine de cuivre
Verte de la Chine, qui eft fi recherchée des curieux,
eft de cette efpece.
40. Le bleu de montagne ou chryfocolle bleue. C ’eft
du cuivre qui a été diflous naturellement, qui par le
concours d’un alkali volatil a pris une couleur bleue,
& qui de même que le verd de montagne s’eft attaché
à quelque fubftance terreufe ou pierreufe : fon
bleu eft plus ou moins éclatant. Le lapis la^uli eft
uné mine de cuivre de cette efpece.
50. La mine de cuivre attiré. Elle eft d’un tiffu qui
la fait reffembler à du verre dans l’endroit oit elle a
été rompue. Elle eft d’un bleu plus ou moins mélangé
: ce n’eft vraiffemblablement qu’une variété de la
mine qui précédé.
6°. La mine de cuivre vitreufe. La couleur de cette
mine eft affez variée ; elle reffemble à du verre, ce
qui lui a fait donner le nom qu’elle porte.
' 7 0. La mine de cuivre grife. Elle eft d'un gris plus
ou moins foncé. Il eft allez difficile au fimple coup-
d’oeil de la diftinguer d’avec une mine de fer.
8°. La mine de cuivre hépatique. Elle eft d’un rouge
mat ou d’un brun jaunâtre qui la fait reffembler à
du foie : c’eft la quantité de parties martiales qu’elle
contient qui lui donne cette couleur. Elle contient
auffi du foufre.
o°. La mine de cuivre blanche. Cette blancheur n’eft
que relative; c’eft proprement un gris clair qui tire
un peu fur le jaunâtre. Cette mine contient du fe r ,
de l’arfenic, & même un peu d’argent.
io°. La pyrite cuivreufe , ou mine jaune de cuivre ;
c’eft la moins riche & la plus commune des mines
de cuivre ; elle contient, outre le cuivre, du fer, du
foufre & de l’arfenic. Cette mine eft quelquefois
d’un jaune d’or très-éclatant, entre-mêlé de différentes
couleurs très-brillantes , rouges , violettes ,
bleues, vertes, gorge de pigeon, &c. Quelquefois
cette mine eft d’un jaune-pâle, ou d’un jaune tirant
fur le verdâtre ; mais ces deux dernieres mines ne
font que des pyrites cuivreufes, à qui plus ou moins’
d’arfenic & une moindre quantité de cuivre ont fait
prendre une nuance plus claire.
ii°. Les mines de cuivre figurées. On peut nommer
ainfi les mines de cuivre dans lefquelles on remarque
une figure étrangère au régné minéral. Ces mines
de cuivre fe trouvent toujours dans de l’ardoife. Il
y a une mine de cette efpece à Mansfeld en Thurin-
g e , dans laquelle on trouve des empreintes de poif-
fons ; dans d’autres on voit des empreintes de végétaux.
12°. La mine de cuivre terreufe : elle eft de différentes
couleurs, comme grife, jaune, brune, &c.
c’eft du cuivre uni avec de l’ochre ou avec de la terre
de différente efpece. On reconnoît fouvent la préfence
du cuivre dans ces terres, par l’enduit du verd-
de-gris qu’on y remarque. L’ochre de Goflar paroît
être de cette nature ; on la mêle avec de l’huile de
lin ; on en forme des globules qu’on met endiftilla-
tion dans une cornue bien luttée ; on donne un très-
grand féu , enfuite on écrafe les globules , on les
paffe au-travers d’un tamis, &fiur la poudre qui eft
paffée on verfe de l’eau pour en faire le lavage : on
lepare la partie la plus légère d’avec laplus pefante
qui va au fond : on mêle cette derniere avec deux
parties dé flux noir, & on la fait fondre dans un
creufet : on obtient par-là du cuivre. Vjye^ Juncker,
de cupro , tab. xxxv. p . q06. 'C’eft-l'à ce que quelques
Chimiftes ont appellé cuivre artificiel. D ’autres
ont crû que dans cette opération il fe faifoit-une
tranfmutatîon ; mais il eft évident que ce n’eft autre
chofe qu’une féparation & une rédu&ion de la partie
cuivreufe qui étoit contenue dans l’ochre de
Goflar.
Outre les mines dont on vient de faire rémunération
, il fe trouve encore des parties cuivreufes
melees avec les mines des autres métaux; il y a
auffi des portions decemétal unies avec une grande
quantité de terres & de pierres : en général on a lieu
de foupçonner fa préfence dans la plûpart de celles
où l’on remarque du verd ou du bleu ; cependant
cette réglé n’eft point fans exception, attendu que
le fer peut auffi quelquefois produire les mêmes couleurs.
Il eft certain néanmoins que le cuivre eft ce
qui donne le bleu & le verd à un grand nombre de
fubftances minérales, telles que l’éméraude, le fa-
phir, la turquoife , le lapis lazuli, &c. Glauber
prétend avoir trouvé du cuivre dans les tourbes de
Hollande, & fur - tout dans celles qui font le plus
profondément fous terre. Si l’on veut un détail plus
circonftancié fur les mines de cuivre, on peut consulter
la Minéralogie de "Wallerius, tome 1. p. 4g5 &
Les différentes opérations en ufage pour tirer le
cuivre de fa mine, font un chef-d’oeuvre de la Métallurgie
: il n’y a point de métal plus difficile à traiter
; on en pourra juger par le détail abrégé de ces
opérations, qu’on va trouver dans cet article. Ces
difficultés viennent des matières étrangères, martiales
, fulphureufes, arfénicales , terreufes ou pier-
reufes, &c. qui font quelquefois étroitement unies
avec le cuivre dans fa mine. Les Fondeurs fuédois
diftinguent trois efpeces de mines de cuivre : i°. les
mines de cuivre fimples ; ce font celles qui font dégagées
des parties terreufes & pierreufes : 20. les mines
de cuivre dures; ce font celles qui font unies avec
des pierres vitrifia blés, telles que le quartz, ce qui
en rend la fufion difficile : 30, les mines de cuivre réfractaires
; ce font celles qui font mêlées avec des
pierres qui rëfiftent à l’aélion du feu , telles que le
talc, l’amianté, &c. Voyez la Minéralogie de Wal-
lerius , tome l. p. 5 iy & fuiv.
Il arrive fouvent que dans les mines de cuivre les
parties hétérogènes , telles que le fer, la terre , la
pierre, & c . s’y trouvent en beaucoup plus grande
abondance que-ce métal: ces inconvéniens n’empêchent
point de travailler ces mines pauvres dans
les pays , comme la Suède & quelques parties de
l’Allemagne , où le bois eft commun & la main-
d’oeuvre à bon marché ; hors ces cas , il y auroit
beaucoup de perte à vouloir les traiter.
Maniéré de traiter la mine de cuivre.■ -C’eft une fuite
de différentes opérations , dont nous aillons donner
le détail le plus exaéfc. Ces opérations -ne font pas
abfolumentles mêmes partout; elles-varient félon la
qualité des mines : mais c’eft à l’expérience -à i nftruire
delà nature & du befoin de ces variétés. Il fuffit dans
un ouvrage de décrire avec précifion & clarté un
procédé général qui puiffe fetvir de’bafe dans-toutes
les circonftances poflibles.
Du triage de la mine. C ’eft l ’opération parlaquelle
on commence : elle confifte , i°. à féparer les morceaux
purement -pierreux, des morceaux tenant métal
, & à rejetter ceux-là : 20. à féparer ceux qu’on
croit purement métalliques, pour les -envoyer à la
fonderie : 3 0. -à féparer-ceux quifont mêlés de-pierre
& de mine, qu’on appelle mine à bocard, & qu’on
fait bocarder.
Détail du triage. On commence par paffer toute
la mine par un crible à mailles quarrées , de la largeur
d’un pouce ou quinze 'lignes : ce crible a dix-
neuf pouces de diamètre fur cinq pouces de profondeur.
La mine eft ramàffée dans un coin ; on en va
Charger fon crible, & on fe tranfporte dans -un autre.